
• Opéra Bastille, première représentation du 27 janvier 2026, 19h30
• Prochaines représentations les 30/01, 2, 5, 11, 14, 17, 20, 23 et 26/02, 19h30 et 8/02, 14h30
• Photo : Anna Netrebko (copyright Benjamin Girette / OnP)

• Palais Garnier, Paris, 26 janvier 2026, 19h30
• Prochaines représentations les 6, 9, 12, 18, 21, 24 et 27/02, 19h30 et les 1er et 15/02, 14h30
• Photo : Bogdan Volkov (copyright Guergana Damianova/OnP)


Laurent Bury
• photo : Ludovic Tézier (Scarpia) et Saioa Hernández (Tosca) - Elisa Haberer / OnP

• 1er décembre à Paris, Théâtre des Champs-Élysée
• Prochaines représentations les 8, 10 et 12/12 (19 h 30) et 14/12 (17 h)
• Photo : Julie Fuchs (Edwige) et Sahy Ratia (Robinson) - (c) Vincent Pontet

• Le 12/12 à Paris, Salle Gaveau, récital de Muza Rubackyté

Énième tentative de mise en scène de la légende dramatique La Damnation de Faust d’Hector Berlioz (1846), celle de Silvia Costa pour le Théâtre des Champs-Élysées n’échappe pas à la déception. Pendant des années, cette Damnation était une merveilleuse pièce de concert qui, malgré son découpage en tableaux, possédait grâce à sa dramaturgie interne et à la force du texte adapté de Goethe par Gérard de Nerval, la capacité de permettre au spectateur de rêver son Faust. Une seule fois, en 2001, on a cru au miracle avec la mise en scène pour l’Opéra de Paris par Robert Lepage, metteur en scène canadien virtuose de la vidéo, des éclairages et de la direction d’acteurs. Le travail scénique proposé au Théâtre des Champs-Élysées par Silvia Costa qui signe une mise en scène brouillonne, une scénographie d’une grande laideur et des costumes sans imagination ne montre jamais au spectateur ce que le texte dit et vice versa. « Réinventer Faust « n’est pas une mince affaire, d’autant plus que l’idée de base – le héros est un ado un peu paumé vivant entouré de nounours dans une chambrette – fait vite long feu : rien ne permet à la légende d’exister scéniquement et tout distrait inutilement l’oreille.

« Kindermusic » 1CD, durée 57 minutes. HMM 905399. Harmonia Mundi - octobre 2025.
• Florent Albrecht en concert le 13/11 à Genève (Fondation-Musée Zoubov/"Mozart,Haydn & Cie") : L’Encyclopédie le 13/12 à Genève (Fondation-Musée Zoubov/Symphonies de Beethoven et Hummel)

Des contes de Nicklausse ?
• Salle Favart le 25 septembre 2025
• Prochaines représentations les 29 septembre, 1er et 3 octobre, 20h et 5 octobre, 15h
• Photo : Jean-Sébastien Bou (Lindorf/Coppélius/Miracle/Dapertutto) et Michael Spyres (Hoffmann) DR Stefan Brion

photo : © DR
Prochains concerts : le 5/09, Mahler par le Philh de Berlin, dir. K. Petrenko, 7/09, Verdi, Rossini par l’Orch de la Scala de Milan, dir. R. Chailly et 10 et 11/09, V. Lucas, Copland, Gershwin, Tower et Varèse par l’Orch de Paris, dir. K. Mäkelä

Le 10 juillet 2025, Reims, Cirque du manège
• En duo le 12/09 à Santar (Portugal) : « Bach Mirror »
• Vassilena Serafimova le 18/07 à Paris (Jardin des Tuileries), le 24/07 avec Rémi Delangle à Vendôme (Fest Quatuor à Vendôme) et le 27/07 avec Hélène Escriva à Menton (Palais de l’Europe)
• Thomas Ehnco avec D. Tepfer le 19/07 à Nancy (2 pianos) ; les 22/07 à Léognan, 24/07 à Monaco, 26/07 à La Romieu, 4/08 à Biarritz, 13/08 à Arradon, 20/09 à Hambourg, 24/09 à Sète et 29/09 à Paris (TCE) : « Mozart Paradox ».
Photo : © Frank Loriou / Sony Music

Paris (Philharmonie), 24 juin (photo ©) Arthur Elgort)
Alexandre Kantorow avec le SWR, dit. A. Orozco-Estrada les 10/07 à Freiburg (Brahms, Concerto pour piano n°1), 12 et 13/07 à Grenade (Brahms, Concertos pour piano 1 & 2) ; avec R. Capuçon (v) le 15/07 à Bad Kissengen (Brahms) ; avec R. Capuçon (v), L. Power et V. Julien-Laferrière le 16/07 à Wupperthal (Brahms) ; avec l'Orch. phil. de Marseille, dir. L. Foster le 22/07 à La Roque d'Anthéron (Brahms) ; avec le Scottish Ch. Orch.,dir. M. Emelyanychev le 25/07 à Londres (BBC Proms, Saint-Saëns) ; avec l'Orch du Fest de Verbier, dir. T. Currentzis le 31/07 à Verbier (Rachmaninov, Rhapsodie sur un thème de Paganini) ; avec le Phil. de Hong Kong, dir. J. Van Sweden le 31/08 à Amsterdam (Rachmaninov) ; récital Bach/Liszt, Medtner, Rachmaninov et Bach/Brahms le 4/09 à Hagen-Haus, Liechtenstein ; avec l'Orch phil royal, dir. V. Petrenko le 12/09 à Bucarest (Liszt) ; récital Bach, Liszt et Chopin le 20/09 à Sainte Marie du Mont ; avec l'Orch de Strasbourg, dir. A. M. Patino-Osorio le 26/09 à Strasbourg et 27/09 à Thaon-les-Vosges (Prokofiev, Concerto pour piano n° 3).


Prochaines représentations les 19, 22 et 28/05/2025 (19h) et 25/05/2025 (14h)
© Guergana Damianova / OnP : Asmik Grigorian (Suor Angelica) Karita Mattila (Zia Principessa) dans Sœur Angélique

 Piano quantique
Piano quantiqueAvantage de la musique vivante : On profitait au « TCE » de deux « stars », Kit Armstrong, musicien surdoué et personnage fulgurant et romanesque, et le piano Steinway, somptueux outil, qui répondait aux moindres nuances du jeu du pianiste. Celui-ci ne se privait pas de passer en un instant d’un univers à un autre, d’une violence fulgurante à une douceur séraphique, ou de faire percevoir les voix complémentaires de sa main droite et de sa main gauche, en éloge et illustration du contrepoint. Kit Armstrong a une totale maitrise de son propos, et c’est un musicien « pédagogue ». Ici, la filiation de Bach à Chopin, puis à Rachmaninov. Armstrong qui, malgré son jeune âge, est aussi un compositeur prolifique, adore illustrer un répertoire débutant à Guillaume de Machaut, en passant par les virginalistes anglais, William Bird ou John Bull, en soulignant leur apport aux musiciens suivants, tout en jouant également des compositeurs contemporains. Michel Mollard, complice de Kit Armstrong dans la composition du programme de cette soirée compare malicieusement le pianiste au chat de Shrodinger, illustrant un paradoxe de la physique quantique qui est la propriété d’être en même temps dans deux lieux différents. La comparaison s’impose pour ce pianiste anglo-taiwanais, né en 1992, qui, à 20 ans, soutenait un master de mathématiques à Paris, après des études aux Etats unis et à Oxford. A 14 ans, une rencontre fortuite avec Alfred Brendel avait débouché sur « 4 heures de travail commun sur la sonate Les Adieux de Beethoven », puis le soutien indéfectible de Brendel. En 2012, Armstrong a racheté l’ancienne église de Hirson, dans l’Aisne, qui, depuis, abrite ses expériences musicales et accueille nombre de ses amis, chambristes ou chanteurs. Il vit aussi bien à Hirson qu’en Italie, en Autriche, partout où sa boulimie de musique, de rencontres et de partage trouve à s’exercer. Dernier projet en date, une « expédition Mozart » à travers l’Europe avec un groupe d’amis musiciens et chanteurs : treize dates à sillonner l’Europe entre le 18 avril 2024 et le 1er février dernier.
• Paris, Théâtre des Champs-Élysées, le 8 février. Photo DR
• En concert les 11/02 à Berlin (Philharmonie, avec Ensemble der Berliner Philharmoniker), 15/02 à Bamberg et 16/02 à Erlangen : Concerto en Fa de Gershwin avec Bamberger Philharmoniker, dir. B. de Billy ; 17/03 à Barcelone (Palau de la Músican) : récital Bach et Liszt ; 19/03 à Saint-Étienne (Théâtre Copeau) : Chopin, Liszt, Rachmaninov et Saint-Saëns ; 26/03 en récital à Bilbao ; 2/05 à Hirson (Église Sainte-Thérèse) : Semaine de la voix.

Paris, Théâtre des Champs-Élysées, le 11 décembre. Photo : © Vincent Pontet

• Représentations suivantes les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 décembre (20 h) à Lyon, Théâtre du Point du Jour.

• Der Silbersee (Le Lac d’argent) de Weill sur un livret de Georg Kaiser
Photo : Le Lac d'argent © Jean-Louis Fernandez

• « Birds » d’après Aventures et Nouvelles aventures de Ligeti et Eight songs for a Mad King de Peter Maxwell Davies par l’Ensemble Maja, dir., conception et piano Bianca Chillemi les 9 et 10 février (20 h) à l’Athénée Théâtre Louis Jouvet (Paris)
Photo : Crédit @Animata Beye

Photo : Lohengrin 23-24 © Charles Duprat - OnP


On peut aussi prendre un plaisir plus simple à entendre les grands tubes bernsteiniens, de West Side Story à Mahler, en passant par les opéras célèbres revisités par le maestro, de Carmen grisée par les volutes de fumée au Chevalier à la rose comme une grande déclaration d’amour à Vienne, le tout ponctué d’extraits de répétitions filmées, où Lenny himself révèle son art bien connu de « passeur de musique ».
Salle pleine (entrée gratuite sur réservation) réservant un triomphe au chef Ramon Theobald et à l’arrangeur Benjamin Laurent, aux huit chanteurs et aux huit instrumentistes et pianistes. Citation, dans le programme, de Samuel Beckett : « Enlacés, la tête dans les épaules, se détournant de la menace, ils attendent ». Godot/Bernstein ne viendra pas, mais l’attente aura été active, et fructueuse. Le spectacle se donne encore vendredi 30. Ne le manquez pas.
Crédit photo : (c) Studio J'adore ce que vous faites / OnP

Opéra-Comique, Paris, jusqu’au 1er juillet (Photo © Stefan Brion)

Opéra National de Paris – Bastille jusqu’au 15 juillet - En direct le 26 juin à 19h30 sur France.tv/Culturebox, dans les cinémas UGC, dans le cadre de « Viva l’Opéra ! », dans les cinémas CGR et des cinémas indépendants - Diffusion ultérieure sur une chaîne de France Télévisions et la plateforme de l’Opéra national de Paris – En différé le samedi 8 juillet sur France Musique à 20h
(Photo © Vincent Pontet / OnP)

Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez, 8 et 9 juin – Festival ManiFeste, jusqu’au 1er juillet : manifeste.Ircam.fr


Orangerie du Château de Bois-Préau, Parc de Malmaison, 15h & 18h30, dimanche 28 mai 2023


(Photo © DR Opéra National de Lyon)

Photo©C Vincent Lappartient-Studio j'adore ce que vous faites !/OnP

François Lafon
Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Paris, 8 représentations jusqu’au 16 avril
Tournée à Dijon, Rouen, Avignon (décembre 2023), Massy (mars 2024) (Photo © Marie Pétry)

Opéra National de Paris-Bastille, jusqu’au 9 avril - En direct le 30 mars sur Arte concert, et avec le concours de FRA cinéma, dans les cinémas UGC, dans le cadre de leur saison « Viva l’Opéra ! » et dans des cinémas indépendants en France et en Europe, et ultérieurement dans le monde entier. Diffusion le 2 mai dans les cinémas CGR. Diffusion ultérieure sur Arte. En différé le 22 avril sur France Musique
(Photo © DR)

Théâtre de l’Athénéee-Louis-Jouvet, jusqu’au 18 février (Photo©Martin Noda)


Franck Mallet
Paris, Théâtre des Champs-Élysées, 26 janvier, 20h « Carte blanche à David Fray, I » Schubert, Wintereise D. 911
Peter Mattei (baryton) et David Fray (piano) (Photo : © DR)
• Prochains rendez-vous : le 31 mars (20h) : Schubert et Liszt par David Fray avec la participation de Jacques Rouvier ; 26 juin (20h) : Schubert par David Fray (piano) et Renaud Capuçon (violon)


Photo : Vincent Pontet / OdP

Photo : Danny Clinch /OnP

Opéra-Comique, Paris, jusqu’au 3 février (Photo © Stéphane Brion)

Philharmonie de Paris, Grande salle Pierre Boulez, 22 janvier (Photo © DR)


Opéra-Comique, Paris, jusqu’au 25 décembre (Photo © Stéphane Brion)


Opéra Comique, Paris, jusqu'au 15 novembre (Photo ©Stéphane Brion)


Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 5 novembre - En direct le 27 octobre sur L’Opéra chez soi et Medici.tv ainsi qu’au cinéma (Fra Cinéma, « Viva l’opéra » – En différé le 4 novembre à 21h sur Mezzo Live HD et le 30 novembre dans les cinémas CGR (Photo © Agathe Poupeney / OnP

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 8 octobre (Photo © Stéphane Brion) - En direct sur Arte Concert le 6 octobre à 20h - Sur France Musique le 22 octobre à 20h

Philharmonie de Paris, Grande salle Pierre Boulez, 9 septembre. Concert du 8 sur France Musique pendant un an, gratuitement en streaming sur Medici.tv pendant 90 jours et sur Philharmonie Live pendant 6 mois (Photo © DR)

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 13 juillet (Photo © Charles Duprat / OnP


Athénée Théâtre Louis-Jouvet, 20 juin (Photo © Ph. Delval) - Au Midsummer Festival de Hardelot le 23 juin

Philharmonie de Paris - Cité de la Musique, salle des concerts, 8 juin - En différé sur France Musique le 22 juin, puis en streaming pendant trois ans - Festival ManiFeste, du 8 juin au 2 juillet : manifeste.ircam.fr (Photo © Bertrand Desprez)

Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 1er juin. César Franck au Festival Palazetto à Paris jusqu’au 19 juin. Opéra en concert : Phryné de ... Saint-Saëns le 11 juin à l'Opéra Comique (Photo © DR)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 25 mai (Photo © Stefan Brion)


• prochains concerts Bach le 21/05 à Paris (Temple du Foyer de l’Âme) et le 31/05 à Ivry-sur-Seine (Médiathèque Antonin Artaud). (Photo © DR)

Opéra National de Paris – Palais Garnier, jusqu’au 19 mai – En différé sur France Musique le 1er juin (Photo © Sébastien Mathé / OnP)

Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez, 21 avril - En différé sur Radio Classique le 8 mai à 21h (Photo © Annick Ramp)

Athénée Théâtre Louis-Jouvet, jusqu'au 15 avril (Photo © Xavier Lambours)



(*) www.unicef.fr/urgence

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 30 mars (Photo © Agathe Poupeney / OnP











François Lafon

Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet, jusqu’au 11 décembre (Photo © Patrick Laffont De Lojo)

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 30 décembre. En différé sur France musique le 8 janvier 2022 à 20 heures dans le cadre de l'émission "Samedi à l'Opéra" (Photo © Charles Duprat/OnP)

Théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet, Paris, jusqu'au 27 novembre. Tournée jusqu'au 1er octobre 2022 (Photo © Alban Van Wassenhove)





(Photo © DR)



A propos de super-héros, ne pas manquer la journée (colloque, masterclass, concert) consacrée le 6 octobre à l’Opéra Comique par le Centre Européen de Musique à la légendaire Pauline Viardot, dont Berlioz écrivait qu’en Leonore de Fidelio, « elle tenait toute la salle haletante sous le feu de son regard, par la véhémence de sa voix, l’énergie menaçante de son attitude ».




Athénée Louis-Jouvet, Paris, jusqu’au 30 juin (Photo © Christina Schmitt)

Théâtre du Châtelet, Paris, jusqu’au 23 juin, dans le cadre du 8ème festival Palazzetto Bru Zane (8 juin – 31 juillet) – Captation sur le site Opera on video (Photo©Eric Bouloumié)

Théâtre de l’Athénée, Paris. Pelléas et Mélisande, Powder Her Face, en alternance jusqu’au 20 juin (Photo © Magali Dougados)

Opéra-Comique, Paris, jusqu’au 10 juin. En direct sur Mezzo le 10 juin, en différé sur France Musique le 3 juillet.
(Photo © Stefan Brion)
Sous le titre Qui oserait encore se retourner ? le collectif Wipplay et l’Opéra Comique proposent du 5 mai au 16 juin un concours photo. « Sortir des enfers en juin 21 : quelles images pour en parler aujourd’hui, quel Orfeo serez-vous après ces mois reclus ? » Exposition des lauréats en septembre sur les grilles du théâtre. Pour tout savoir, c'est ici.


Opéra National de Paris Palais Garnier, jusqu’au 13 juin. Diffusion gratuite le 13 juin à 14h30 sur la plateforme maison L’Opéra chez soi et pendant 48h sur medici.tv. En différé sur France Musique le 19 juin
(Photo © Elisa Haberer/OnP)




Panthéon, place du Panthéon, Paris (Photo © DR)



Le ténor Kevin Amiel et la soprano Marie Perbost ne sont déjà plus des débutants, ils chantent extraverti, jouent sur leur présence efficace, ce qui séduit dans l’opéra italien (Donizetti) mais n’est pas toujours ad hoc ailleurs : on attend parfois un peu plus d’intériorité et de tempérance vocale (chez Massenet pour lui, chez Debussy pour elle).
Les trois nommés dans la catégorie Soliste instrumental complètent le plateau. Théotime Langlois de Swarte, si éblouissant dans le répertoire baroque (voir ici), se trouve un peu étouffé chez Mozart par le hautbois de Gabriel Pidoux : dans des transcriptions de La Flûte enchantée par Wolfgang himself (air de Papageno, deuxième air de la Reine de la nuit), celui-ci occupe magnifiquement un espace dont les résonances le favorisent. Et il récidive dans la Sonate pour hautbois de Saint-Saëns, pièce rare, où il fait merveille. Quant à la violoniste Raphaëlle Moreau, chez Chostakovitch (Pièces pour deux violons) comme dans un Nocturne de Lili Boulanger ou dans l’Elégie de Massenet, elle fait preuve d’une superbe musicalité et d’un caractère affirmé. Elle rayonne.


Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet, jusqu’au 16 octobre

Prochaines représentations : 2, 4 et 6 octobre, Opéra national de Lorraine, Nancy ; 16, 18 et 20 novembre, Opéra de Dijon.
Photo : Görge le rêveur@Jean-Louis Fernandez



Côté Bach, des cantates of course, des Concertos pour trois et quatre clavecins avec Bertrand Cuiller, Violaine Cochard, Pierre Gallon et Olivier Fortin (rien que ça), et en clôture, la Passion selon Saint-Jean par Vox Luminis qui, depuis quelques années, s’épanouit bien dans l’Abbaye.
Et les autres ? Gli angeli avec un bouquet de Stabat Mater (Palestrina, Scarlatti, Pergolese et Pärt), Le Banquet céleste de Damien Guillon avec un oratorio de Stradella, Les Talens lyriques dans les Quatre Saisons de Vivaldi (une première) et puis, et puis... une vingtaine d’autres programmes, de quoi frissonner de plaisir pendant 8 jours.
(Photo : Philippe Herreweghe © Michel Garnier)


Opéra Comique, Paris, jusqu’au 1er mars (Photo © Christophe Raynaud de Lage)

Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez, 14 février - 30ème Festival Présences, jusqu’au 16 février - Disponible sur www.francemusique.fr (Photo © Chris Christodoulou)

Le 13 février 2020, à Lyon 4e, Théâtre de la Croix-Rousse (Photo © Opéra de Lyon-Blandine Soulage)
Prochaines représentations : 15, 16, 18, 19, 20, 22 et 23 février, Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon, 4e

Festival Présences, Maison de Radio France, Philharmonie de Paris, du 7 au 16 février. Concerts en direct sur France Musique, disponibles en www.francemusique.fr (Photo © Christophe Abramowitz)



Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 6 février. Le 15 février au Théâtre à l’Italienne de Saint-Dizier (Photo © Nicolas Descoteaux)

Châtelet, Paris, jusqu’au 31 janvier (Photo © Patrick Berger)

9ème Biennale de quatuors à cordes – Cité de la Musique/Philharmonie de paris, jusqu’au 19 janvier (Photo : Quatuor Goldmund © Gregor Hohenberg)

Fosse, Centre Georges Pompidou, Paris, les 10 et 11 janvier de 19h à 22h, 12 janvier de 17h à 20h (Spectacle en continu, durée de chaque cycle musical : 50 minutes) (Photo © Hervé Véronèse-Centre Pompidou)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 22 décembre. Diffusion ultérieure en différé sur France Musique (Photo © Stéphane Brion)



Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 26 décembre. En direct au cinéma, sur Mezzo et Culture Box le 17 décembre, en différé le 25 janvier sur France Musique et ultérieurement sur France Télévisions (Photo © Agathe Poupeney / OnP)


Eglise Saint Roch Paris le 22 novembre (Photo © DR)

Paris – Cité de la musique, 20 novembre (Photo © Philharmonie de Paris)

Concours Long-Thibaud-Crespin 2019. - Palmarès 16 novembre en fin de soirée : www.long-thibaud-crespin.org › concours › piano-2019 (Photo : Kenji Miura © DR)

Théâtre Déjazet, Paris, jusqu’au 30 novembre (Photo © DR)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 12 novembre - Versailles, Opéra Royal, les 23 et 24 novembre – En direct le 8 novembre sur Arte Concert, en différé ultérieurement sur France Musique (Photo © S. Brion)



Philharmonie de Paris, Grande salle Pierre Boulez, 16 octobre (Photo © DR)

Opéra National de Paris – Amphithéâtre Bastille, 8 octobre (Photo © Cassandre Berthon)


Abbaye de Royaumont, Val d’Oise, 28 septembre (Photo : Laura Fernandez Granero © DR)

(Photo © Little Shao / OnP)

Maison de Radio France, Auditorium, 20 septembre. Disponible 30 jours sur francemusique.fr (Photo © DR)



Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez, 4 septembre. Diffusé en direct sur Mezzo, Arte Concert et philharmonielive.tv (en streaming pour 6 mois) et sur Radio Classique (en streaming pour 3 mois) (Photo : Karina Canellakis © Mathias Bothor)

Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence, 15 juillet (Photo © DR)


Cité de la Musique, église Saint-Jacques-Saint Christophe, Paris, 29 et 30 juin – Disponible ultérieurement sur medici.tv et internet live.philharmoniedeparis.fr (Photo © Nieto)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 30 juin (Photo © S. Brion)

Bouffes du Nord, Paris, 17 juin (Photo © DR)

Opéra National de Paris - Palais Garnier, du 11 juin au 13 juillet – En direct sur Culturebox, Radio Classique et au cinéma le 21 juin (Fête de la musique) – Ultérieurement sur France 2 (Photo © Charles Duprat/OnP)

Théâtre Marigny, Paris, jusqu’au 15 juin (Photo © Frédéric Stéphan)

Manifeste 2019, du 1er au 29 juin. Lullaby Experience, les 1er et 2 juin (Photo © Quentin Chevrier)

Auditorium du Musée du Louvre, 24 mai (Photo © DR)

Franck Mallet
16 mai, Auditorium, Bordeaux (Photo © Éric Boulimié) Prochaines représentations 20 & 23 mai

Opéra de Lyon, jusqu’au 26 mai. DVD disponible chez Opus Arte, capté lors de la création au Covent Garden de Londres sous la direction de George Benjamin (Photo © Stofleth)


Philharmonie de Paris, Grande salle Pierre Boulez, 10 mai. Disponible trois mois sur live.philharmoniedeparis.fr. Diffusion le 15 mai sur France Musique et disponible trois ans sur francemusique.fr (Photo : Matthias Pintscher © Frank Ferville)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 21 mai (Photo © Stefan Brion)

3 mai, Salle Élie de Brignac, Deauville (Photo © DR)

Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 27 avril (Photo © Bohumil Kostohryz)

Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet, Paris – La Scala-Paris, 15 avril (Photo © Pierre Grosbois)

Opéra National de Paris-Bastille, jusqu’au 25 avril. En direct au cinéma le 16 avril (réalisation Stéphane Medge), diffusion ultérieure sur Mezzo. En différé sur France Musique le 12 mai (Photo © Bernd Uhlig / OnP)

Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 14 avril. Tournée (France, Allemagne, Etats-Unis, Royaume-Uni, Russie, Belgique) jusqu’en mai 2020 (Photo © DR)

Opéra Comique, Paris, jusqu'au 9 avril. En différé sur France Musique le 28 avril (Photo © Stéphane Brion)


Opéra de Dijon - Auditorium, jusqu’au 28 mars - A venir sur Culturebox et Mezzo - DVD Warner en 2021 (Photo © Gilles Abegg - Opéra de Dijon)

La Scala-Paris, Festival international Chopin jusqu’au 23 mars.
Festival Rachmaninov et la musique russe, du 27 au 30 mars
(Photo:Ismaël Margain, Joseph Moog, Leonardo Pierdomenico, Tanguy de Williencourt©B. Millot, Thommy Mardo, DR)


MC 93, Bobigny, jusqu’au 23 mars - Les 2 Scènes, Besançon, du 3 au 5 avril – Théâtre Impérial de Compiègne le 26 avril – Maison de la culture d’Amiens, du 15 au 17 mai – MC2 Grenoble du 22 au 24 mai. Deux distributions en alternance (Photo © DR)

Bouffes du Nord, Paris, 2 et 3 février (Photo © Silvia Delmedico/Les Théâtres de la Ville de Luxembourg)

Théâtre de l’Athénée, 23 février (Photo : Stéphane Degout©DR)

Présences, festival de création musicale de Radio France, du 12 au 17 février (Maison de la Radio, cinéma le Balzac). Concerts retransmis par France Musique (Photo Wolfgang Rihm © DR)

Opéra du Rhin : Strasbourg jusqu’au 16 février, Mulhouse les 1er et 3 mars, Colmar le 9 mars. Nancy, Opéra, du 20 au 24 mars. Versailles, Opéra Royal, les 13 et 14 avril (Photo © Klara Beck)


François Lafon
Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 12 février. En léger différé le 31 janvier sur Arte et Arte Concerts. En différé le 10 mars sur France Musique (Photo © Vincent Pontet / OnP)

Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu'au 23 février. En différé sur France Musique le 17 mars (Photo © Bernd Uhlig / OnP)

Théâtre de l’Athénée, 21 janvier. Diffusion ultérieure sur France Musique (Photo © Sarah Bouasse)


Ecole Normale de Musique, Salle Cortot, jusqu’au 26 janvier (Photo : Kojiro Okada © DR)

Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez, 11 janvier. Concert disponible pendant six mois sur live.philharmoniedeparis.fr (Photo : Tabea Zimmermann © Marco Borgreve)


Seine Musicale, Boulogne-Billancourt, 21 décembre (Photo : Julie Prola © DR)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 29 décembre (Photo © Vincent Pontet)



Les Concerts de Poche, Morsang-sur-Orge, 7 décembre

La Scala Paris, 30 novembre (Photo : United Instruments of Lucilin © Emile Henge)


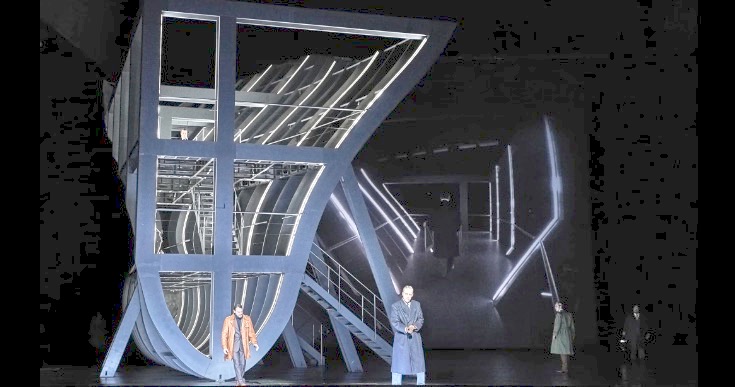


(Photo © Jean-Louis Fernandez)




Philharmonie de Paris, Grande salle Pierre Boulez, 19 octobre. Diffusion ultérieure sur France Musique
(Photo © Jean-François Leclercq)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 24 octobre. En direct sur Arte Concert le 18 octobre.
Diffusé ultérieurement sur France Musique (Photo © Pierre Grosbois)

Théâtre de l’Athénée, Paris. King Arthur, jusqu’au 7 octobre - Queen Mary, du 10 au 13 octobre (Photo © DR)

Bouffes du Nord, Paris, 1er octobre (Photo © DR)

Opéra National de Paris – Garnier, jusqu’au 17 octobre (Photo © Monika Rittershaus / OnP)

Opéra National de Paris - Bastille, jusqu'au 24 octobre. En direct au cinéma et sur Culturebox le 4 octobre. En différé sur France Musique le 21 octobre à 20h et sur France 3 ultérieurement (Photo © DR)

Orléans, Théâtre, vendredi 21 septembre, 20h30 (Photo © Cyrille Guir)

La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt, jusqu’au 26 septembre (Photo © A. Poupel)

Cité Musicale de Metz, Grande salle de l’Arsenal, 14 septembre (Photo © DR)




(Photo © Christophe Grémiot)



(photo :Justin Taylor © Sébastien Laval)


Gérard Pangon
(Photo © Lucie Favriou)

Gérard Pangon
(Photo © Léa Parvéry)


Opéra Comique, paris, jusqu’au 15 juillet. Tournée dans toute la France jusqu’en 2019 et au-delà (Photo©Pierre Grosbois)

Basilique de Saint-Denis, 26 juin. Festival de Saint-Denis, jusqu’au 5 juillet (Photo © HSBenjamin Suomela)

Théâtre d l’Athénée, Paris, 25 juin (Photo © Le Balcon)

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 29 juin (Photo©Nemo Perier Stefanovitch)


Opéra National de Paris – Palais Garnier, jusqu’au 12 juillet. En direct au cinéma et sur Culturebox le 19 juin
(Photo © Vincent Pontet/OnP)

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 12 juillet. En direct au cinéma et sur Cluturebox le 7 juin. En différé sur France Musique le 24 juin (Photo © Agathe Poupeney/OnP)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 14 juin. En direct sur Cluturebox le 12 juin (Photo©Pierre Grosbois)

Opéra de Lyon, jusqu’au 4 juin. En différé sur France Musique le 3 juillet (Photo © DR)

Musée d’Orsay, Paris, Festival baltique jusqu’au 29 mai. Exposition Âmes Sauvages. Le symbolisme dans les pays baltes jusqu’au 15 juillet (Photo © DR)

Philharmonie de Paris, Grande salle Pierre Boulez, 15 mai. A voir sur Culturebox et les sites de la Philharmonie (live.philharmoniedeparis.fr) et de l’Opéra de Paris. Diffusion ultérieure sur France 3, Mezzo et TF1 (Photo © DR)

Théâtre de l’Athénée, Paris, 14 mai (Photo : E. Fardini-T. de Williencourt © DR)

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 23 mai. En différé sur France Musique le 27 mai (Photo © Emilie Brouchon/Opéra national de Paris)



Opéra Comique, Paris, jusqu’au 29 avril (Photo © Vincent Pontet)

Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 3 mai. Tournée (à ce jour) en France, Suisse, Italie, Grande-Bretagne, Grèce et Luxembourg jusqu’en 2020 (Photo © Patrick Berger)

Paris - 16 avril (Photo : Maria et Nathalia Milstein © DR)



Opéra Comique, Paris, jusqu’au 5 avril. En différé le 15 avril à 20h sur France Musique (Photo © Vincent Pontet)

Opéra de Lyon, jusqu’au 5 avril (Photo © DR)


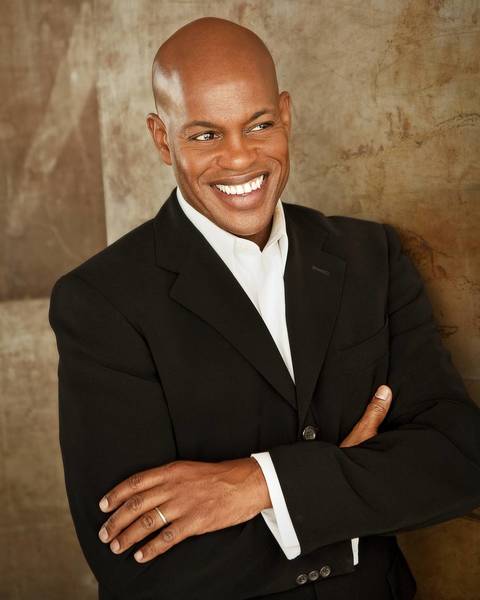
Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez, 22 mars. Disponible en streaming sur les sites d’Arte Concert, de l’Orchestre et de la Philharmonie de Paris (Photo : Jubilant Sykes©DR)


Photo : (c) Felix Broede

Photo @ Oscar Vazquez

Photo : Pierre Grosbois




Opéra Comique, Paris. Le Mystère de l’écureuil bleu, jusqu’au 25 février. « Mon premier festival d’opéra », jusqu’au 11 mars (Photo © Vincent Pontet)

(Photo : Hanz-Werner Henze dans les années 70 © INTERFOTO/Alamy Stock Photo)

Présences, Radio France, jusqu’au 11 février (Photo © Claire Delamarche)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 11 février. En direct sur Mezzo Live HD et Culturebox le 9 février
(Photo © Pierre Grosbois)

En différé sur France Musique le 9 mai à 20h (Photo © Elisa Haberer/OnP)

Une jeune fille dont le père s’est suicidé est vendue à une maison de thé, lieu de prostitution. Rachetée par un mandarin, elle devient sa deuxième épouse et lui donne un enfant. Jalouse, la première épouse empoisonne son mari et s’approprie l’enfant pour profiter de l’héritage, puis soudoie un magistrat qui condamne à mort la jeune fille pour vol d’enfant et assassinat. Cette dernière ne doit son salut qu’à un coup de théâtre, car l’homme qui succède à l’empereur le jour de sa condamnation n’est autre que celui qu’elle avait rencontré brièvement comme jeune prostituée. Épris de justice, celui-ci fait éclater la vérité… et l’épouse.
(photo © Jean-Louis Fernandez ; à gauche Doris Lamprecht, à droite Ilse Eeren)

Biennale de quatuors à cordes, Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, jusqu’au 21 janvier
(Photo : Quatuor Ebène © Julien Mignot)

(Photo © Monika Rittershaus/OnP)

Philharmonie de Paris, grande salle Pierre Boulez, 22 décembre. En streaming pendant 12 mois sur les sites d’Arte Concert et de l’Orchestre de Paris. Diffusion ultérieure sur France Musique et Arte.tv. Disponible à partir du 1er janvier 2019 sur la nouvelle plateforme vidéo de France Musique, francemusique.fr/com (photo ©DR)




www.centredemusiquedechambre.paris


Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 31 décembre. En direct le 12 décembre au cinéma, sur Culturebox et Medici, ultérieurement sur TF1 et France 3. En différé sur France Musique le 14 janvier 2018 à 20h
(Photo © Bernd Uhlig / Opéra de Paris)

Bibliothèque-Musée de l’Opéra de Paris, Palais Garnier, du 18 novembre au 3 mars. Au Studio Bastille, du 19 au 26 novembre, projection des captations vidéo des spectacles mis en scène par Patrice Chéreau (Photo © DR)




Opéra Comique, Paris, jusqu’au 14 novembre (Photo © Iko Freese)


Mardi 17 octobre, Théâtre Graslin, Nantes. (Photo : de gauche à droite : Logan Lopez Gonzalez (Amour), Chiara Skerath (Poppée) et Elmar Gilbertsson (Néron) ; ©Jef Rabillon)

Salle Cortot, Paris, 20 octobre (Photo © DR)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 22 octobre (Photo © DR)

Vendredi 13 octobre, Cathédrale, Laon. (Photo : de gauche à droite : Vincent Bouchot, Édith Canat de Chizy et Adrien Perruchon ; crédit©Michel Debeusscher)

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 11 novembre. Sur Arte et Arte Concerts le 19 octobre à 20h55. En direct le même jour au cinéma. En audio sur France Musique le 29 octobre à 20h (Photo © Agathe Poupeney)

Cité de la Musique, Paris, Amphithéâtre, 12 octobre (Photo : John Chest © DR)

François Lafon
Week-end colombien, théâtre de l’Athénée-Louis-Jouvet, Paris, 6, 7, 8 octobre (Photo © Andres Gomez Sierra)


Fondation Louis Vuitton Neuilly-sur-Seine, 29 septembre. Diffusion sur Medici et Radio Classique (photo © DR)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 5 octobre. En direct sur Arte Concert le 29 septembre à 20h. Sur France Musique le 15 octobre à 20h (Photo © Pierre Grosbois)

Philharmonie de Paris, Grande salle Pierre Boulez, 22 septembre (Photo © Charles d'Hérouville)


Les 80 ans de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 15, 17, 17 septembre, Auditorium, Studio 104. Concert du 15 en streaming sur Arte Concert (pendant six mois) et francemusique.fr (Photo © C. Abramowitz/Radio France)

Maison de Radio France, Auditorium, 7 septembre. En streaming sur Arte Concert et Francemusique.fr. Ultérieurement sur Mezzo. (Photo © DR)




Festival de Sablé-sur-Sarthe, jusqu’au 27 août – La Sultane en replay sur Culturebox.fr - Les Indes galantes ultérieurement sur France Musique

(Photo : Héloïse Gaillard © Festival de Sablé)

Festival de La Roque d’Anthéron, 12 août (Photo © Christophe Grémiot)

Festival de La Roque d’Anthéron, 11 août (Photo : Lars Vogt © Christophe Gremiot)

Festival d’Aix-en-Provence, Théâtre de l’Archevêché, jusqu’au 21 juillet (Photo © Pascal Victor/Artcompress)

Festival d’Aix-en-Provence, Théâtre de l’Archevêché (Photo © Patrick Berger/Artcompress)

Festival d’Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence, jusqu’au 20 juillet (Photo © Patrick Berger/Artcompress)

Festival d’Aix-en-Provence, Théâtre du Jeu de Paume, jusqu’au 21 juillet. Tournée ultérieure, entre autres à Versailles et Saint-Denis (festival 2018) (Photo © Patrick Berger/Artcompress)

Festival Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence. Représentations ultérieures au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, à l’Opéra de Dijon et à l’Opéra de Bordeaux (Photo © Patrick Berger/Artcompress)


Bouffes du Nord, Paris, 16 juin (Photo © DR)


François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, 11 juin. En différé sur France Musique le 27 juin à 20H. Reprise à l’Opéra de Reims le 10 novembre 2017 (Photo © Grégory Forestier)

Opéra National de Paris – Palais Garnier, jusqu’au 13 juillet. En direct au cinéma le 20 juin à 19h30, et sur Culturebox le 22, diffusion ultérieure sur France 3 (Photo © Vincent Pontet / OnP)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 19 juin – En différé sur France Musique le 2 juillet (Photo © Pierre Grosbois)

Auditorium du Musée d’Orsay, Paris, 6 juin (Photo © DR)



Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 20 mai (Photo © DR)

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 6 mai. Phèdre du 10 au 13 mai, Ajax du 17 au 20 mai (Photo © DR)

François Lafon
Opéra Comique, Paris, jusqu’au 7 mai. Opéra Royal de Versailles les 8, 10 et 11 juin. Rencontre avec Jordi Savall et Louise Moaty le samedi 6 mai à 18h, dans le cadre de l’opération Tous à l’Opéra. En direct le 6 mai à 20h sur Mezzo Live HD (Photo © Vincent Pontet)

Seine musicale, Boulogne-Billancourt, 22 avril (Photo © DR)





Aux Bouffes, tout le contraire : première partie Schubert (Rondo brillant) / Brahms (1er Trio avec piano), comme un « avant » dont Pierrot lunaire sera l’« après » radical : exacerbation des rythmes et des timbres, narration plus « Sprech » que « melodie » de Marion Tassou – l’autre schönbergienne Française que les directeurs se disputent. Atmosphère militante, expressionnisme virtuose de l’ensemble dirigé du piano par Jean-François Heisser, où se distinguent le violoncelliste Victor Julien-Laferrière (déjà remarquable dans Brahms) et la flûtiste Kaisa Kortelainen. A venir (web-série et concert) sur le site la-belle-saison.com. Version Athénée jusqu’au 31 mars, pas d’enregistrement prévu, donc pas de confrontation a posteriori des deux options. Dommage : à qualité égale…
Bouffes du Nord, Paris, Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 31 mars (Photo © DR)


Opéra de Dijon - Auditorium, jusqu’au 25 mars. En version de concert à la Philharmonie de Paris le 3 avril
(Photo © Gilles Abegg/Opéra de Dijon)

En seconde partie - double signature chorégraphique d’Emilio Greco et Pieter C. Scholten (équipe directrice du BNM depuis 2014) -, Il Ballo delle Ingrate, le plus célèbre ballet de Monteverdi, connaît une actualisation farouche… à un mois de la présidentielle française. Ces Ingrates, châtiées pour avoir refusé de se soumettre aux dictats masculins dans l’original du livret de Rinuccini, devient dans le regard convergent du chorégraphe et du metteur en scène un manifeste contre l’oppression. Tout en respectant les indications scéniques du XVIIème siècle (bouche des Enfers, vêtement des Âmes Ingrates couleur cendre, gestes de lamentation, etc.), ils enrichissent l’espace sonore de fragments de discours des candidats à la présidence, et confient aux (très) jeunes danseurs des pancartes couvertes des habituels slogans creux délivrés en de telles circonstances. « C’est violent, mais cohérent », explique une spectatrice enthousiaste à ses amis, au sortir du spectacle. Chahutés, certainement… Mais l’art de Monteverdi aura toujours plus de sens que la banale harangue politique – et ces « Corpi Ingrati » valent surtout pour les audaces expressives de partitions restituées avec panache par Maria Cristina Kiehr et Anne Magouët (sopranos), Pascal Bertin (contreténor), Renaud Delaigue (basse) et Lluis Vilamajo (ténor), sous la férule d’un chef, organiste et claveciniste à son affaire. Restent le mouvement et les gestes des quatre danseurs du BNM, dont l’intensité fusionne avec la virulence du stilo recitativo du chant monteverdien.
(Photo © François Guery)

François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 19 mars. Le Figuier blanc, Argenteuil, 26 mars

François Lafon
Opéra National de Paris – Garnier, jusqu’au 5 avril. En différé sur France Musique le 31 mai (Photo © Elena Bauer/OnP)




Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 4 mars (Photo © PR)


Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 4 mars (Photo © Sébastien Gaxie)

François Lafon

François Lafon
Présences, Maison de Radio France, 18 concerts jusqu’au 19 février (Photo © DR)


Opéra National de Lyon, jusqu’au 3 février (Photo © Stofleth)
François Lafon
Opéra National de Paris – Palais Garnier, jusqu’au 19 février. En direct au cinéma le 16 février, et sur Mezzo et Mezzo Live HD le 23 février. En différé sur France Musique le 5 mars


Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 18 février (changement de distribution à partir du 2 février) – En différé sur France Musique le 12 février (photo © DR)

Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 5 février. En tournée française jusqu’au 24 mars (Photo © Jean-Louis Fernandez)

François Lafon
Théâtre Gérard Philipe, Saint-Denis, jusqu’au 29 janvier, et en tournée française Photo © Guillaume Chapeleau

Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 8 janvier (Photo © Marcel Hartmann)

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 7 janvier Photo © DR

François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, 12 décembre. L’Infini turbulent, sur Arte Concert

Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 25 décembre Photo © Guergana Damianova/Opéra de Paris

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 11 décembre

François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, jusqu’au 23 décembre. En différé sur France Musique le 25 décembre (!!!) à 20h

François Lafon
Salle Gaveau, Paris, 18 novembre. CD Moussorgski-Tchaïkovski-Rachmaninov (La Musica) Photo © DR


A l’Auditorium du Musée d’Orsay, parallèlement à l’exposition Spectaculaire Second Empire, Karine Dehayes et Delphine Haidan (« Deux mezzos sinon rien ») avec François Chaplin au piano, parcourent en lieder et mélodies, solos et duos, cette période où l’on dansait le cancan au bord du gouffre. Au programme : Schubert, Schumann et Liszt (l’influence allemande), Berlioz (inévitable), Gounod, Massenet et Delibes (l’ère bourgeoise) et bien sûr Offenbach, fou de l’Empereur plus subtil qu’il n’y paraît. Première partie aléatoire : les deux voix pas toujours ensemble, le pianiste plus soliste qu’accompagnateur. Et puis la Montgolfière s’envole, ou l’esprit descend (au choix) : François Chaplin donne, en guise d’interlude, un formidable Impromptu en sol mineur (D.899) de Schubert, Karine Deshayes retrouve son charisme (et sa diction) pour des Filles de Cadix (Delibes) d’anthologie, avant une Lettre de La Périchole (Offenbach) à la fois classe et discrètement canaille. En (vrai) bis, le duo de Brahms (Die Schwestern) raté au début, cette fois réussi. Soirée sauvée, mystère de l’instant. Ouf !
François Lafon
Musée d’Orsay, Paris, Auditorium, 17 novembre


A la Philharmonie de Paris, Andris Nelsons dirige l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam. A priori, un événement. Grand auditorium bondé, électricité des grands jours, programme old fashion – grandes pages de Wagner en première partie, deux poèmes symphoniques de Strauss après l’entracte – rappelant les concerts Pasdeloup du dimanche après-midi. Frustration à la mi-temps : cordes célestes mais climax pas vraiment solaire pour Lohengrin (Prélude de l’acte 1), cuivres vieil or mais solennité sans âme dans Parsifal (Prélude et "Enchantement du Vendredi Saint"). Où est passé le Nelsons justement adulé à Bayreuth ? Avec Mort et Transfiguration – pas le plus facile des Strauss, même si l’on y entend en avant-première des thèmes repris plus tard dans Une Vie de Héros et les Quatre derniers Lieder - on retrouve le jeune chef pas encore starisé qui, il y a tout juste six ans à la Cité de la Musique, avait donné avec l’Orchestre de Paris un Ainsi parlait Zarathoustra d’anthologie. Promesse confirmée avec Till Eulenspiegel, où l’orchestre se couvre de gloire et, en bis, un Prélude de l’acte 3 de Lohengrin acclamé par une salle qui, in extremis, a retrouvé le Nelsons bayreuthien déjà évoqué.
François Lafon
Philharmonie de Paris, Grande Salle, 14 octobre Photo © DR

En choisissant pour son ouverture de saison L'Ange de feu, l’ouvrage lyrique le plus mal-aimé, voire maudit, de Prokofiev, l’Opéra de Lyon relevait plusieurs défis. La composition, chaotique, qui s’étendit sur plus de vingt ans, connaît tout d’abord une création posthume, en version de concert, à Paris, en 1954. La Russie la découvre dans une version expurgée seulement en 1983. Huit ans plus tard, l’original était enfin créé, à Saint-Pétersbourg. Son sujet, aussi scabreux que celui de la Sancta Susanna de Hindemith, et qui renoue avec l’aspect sadomaso du Joueur d’après Dostoïevski, mis en musique quatre ans plus tôt, tire son livret du roman éponyme du symboliste Valeri Brioussov, qui mêle érotisme, grand-guignol et spiritisme. En faisant appel à l’Australien Benedict Andrews pour la mise en scène (sauf erreur, sa première en France, pour cette reprise de son spectacle au Komische Oper de Berlin), Lyon a évité la surenchère d’un spectacle « gore » et clinquant. Au premier acte, où la jeune Renata est déchirée entre un Ange de lumière qui l’habite et Henri qu’elle imagine être sa réincarnation humaine, la rotation d’un décor de chambres / cellules séparées par des panneaux, suggère l’espace intérieur de l’héroïne où, entourée de ses doubles maléfiques (fantômes, femmes-enfants), elle bascule dans l’hystérie. Un art de la suggestion qui épouse la violence inouïe d’une partition à mille lieux des mélodies enjouées de L’Amour des trois oranges, et où l’orchestre, tapi dans l’ombre au premier acte, explose ensuite comme des coups de canon – final du 2e acte ! Une densité sonore sidérante, aiguisée comme celle du ballet Le Bouffon et domptée par la direction vive de Kazushi Ono, patron incontesté de la maison lyonnaise – maintes fois distingué, notamment dans Le Joueur, du même Prokofiev, en 2009. Sur scène, dans le redoutable rôle de Renata, on retrouve la soprano lituanienne Ausrine Stundyte, déjà remarquable en Lady Macbeth, à Lyon et avec Ono, en début d’année. Engagée à fond, elle nous tient en haleine et électrise de sa présence ce spectacle de deux heures d’un fantastique accompli – puisque à un grand maître de la magie noire, au 2e acte, s’ajoutent Faust et Méphistophélès, aux 4e et 5e actes. Comme l’avait remarqué Prokofiev alors qu’il s’attelait à son opéra, l’intrigue de L’Ange de feu repose essentiellement sur deux personnages : en effet, aux côtés de Renata, tenir celui de Ruprecht, son amoureux transi puis complice et meurtrier, n’est pas une mince affaire. Laurent Naouri, dans une forme vocale éclatante, endosse magnifiquement l’habit de ce chevalier sombre, désabusé mais prêt à tout à l’image du loup de Tex Avery. Ovation justifiée ce soir-là pour un ouvrage qui condense à lui seul La femme et le pantin, Wozzeck et L’Exorciste : belle revanche pour ce mal-aimé.
Franck Mallet
Opéra de Lyon, 11 octobre 2016. Prochaines représentations : 13, 15, 17, 19, 21 et 23 octobre.
Photo : Ausrine Stundyte (Renata) & Laurent Naouri (Ruprecht) © Jean-Pierre Maurin

AuThéâtre de l’Athénée dans la série Les Pianissimes, Hervé Billaut et Guillaume Coppola jouent Brahms et Schubert à quatre mains. Ni duo constitué façon sœurs Labèque, ni choc d’egos surdimensionnés, plutôt le maître (Billaut) et son ex-élève dont les carrières se croisent sans toujours se rencontrer, tous deux parmi les têtes de pont d’une jeune école française riche en personnalités. Deux natures complémentaire surtout, sorte de duo schumanien s’échangeant les rôles d’Eusebius le rêveur et de Florestan le fougueux. Pour Brahms, Coppola à gauche tient la barre. Avec les 16 Valses op. 39, que le compositeur lui-même ne considérait pas comme ses chefs-d’œuvre, ils installent le jeu : précision d’horloge et rythmes dansants, comme une préparation à la furia des Danses hongroises (n° 2, 4, 8, 11), déjà orchestrales dans leur version pour clavier. Entre les deux, changement de place (Billaut aux graves) pour Schubert, un Divertissement à la hongroise à la fois sur ressorts et sur un nuage, noyau dur d’un programme bien plus que seulement ludique. En bis, Schumann (une des Bilder aus Osten, "Images d’orient") et Dvorak (une des Danses slaves, clin d’œil à Brahms) tout aussi supérieurement équilibrés, Eusebius et Florestan réunis. Même programme, différemment agencé, sur disque (1 CD Eloquentia), tout juste paru. Commentaire à venir.
François Lafon
Photo © DR

Retour à l’Opéra Bastille de Samson et Dalila de Saint-Saëns, vingt-cinq ans après la première in loco, à l’époque mise en scène par un Pier Luigi Pizzi déchaîné (chambres à gaz, références aux Damnés de Visconti, etc). Cette fois, le Vénitien Damiano Michieletto, dont le Barbier de Séville « Cinecittà » a laissé un bon souvenir (voir ici), cède lui aussi à la mode, « afin que le mythe soit connecté à notre réalité » : plus de péplums ni de vilains Philistins, plus de super-héros ni de femme fatale assoiffée de vengeance, mais un monde décadent où la Kalachnikov remplace le sabre, où les bacchanales sont des bals costumés (en péplum évidemment), où Dalila est sincèrement amoureuse de Samson, lequel se coupe lui-même les cheveux pour offrir sa force à sa bien-aimée. Aux chanteurs - elle en nuisette, lui en marcel, s’ébattant sur un lit king size - d’assurer le glamour. Ils ont leur voix pour cela, Anita Rachvelishviki faisant fondre la salle avec un « Printemps qui commence » en mezza voce veloutée, Aleksandrs Antonenko rappelant, par le timbre plus que par le charisme, l’insurpassé Jon Vickers, tous deux entourés par un Grand prêtre spécialiste de Wotan (Egils Silins) et quelques francophones au style châtié (Nicolas Cavallier, Nicolas Testé). Dans la fosse, Philippe Jordan s’ingénie à conférer unité et élégance à une partition qui manque trop souvent de l’une et de l’autre, imbriquant oratorio néo-haendelien, grand opéra à la française et bastringue orientalisant. On entend dire souvent que ce répertoire autrefois populaire (987 représentation à l’Opéra de Paris depuis 1892) se marginalise faute de grandes voix. Le problème, comme ce spectacle le montre, n’est pas seulement là.
François Lafon
Diffusion en direct dans les salles de cinéma le 13 octobre et sur Arte Concert à partir du 14 octobre. En différé sur France Musique le 23 octobre Photo © DR

A l’Opéra de Dijon (Auditorium) : L’Orfeo de Monteverdi, premier volet d’un diptyque (Orphée et Eurydice de Gluck en janvier) et même d’un triptyque (Le Retour d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi en mars) révélant une fois de plus le goût du risque du directeur Laurent Joyeux. Pari risqué aussi que de faire briller ces bijoux baroques dans un espace taillé aux dimensions de Turandot ou d’Elektra. Pari gagné tout de même pour cet Orfeo transposé par le jeune metteur en scène Yves Lenoir dans une chambre du célèbre Chelsea Hôtel de Manhattan, où le Père de la musique rejoindrait Bob Dylan, Leonard Cohen et les fantômes de la Factory d’Andy Warhol dans leur (bad) trip créatif. Une transposition qui ne fonctionne pas trop mal, moins contraignante qu’elle pourrait l’être, réussissant mieux – contrairement à l’habitude – la première partie encore madrigalesque que la seconde, où s’invente l’opéra. Réussite musicale surtout, grâce à Etienne Meyer et ses jeunes Traversées Lyriques – stylistiquement informées et dramatiquement efficaces – soutenant une troupe de de spécialistes (Emmanuelle de Negri, Frédéric Caton, Claire Lefilliâtre) dominée par Marc Mauillon pour ses débuts réussis en Orphée, vocalement glorieux et émouvant en rock star bénie des dieux et rattrapée par ses démons. Public pas assez nombreux (matinée du dimanche) mais enthousiaste pour ce spectacle donné trois fois seulement, et qui mériterait de voyager.
François Lafon
Auditorium de Dijon, les 30 septembre, 2 et 4 octobre Photo © DR

A l’auditorium du Musée d’Orsay, parallèlement à l’exposition Spectaculaire Second Empire, Un dîner avec Jacques, opéra-bouffe d’après Offenbach, co-production avec l’Opéra-Comique dans le cadre de ses « Folies Favart » hors les murs. En treize salles et onze étapes (« Comédie du pouvoir », « Portraits d’une société », « Nouveaux loisirs, nouvelle peinture », …), l’exposition, remarquablement pensée et richement documentée, s’attache davantage aux stratégies politico-culturelles de cette époque à laquelle on compare (trop ?) souvent la nôtre qu’elle n’en pointe la face sombre. A l’entrée et à la sortie, deux tableaux – les Tuileries incendiées après la Commune et l’impératrice Eugénie exilée en Angleterre avec le Prince impérial – suffisent à isoler ces deux décennies de danse sur un volcan. La tempête sous un crâne grisé au champagne, on l’attendait du spectacle, dont Gilles Rico, son concepteur et metteur en scène, annonçait « un festin donnant lieu à toutes sortes de jeux érotiques, à des dérives anthropophages ». Il avait le choix, du « Trio du jambon de Bayonne » (Tromb-Al-Casar) à « Ô la plus charmante des chattes » (La Chatte métamorphosée en femme) et à « La mort m’apparaît souriante » (Orphée aux Enfers). Mais la trame en est lâche et l’humour laborieux, laissant aux chanteurs-acteurs, triés sur le volet (Yann Beuron, Jean-Sébastien Bou, Antoinette Dennefeld) et alertement dirigés par l’éclectique Julien Leroy - ex- de … l’Ensemble Intercontemporain cette fois à la tête des très spécialisées Frivolités Parisiennes -, seuls avec ces petites bombes musicales dont l’impertinence, elle, n’a rien perdu de sa charge détonante.
François Lafon
Un Dîner avec Jacques, Auditorium, jusqu’au 9 octobre (en partenariat avec le Théâtre impérial de Compiègne et le Théâtre de Bastia) - Exposition Spectaculaire Second Empire, jusqu’au 15 janvier 2017. Musée d’Orsay, Paris. www.musee-orsay.fr Photo © DR

"Fantastic party" : après le festival Berlioz (voir ici) et l’enregistrement audio (voir là), troisième audition, à l’occasion de la réouverture du théâtre de l’Athénée après une année de travaux, de la Symphonie fantastique « librement adaptée » par Arthur Lavandier pour l’ensemble Le Balcon. Foule sur le floor (parterre débarrassé de ses sièges), joie générale quand le "Bal" devient jazzy, quand l’Académie de musique de rue « Tonton a faim » déchaîne la "Marche au supplice", quand le "Songe d’une nuit du Sabbat" tourne au délire. Ecoute différente encore dans ce théâtre à l’italienne, où les effets acoustiques semblent faire éclater les murs. L’humour, le côté potache sont surexposés, reçus 5/5 par un public-maison ravi de retrouver ce lieu historique (le théâtre de Louis Jouvet) dont le directeur Patrice Martinet a fait un palais de la surprise permanente, bonne le plus souvent, tous genres scéniques représentés et de plus en plus musicale avec Maxime Pascal et le Balcon, ses résidents réguliers. Fête en after : jazz au bar, jeu de quizz sur scène, grenier techno, Brèves volantes de Jacques Rebotier, Paroles et Musiques de Morton Feldman enregistré in loco la saison dernière, tournage d’un clip « Symphonie fantastique ». Dimanche : matinée avec goûter fantastique de la même veine. Admiration au passage de la fosse d’orchestre élargie et automatisée : promesse, encore, de surprises musicales.
François Lafon
athenee-theatre.com Photo © DR

Né en 1994 à Paris, le violoncelliste Edgar Moreau dispose d’un palmarès brillant et bien rempli : lauréat des Concours Rostropovitch et Tchaikovski, « révélation soliste instrumental » aux Victoires de la musique en 2013, « soliste instrumental » deux ans plus tard, etc. Il vient de jouer avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France le concerto pour violoncelle de Schumann : œuvre tardive (1850) d’un compositeur âgé seulement de quarante ans, mais déjà en proie aux hallucinations et qui se jettera dans le Rhin trois ans plus tard. Le concerto pour violoncelle n’a rien de « l’ardeur frémissante » de celui pour piano, ces deux grands concertos de Schumann, étant sans équivalents dans le deuxième quart du XIXème siècle pour leurs instruments respectifs. Celui pour violoncelle est même unique. Il ne fait aucune concession à la virtuosité, et l’orchestre lui aussi se montre discret, hésitant, sauf parfois dans le dernier de ses trois mouvements enchaînés. Commencer un concert par cette musique d’apparence si réservée peut se révéler risqué, et il est sûr qu’il y a quelques décennies, le programme aurait débuté par une ouverture, de Schumann lui-même, de Mendelssohn ou de Weber. Mais du concerto pour violoncelle, Edgar Moreau et Mikko Franck au pupitre ont su rendre la tension sous-jacente, sachant bien que chez Schumann, le calme soit toujours de surface. Après l’entracte, une flamboyante Première Symphonie de Mahler.
Marc Vignal
Philharmonie de Paris, 23 septembre Photo © Julien Mignot

Aux Bouffes du Nord : Traviata, vous méritez un avenir meilleur, conçu par Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith Chemla, respectivement metteur en scène, musicien et interprète principale, mais collectivement tout cela et bien d’autres choses. Le pari était tentant : offrir à une actrice, chanteuse, performeuse (et bien d’autres choses) un rôle emblématique de l’opéra mais aussi du théâtre, en s’appuyant sur l’ouvrage de Verdi et sur ses doubles-fonds que sont le roman et la pièce d’Alexandre Dumas fils, ce dernier mettant en scène sa propre relation avec une courtisane célèbre. Pas d’orchestre ni de chœurs, mais des musiciens-chanteurs-acteurs multitâches, un constant va-et-vient dramatique et linguistique (français pour le théâtre, italien pour le chant), entre vie rêvée et dure réalité, références littéraires et culture populaire, scrupule philologique et anachronisme maîtrisé. On pense aux célèbres décoctions lyriques (Tragédie de Carmen, Impressions de Pelléas, La Flûte enchantée) de Peter Brook sur la même scène, mais aussi à la remise en chantier (une vraie-fausse répétition – voir ici) de l’opéra de Verdi au Festival d’Aix 2006, due à Jean-François Sivadier avec Natalie Dessay. Aucun plagiat formel ni surtout textuel (l’ouvrage à Aix était bien-sûr donné tel quel), mais une façon assez semblable d’aller à la recherche de ce qui, via Verdi, a transmué en mythe un mélo rebattu. Semblable aussi le ballet virtuose de toute la troupe (excellents père – Jérôme Billy – et amant – Damien Bigourdan) autour de Judith Chemla, stupéfiante Violetta Valery/Marguerite Gautier/Marie Duplessis réconciliant tout naturellement les faux jumeaux que sont le théâtre et l’opéra.
François Lafon
Bouffes du Nord, jusqu’au 15 octobre. (France, Suisse, Luxembourg) jusqu’en mars 2017 Photo © Charles Mignon

Ouverture de saison casse-cou à l’Opéra de Paris : Eliogabalo, dernier ouvrage conservé de Francesco Cavalli (1668). Un portrait d’empereur romain/monstre naissant, sorte de pendant au Couronnement de Poppée de Monteverdi, si ce n’est qu’Héliogabale, cousin de Caracalla, est moins célèbre que Néron, que Cavalli, illustre de son vivant, est encore trop méconnu, et que son Eliogabalo a joué de malchance : librettiste anonyme (c’était peut-être Busenello, auteur du Couronnement), retrait de l’œuvre en cours de répétitions au profit d’une autre, moins ambitieuse, plus à la mode. « Un chef-d’œuvre dérangeant, musicalement somptueux », en dit René Jacobs, artisan de sa redécouverte en 2004. D’où, peut-être, l’idée d’en confier la mise en scène à Thomas Jolly, promu vedette à la suite d’un Henry VI de Shakespeare (16 heures de spectacle) faisant feu de tout bois – armures et t-shirts, éclairages de music-hall et musique rock. La plongée dans l’univers industriel de l’opéra ne lui a pas coupé les ailes. Pas d’actualisation à tout faire, pas de vidéo en temps réel – monnaie (trop) courante actuellement sur les scènes. On retrouve sa manière personnelle, à la fois ambitieuse et bricolée, littérale et sans complexe, mais il peine à faire exploser le cadre, à jongler avec les conventions du genre, à rende sa sulfureuse aura à cet Héliogabale bien éloigné de l’« anarchiste couronné » glorifié par Antonin Artaud. La force du spectacle tient davantage à la direction de Leonardo Garcia Alarcon, habile à défendre le génie théâtral et mélodique de Cavalli, préfigurant - plus que celui, solitaire et inégalé, de Monteverdi -, les trois siècles d’opéra italien qui vont suivre. Dominée par le solide ténor Paul Grove et le contre-ténor Franco Fagioli, qui n’en fait pas trop en despote fou, la distribution est plus homogène dramatiquement que vocalement.
François Lafon
Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 15 octobre. En direct le 7 octobre sur le site de France Télévision Culture Box. Diffusion ultérieure sur France 2 et France Musique Photo © Agathe Poupeney/OnP

The Indian Queen, second volet, à l’Opéra des Nations – salle éphémère délocalisée du Grand Théâtre de Genève - du doublé Rameau - Purcell par Teodor Currentzis et son ensemble MusicAeterna. Version semi-staged pour ce semi-opéra inachevé, parent pauvre des grands masks purcelliens (The Fairy Queen, King Arthur), reprenant l’adaptation de Peter Sellars créée à Madrid en 2013 : nombreux ajouts musicaux (dont les tubes "O Solitude" et "Music for a while") structurant sans couture visible ce chef-d’œuvre en pointillé, beau commentaire en voix off de l’écrivain nicaraguayen Rosario Aguilar, élargissant l’intrigue initiale (la belle indienne et le conquistador) aux dimensions de l’actuelle réflexion sur le choc des cultures. Nouvelle démonstration surtout du génie de Currentzis à mettre en scène l’orchestre, éclairant l’ensemble comme un tableau de maître, conservant de Sellars la tension dramatique et l’étonnante gestuelle des solistes et des chœurs, créant une sorte de précipité sellarso-currentzisien, réinvention inespérée de ces spectacles qui firent fureur en Angleterre et tombèrent dans l’oubli, où musique et théâtre se mêlaient selon une alchimie à jamais mystérieuse. Trois grandes heures qui passent comme l’éclair entre hédonisme et spiritualité, où le chef, mieux encore à son affaire qu’hier dans Rameau, mène les choristes, instrumentistes et chanteurs (exceptionnels Willard White et Christophe Dumaux) en chaman musicien actuellement à nul autre pareil.
François Lafon
Photo © DR

Premier volet, pour le 70ème anniversaire du festival de Montreux-Vevey, du doublé Rameau - Purcell par Teodor Currentzis et son ensemble MusicAeterna : "Rameau, le son et la lumière". Un best of diablement agencé, à voir autant qu’à entendre, de la pénombre (Pièces de clavecin en concert) au plein feu (l'Orage des Indes galantes). Orchestre fourni – comme l’aimait le compositeur – occupant la (trop ?) vaste estrade du non moins vaste Auditorium Stravinski, solistes itinérants, soprano aux allures (pas la voix, hélas !) de la regrettée Lorraine Hunt (la Callas du baroque), violons assis-debout, tous dominés par la silhouette interminable du chef, faune paganinien mimant la musique et déchaînant des tempêtes : Rameau homme de théâtre même quand il n’écrivait pas (encore) pour le théâtre. Public ravi, comme étonné de retrouver la chair fraîche sous la poudre de riz, fasciné par ce chef à la fois rock’n’roll et à l’ancienne, en ce qu’il tire la couverture à lui comme on n’ose plus le faire depuis Mengelberg ou Toscanini. Défaut de leurs qualités : le maestro et ses musiciens (russes, de Perm, ex-Molotov) soulignent et surlignent, décrivent au lieu de suggérer, dessinent une fleur là où - en bon classique - Rameau expérimente l’idée de la fleur appliquée aux sens de l’auditeur. « La musique de Rameau (…) va droit au cœur, de la même façon que le soleil traverse l’espace noir infini de l’univers avant de parvenir à l’œil de l’homme », commente Currentzis. Sans brimer son explosive personnalité, que ne cultive-t-il davantage ce très ramiste jeu d’optique… Second volet du doublé, demain à Genève : The Indian Queen de Purcell.
François Lafon
Festival de musique classique Montreux-Vevey - http://www.septmus.ch/fr Photo © DR

Avec en ouverture Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi et en clôture la Passion selon saint Jean de Jean-Sébastien Bach ce samedi soir, l’édition 2016 des Rencontres musicales de Vézelay se distinguait particulièrement. Confier ce monument de la littérature sacrée occidentale à des interprètes aussi jeunes aurait pu révéler leurs limites à traduire les nuances d’une partition qui réclame une sérieuse expérience, voire un bagage culturel conséquent et le sens du drame… Une combinatoire sur laquelle ont travaillé pendant plusieurs années d’éminents artisans du renouveau de l’interprétation baroque comme Harnoncourt, John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe et René Jacobs… Mais, pour la jeune génération, il semble que tout aille très vite, en particulier pour des chefs comme Raphaël Pichon (dont le directeur des Rencontres Nicolas Bucher nous a confirmé la venue, au cours de l’été 2017) et Mathieu Romano qui, à la tête de son Ensemble Aedes, fondé il y a dix ans, relevait le défi de cette Saint Jean, à la basilique – avec les instrumentistes de l’Ensemble Les Surprises, cofondé en 2010 par Louis-Noël Bestion de Camboulas, à l’orgue ce soir-là. Du rythme, de l’ampleur et de la compassion : à l’image de l’imprécation si lyrique du premier chœur, « Seigneur, notre souverain », cette Passion selon saint Jean trouve aussitôt ses marques. Tout est dans l’articulation et la cohésion de ces voix d’une limpidité remarquable, écho souverain et bigarré de la « Foule ». Nous vivons la Passion du Christ grâce à l’évangéliste théâtral du ténor portugais Fernando Guimaraes, à la fois emporté et expressif dans les récits, et émouvant dans les arias. Si l’alto Margot Oitzinger manque de présence dans sa première aria (« Pour me délier des liens de mes péchés »), elle se reprend à la suivante « Tout est accompli » célèbre dialogue plein d’humanité avec la viole solo. On admire tout autant le soprano radieux de Rachel Redmond (révélée par Les Arts Florissants de William Christie) dans l’air « Je te suis pareillement » avec sa guirlande de flûte en accompagnement, ou le douloureux « Fonds, mon cœur » couronné du hautbois solo. Autre révélation du Jardin des Voix de Christie, la basse Victor Sicard est un atout supplémentaire pour exprimer la simplicité et la ferveur qui conviennent à cette interprétation – arias « Contemple, mon âme » et « Mon cher sauveur… ». D’ailleurs, en quittant la basilique, le visage recueilli de plusieurs religieuses en habit bleu et blanc (la Fraternité Monastique de Jérusalem, établie à Vézelay depuis 1993), montrait combien mémorable fut pour elles comme pour le public cette interprétation juvénile.
Franck Mallet
Rencontres musicales de Vézelay, 20 août. Photo : de gauche à droite Victor Sicard (baryton), Mathieu Romano (direction), Fernando Guimaraes (ténor) avec les Ensembles Aedes et Surprises. © François Zuidberg

Depuis la basilique de Vézelay, après être descendu de la colline à travers bois et champs, on rejoint Asquins (prononcer « Aquins ») – où Maurice Clavel termina ses jours –, pour le concert de milieu d’après-midi « Paz, Salam et Shalon » d’Emmanuel Bardon et son ensemble Canticum Novum, à l’église Saint-Jacques. À travers ce programme œcuménique de cantigas d’Alphonse Le Sage, chants séfarade et instrumentaux turque et berbère, les musiciens ont voulu célébrer l’idée de la « coexistence pacifique » des chrétiens, musulmans et juifs durant sept siècles, à partir de la conquête musulmane de la péninsule ibérique en 711. Outre la voix, bien sûr – Barbara Kusa a d’ailleurs de bien meilleures dispositions pour le chant que le fondateur de Canticum Novum –, on observe que la plupart des instruments sont communs aux trois populations : oud, tambourin, flûtes, kamânche, vièle, kanun, rebec, etc. En revanche, l’enchaînement au sein d’un même concert d’un instrumental traditionnel d’Alexandrie – aussi magnifique que fut cette mise en bouche Las Estrellas de los cielos –, avec un poème médiéval consacré à la Vierge Marie comme le Cantiga 209 « Muito faz grand’erro… » d’Alphonse X Le Sage, ne fait que mettre en évidence les différences de style, de fonction, sans parler de l’époque… Au-delà du pur raffinement sonore montait peu à peu la frustration : n’aurait-il pas été préférable de se concentrer uniquement sur les Cantigas du XIIIème siècle, ou bien le chant séfarade, ou encore sur ces airs à danser de la Méditerranée ?
Confrontation plus réussie, en soirée, avec l’ensemble La Tempête qui, remplaçant au pied levé le Chœur Magnificat de Budapest, avait composé un « office imaginaire orthodoxe, du coucher jusqu’à l’aube » à partir des Vigiles nocturnes op. 37 (ouVêpres) de Rachmaninov en y intercalant des passages du Cantique du soleil de Sofia Gubaïdulina. A priori, rien ne rapproche les deux compositeurs, si ce n’est qu’ils sont nés en Russie, à plus d’un demi-siècle de distance : 1873 pour le premier, 1931 pour la Tatare. Conçu par le chef de chœur Simon-Pierre Bestion, ce montage offrait en outre une scénographie originale, La Tempête évoluant du fond de la nef en un chant planant univoque pour se séparer ensuite en deux voies distinctes dans les allées, afin de rejoindre le chœur de la basilique. Jeux de scène et de lumière entre les solistes et l’ensemble debout, assis ou couché : un light-show des plus efficaces pour une musique basée sur des airs traditionnels de Kiev — avec d’impressionnantes notes finales dans le grave (si bémol) demandées aux basses. Le classicisme épuré et enveloppant de Rachmaninov entrait en résonance avec les glissements spectraux du Cantique du soleil d’après Saint François d’Assise, pour violoncelle, percussion et chœur de chambre. Léger bémol pour cette œuvre tardive (1997) : la partie de violoncelle solo, à l’écriture peu développée et aux accords répétitifs systématiquement dans le grave, affadit quelque peu la partition qui paraît s’éterniser. Mais qu’importe, car le final, déclamé par les vingt-quatre voix individualisées de La Tempête, révèle un ensemble d’une tenue exceptionnelle.
Franck Mallet
Rencontres musicales de Vézelay, 19 août. Photo : La Tempête © François Zuidberg

 En montant la rue principale du village le plus visité de Bourgogne – 400 habitants hors-saison ! – on reste coi face aux plaques qui ornent plusieurs maisons où ont séjourné, vécu et même terminé leurs jours de nombreuses célébrités, de Romain Rolland à Max-Paul Fouchet en passant par Jules Roy (sa maison, devenue une bibliothèque publique, accueille des activités liées à la littérature), du chef d’orchestre Ingelbrecht à l’écrivain George Bataille, sans oublier Christian Zervos, critique et fondateur des Cahiers d’art, grand collectionneur de Picasso, Léger, et autres Calder dont les œuvres ornent le Musée qui porte son nom… dans l’ancienne maison de Romain Rolland. Encore quelques mètres à gravir et voici qu’apparaît au sommet la Basilique Sainte-Marie Madeleine, visible à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde, adossée aux collines du Morvan. Depuis plus de quinze ans s’y déroulent chaque été les Rencontres musicales, créées à l’initiative du chef d’orchestre Pierre Cao, qui y fonda ensuite le chœur Arsys Bourgogne, épaulé par la Région. Tel un vétéran, et même s’il a passé la main depuis trois ans à Nicolas Bucher – qui signe seulement cette année sa « première » programmation –, il est toujours présent, ému de retrouver ses amis musiciens.
En montant la rue principale du village le plus visité de Bourgogne – 400 habitants hors-saison ! – on reste coi face aux plaques qui ornent plusieurs maisons où ont séjourné, vécu et même terminé leurs jours de nombreuses célébrités, de Romain Rolland à Max-Paul Fouchet en passant par Jules Roy (sa maison, devenue une bibliothèque publique, accueille des activités liées à la littérature), du chef d’orchestre Ingelbrecht à l’écrivain George Bataille, sans oublier Christian Zervos, critique et fondateur des Cahiers d’art, grand collectionneur de Picasso, Léger, et autres Calder dont les œuvres ornent le Musée qui porte son nom… dans l’ancienne maison de Romain Rolland. Encore quelques mètres à gravir et voici qu’apparaît au sommet la Basilique Sainte-Marie Madeleine, visible à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde, adossée aux collines du Morvan. Depuis plus de quinze ans s’y déroulent chaque été les Rencontres musicales, créées à l’initiative du chef d’orchestre Pierre Cao, qui y fonda ensuite le chœur Arsys Bourgogne, épaulé par la Région. Tel un vétéran, et même s’il a passé la main depuis trois ans à Nicolas Bucher – qui signe seulement cette année sa « première » programmation –, il est toujours présent, ému de retrouver ses amis musiciens.
Les Rencontres ont évolué, pris du poids et se sont diversifiées. Dans l’esprit du Festival de Saintes ou d’Ambronay, les concerts s’étalent désormais sur toute l’année (« une activité de Janvier à décembre », dixit Nicolas Bucher), accueillent des résidences d’artistes « durant 2 à 3 semaines », comme celle de l’ensemble Les Surprises, et disposent à présent d’un studio d’enregistrement, d’un auditorium indépendant de la Basilique, et de studios d’accueil pour les artistes – le tout grâce à la transformation des anciens hospices en lieu dévolu à la création musicale avec l’installation de la Cité de la Voix, en 2010.
Il faut reprendre la route pour assister au premier concert, à Avallon, où s’étend l’activité des Rencontres. La collégiale Saint-Lazare reçoit l’ensemble Gilles Binchois et les Sonadori, dirigés par Dominique Vellard, avec un programme de polyphonies de la Renaissance, « de Tolède à Venise ». Entre sobriété et savant mélisme – extraordinaires Cipriano de Rore ! –, voix et cordes épousent à merveille la voûte colorée de l’édifice dont l’origine remonte au XIIe siècle.
Sécurité renforcée le soir, à la Basilique, pour l’arrivée discrète de la ministre de la Culture qui, finalement, ne donnera pas de conférence de presse le lendemain, comme initialement prévu – mais accordera seulement quelques mots au quotidien régional, l’Yonne Républicaine. En assistant aux Vêpres de la Vierge, force est de constater qu’Audrey Azoulay a fait le bon choix, tant la vision qu’a le jeune chef Mihály Zeke de l’œuvre de Monteverdi s’est révélée d’une beauté captivante. À la tête de l’Académie et de son chœur Arsys Bourgogne associés à l’Ensemble La Fenice (photo), il a osé plusieurs transpositions hardies, où les solistes se répondent avec encore plus de flamboyance, renforçant l’idée monteverdienne d’un théâtre de style baroque, se libérant du cadre religieux. Voix et instruments doublés en écho, sonorités somptueuses du chœur, des cordes et des vents : cette vision audacieuse mérite d’être suivie de près (de nouvelles exécutions sont prévues), quitte à en raffiner l’équilibre sonore – ainsi l’enregistrement programmé (« mais pas avant fin 2017 » selon Bucher), devrait se révéler des plus novateurs.
Franck Mallet
Rencontres musicales de Vézelay, 18 août. Photo : Mihály Zeke à la tête de l’Académie et Chœur Arsys Bourgogne et l’Ensemble La Fenice ; © François Zuidberg

Triangle Berlioz à La Côte-Saint-André : maison natale – église – château. Dans les caves de la première (musée) : exposition Benvenuto Cellini, l’opéra maudit, depuis la création (lettres superbes du compositeur à sa sœur Adèle) jusqu’à nos jours, à travers quelques lectures (riche galerie de costumes de Jacques Dupont - Paris 1972) ou relectures (Terry Gilliam à Londres). A l’église, Trios de Beethoven, suite et fin (voir ici), François-Frédéric Guy entraînant Tedi Papavrami et Xavier Phillips très loin dans son Projet Beethoven au long cours, tous comme en apesanteur. Au Château Louis XI : Roméo et Juliette, « symphonie dramatique » ou opéra inversé, où l’orchestre personnifie, les solistes invoquent et le chœur commente. Avec le Monteverdi Choir et l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Eliot Gardiner peint à fresque tout en passant le chef-d’œuvre au scanner, démêlant l'écheveau pour mieux en faire apparaître la complexité, comme il l’avait fait avec les Troyens (Châtelet – 2003). « J’ai beaucoup chanté Frère Laurent, mais alors là… », s’ébahit Laurent Naouri, résumant la situation. A programme sans pareil, sensations uniques : tout ce que les festivals peinent à retrouver. Berliozien tout cela, encore une fois.
François Lafon
Benvenuto Cellini le 28 août (direction François-Xavier Roth) au Château Louis XI Photo : Musée Berlioz © DR

Chemins de traverse berlioziens plutôt. Escapade à Matheysine, près du Parc national des Ecrins, où Olivier Messiaen a composé l’essentiel de son œuvre : terrain escarpé, trois maisons toutes simples, vue sur lac, chants d’oiseaux, montagnes escaladant le ciel. Désormais une résidence d’artistes, avec confort moderne mais préservée, inaugurée il y a peu par le pianiste messianesque Roger Muraro. Pourquoi Messiaen ? « Parce que – et cela en étonne plus d’un – Messiaen se considérait d’abord comme un héritier de Berlioz », explique Bruno Messina, là aussi aux commandes. De retour à la Côte Saint-André, première moitié (suite demain) des Trios de Beethoven par François-Frédéric Guy, Tedi Papavrami et Xavier Phillips. Pourquoi Beethoven ? Question de filiation encore, et joué en plus dans l’église (pleine à craquer) où a été baptisé le petit Hector. Tiercé gagnant : violon volontaire, violoncelle rêveur, piano épique, circulation sensible de l’énergie, un Trio des Esprits d’anthologie. Le soir au château Louis XI, retour aux fondamentaux avec François-Xavier Roth et Les Siècles, désormais symboles d’un Berlioz historiquement informé : ouverture des Francs-jJuges, dispensatrice, selon le compositeur, « d’un effet de stupeur et d’épouvante difficile à décrire » (??) et Harold en Italie, trip sensible de l’alto solo (Byron dématérialisé, ce soir l’excellent Adrien La Marca) au sein d’un orchestre enjôleur. Mais surtout en vedette américaine, Anne Sofie von Otter dans Les Nuits d’été. Timbre amenuisé mais génie de diseuse, plus encore que dans son enregistrement célèbre (DG), Roth et ses troupes aux petits soins. Demain : John Eliot Gardiner dirige Roméo et Juliette.
François Lafon
Photo © DR

« Grande ouverture festive » du festival Berlioz 2016 au château de Sassenage (Isère), dit château de Mélusine. Pourquoi la fée-serpent, que l’on entend encore siffler et crier dans les grottes proches ? Parce que le thème de l’année est « Les Fleurs du mal ou Berlioz au bal des sorcières ». Pourquoi Baudelaire et Berlioz, le poète et le musicien ne s’étant pas rencontrés ? Une pirouette au fond très berliozienne comme les aime Bruno Messina, tête pensante et artisan du succès de la manifestation, rappelant que Théophile Gautier, inspirateur des Nuits d’été, était l’idole de l’auteur du « Balcon ». C’est d’ailleurs l’ensemble Le Balcon, dirigé par Maxime Pascal, qui ouvre les festivités sur la pelouse de cette demeure XVIIème, avec une Symphonie fantastique revisitée par le jeune compositeur Arthur Lavandier. Orchestre sonorisé (constante du Balcon), vraies cloches (fondues in loco en 2013 – voir ici) et procession infernale pour la « Marche au supplice », dérapages jazz, sonorités étranges et rythmes détricotés, « l’histoire racontée étant celle d’un décalage du réel vers l’halluciné » (Lavandier), se démarquant toujours plus de l’original au fil des cinq mouvements. Un jeu de piste pour l’amateur, lequel se demande quand même si la Fantastique telle qu’en elle-même n’est pas plus angoissante, voire plus moderne pour peu qu’on la joue comme l’a fait John Eliot Gardiner avec l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique l’année dernière au festival (voir ici). Public bon enfant, séduit et un peu décontenancé, chauffé par un après-midi gentiment fantastique mettant en lumière les diverses composantes du festival : chœur d’enfants – formidable – du projet vocal « A travers chants » dans le conte de Marcel Landowski et Pierre Gripari La Sorcière du placard à balais, Grand Orchestre Fantastique (et amateur) passant de Hänsel et Gretel à Harry Potter), Quintette à vents et cors des Alpes dans la grotte de la fée, Trio Journal Romantique (alto, piano, acteur, en l’occurrence Daniel Mesguich) célébrant Schumann sous les fresques imitées de Raphaël du grand salon du château. Un patchwork très berliozien, là encore.
François Lafon
La Côte Saint-André, jusqu’au 30 août. www.festivalberlioz.com Photo © DR

Ouverture de la 19ème édition de Classique au vert au Parc floral du bois de Vincennes : Deux mezzos sinon rien !, duo grave réunissant Karine Deshayes et Delphine Haidan, avec Thomas Palmer au piano. Bien dans le ton de ce festival gratuit (si ce n’est l’entrée au Parc) dont les programmatrices Marianne Gaussiat et Isabelle Gillouard pratiquent depuis cinq saisons l’art du grand écart. Public nombreux - de 7 à (surtout) 77 ans - pour ce bain musical sans complexes, animant un Paris estival chiche en musique : scène amateurs et atelier vocal, Bach aux marimbas, Britten par le nouvel Orchestre (d’amateurs) maison, mais aussi David Zinman dirigeant Mahler, musique de chambre plus (J.B. Vuillaume Trio dans Schubert et Schönberg) ou moins (Henri Demarquette en Offenbach) sérieuse, pianiste à découvrir (Vasilis Varvaresos jouant Beethoven et Starwars revu par lui-même). De plus en plus complémentaires, les mezzos Haidan et Deshayes : au timbre sombre de la première répond celui, désormais sopranisant, de la seconde, leur permettant de pratiquer l’ambiguïté (homme-femme de La Clémence de Titus, double dames des Noces de Figaro, petit frère – petite sœur de Hänsel et Gretel d’Humperdinck) et de faire jeu égal en bis pour un « Over the rainbow » au succès assuré. Le tout discrètement sonorisé, confort ou sacrilège aujourd’hui admis, en plein air tout au moins.
François Lafon
Classique au vert, 7 week-ends jusqu’au 18 septembre. www.classiqueauvert.paris.fr Photo © DR

Pas annoncé dans la brochure de la saison 15/16, contrairement au précédent spectacle de l’Académie de l’Opéra national de Paris (« Ensemble d’opéras de Mozart » le 9 avril dernier), le « Workshop Kurt Weill » qui s’est déroulé le 30 juin dernier à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille semble bien avoir été ajouté à la dernière minute, comme celui qui réunissait plusieurs solistes dans des lieder de Strauss un mois plus tôt (30 mai), au même endroit… Qu’importe, car entre les parents des différents jeunes artistes présents, les habitués de la Bastille et les curieux, y compris le metteur en scène Robert Carsen venu en simple spectateur, l’amphi était quasiment comble. Sur une scénographie et une dramaturgie qui fleurait bon un spectacle de fin d’année de terminale – une audition pour chanter du Weill… – signée Mirabelle et Philippine Ordinaire et Joël Huthwohl, ce ne sont pas moins de 12 solistes, 3 pianistes (dont l’un, Benjamin Laurent, avait été sollicité pour plusieurs réductions et arrangements bien tournés) et un sextuor à cordes qui se retrouvaient pour célébrer Weill. Passé de l’expressionisme de l’Allemagne de Weimar à la comédie musicale américaine de Broadway, avec un détour par le réalisme poétique de la France des années trente, il fut au XXe siècle l’auteur d’une œuvre protéiforme, dont les mélodies enjouées touchent encore et toujours un large public. D’ailleurs, plusieurs de ses ouvrages pour petit ensemble et / ou chœur d’enfants ont naturellement trouvé le chemin de l’amphithéâtre depuis l’ouverture de la Bastille. En langue originale, c’est-à-dire en allemand, anglais ou français, plus d’une vingtaine de ses airs fut distribuée à de jeunes chanteurs en devenir – quitte à ce que certains se révèlent meilleurs comédiens, ou que d’autres captent d’emblée le style de la mélodie, indépendamment du fait que leur voix va à l’avenir évoluer et se transformer. Au sein d’un plateau plutôt encourageant, on remarquait ce soir-là le timbre bien charpenté de la mezzo Emanuela Pascu, entrée à l’Académie en septembre 2015 (Nanna’s Lied), le soprano idoine d’Élisabeth Moussous dans l'éloquent air de Butterfly, Un bel di vedreno – c’est elle qui chantait Annina, dans La Traviata, à la Bastille, en mai, et qu’on retrouvait au final, entraînant tous ses camarades dans Youkali. Timbre plus léger et articulation parfaite dans La complainte de la Seine et le Duo de la jalousie pour Pauline Texier, qui fut également Kätchen dans Werther, en début d’année. Mais il faudrait plébisciter tout autant les sopranes Gemma Ni Bhriain, Ruzan Mantashyan et Adriana Gonzalez, sans oublier le baryton basse Mikhail Timoshenko, ainsi que les instrumentistes ! – qu’on retrouvera à coup sûr la saison prochaine.
Franck Mallet
Paris, Amphithéâtre de l’Opéra Bastille 30 juin Photo : Emanuela Pascu © Julien Mignot

Au Festival de Versailles, dernier concert de la série Les Voix royales : "Versailles - Barcelone, chefs-d’œuvre sacrés de l’Espagne de Philippe V," par Jordi Savall, la Capella Reial de Catalunya et Le Concert des Nations. Deux messes, signées Henry Desmarest (Messe à deux choeurs et deux orchestres – 1707) et Francesc Valls (Missa Scala Aretina – 1702), lesquels ont dû se croiser à Barcelone, où le Français, chassé de son pays natal pour une affaire de mœurs, était au service du roi d’Espagne Philippe V, petit-fils de Louis XIV. Moins de points communs qu’on l’imaginerait pourtant entre la pompe marquée « Roi Soleil au crépuscule » de l’un, et l’audace (jusqu’à la dissonance, contestée à l’époque) de l’autre. Dans le cadre adéquat de la Chapelle royale, Savall et ses troupes (de luxe, avec le harpiste Andrew Lawrence-King, Manfredo Kraemer et Philippe Pierlot, violon et taille de violon) offrent à Desmarest l’opulence qu’il réclame, mais c’est tout feu tout flamme et avec un enthousiasme communicatif qu’ils fêtent le grand Catalan déjà européen de style et d’influences. Un enregistrement est à venir, à comparer, pour la Missa Scala Arentina, avec celui, historique, de Gustav Leonhardt.
François Lafon
Festival de Versailles, Chapelle royale, 3 juillet Photo © DR

Fin de saison à l’Opéra de Lyon : L’Enlèvement au sérail de Mozart. Un Enlèvement révisité : le metteur en scène Wajdi Mouawad, auteur dramatique libano-canado-français, naguère coqueluche du festival d’Avignon et depuis peu successeur de Stéphane Braunschweig à la tête du Théâtre de la Colline, en a revu la dramaturgie et réécrit les dialogues parlés. « J’ai le sentiment que si, au temps de Mozart, il était bon de rire des Ottomans comme pouvait le faire Molière dans Le Bourgeois Gentilhomme et d’en faire nos « têtes de Turcs », aujourd’hui, ce rire peut être interprété dangereusement si l’on ne prend pas le temps de le dégager de ce que l’actualité pourrait lui faire dire à nos dépens. ». En teintant à la manière de Diderot le singspiel mozartien de moralisme, en lui ajoutant un prologue explicatif (« Ces effroyables mahométans ? »), en évitant d’actualiser l’action (presque une audace, par les temps qui courent), il prend le contrepied d’un Martin Kusej, dont l’ « Enlèvement chez Daesh » avait fait long feu au festival d’Aix il y a deux ans. Mais la démonstration n’est pas toujours légère, et une bien-pensance peut en cacher une autre. Sa mise en scène sauve la mise, plus agile à jongler avec les codes Orient - Occident, à retrouver l’ambiguïté légèreté - gravité chère à Mozart, comme en témoigne la scène qui ouvre la seconde partie, où les prisonniers travaillent à leur évasion tout en participant à la grande Prière. Plateau jeune, dominé par Cyrille Dubois (Belmonte), Joanna Wydorska (Blonde) et David Steffens en Osmin débouffonisé, direction vif-argent (au prix de quelques dérapages) du violoniste-chef Stefano Montanari, achevant d’entretenir le doute quant à la pérennité du message des Lumières en notre époque troublée.
François Lafon
Opéra National de Lyon, jusqu’au 15 juillet Photo © Stofleth

Clôture du 4ème Festival Palazzetto Bru Zane (Venise) aux Bouffes du Nord : Quatuor romantique avec le Quatuor Mosaïques. Un romantisme élargi : 2ème Quatuor de Gounod (renié par son auteur, redécouvert en 1993) à la manière très 3ème République des classiques viennois, Quatuor de Debussy, à peine postérieur, encore « selon les règles » mais tellement plus prospectif, double piste d’envol pour le 2ème Quatuor de Benjamin Godard, héros de l’année au Palazzetto, et le plus romantique des trois. Mais qu’est-ce que le romantisme à la française, en cette fin de XIXème siècle où l’Ars gallica lutte tant bien que mal contre le wagnérisme déferlant ? Franco-Viennois, connus pour leur jeu historiquement informé et l’équilibre de leurs pupitres (du leader Erich Höbart, ex-du Quatuor Vegh, au violoncelliste classé baroque Christoph Coin), Les Mosaïques mettent tout naturellement en lumière le sérieux et la densité (germaniques ?) dont témoignent ces œuvres ostensiblement françaises. Témoins : l’étonnant Allegretto chuchoté du Quatuor de Gounod (bissé - et encore plus étonnant - en fin de concert), ou le mendelssohnien Allegro molto final de celui de Godard.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, 4ème Festival Palazzetto Bru Zane, 9 juin Photo © DR

4ème Festival Palazzetto Bru Zane (Venise) aux Bouffes du Nord : L’Invitation au voyage, mélodies françaises - années 1890 (Fauré, Lekeu, Hahn, Koechlin, Debussy, Duparc) par Marie-Nicole Lemieux (contralto) et Daniel Blumenthal (piano). Question de Christophe Huss, Français installé au Canada et chroniqueur musical du quotidien Le Devoir : « D’où vient la cote d’amour, sentimentale autant qu’artistique, du public français pour cette chanteuse ? » Une évidence … et une colle. L’évidence : sa voix (rare, un vrai contralto), sa musicalité (naturelle, sans effet extérieur), son intelligence des textes. Ce soir, grands moments musicaux - du presque parlé aux grandes orgues vocales - avec Reynaldo Hahn (Fêtes galantes - Verlaine), Charles Koechlin (L’hiver - Théodore de Banville), Debussy (Colloque sentimental d’anthologie), Duparc (impeccable Phidylé). En bis : somptueuse Prière de Jocelyn, de Benjamin Godard, musicien de l’année au Festival. La colle : grand moment de théâtre quand le pianiste enchaîne sur Debussy en oubliant Koechlin : « Ah non, je tiens à mon ordre ! ». Rire (communicatif), aparté : « Il est timide ». Un talent comique, aucun cabotinage. Tentative de réponse à la question : Marie-Nicole Lemieux est comme elle chante, le cœur sur la main, pas la main sur le cœur. Une spécialité québécoise, peut-être.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, 4ème Festival Palazzetto Bru Zane, jusqu’au 9 juin Photo © Alvaro Yañez

A l’Auditorium de Radio France dans le cadre de ManiFeste, festival de l’IRCAM : concert Yan Maresz – Magnus Lindberg –Witold Lutoslawski. En un mois et géographiquement éclaté (Beaubourg, Philharmonie, Bouffes du Nord, Cent-Quatre), ManiFeste marche cette année de concert avec le Centre Pompidou, où se tient l’exposition « Un Art pauvre », courant plus connu sous son nom italien d’Arte povera. Art pauvre, la riche 4ème Symphonie (1992) de Lutoslawski, l’efflorescent Corrente II de Lindberg (idem), le millimétré Répliques de Maresz (2015-2016), créé ce soir avec en soliste le formidable harpiste Nicolas Tulliez et le Philharmonique de Radio France dirigé par le nouveau favori de la « contemporaine » Julien Leroy ? Question de définition. Maresz aussi bien que Lindberg se réclament de Lutoslawski. Cela s’entendrait-il autant si dans son ultime symphonie (il est mort un an plus tard), le grand Polonais n’avait résumé son art avec une liberté qui pulvérise les notions de classique et de moderne… au risque de faire paraître monochromes les œuvres pourtant raffinées de ses disciples ? Pas de pyrotechnie informatique dans ces trois œuvres, si ce n’est un système de capteurs collés sur la caisse de la harpe de Nicolas Tuilliez dans celle de Maresz : souvent donnée comme parent pauvre de l’orchestre, la harpe y révèle ses fastes en gros plan. Un clin d’œil à la richesse de l’Arte povera ?
François Lafon
Radio France, Auditorium, 4 juin – ManiFeste 2016, jusqu’au 2 juillet – Exposition Un Art pauvre, Centre Pompidou, Paris, du 8 juin au 29 août Photo © Centre Pompidou-DR

Le composteur finlandais Magnus Lindberg (né en 1958) est de ceux à qui l’on peut consacrer plus de la moitié d’un concert. Sa réputation internationale est établie, et il s’est depuis le début de années 1980 placé au premier rang, en particulier pour sa maîtrise de l’orchestre. De nombreux ouvrages en témoignent. Le plus vaste à ce jour est Aura (1993-1994), dédié à la mémoire de Witold Lutoslawski : une quarantaine de minutes, quatre mouvements enchaînés. Mais, insiste le composteur, il ne s’agit pas tout à fait d’une symphonie, ni d’un concerto pour orchestre, malgré le fréquent traitement de groupes instrumentaux en solistes virtuoses. Les déchaînements sonores n’excluent pas la transparence, et la tension se résout sur une sorte de choral parfaitement intégré au reste. Beau succès pour le Philharmonique de Radio France et le chef Jukka-Pekka Saraste. Auteur de plusieurs concertos, Lindberg affectionne la virtuosité instrumentale et son association à un orchestre. Cet orchestre est moins fourni dans le Concerto pour violon n°1 (2006) que dans Aura, limité à 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors et aux cordes : ce concerto a été écrit lors de la célébration du 250ème anniversaire de Mozart. Il y a dialogue, mais la Néerlandaise Simone Lamsma, soliste de la soirée, constamment en activité, a tenu l’auditoire en haleine par son jeu parfois aux limites du silence, parfois débridé (longue cadence du deuxième mouvement). Un concerto ayant tout pour devenir un classique ! En fin de programme, l’austère mais si riche Quatrième Symphonie de Sibelius (1911), dirigée par Saraste avec les coups de boutoir nécessaires. Surtout, sans ralentir après la « catastrophe » du finale, en conservant le tempo jusqu’à la chute soudaine dans l’inconnu.
Marc Vignal
Auditorium de Radio France, 20 mai Photo : Jukka-Pekka Saraste © DR

Opéra contemporain (ou presque) au Palais Garnier : Lear d’Aribert Reimann. Presque classique plutôt : création à Munich en 1978, première parisienne (même lieu) en 1982. A l’époque, la salle se vidait par rangs entiers. Aujourd’hui, public sage devant cette adaptation du monument shakespearien commandé par Dietrich Fischer-Dieskau à Benjamin Britten d’abord, à ce compositeur (et occasionnellement son accompagnateur au piano) spécialisé dans la mise en musique des grands auteurs (Lorca, Strindberg, Kafka) ensuite. Pas tout à fait classique pourtant, dans la mesure où, pour être réputé inclassable, le style de Reimann avoue son âge, sans atteindre à l’atemporel : attendus ces clusters à la chaîne, ces déferlements orchestraux, et même ces références répétées à Britten dans les moments hypnotiques telle la mélopée d’Edgar - ténor montant au contre-ténor quand il joue le Pauvre Tom (audacieux, à l’époque) -, ou dans le parlé-à-peine-chanté du Fou, rappelant Puck dans Le Songe d’une nuit d’été. L’ensemble pourtant (d’où son succès : plus de vingt productions à ce jour) est à la hauteur d’un sujet devant lequel Berlioz, Debussy et Verdi ont déclaré forfait. Légère déception quant à la mise en scène de Calixto Bieito pour ses débuts parisiens : on redoutait un excès de trash, on a une nième illustration des théories de Jan Kott (Shakespeare notre contemporain – 1964) rapprochant les héros shakespeariens des clochards métaphysiques de Samuel Beckett. Direction sans bavures (Fabio Luisi) et chant impeccable en revanche pour ce répertoire où le cri et le parlando sont trop souvent des valeurs-refuges : grandiose trio Bo Skovhus (Lear) - Andrew Watts (Edgar) – Kor-Jan Dusseljee (Kent), dames à l’unisson, à peine handicapées par un jeu conventionnel (des mégères, mais pas que cela …) sans doute imposé – ou toléré – par le metteur en scène.
François Lafon
Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 12 juin. En différé sur France Musique le 18 juin Photo © DR

A l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille, spectacle de fin de saison de l’Académie (englobant désormais l’Atelier lyrique) de l’Opéra de Paris : L’Orfeo de Monteverdi. Lieu et place tout trouvés pour ce prototype (1607) du genre, où l’on voit et entend en temps réel le madrigal engendrer le théâtre chanté. Dans cette arène à la fois ouverte et souterraine, le chef Geoffroy Jourdain crée un jeu particulier de miroir entre son ensemble Les Cris de Paris et les jeunes solistes, considérés comme un groupe duquel naissent les personnages. Revers de la médaille : cet espace éclaté gêne la nécessaire fusion des timbres, comme si l’ensemble instrumental peinait à communiquer aux voix son énergie et sa richesse. La faute aussi à la mise en scène de Julie Berès, réputée selon le programme pour « créer un théâtre en prise avec le réel, fort des contradictions de son temps », mais restant ici anecdotique et disparate. Reste que s’ils ont souvent l’air – surtout dans la première partie « madrigalesque » – de marcher sur des œufs, les membres de l’Atelier ont intégré le style montéverdien, cette expression des affects où tout est dit pour les quatre siècles à venir : bel Orphée, terrien et poétique (le baryton Tomasz Kumiega), imposante Messagère (la mezzo Emanuela Pascu), Apollon naturellement arbitre du jeu (Damien Pass, ancien de l’Atelier). En ce sens, et c’est là le but de l’expérience, les élèves ne sont pas si loin d’être des maîtres.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, Amphithéâtre, jusqu’au 21 mai Photo © Studio

Aux Bouffes du Nord : Verso Medea (vers, du côté de Médée) d’Emma Dante d’après Euripide. Apparemment plus classique mais non moins assagie, la trublion(ne) palermitaine continue de réactiver les grands mythes. Chœur de femmes joué par des hommes, périodes sublimes et lazzi de commedia dell’arte, gestes de tous les jours et pirouettes virtuoses, et surtout mélange de sauvagerie et de raffinement extrême, comme on en trouvait chez Pasolini (Edipo Re, Medea), comme le transmettent les extraordinaires comédiens-danseurs-performers réunis autour (ou du côté - verso) d’Elena Borgogni, fulgurante Médée petite-fille du Soleil et matrone enceinte du fruit de sa vengeance (quelle autre version du mythe la fait accoucher devant nous de l’enfant qu’elle va tuer ?). En contrepoint, les frères Mancuso, voix de la Sicile immémoriale, timbres d’opéra brûlés, confrontent et confondent folklore et extrême religiosité. Une façon de se rapprocher (peut-être) du son de la tragédie grecque, chaînon à tout jamais manquant de ce rituel mystérieux dont procèdent pourtant nos plus anciennes traditions. Plus de sous-titres (les frères ont refusé) pour cette plongée musicale et dialectale en mémoire profonde.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 28 mai Photo © DR

A l’Opéra du Rhin - Strasbourg, première française (une spécialité maison) de Das Liebesverbot (La Défense d’aimer - 1836), deuxième essai lyrique du jeune Wagner, d’après Mesure pour mesure de Shakespeare. Une œuvre déroutante, dont on se demande s’il s’agit d’un pastiche de Rossini, Bellini et Donizetti par le futur compositeur de Parsifal, où d’un à la manière de Wagner signé Rossini, Bellini, etc. Déjà du Wagner pourtant, dans la gestion du (long) temps, dans certaines fulgurances mélodiques et orchestrales, dans le traitement de la voix, même lorsque – péché de jeunesse – la soprano principale doit passer sans solution de continuité des grandesorgues pré-Vaisseau fantôme aux cocottes de Lucia di Lammermoor. Hiatus aussi, si l’on considère la pièce rarement joué, classé parmi les « œuvres à problèmes » de Shakespeare, ni drame ni comédie, réflexion ambiguë sur le pouvoir et l’interdit dans une Vienne rêvée régie par un Duc philosophe, devenue sous la plume de Wagner manifeste libertaire pour le droit au(x) plaisir(s) – d’où le changement de titre – dans une Sicile jouisseuse soumise à un Teuton puritain. En guise de courts-circuits signifiants, la metteur(e) en scène Mariame Clément applique les standards du regietheater, en grossissant le trait : décor unique (un café… viennois, lieu de licence et de répression), allusions à l’actualité (foulard pour les femmes quand vient … la défense d’aimer), libération finale (assez réussie, cela dit) convoquant la ferblanterie des futurs dieux wagnériens. Chœurs très au point, plateau aussi satisfaisant que possible compte-tenu des prouesses vocales requises, direction énergique mais neutre de Constantin Trinks, là où il aurait fallu un Fregoli de la baguette, capable de réunir les contraires.
François Lafon
Opéra National du Rhin : Strasbourg (Opéra) jusqu’au 22 mai, Mulhouse (La Filature) 3 et 5 juin.

Les deux concertos pour violoncelle de Chostakovitch (1959 et 1966) sont tous deux dédiés à - et ont été créé par - Mstislav Rostropovitch. Le second, sa dernière œuvre concertante, s’ouvre par une phrase grave et méditative du soliste, et pendant assez longtemps, il n’y a guère de virtuosité. Même dans les deux mouvements suivants, enchainés et marqués l‘un et l’autre Allegretto, l’introspection domine, par delà leurs roulements de tambour et leurs sonorités de xylophone. Après un Prélude à l’après-midi d’un Faune d’un beau mystère, la violoncelliste Sol Gabetta, née en Argentine de parents français et russe, a interprété l’ouvrage de l’intérieur, sans ostentation, dévoilant peu à peu ses secrets. L’Orchestre philharmonique de Radio France et Mikko Franck ont ensuite attaqué la Cinquième Symphonie de Sibelius (1919) : un univers fort différent, porté par un orchestre aux plans multiples, aux perspectives spatiales, et des tempos changeants, s’imbriquant les uns dans les autres. Dans cette Cinquième, on attend les chefs aux tournants, et dieu sait s’ils sont nombreux : le grand sommet soudant les parties lente et rapide du premier mouvement, la conclusion de ce mouvement, qu’il faut couper net, et surtout les six accords finaux, largement et irrégulièrement espacés, tranchants, qui doivent se suivre sans que la tension se relâche. Mikko Franck était au rendez-vous, dirigeant de façon tantôt paisible, tantôt péremptoire, tirant des cordes graves, dans les épisodes aux limites du silence, des accents fugitifs et néanmoins très pointus.
Marc Vignal
Philharmonie de Paris, 21 avril Photo © DR

Suite du "Printemps de la Pop" (la Péniche-Opéra new look – voir ici) : La Lanterne magique de M. Couperin, reprise de la performance donnée en 2010 au festival de La Roque d’Anthéron. Idée lumineuse : tandis qu’à la lueur de quelques bougies la claveciniste Violaine Cochard enchaîne des pièces de François Couperin (programme établi par Bertrand Cuiller), Louise Moaty, metteuse en scène, conceptrice et réalisatrice, projette sur un écran en forme de pleine lune des images « belles et remuables », ainsi que les décrivait Leibnitz, en admiration comme ses contemporains devant ces « mouvements bien extraordinaires et grotesques que les hommes ne sauraient faire ». Etonnantes correspondances entre ces images à la fois somptueuses et (à nos yeux) maladroites et cet instrument sonnant idéalement dans ce lieu à sa mesure, ballet non moins étonnant de la manipulatrice créant un rêve animé deux siècle avant l’invention du cinéma. Salle (enfin, cale) pleine, beaucoup d’enfants sages comme des images (animées) devant ce jeu vidéo avant la lettre accompagnant la plus belle des musiques.
François Lafon
15, 16 et 17 avril (16h30) à La Pop, amarrée devant le 46 quai de La Loire, 75019 Paris Photo © DR

Nouvelle mise en scène à l’Opéra Bastille du Rigoletto de Verdi, remplaçant celle, très usée, de Jérôme Savary et complétant la « trilogie populaire » (avec Le Trouvère et La Traviata) programmée cette année. En représentant justement estimé du Regietheater à l’allemande, Claus Guth (psych)analyse le mélo hugolien (Le Roi s’amuse) revu par le librettiste Piave et nous en explique le pourquoi du comment. Il va chercher chez Hésiode (VIIème siècle av. J.C.) l’idée maîtresse du spectacle : telle la boîte de Pandore (« Seule l’Espérance resta dans la boîte, arrêtée par ses bords »), la scène devient la projection du drame intime du bouffon trainant dans son errance la robe ensanglantée de sa fille assassinée. Deux Rigoletto (celui qui se souvient et celui qui agit), Gilda enfant (projections au ralenti), un Duc cocaïnomane, une Maddalena meneuse de revue (effet de la coco chez Le Duc ?) évoluent donc dans une boîte de petits Lu géante, fréquentée aussi par des courtisans comploteurs et gesticulants sortis du film Men in black. Mais Verdi, qui n’en demande pas tant, n’a pas son pareil pour rejeter le greffon, et tant pis pour ceux qui auront du mal à retrouver le texte sous l’éxégèse. Ils pourront s’appuyer sur la musique, servie sans magie mais avec efficacité par le chef Nicola Luisotti et par un plateau solide, où le ténor Michael Fabiano fait bel effet en dépit d’une certaine tendance à faire durer la note, où la soprano Olga Peretyatko est impeccable à défaut d’être émouvante, où la grande Vesselina Kasarova joue (si l’on peut dire) les utilités, mais où le baryton Quinn Kelsey s’impose comme le Rigoletto du moment.
François Lafon
Opéra National de Paris – Bastille jusqu’au 30 mai (deux distributions prévues). En direct au cinéma le 26 avril, sur Culture Box à partir du 28 avril et sur France 2 ultérieurement.
En différé sur France Musique le 28 mai Photo © Monika Riitershaus

Lancement, à la Maison de la culture du Japon à Paris, du 37ème festival Piano aux Jacobins (de Toulouse – extension désormais annuelle en Asie), avec un récital de Kotaro Fukuma, pianiste éclectique de formation nippo-franco-allemande, fêté - entre autres dans Musikzen (voir ici) - pour ses enregistrements inventifs. Programme décomplexé pour le public (nombreux) de l’Auditorium à dominante bois clair du lieu : Beethoven (la « Clair de lune »), Chopin et Smetana (La Moldau transcrite par l’artiste) en première partie, Debussy, Takemitsu et Scriabine après l’entracte. Comme pour bien marquer la césure, Tokaro Fukuma change de tenue : smoking et chemise blanche d’abord, chemise noire à col ras ensuite. Césure aussi dans son jeu : grande maîtrise mais relative neutralité dans Beethoven et Chopin, fine mise en valeur de la filiation Debussy-Takemitsu, bis éclectiques, parmi lesquels la transcription due à Alexis Weissenberg d’Avril à Paris de Charles Trénet, que Fukuma a découvert – explique-t-il dans un français sans reproche - en même temps que la culture hexagonale. Légère frustration tout de même, comme si le charme des disques avait un peu de mal passer la rampe.
François Lafon
Maison de la culture du Japon à Paris, 6 avril – www.pianojacobins.com Photo © DR

Première saison de la Pop : Tristan et Iseut, ni toi sans moi, ni moi sans toi. Explication : à fond de cale relookée chic (noir, rouge) de la Péniche Opéra rebaptisée (seules restent les initiales) mais toujours flottant sur le bassin de la Villette, Geoffroy Jourdain (nouveau maître des lieux avec Olivier Michel), Morgan Jourdain (musique) et Nicolas Vial (metteur en scène) manient le mythe et en assument les dérives. Re-explication : ce Tristan joué, chanté, rafistolé par quatre comédiens-chanteurs-rafistoleurs virtuoses commence à la manière de Poulenc et Michel Legrand, se poursuit à la fortune du pot (verres frottés, bouteilles soufflées, tuyaux de plastique) et se termine dans une apothéose wagnérienne elle-même clôturant une réjouissante rencontre-débat sur le thème « Qu’est-ce que ce mythe nous dit, à nous, aujourd’hui ? ». Peu de moyens mais pas mal d’idées, un art du pince sans rire évitant les délires téléphonés, jeu assez fin avec les niveaux de lecture - même si les parents rient plus fort que les enfants. « La Pop, c’est un laboratoire où des artistes d’horizons variés s’emparent de l’objet sonore et musical pour raconter une histoire », résume Geoffroy Jourdain, d’abord connu comme animateur de l’ensemble vocal Les Cris de Paris. « Un lieu où les spectacles naîtront avant d’aller se faire voir ailleurs », ajoute-t-il en prélude au spectacle. Sur le papier : une volonté (risquée) de se démarquer du style bon enfant de la Péniche Opéra. A en juger par ce Tristan assez désopilant, une continuation finement décalée de la tradition maison.
François Lafon
La Pop, Quai de la Loire, Paris. www.lapop.fr Photo © DR

Aux Bouffes du Nord, Adesso voglio Musica e basta (A présent, je ne veux que musique et basta), voyage à travers le monde (pas seulement mais très) musical de Pippo Delbono, acteur, danseur, dramaturge, metteur en scène et cinéaste, habitué à Paris du Théâtre du Rond-Point, délaissant cette fois son théâtre esthétiquement incorrect et politiquement offensif pour raconter en trois concerts-performances le monde tel qu’il l’entend. C’est, dans Il Sangue (Le Sang), une variation sur le mythe d’Œdipe où, accompagnée au luth, au oud et à la guitare électrique par la formidable Ilaria Fantin, la voix protéiforme de Petra Magoni confère à de simples chansons - d’"Alleluia" de Jeff Buckley à "Both Sides now" de Joni Mitchell – des couleurs baroco-intemporelles. C’est le lendemain, une lecture de La Notte (La Nuit juste avant les forêts), monologue superbe et halluciné de Bernard-Marie Koltès que Delbono joue, surjoue, paraphrase et musicalise, secondé par la guitare électrique de son complice de longue date Piero Corso à la manière du groupe rock britannique Dire Straits. Moment fort : le duo final d’Il Sangue par Petra Magoni et Bobo, handicapé à la présence fantastique, interprète fétiche du Delbono circus. Comme un condensé de l’art de ce virtuose aux allures d’improvisateur, descendant par son père de Paganini en personne.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, du 29 mars au 2 avril Photo © Chiara Ferrin

A la salle Gaveau, François-Frédéric Guy joue les trois Sonates pour piano de Brahms. Une heure et demie de furie romantique, un triple hommage iconoclaste au dernier Beethoven asséné par un génie de vingt ans, à propos duquel Schumann écrit : « Il transforme le piano en un orchestre aux voix tour à tour exultantes et gémissantes. Ce furent des sonates, ou plutôt des symphonies déguisées ». Significativement, le pianiste commence par la 2ème, terminée avant la 1ère, mais surtout celle où le jeune Brahms affirme sa singularité, impose un foisonnement aussi exaltant qu’épuisant pour l’auditeur comme pour l’interprète. Pour quel autre Himalaya François-Frédéric Guy quitterait-il les sommets beethovéniens qu’il fréquente avec succès, et dont celui-ci est l’héritier ? Symphonique, son interprétation l’est, au point que l’on plaint le piano (un Steinway enclin à ferrailler dans les nombreux passages paroxystiques) et que l’on souhaiterait – une fois n’est pas coutume – que la salle soit plus grande, que le son puisse s’y déployer plus librement. Réfugié au 2ème balcon (public clairsemé), on souffle à la 3ème Sonate, la plus contrastée, où le compositeur se permet de rêver, et où l’interprète lâche la bride le temps d’un Andante espressivo d’anthologie, avant de passer en bis « du très jeune au très vieux Brahms » avec un 1er Intermezzo de l’opus 119 suspendu comme il le faut pour mieux en exalter les subtiles dissonances. L’enregistrement des Sonates (label Evidence), réalisé à l’Arsenal de Metz sur un piano Yamaha, paraît le 15 avril.
François Lafon
Salle Gaveau, Paris, 30 mars Photo © DR

En l’espace de trois jours passés à Lyon, à l’occasion de sa Biennale autour du thème du « divertissement », il s’agissait d’apprécier mercredi 16, à la fois des reprises (Répertoire et Dressur de Kagel et Kits de Philippe Hurel), dans l’ébouriffante mise en scène d’un « Lever de rideau » et par d’exceptionnels percussionnistes (et comédiens !) du CNSMD de Lyon, suivies de non moins passionnants « Sports & Divertissements » provoqués par Les Percussions Claviers de Lyon, autour d’adaptations de pièces de Satie, mais aussi la création de haletants Temps Modernes de Moritz Eggert. Le lendemain, au Musée des Confluences, dopage électro-visuel avec Test Pattern, installation du toujours fascinant Ryoji Ikeda, à mettre en parallèle avec le gracile « Buisson de smartphones » et ses rires en cascade, autre installation, interactive celle-ci, du tandem Borrel-Lebreton. En soirée, L’ensemble Celadon (1 contre-ténor + 5 violes) mariait Renaissance anglaise et création. No Time in Eternity, commande passée à Michael Nyman par le chanteur Paul Bündgen, montrait que la viole de gambe, noble instrument du passé, pouvait être habitée d’une frénésie rock. La soirée du vendredi 18 aura été l’occasion d’assister à l’un des spectacles les plus réussis grâce au jeune Danois Simon Steen-Andersen. Tiens, « Andersen » ? À croiser théâtre, musique, vidéo et technologie, un conte d’un nouveau genre surgit, où la nuit (soirée Night – Staged Night) redevient cet espace évocateur cher aux romantiques. Un fantastique certes revisité à la suite de David Lynch, Boltanski et même Kraftwerk où, plongé dans l’univers de Bach (cantate « Ich habe genug »), Mozart (Flûte enchantée) et Ravel (Gaspard de la nuit), l’ensemble Ascolta en transforme insidieusement le contenu pour déboucher sur le grand guignol et l’absurde. Les mains du pianiste s’envolent chez Ravel tandis qu’apparaît son fantôme. L’air de la Reine de la Nuit, version caoutchouc, rebondit sur un podium de boîte de nuit miteuse, et Bach perd les pédales, se liquéfiant tout doucement au son d’un trombone qui aurait goûté à la « trempette » fatale de Roger Rabbit. Drôle, magique et futé - c’est à coup sûr l’une des voies de la création d’aujourd’hui. Merci la Biennale !
Franck Mallet
Lyon, Biennale Musiques en Scène 2016, 1er au 26 mars. Photos : Staged Night © DR

Dans le cadre du "Festival Pour l’humanité" (ou Contre la barbarie) à l’Opéra de Lyon, création de Benjamin, dernière nuit, musique de Michel Tabachnik sur un livret de Régis Debray. Pas tout à fait un livret, d’ailleurs, puisque celui-ci avait d’abord imaginé un spectacle de théâtre-cabaret alla Brecht et Weill pour raconter les ultimes réminiscences de Walter Benjamin, intellectuel inclassable, médiologue avant que Debray n’invente le terme, conscience d’un monde devenu fou, retrouvé mort le 26 septembre 1940 dans une chambre d’hôtel de Port-Bou, à la frontière franco-espagnole. En une heure et demie, Benjamin et son double (un ténor pour le rêve, un acteur pour la réalité), convoquent sous forme de dialogues rapides aux résonances actuelles (spiritualité, déracinement) ses vrais et faux amis, panthéon de l’intelligentsia de l’époque : Arthur Koestler et Bertolt Brecht, Hannah Arendt (sa biographe) et Gershom Sholem (théoricien du sionisme), André Gide et Max Horkheimer (co-fondateur de la Kritische Theorie). Avec un tel scénario, Tabachnik n’a eu qu’à « coller la musique sur le texte », selon ses propres termes. Pas d’intervention électroniques, mais des citations variées, chansons populaires, chants religieux, musiques militaires, imbriqués dans un langage « atonal incluant la tonalité » que n’aurait pas renié son maître Pierre Boulez. Tuilage supplémentaire : la mise en scène de John Fulljames accumule miroirs et projections, ballets et cavalcades, sollicitant l’oeil alors que l’oreille est déjà très occupée. Du coup, ce portrait-gigogne s’alourdit, oubliant – comme souvent le répertoire contemporain – que l’opéra est paradoxalement un art de l’épure. De Bernhard Kontarsky dirigeant un plateau sans faille, Tabachnik, chef lui-même, dit : « Je lui fais une absolue confiance ». Il a raison.
François Lafon
Opéra de Lyon, jusqu’au 26 mars. Festival Pour l’humanité (Benjamin, La Juive, Brundibar, L’Empereur d’Atlantis), jusqu’au 3 avril Photo © Stofleth/Opéra de Lyon

Musical annuel (le cinquième) de Stephen Sondheim au Châtelet : Passion. Un des moins connus et pour cause. Inspiré du roman Fosca d’Iginio Ugo Tarchetti (un classique en Italie) via Passione d’amore, le film qu’en a tiré Ettore Scola en 1981, c’est un sujet risqué pour Broadway : trois personnages et quelques comparses, pas de ballets, une dramaturgie complexe (transposition à la fois onirique et distanciée de la forme épistolaire du roman) et une histoire tragique, celle d’un beau soldat qui trahit jusqu’à la folie sa non moins belle maîtresse avec une femme laide et perturbée. Un rôle en or pour Natalie Dessay (« Une hystérique dans un Sondheim, j’ai dit oui tout de suite »), utilisant – sono aidant – les graves que sa voix d’opéra lui refusait, un pari qui ne pouvait que tenter Fanny Ardant (laquelle parle, elle, de « saut dans le vide ». Sans jeu de mot ?) pour sa deuxième mise en scène in loco, après la plus souriante Véronique de Messager : un univers nocturne, un paysage mental ponctué par les toiles en noir et blanc du plasticien Guillaume Durrieu et parcourue par les superbes costumes (quelles crinolines !) de Milena Canoreno. Musicalement, du pur Sondheim : harmonies aussi complexes qu’inattendues (habiles orchestrations de Jonathan Tunick pour un gorgeous Philharmonique de Radio France), pas de solution de continuité entre le parlé et le chanté, mais aussi le soin de ne pas désarçonner le public, de lui faire entendre « Une longue chanson rhapsodique ». Un peu frustrant en l’occurrence, même de la part d’un compositeur qui déclare : « Pendant toute mon existence, j’aurai résisté aux séductions de l’opéra ».
François Lafon
Châtelet, Paris, jusqu’au 24 mars. Sur France Musique le 23 à 19h Photo © Théâtre du Châtelet/Marie-Noëlle Robert

Au Palais Garnier, Iolanta/Casse-noisette de Tchaikovski, mis en scène par Dmitri Tcherniakov secondé par les chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui, Edouard Lock et Arthur Pita. Un pari historiquement informé puisque l’opéra – longtemps oublié – et le ballet – un classique – ont été créés ensemble, au Mariinski de Saint Pétersbourg en 1892. Un doublé marathon (3 h 30 plus deux entractes) riche en prolongements, Iolanta, fille du roi René de Provence, passant de la cécité à l’illumination (de l’amour) pour découvrir le plus visuel des arts scéniques. Expert en drames familiaux depuis son superbe Eugène Onéguine au Palais Garnier en 2008, Tcherniakov confine l’opéra dans le salon en format 4/3 où la jeune Marie fête son anniversaire pour raconter en cinémascope son amour rêvé et son retour au point de départ après l’apocalypse qu’on appelle la vie. Difficultés de l’entreprise : réconcilier le temps de l’opéra et celui de la danse, raconter la même histoire en deux langues différentes, élargir le champ sans être redondant. Gageure tenue, si ce n’est qu’après l’opéra débarrassé de ses parures historico-fantastiques, le ballet paraît plus patchwork encore : sublimes pas de deux sur terre brûlée signés Cherkaoui, étonnant jeu de peluches géantes mais aussi tics répétés façon Lock, fête-cauchemar un peu appuyée selon Pita. Musicalement, le bonheur : jeu de correspondances inattendues – et opportunément relevées par l’excellent chef Alain Altinoglu – entre le romantisme opulent de Iolanta et les clins d’œil de Casse-noisette, parfait duo en miroir de la soprano Sonya Yoncheva (pourtant annoncée souffrante) et de la ballerine Marion Barbeau, entourées d’une double troupe – chanteurs et danseurs – sans faiblesse, si ce n’est un ténor honorable musicien mais aux prises avec la tessiture périlleuse de son personnage.
François Lafon
Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 1er avril. En direct le 17 mars dans les cinémas UGC. Sur Culturebox à partir du 18 mars Photo © DR

Débuts à l’Opéra Bastille des Maîtres chanteurs de Nuremberg, la dernière représentation maison datant de 1989 au Palais Garnier, dans une mise en scène très politique d’Herbert Wernicke. Celle-ci, due à Stefan Herheim et venue de Salzbourg, n’exploite pas le filon « Saint Art allemand, opéra favori des nazis, etc. », ou plutôt l’exploite à rebours, montrant Wagner en pleine crise existentielle, rêvant d’une fête de la Saint-Jean shakespearienne façon Songe d’une nuit d’été et peuplant son intérieur Biedermeier de héros minuscules destinés à devenir très grands. Deux scènes clés : le charivari nocturne du 2ème acte, où Beckmesser se retrouve cerné par les sept Nains, le Chat botté et le Grand Méchant Loup, et l’apothéose finale, où Wagner/Hans Sachs dévoile son propre buste à côté de celui de Beethoven et salue en chemise et bonnet de nuit, fou génial offrant au monde la Musique de l’Avenir. La captation du spectacle à Salzbourg (voir ici) soulignait son aspect Magicien d’Oz et le parti pris caricatural de la direction d’acteurs. En grand large sur la scène de Bastille, avec une distribution renouvelée, c’est « l’effet clip-clap des images, où la magie côtoie l’onirisme » (dixit le programme) qui prévaut. Plateau vocal sans faute, avec en vedette le duo Gerald Finley/Sachs – Bo Skovhus/Beckmesser (Dr. Wagner-Jekyll et Mr. Wagner-Hyde), et surtout direction « musique de chambre » de Philippe Jordan (« Pourquoi les orchestres s’entêtent-ils à jouer fortissimo le do majeur de l’ouverture, quand Wagner l’annote seulement d’un forte ? ») accentuant le côté pré-straussien de cette « conversation en musique » pas si martiale que cela.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, jusqu’au 28 mars. En différé sur France Musique le 30 avril
Photo © Opéra National de Paris

Né en 1958, Magnus Lindberg est un compositeur finlandais de renommée internationale et à la discographie abondante. Il considère l’orchestre comme « un instrument ingénieux. On peut aller dans différentes directions en enlevant ou en ajoutant quelque chose, mais on n’a pas besoin de le remanier radicalement. » La virtuosité et l’écriture pour soliste étant une des marques de son style orchestral, il est naturel qu’il ait écrit plusieurs concertos, tous destinés à un soliste précis de ses connaissances : un pour piano, un pour violoncelle, un pour clarinette et deux pour violon (2006 et 2015), sans oublier un concerto pour orchestre. Le premier pour violon fait appel à un orchestre mozartien de 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors et cordes, mais « c’est son seul lien avec Mozart ». Le second, créé à Londres le 9 décembre 2015, vient d’être donné à Paris par son destinataire Frank Peter Zimmermann et le Philharmonique de Radio France, avec à sa tête Alan Gilbert. Le violon, précise le compositeur, « perce » plus aisément que le violoncelle, et l’on a ici un orchestre avec « pas mal de chair autour des accords », non sans une « fluidité » sonore permettant de constants échanges entre soliste et orchestre. Lindberg se déclare moins « effrayé » par l’instrument qu’en 2006, avec comme résultat une partie de violon « brillante mais jouable », moins de « traits violonistiques » et davantage d’insistance sur l’harmonie et les questions de hauteur. Beau succès pour l’œuvre et pour Frank Peter Zimmermann, ainsi que pour les pages de Schumann dirigées avec brio avant et après le concerto, l’ouverture de Manfred et la Symphonie n°1 « du Printemps ».
Marc Vignal
Philharmonie de Paris, 19 février Photo © DR

Quatorzième et dernier concert d’Oggi Italia, vingt-sixième édition du festival Présences de Radio France : six Madrigaux de Carlo Gesualdo et Professor Bad Trip – Lesson 1, Lesson II, Lesson III – de Fausto Romitelli. Studio 104 (ex-auditorium Olivier Messiaen) presque plein, remerciements des organisateurs - à commencer par Jean-Pierre Derrien, voix de la contemporaine sur France Musique et mis à la retraite sur ce dernier coup d’éclat. Sur scène : Maxime Pascal et Le Balcon, ensemble instrumental flirtant avec l’informatique musicale en résidence au théâtre de l’Athénée (réouverture à la rentrée prochaine), aussi à l’aise avec Richard Strauss (voir ici) qu’avec Peter Eötvös (voir ici). C’est dire que leur Gesualdo est plus prospectivement qu’historiquement informé, donné comme l’initiateur d’un chromatisme fiévreux qui inspirera Stravinsky et bien d’autres. On aurait rêvé d’entendre ses madrigaux, sensiblement chantés par Léa Trommenschlager, en alternance avec les trois Lessons de ce Professeur Bad Trip (1998-2000), clone d’Henri Michaux écrivant sous mescaline, déroulant presque trois quarts d’heure durant un voyage de flash et de cauchemar. A moins que ces deux univers, une fois mêlés, ne se soient au fond repoussés au lieu de s’éclairer l’un l’autre. Une invitation quand même à retrouver Romitelli, pionnier de l’Ircam prématurément disparu.
François Lafon
Maison de Radio France, Studio 104, Paris, le 14 février Photo : Léa Trommenschlager © Isabelle Retall

Au Châtelet, suite (et pas fin : Passion de Stephen Sondheim est annoncé pour mars) du Broadway dream maison avec Kiss me, Kate de Cole Porter, guère connu par les amateurs français du genre que par le film de George Sidney (1953). Du théâtre dans le théâtre, et pas n’importe lequel, le titre n’étant autre que la dernière réplique de La Mégère apprivoisée de Shakespeare. Le couple vedette, divorcé depuis un an, retrouvera l’amour, tels les héros Petruchio et Katharine, lors du happy end obligé. Même équipe que les Sondheim (Sweeney Todd, Into the Woods) - le Britannique Lee Blakeley à la mise en scène, l’Américain David Charles Abell au pupitre – le premier toujours inventif mais assez conventionnel pour donner l’illusion d’une lecture de première main aux Parisiens découvrant enfin ce répertoire en vrai, le second dirigeant une version reconstituée d’après les sources, richement orchestrée (comme jamais à Broadway) pour l’Orchestre de Chambre de Paris. Salle presque pleine (titre pas assez porteur, manque de têtes d’affiche ?), public bon enfant sensible à l’énergie apparemment inépuisable dispensée par la troupe, avec en tête deux voix d’opéra : David Pittsinger et l’excellente Christine Buffle (le double rôle de la Mégère avait, en vue de la création en 1948, été refusé par les divas Lily Pons, Jeannette Mac Donald et Jarmila Novotna). Inutile donc de plaider davantage en faveur de ce genre mineur mais servi en majeur, sinon pour anticiper la frustration que ne manquera pas d’entraîner le tournant moins élitiste (???) voulu pour le Châtelet par la Mairie de Paris, lors de sa réouverture après travaux et avec une nouvelle équipe directoriale.
François Lafon
Châtelet, Paris, jusqu’au 12 février Photo © Théâtre du Chätelet/Marie-Noëlle Robert

Ovation pour le nouveau Trouvère (Verdi) à l’Opéra Bastille. Ou plutôt pour les voix du Trouvère, la mise en scène venue d’Amsterdam, signée des pourtant talentueux Alex Ollé et Valentina Carrasco (du collectif La Fura Dels Baus) étant inexistante, et la direction de l’habituellement professionnel Daniele Callegari, brouillonne et agitée. Quatre voix donc (cinq si l’on compte l’excellente jeune basse Roberto Tagliavini en Ferrando) suffisantes pour animer ce curieux chef-d’œuvre, affligé d’un livret impossible mais qui a inspiré à Verdi un théâtre sonore inégalé. Oubliés la transposition de l’histoire pendant la Grande Guerre (on a au moins échappé à la Guerre d’Espagne, eu égard aux origines ibériques du livret) et l’absence de direction d’acteurs, oublié le fait qu’abandonnés sur ce plateau géant, Anna Netrebko, Ekaterina Semenchuk, Marcelo Alvarez et Ludovic Tézier sacrifient le sens au son, le théâtre à… A quoi au juste ? A une ivresse quasi abstraite, la palme étant remportée à l’applaudimètre par Tézier au timbre plus violoncelle que jamais, suivi de près par la star Netrebko, royale dans le "Miserere" après une première mi-temps où elle cherchait la justesse et courait après une assise rythmique refusée par le chef. « Au moins ça chante », entend-on à l’entracte. Et qu’on le veuille ou non, c’est ça aussi l’opéra.
François Lafon
Opéra National de Paris – Bastille jusqu’au 15 mars (Double distribution à partir de mi-février). En direct au cinéma et sur Radio Classique le 11 février et sur Mezzo le 18 février. Photo © Mwangi Hutter/Adagio - Opéra de Paris

Aux Bouffes du Nord : Fugue, de La Vie brève, mise en scène de Samuel Achache. La troupe (rien à voir avec l’opéra homonyme de Manuel de Falla) s’était déjà illustré en 2013 sur la même scène avec Crocodile trompeur/Didon et Enée (voir ici), happening lyrique savamment incontrôlé. Cette fois, Purcell est encore mis à contribution, mais aussi Couperin et Bach, ainsi que le contemporain Florent Hubert, pour une fugue prise au pied de la lettre, c’est à dire une fuite en avant musicale d’un rapport mathématique parfait, produisant pourtant une infime inharmonie « amenant à repenser la norme de la justesse ». D’où une abracadabrantesque histoire de mission scientifique dans les glaces du pôle Sud (le spectacle a été créé au festival d’Avignon par 30° à l’ombre) très librement inspiré d’un documentaire du cinéaste Werner Herzog, où l’on joue et philosophe, où « l’on chante quand les mots manquent ou qu’ils ne suffisent pas », où les objets ont une âme, à commencer par cette baignoire remplie donnant - si l’on peut dire - la réplique à un contre-ténor emmailloté de sparadrap informatique. Et si l’on est moins bluffé par cette Fugue que par Crocodile trompeur, c’est parce que l’effet de surprise est passé, mais peut-être aussi parce que les auteurs-acteurs y jouent davantage sur la réflexion que sur l’énergie pure.
François Lafon
Aux Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 24 janvier. En tournée du 29 janvier au 16 mars (Romans, Lyon, Châlons-sur-Saône, Toulouse, Cherbourg, Vanves, Valence) Photo © Jean-Louis Fernandez

A l’Opéra Bastille, troisième nouveau spectacle de la saison : La Damnation de Faust de Berlioz. Sold out depuis des mois : ouvrage populaire (après Schoenberg et Bartok - voir ici et ici), cast introuvable (Jonas Kaufmann, Bryn Terfel, Sophie Koch). Bronca à la fin pourtant, et même en cours de représentation : en assimilant le voyage infernal de Faust à l’émigration sur Mars, seul issue pour l’humanité selon le savant Stephen Hawking (auteur du best seller Une brève histoire du temps), le metteur en scène Alvis Hermanis, connu entre autres pour d’impressionnants Soldaten (Zimmermann) à Salzbourg (DVD EuroArts), ne remporte pas la mise : vidéos redondantes (entre 2001 l’Odyssée de l’espace et Yann Arthus-Bertrand), chorégraphie ridicule et envahissante (en hommage diabolique à Maurice Béjart, dont La Damnation au Palais Garnier est resté mythique ?), le tout en porte à faux perpétuel avec l’ouvrage, grand rêve romantique où le théâtre est davantage dans l’orchestre que dans l’action. Décalage moins explicable dans la direction de Philippe Jordan, assez lente et lourde, juxtaposant les épisodes sans trouver le rythme ni le ton. Restent les chanteurs, errant au milieu des choristes (excellents) transformés en laborantins de l’espace, mais faisant assaut d’aisance et de raffinement (Ah, l’ "Invocation à la Nature" par Kauffmann, la Sérénade de Méphisto par Terfel !), et même de courage lorsque Sophie Koch parvient à sublimer « D’amour l’ardente flamme » sur fond d’escargots de Bourgogne copulant en plan rapproché.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille jusqu’au 29 décembre. En direct le 17 décembre dans les salles UGC, en différé sur Mezzo et Mezzo Live HD le 24 décembre, et ultérieurement sur France 3. Disponible sur Culture Box à partir du 18 décembre. Photo © Felipe Sanguinetti / Opéra de Paris

L’Orchestre Pulcinella, ensemble à géométrie variable (du trio à l’orchestre de chambre), vient de fêter son dixième anniversaire par une manifestation très bigarrée faisant appel à diverses disciplines artistiques. Part du lion réservée à la musique, mais avec en prime lectures de texte et danse, tout cela ou presque sous le signe de Venise, de la Folie et de l’Espagne. Le choix de deux symphonies pour cordes de cet esprit fantasque qu’était Carl Philipp Emanuel Bach, un des compositeurs de chevet de Pulcinella, s’imposait, l’une en début et l’autre en fin de programme. La Folia, à l’origine danse populaire portugaise du XVIème siècle, passa ensuite en Espagne, et un spécimen s’en répandit à travers l’Europe sous le nom de Folie d’Espagne, traité en variations jusqu’au XXème siècle par de nombreux compositeurs dont Vivaldi : un des grands succès de la soirée, mais précédé de la lecture d’un texte assez délirant sur le Prêtre Roux et ses rapports avec Venise. Impossible pour la violoncelliste Ophélie Gaillard, directrice artistique de Pulcinella, d’oublier Boccherini, Italien fixé en Espagne : d’où les deux derniers mouvements de son concerto en sol G.480, avec pour le finale une cadence improvisée dotée d’une fugitive citation mozartienne. Seconde partie largement consacrée à Haendel : pages vocales et instrumentales du meilleur aloi, suivies d’une improvisation pour violoncelle (Bach) et danseur, et d’une seconde lecture quant à elle tout à fait en situation : d’un texte de Casanova, autre éminent Vénitien. Au total, une quinzaine de morceaux se succédant sans heurts, tout naturellement, comme autant de lettres à la poste. Mais en vertu de quoi faire croire que la symphonie en mi mineur Wq.178 de l’Allemand du nord Carl Philipp Emanuel Bach, une de ses plus connues, est dite « du Fandango » ?
Marc Vignal
Salle Gaveau, 27 novembre Photo © DR

A l’Amphithéâtre de la Cité de la musique : révélation des lauréats HSBC (Hong Kong & Shanghai Banking Corporation) de l’Académie du festival d’Aix-en-Provence 2015, en ouverture de la saison 2 de résidence du festival à la Philharmonie de Paris. Soirée institutionnelle (HSBC soutient l’Académie) mais aussi - et surtout - musicale : une fois le palmarès proclamé par Bernard Foccroulle, directeur du festival, la mezzo franco-britannique Anna Stéphany (lauréate 2006) et le pianiste Alphonse Cemin (lauréat 2010) dédient leur récital « Aux Demoiselles », via Haydn, Ravel, Wolf et de Falla. Un duo représentatif du paysage lyrique actuel, réunissant une chanteuse tout-terrain à la carrière déjà assurée et un accompagnateur atypique, passé par l’Atelier d’art lyrique de l’Opéra de Paris et co-fondateur avec Maxime Pascal de l’excellent ensemble Le Balcon. Points forts : de beaux Wolf plaçant les deux artistes à égalité, et une superbe Meditation on Haydn’s name pour piano solo de George Benjamin – compositeur culte à Aix depuis son opéra Written on skin -, pendant du non moins magique Menuet sur le nom de Haydn de Ravel. Vedette soufflée cependant par la lauréate 2015 Beate Mordal présentée par Focroulle en prélude au concert, sorte de Björk classique soulevant la salle dans deux Cabaret songs de Benjamin Britten.
François Lafon
Palmarès Aix-HSBC 2015 : http://www.festival-aix.com/en/node/4866 - Résidence Aix à la Philharmonie de Paris : philharmoniedeparis.fr Photo Beate Mordal © DR

Au Palais Garnier, Le Château de Barbe-Bleue (Bela Bartok – Bela Balazs) et La Voix humaine (Francis Poulenc – Jean Cocteau), diptyque inattendu et pourtant évident selon Krysztof Warlikowski. Propositions inversées, propre à inspirer le metteur en scène : rejoindre l’humain par le mythe chez Bartok, atteindre le mythe par l’humain chez Poulenc. Deux pièces faussement intimistes : un homme et une femme pour le premier, une femme et un homme (au bout du fil) pour le second, mais deux orchestres grand format, véritables narrateurs. Clés de lecture du spectacle : « Dehors – dedans ? » (Prologue parlé de Barbe-Bleue), « une chambre de meurtre » (description par Cocteau du décor de La Voix humaine). Tandis que la dernière femme de Barbe-Bleue accepte la nuit éternelle, la Parisienne abandonnée investit l’espace warlikowskien, murs mouvants et rideaux argents, films mentaux avec comme leitmotiv Jean Marais en Bête (oùest la Belle?) dans le film de … Cocteau. Comme irréductible à toute élucidation, l’opéra de Bartok devient le sésame de celui de Poulenc. Plus de téléphone mais un révolver : à qui parle « Elle » ? A cet homme blessé qui vient mourir à ses pieds tandis qu’elle se suicide ? Relecture extrême, de celles qui affleurent parfois mais que seul un metteur en scène de cette envergure peut mener aussi loin. Sous la baguette non moins magistrale d’Esa-Pekka Salonen, Bartok et Poulenc avouent une égalité d’inspiration qui en dérangera plus d’un. Beau couple Barbe-Bleue – Judith (John Relyea – Ekaterina Gubanova), éclipsé pourtant par Barbara Hannigan, fascinante en monologueuse poulencienne.
François Lafon
Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 12 décembre. En direct sur Mezzo et Mezzo Live HD le 10 décembre (filmé par Stéphane Medge). En différé sur France Musique le 19 décembre. Photo Barbara Hannigan © Bernd Uhlig

Créé à Paris en 1783, le Concert de la Loge Olympique commande peu après à Haydn ses six Symphonies parisiennes n°82-87, composées en 1785-1786 et immédiatement publiées à Vienne, Paris et Londres. Le Concert de la Loge olympique les joue dans la saison 1786-1787. En 2015, le violoniste Julien Chauvin fonde un orchestre qu’il baptise Concert de la Loge Olympique et dont il prend la direction musicale, destiné à jouer notamment le répertoire entendu à Paris à la fin du XVIIIème siècle, avant la Révolution. Cet orchestre vient de se produire dans un programme de ce type, mêlant pièces instrumentales et vocales (chantées par Sandrine Piau), à la manière de ce qu’on faisait souvent du temps de Haydn et Mozart. De la symphonie de Haydn n°85 (La Reine de France), les deux premiers mouvements ouvraient la première partie du concert, les deux derniers la seconde. Il n’est pas sûr qu’on ait procédé de la sorte à Paris dans les années 1780, mais peu importe. Du concerto pour violon opus 5 n°3 du chevalier de Saint-George (c’est lui qui transmit la commande à Haydn), on n’entendit que l’Andante central, et des trois mouvements de la symphonie opus 12 n°4 de Henri-Joseph Rigel (1741-1899), que les deux extrêmes, séparés par un air de Didone abbandonata de Giuseppe Sarti. On aurait effectivement pu chanter cet air à Paris à la fin de l’Ancien Régime. C’est vrai aussi de celui en provenance de L’Endimione de Johann Christian Bach (doté d’un extraordinaire partie de flûte concertante), comme à la rigueur de ceux tirés de deux opéras de jeunesse de Mozart (Il Re Pastore et Mitridate). Beau succès pour l’orchestre et pour Sandrine Piau, en particulier dans l’air de Pamina « Ach ich fühl’s » de La Flûte enchantée. Il faut cependant dire que dans un tel programme, cet air agissait comme un intrus, par son style et son usage de la langue allemande.
Marc Vignal
Salle Gaveau, 9 novembre Photo © DR

La Sixième Symphonie de Mahler est la seule qui se termine « mal », sur une défaite psychologique. C’est aussi la seule qui, par sa structure, suit de près les « modèles classiques » : quatre mouvements, alors que les autres symphonies en ont souvent davantage (ou moins en ce qui concerne la Huitième), mouvements extrêmes, par-delà leurs dimensions (le finale dure à lui seul une demi-heure) et leur violence, en stricte forme sonate, même tonalité (la mineur) au début et à la fin, alors que dans beaucoup d’autres, conclure sur une tonalité majeure autre que celle (mineure) du début est perçu comme une rédemption. Tous ces traits sont liés, comme si les références à la tradition ne pouvaient déboucher que sur un désastre. Cela dit, la Sixième est une des plus grandes symphonies de Mahler. Il y a dans le finale les fameux coups de marteau qu’Alma, l’épouse du compositeur, évoque en ces termes : « Le héros qui reçoit trois coups du destin dont le dernier l’abat comme un arbre. Ce sont les propres paroles de Mahler. La Sixième, son œuvre la plus personnelle, est aussi la plus prophétique. Lui aussi a reçu trois coups du destin, et le dernier l’a abattu. » La Sixième doit procéder de façon inexorable, ce que sait bien Myung-Whun Chung, qui vient de la diriger à la tête de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Il a choisi pour l’ordre des deux mouvements centraux le plus convaincant dramatiquement (le Scherzo avant l’Andante) et a surpris en faisant frapper trois (pas seulement deux) coups de marteau, le dernier lors de la catastrophe finale. Beau succès pour un ouvrage qui après bien des vicissitudes n‘est depuis longtemps plus une rareté au concert.
Marc Vignal
Auditorium de Radio France, 6 novembre Photo © DR

A la Philharmonie de Paris, second des "premiers concerts de l’orgue symphonique", construit par l’entreprise Rieger (Autriche) et harmonisé par son facteur (français) Michel Garnier. L’inauguration officielle aura lieu les 6 et 7 février prochains, quand les 6055 tuyaux et les 91 jeux seront prêts. Pour cette avant-première (2/3 des jeux utilisables), Thierry Escaich improvise, arcbouté tel le capitaine Nemo sur le clavier de la console de pilotage (blanche, esthétique années 1970), tandis que s’efface le mur du fond et qu’apparaît à contre-jour la formidable machinerie. Un impressionnant jonglage avec les non moins impressionnantes possibilités de l’instrument, mettant Saint-Saëns (thème du Cygne) à l’honneur, comme une introduction au reste du programme : Concerto en la mineur pour violoncelle et orchestre et Symphonie n° 3 « avec orgue ». Standing ovation pour Paavo Järvi et l’Orchestre de Paris toute harmonie dehors, funambules virtuoses entre le grandiose et le pompier qui caractérise la Symphonie. Beau moment aussi pour la violoncelliste Sol Gabetta dans … l’Elégie de Fauré (en bis), le Concerto de Saint-Saëns trouvant la fougueuse Argentine de Paris à court de son et de vélocité. Le premier « premier concert », hier, proposait en création mondiale le Concerto pour alto du compositeur allemand Jörg Widmann, avec Antoine Tamestit en soliste. Crainte de ne pas remplir deux salles avec une pièce contemporaine, galop d’essai pour Sol Gabetta et l’Orchestre avant tournée (Budapest, Vienna, Berlin, etc) ? Ironie (ou négligence) du calendrier : à l’Auditorium de Radio France, ce même soir, Edgar Moreau et l’Orchestre National jouaient … le Concerto de Saint-Saëns.
François Lafon
Philharmonie de Paris, grande salle, 28 et 29 octobre

Nouvelle ère - celle de Stéphane Lissner - à l’Opéra Bastille : Moïse et Aaron de Schönberg dirigé par Philippe Jordan et mis en scène par Romeo Castellucci, remplaçant Patrice Chéreau initialement prévu. Un chef-d’œuvre inachevé dont le sujet n’est autre que l’impossibilité de dire et de montrer. En 1995 au Châtelet (direction Lissner), le metteur en scène Herbert Wernicke avait enfermé le débat dans un piège de béton ouvert sur l’infini, tandis qu’au même moment, à Amsterdam, Peter Stein chorégraphiait superbement l’errance du peuple indéfiniment manipulé. Castellucci, maître en images qui disent sans dire, part des derniers mots de Moïse descendant du Sinaï : « O Verbe, Verbe qui me manques » et pose la question « Jusqu’à quel point pouvons-nous croire dans les images ? ». Blanc sur blanc pour montrer l’inmontrable au premier acte, goudron et eau lustrale au deuxième, quand Aaron concède aux Juifs le Veau d’or à adorer, en l’occurrence un (vrai) taureau de concours, blanc lui aussi et à son tour goudronné. Comme à son habitude (de La Divine Comédie à Avignon à Parsifal à Bruxelles – son premier opéra) il crée des rituels pour mieux les casser (le magnétophone enfermant le Verbe, le missile à produire des sortilèges) et suscite l’érotisme à force de le réfréner. C’est en fait à Jordan, occupé avec succès à prouver que cette musique est tout sauf cérébrale, que revient la tâche de jeter un pont entre ce monde et le nôtre. Chœurs superlatifs, orchestre somptueux (pas entendu plus beau depuis Boulez à Amsterdam – voir supra), Moïse (Thomas Johannes Mayer) maniant le sprechgesang comme sa langue natale, face à un Aaron dramatiquement convaincant mais vocalement sous-dimensionné. Applaudissements soutenus mais relativement timides, quarante-deux ans après la première de l’œuvre au Palais Garnier, en version française et sous la baguette de Georg Solti.
François Lafon
Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 9 novembre. Diffusion sur Arte le 23 octobre, et sur France Musique le 31 octobre Photo © Opéra de Paris

A des titres et à des degrés différents, aussi bien Mozart que Richard Strauss se sont produits à Leipzig, et pour Strauss, l’auteur d’Idomeneo était un dieu. En 1944, il dédia sa Sonatine pour vents n°2 « aux mânes du divin Mozart, au terme d’une vie pénétrée de gratitude ». En cette année 2015, l’Orchestre du Gewandhaus a conçu un cycle de concerts (dont trois à Paris) permettant d’entendre des concertos de Mozart entourés de poèmes symphoniques de Strauss. Il fallait oser, les sonorités n’étant pas les mêmes, surtout quand il s’agit, en ce qui concerne le Salzbourgeois, non d’un « grand » concerto pour piano mais du discret Concerto pour violon n°3. Pari tenu : interprétation de Christian Tetzlaff sans rien d’ostentatoire, très intérieure, en contraste total avec les côtés tonitruants de Strauss mais d’autant plus en situation. Exploit renouvelé dans le bis consacré à Bach : salle attentive, retenant son souffle. Auparavant Macbeth, ensuite Ainsi parla Zarathoustra, qui traite de la situation conflictuelle existant entre le surhomme nietzschéen et le monde. Là, quand il le faut, l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig et son chef Riccardo Chailly se déchainent sans retenue, servis par l’acoustique de la Grande salle de la Philharmonie : on entend tout, même en plein vacarme, les silences soudains dont (après un sommet d’intensité) ces ouvrages abondent restent habités de musique, sans aucune impression de sécheresse, et surtout, d’un bout à l’autre, le moindre détail, le moindre accent « parle » ». Une prestation vraiment de grande envergure.
Marc Vignal
Grande salle de la Philharmonie de Paris, 12 octobre Photo © DR
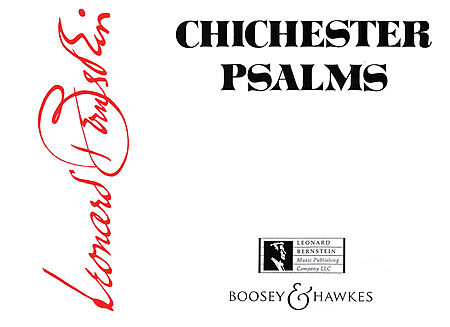
Chichester Psalms est une œuvre de Leonard Bernstein commandée en 1965 par le Southern Cathedrals Festival (Angleterre). Créée le 15 juillet de cette année-là à New York sous la direction du compositeur, elle est entendue le 31 dans la cathédrale de Chichester, dirigée par John Birch. Avec la symphonie Kaddish (1957), c’est l’ouvrage de Bernstein le plus ouvertement « juif ». Il y a trois mouvements suivis d’un finale s’enchainant directement au troisième. Le premier mouvement, joyeux, a la particularité d’être écrit en mesure déhanchée à 7/4, ce qui le rend difficile à exécuter, le deuxième, avec voix d’alto solo, n’est pas sans accents tragiques, mais tout se termine dans la lumière et la sérénité. Dans le cadre de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, Chichester Psalms a été interprété par la Maîtrise Notre-Dame de Paris et le Jeune chœur de Paris sous la direction d’Henri Chalet, dans sa version (authentique) pour orgue, harpe et percussion, des étudiants du Conservatoire régional de Paris assurant les parties vocales solistes. La harpe joue dans Chichester Psalms un rôle important, y compris dans la version pour orchestre (la harpe de David). En début de programme, six œuvres pour chœur (accompagné ou non) d’autant de compositeurs différents, tous sauf un (l’Américain Samuel Barber) bien vivants. Prestations de haut vol, dans les épisodes chantés aux limites du silence mais surtout dans ceux investissant de façon très impressionnante et toute naturelle le vaste espace sonore de Notre-Dame de Paris.
Marc Vignal
Cathédrale Notre-Dame de Paris, 6 octobre

Les Planètes (1918) est une suite pour grand orchestre en sept mouvements du compositeur britannique Gustav Holst (1874-1934). Chaque mouvement « décrit » une des sept planètes, de Mars (qui apporte la guerre) à Neptune (le Mystique) en passant par Mercure (le Messager ailé) ou encore Uranus (le Magicien). Oeuvre très populaire, ce dont le compositeur se plaignait en songeant au reste de sa production, que tous les chefs d’orchestre (dont évidemment Karajan) ont enregistrées, mais très rare au concert, du moins en France. L’Orchestre philharmonique de Radio France l’a inscrite à son programme, accompagnée de la projection d’un film de la Nasa : belles images de notre univers, mais tendant à réduire Les Planètes au rang de musique carrément descriptive. Or ce n’est pas toujours vrai, en particulier dans Saturne (qui apporte la vieillesse), douloureuse procession, le mouvement préféré de Holst. En tout cas, superbe interprétation (Mars d’une cruauté implacable), due non au directeur musical de l’orchestre Mikko Franck, empêché « pour des raisons personnelles », mais à son chef assistant, la Polonaise Marzena Diakun. Le sommet du concert était néanmoins Angels and Visitations (1978) du Finlandais Einojuhani Rautavaara (né en 1928). Page très contrastée, superbement orchestrée, inspirée de vers de Rilke, « née de la conviction qu’en dehors de notre conscience quotidienne, il y a des réalités autres [dont] relèvent des créatures que l’on peut appeler ’anges’ ». Pour en revenir à la musique britannique, à quand une symphonie de Vaughan Williams ?
Marc Vignal
Auditorium de Radio France, 2 octobre Photo © Magdeburski

Au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, Le Dibbouk ou entre deux mondes, mis en scène par Benjamin Lazar. Avec ce classique du théâtre yiddish, le champion de la philologie baroque fait en apparence de l’anti-Lazar. En apparence seulement, car s’il joue l’austérité (minimum de décors, d’accessoires, d’effets), il recherche là aussi le ton et le son d’origine. La pièce de Shalom An-ski s’y prête, baignant à la fois dans le fantastique et la spiritualité, une tradition juive où la moindre erreur dans l’énonciation des textes sacrés est susceptible de convoquer les hordes de l’Enfer. Cette fable « entre deux mondes » (des vivants et des morts mais aussi du théâtre et de la réalité), le français, le yiddish, le russe et l’hébreu lui donnent sa couleur. Mais - et là on retrouve pleinement Lazar – c’est la musique qui achève de structurer le spectacle. Une viole de gambe, un serpent (instruments Renaissance et baroque), un cymbalum, un chantre au timbre d’outre-monde et l’évocation comme l’invocation (le dibbouk est l’esprit d’un mort investissant un corps vivant) nous rapprochent du mystère. Musique déroutante d’Aurélien Dumont détournant les chants traditionnels pour mieux y retourner, acteurs virtuoses (Lazar lui-même, sa collaboratrice Louise Moati, formidable en possédée) : on sort à la fois glacé et enrichi, oubliant un prologue trop long, saturé de questions essentielles tirées d’un autre texte d’An-ski, Der Mensch (L’Homme).
François Lafon
Théâtre Gérard Philipe, Saint-Denis, salle Roger Blin, jusqu’au 17 octobre. Tournée en France jusqu’en mars 2016 Photo © Pascal Gély
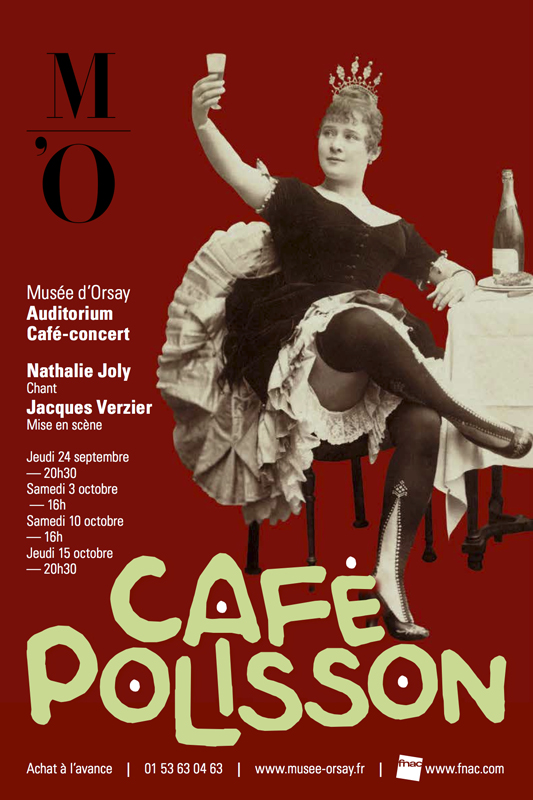
A l’Auditorium du Musée d’Orsay : Café polisson, de et avec Nathalie Joly, en marge de l’exposition Splendeurs et misères, images de la prostitution, 1850-1910. Mis en scène façon café-concert par Jacques Verzier, un florilège de chansons à double, triple ou très simple sens, telles que les aimait cette Belle Epoque d’autant plus portée sur la gaudriole qu’elle était collet-monté. L’exposition, riche de sens et prolixe en chefs-d’œuvre (Toulouse-Lautrec, Degas, mais aussi Courbet, Vlaminck, Munch ou Picasso, tous très inspirés par le sujet) mêle le luxe et le sordide, la prison de Saint-Lazare et les coulisses de l’Opéra, le lit king size de La Païva et les accessoires de maisons closes, les photos sous le manteau et les portraits des grandes courtisanes. Nathalie Joly, chanteuse et comédienne mais surtout « diseuse », va aussi loin, plus loin parfois, par la façon dont – excellemment soutenue par Jean-Pierre Gesbert (pianiste), Louise Jallut (bandonéon) et Bénédicte Chapriat (danse) - elle jongle avec la légèreté et le désespoir, sans se départir de cette élégance canaille qui, d’Yvette Guilbert à Colette Renard, perpétue toute une tradition. Pour l’instant programmé quatre fois seulement, le spectacle mérite une longue carrière. A compléter, dans la série Opéra filmé, par des captations rares de Manon, Carmen, La Traviata et La Périchole (cherchez le point commun) et, par des récitals… liés au sujet de Felicity Lott et Annick Massis.
François Lafon
Café polisson, 3, 10 et 15 octobre – Récitals Felicity Lott le 1er octobre et Annick Massis le 8 octobre - Opéra filmé, le dimanche à 15h, du 27 septembre au 18 octobre - Exposition Splendeurs et misères, images de la prostitution, 1850-1910, jusqu’au 20 janvier

Ouverture de la première saison de l’Orchestre Philharmonique de Radio-France pilotée par le Finlandais Mikko Franck (trente-six ans), successeur de Marek Janowski (seize saisons) et Myung-Whun Chung (quinze). Immense banderole « Bienvenue Mikko » sur la façade de la Maison ronde, conférence de presse où vient la question inévitable : « Les deux orchestres de Radio France ne font-ils pas double emploi ?» En guise de réponse, le chef évoque les programmes : compositeurs rares (Korngold, Rautavaara), compatriote illustre (et Finlandais) en résidence (Magnus Lindberg). Concert d’intronisation parlant lui aussi : pourquoi Shadows of time, grande machine à jouer de l’orchestre composée par Henri Dutilleux pour Seiji Ozawa et le Boston Symphony ? « C’est moi qui l’ai créé dans mon pays quand j’avais dix-neuf ans ». Pourquoi les Litanies à la Vierge Noire de Rocamadour de Francis Poulenc ? « Je tenais à mettre en valeur la Maîtrise de Radio France ». Pourquoi deux poèmes symphoniques de Richard Strauss en seconde partie ? « C’est un répertoire que j’aime bien. » De fait l’orchestre, que Chung a laissé dans un état superlatif, ne fait qu’une bouchée de ce puzzle musical. Grands gagnants : les Litanies de Poulenc (célestes voix féminines de la Maîtrise) et Till Eulenspiegel de Strauss, deux perles rares comparées à celle – de culture – de Dutilleux et au redondant Mort et Transfiguration (plaisir quand même d’entendre un thème que Stauss réemploiera … cinquante-neuf ans plus tard dans les Quatre derniers Lieder). Franck, qui dirige assis mais soulève l’orchestre, maîtrise l’acoustique à la fois flatteuse et sans pitié de l’Auditorium. Après le concert, rencontre avec le public : un petit air de nouveauté. Reste, en misant sur cette relative audace, à remplir durablement une salle ce soir pleine aux quatre-cinquièmes.
François Lafon
A écouter sur francemusique.fr, à voir sur concert.arte.tv

En 1653, après la Fronde et pour asseoir l’autorité de Louis XIV âgé de quinze ans, Mazarin organise un grand ballet de cour, le Ballet royal de la nuit : spectacle de treize heures, s’inscrivant dans une tradition née à la fin du XVIème siècle et mettant en scène, au fil de quarante-trois entrées dansées, la noblesse qu’il s’agit de dompter. Tous les arts sont mis à contribution : littérature (pour le livret), musique, danse, costumes et décors, et le jeune souverain à la fin s’avance, costumé en soleil. L’organiste et claveciniste Sébastien Daucé a tiré de cette œuvre d’art totale, pour La Chaise Dieu et d’autres manifestations, un programme de concert de deux heures ne retenant que la littérature et la musique mais conservant la structure de l’orignal, en quatre « veilles » : la Nuit (ou l’ordinaire de la Ville), Vénus (ou le règne des Plaisirs), Hercule amoureux (ou le jeune roi face au doux visage de l’amour), Orphée (ou l’Amour transfiguré). On apprécie les allusions à Louis et à son entourage dont déborde cet assemblage et surtout l’éventail des musiques instrumentales et vocales, empruntées ou non à l’entreprise de 1653, se prêtant à ce jeu : Michel Lambert, airs de Francesco Cavalli dont certains tirés de son Ercole amante, opéra commandé par Mazarin pour les noces du roi en 1660, Orfeo de Luigi Rossi, premier opéra représenté en France (1647), ou encore Antoine Boesset, sans oublier les anonymes. Impression parfois de pot-pourri, mais toujours compensée par la splendeur des morceaux, du madrigalisme et du coro d’opéra à l’italienne à la scène dramatique à la française, en passant par des danses infernales ou par le sabbat du ballet Junon, Le « Concert royal de la nuit » ? Sans doute l’événement marquant du festival 2015.
Marc Vignal
Abbatiale Saint-Robert, 25 août Photo © DR

Que le festival de La Chaise Dieu ait consacré une soirée entière au grand Henry Purcell (1659-1695) est dans l’ordre des choses. Organiste à Westminster de Londres dès 1679, Purcell devient en quelque sorte le musicien officiel de la monarchie anglaise et est reconnu par ses compatriotes comme le premier compositeur du pays. Après la chute de Jacques II en 1688, il compose la musique du couronnement de Mary II, fille de ce dernier, et de Guillaume III (d’Orange), son époux, avec notamment Praise the Lord, O Jerusalem. Cette page ouvrait le splendide concert du Chœur de chambre toulousain Les Eléments et du Concerto Soave dirigés par Joël Sububiette. Entendus également, plusieurs Anthems (hymnes), ouvrages destinés au culte soit à Westminster soit à la chapelle royale et s’inscrivant dans la glorieuse tradition élizabéthaine et jacobéenne (fin du XVIe siècle et début du XVIIe) tout en tenant compte parfois des acquis de l’école « moderne » italienne. Ne fut pas oublié (sous forme d’extraits instrumentaux) le semi-opéra The Fairy Queen, où triomphe le génie lyrique et dramatique de Purcell, un des premiers du XVIIe siècle. En 1692, Purcell compose pour les trente ans de la reine Mary l’ode Love’s Goddess Sure Was Blind, vaste et d’une invention inépuisable, et trois ans plus tard, pour ses funérailles (precédant de peu les siennes), réunit trois de ses plus beaux et plus célèbres Anthems, dont Man that is Born of a Woman. Moments mémorables, comme ceux vécus à l’écoute de l’extraordinaire hymne vespéral Now that the Sun hath Veiled his Light pour soprano et basse continue, chanté avec intensité et émotion par Maria Cristina Kiehr. Célébrer Purcell comme il faut n’est pas l’apanage des artistes britanniques.
Marc Vignal
Basilique Saint-Julien de Brioude, 27 août (à suivre)

En cette année 2015, le festival de La Chaise Dieu rend hommage à Bach, Haendel et Domenico Scarlatti, tous nés en 1685, il y a trois cent trente ans. La programmation est cependant telle qu’on peut aisément y passer quatre jours sans rencontrer ces trois importants compositeurs. Brahms, sauf erreur, n’est pas de ceux qu’on entend la plus souvent à La Chaise Dieu, mais son Requiem allemand y a évidemment toute sa place. Il ne s’agit pas d’une messe proprement dite, mais d’une musique funèbre sur des textes en langue allemande tirés de l’Ecriture, dans la tradition luthérienne. Soucieux d’universalité, Brahms prit soin de préciser qu’ « allemand » pouvait être remplacé par « humain ». Cet ouvrage de la fin des années 1860 est une spécialité de Raphaël Pichon. Il l’a dirigé à La Chaise Dieu à la tête de son chœur Pygmalion dans sa version avec deux pianos, faisant apparaître la mort non comme un objet de terreur mais dans sa dimension consolatrice. En début de programme, des motets de Brahms, Schütz et Mendelssohn eux aussi magnifiquement interprétés. Laurence Equilbey, le Chœur Accentus et l’Insula Orchestra ont commencé par le puissant Miserere en ut mineur de Jan Dismas Zelenka (1679-1745), compositeur tchèque longtemps actif à Dresde, à l’honneur à la Chaise Dieu il y a deux ans. Après les Vêpres d’un confesseur de Mozart s’est imposé le « grand » Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach, exécuté par ce dernier à Leipzig en 1749 comme acte de candidature à la succession de son père à Saint-Thomas, souhait qui ne devait pas se réaliser. Beau concert avec en prime un Alleluia de Buxtehude (1637-1707), étonnant par sa séduction mélodique et donc fredonné à la sortie par des auditeurs ravis.
Marc Vignal
(à suivre)
Abbatiale Saint-Robert, 24 et 26 août

Festival Berlioz, théâtre éphémère du château Louis XI : la Symphonie fantastique et sa suite Lélio ou le retour à la vie, par John Eliot Gardiner et l'Orchestre révolutionnaire et romantique. La croisée des routes (Napoléon - thème de l'année) et le coeur du sujet, à savoir l'invention d'une symphonie-théâtre dont Roméo et Juliette restera la figure de proue. Coup de canon (un vrai) , devant le château à l'entrée du chef, cloches fondues tout exprès lors du festival 2013 (voir ici), mais aussi dramaturgie visuelle et auditive exacerbée par les sonorités acérées des instruments d'époque. Ainsi placée dans un espace qui n'est qu'à elle - violons et altos jouant debout, harpes cernant le chef pour le Bal (2ème mouvement) - la Fantastique révèle tout ce quelle a d' inouï ( c'est à dire jamais entendu) et mène tout naturellement à ce Lélio qui brouille les codes et abat les règles, "mélologue" avec récitant, portrait - entre ironie sous-jacente et coeur sur la main - de l'Artiste amoureux , suite de séquences orchestrales à la logique shakespearienne coupées d'airs de ténor avec piano et ponctué ée de choeurs flamboyants. Musiciens en état de grâce, choristes (de formidables Ecossais de dix-sept à vingt-quatre ans) prêts à tous les jeux, solistes sur le fil (Michael Spyres, Laurent Naouri), héros justement distancié (Denis Podalydès) : ovation debout pour un concert d'anthologie. L'après-midi à l'église de La Côte-Saint-André : routes moins directement Napoléon de la Pologne, avec déclinaison de la Polonaise (Chopin, Wieniawski, Lipinski) par le pianiste Denis Pascal et ses fils Alexandre (violon) et Aurélien (violoncelle), chambristes déjà aguerris.
François Lafon

Cette année au festival Berlioz de la Côte-Saint-André : "Sur les routes Napoléon". Pluriel signifiant : deux siècles exactement après le retour de l'île d'Elbe, c'est sur nombre de chemins que se croisent le musicen et le meneur d'hommes, tous deux victimes du destin, tous deux loosers gagnants au regard de l'Histoire. Onze jours de festivités, cinquante manifestations, mille musiciens mobilisés. Etapes musicales le long de la route Napoléon, avec bivouac, défilé en costumes et banquet impérial, Te Deum (de Berlioz) monstre au théâtre antique de Vienne : l'ouverture est la hauteur de l'ambition du directeur Bruno Messina, artisan de l'impressionnante montée en puissance d'une manifestation qui s'est longtemps cherchée. Pour preuve le concert Rois et reines, dans l'église monumentale de Saint-Antoine l'Abbaye, en plein Vercors. Autour de le Méditation religieuse extraite du triptyque Trista, où Berlioz met en garde les puissants contre les mirages de la gloire, le chef Hervé Niquet, jouant comme toujours la carte de l'enthousiasme à la tête du Concert Spirituel, confronte les Restaurations : Retour des cendres avec la pré-verdienne Marche funèbre d'Auber pour les funérailles de Napoléon, Messe des morts commandée par Louis XVIII à Charles-Henri Plantade pour commémorer le décès de Marie-Antoinette, Requiem de Cherubini pour le transfert à Saint-Denis des dépouilles royales. Etranges télescopages temporels : classicisme et romantisme, mélodrame et retenue, concessions et hardiesse, cuivres d'outre-monde - chez le bien oublié Plantade - anticipant les microintervalles. Chemin de traverse l'après-midi dans la plus austère église de la Cöte-Saint-André, avec le déjà médiatique Edgar Moreau (violoncelle) et le pas encore connu Pierre-Yves Hodique (piano) pacourant avec un égal panache les "Routes de l'Allemagne romantique" (Mendelssohn, Schumann, Brahms).
François Lafon
Festival Berlioz, La Côte-Saint-André, jusqu'au 30 août. Photo © DR

A l’Auditorium de la Fondation Louis Vuitton (voir ici), premier des deux concerts de la Seiji Ozawa International Academy Switzerland (tout est dans le titre) sélectionnant depuis 2004 la crème des jeunes instrumentistes (vingt-sept ) autour du maestro et de quelques professeurs de luxe, parmi lesquels Pamela Frank (violon) et Nobuko Imai (alto). Comme chaque année : quatuors à cordes en première partie, tous réunis en seconde mi-temps pour un exercice d’ensemble dirigé par Ozawa en personne. Le saut de l’ange pour commencer : virtuosité, réactivité, écoute mutuelle, histoire commune, rien de plus exposé que le quatuor. Certains attelages « prennent » mieux que d’autres, certains trouvent d’emblée le ton voulu (course légère dans Mendelssohn, distance calculée chez Ravel), d’autres s’affirment comme de grands professionnels, comme l’équipe d’anciens de l’Académie menée par la violoniste Alexandra Soumm dans le Langsamer Satz de Webern. La récompense pour finir : Ozawa tel qu’en lui-même, dansant sur le podium, insufflant à ses troupes (profs compris) dans Beethoven et Grieg (des extraits de la Suite Holberg) une énergie d’autant plus inespérée qu’on le sait luttant contre la maladie, obligé d’annuler la masterclass prévue jeudi 2, comme il a dû annuler le même concert à Genève le 28 juin. « Enseigner est comme une drogue. Lorsque vous commencez, vous ne pouvez plus vous arrêter », déclare-t-il. Second concert vendredi 3, session de rattrapage le 8 sur Radio Classique.
François Lafon
Fondation Louis Vuitton, 1 et 3 juillet à 20h30. En différé sur Radio Classique le 8 juillet à 20h Photo © DR

A l’église Saint-Germain-des Prés, dans le cadre du nouveau festival Mezzo - du nom de la chaîne musicale du pôle Radio/TV de Lagardère Active -, le claveciniste Jean Rondeau joue Bach. Un Bach explosif, si l’on en croit le look jeune (il a 23 ans) et le brushing électrique de ce fou de jazz autant que de baroque, élève de la grande Blandine Verlet passé par la Guidhall School de Londres. Or Jean Rondeau joue sage, avec musicalité et un beau toucher – pour autant qu’on puisse en juger en ce lieu plutôt dédié aux grandes orgues. Comme dans son CD carte de visite récemment édité par Erato (voir ici), il fait chanter comme il se doit le Concerto italien et étonne avec sa transcription de la transcription pour piano par Brahms de l’illustre Chaconne de la Partita pour violon seul n° 2. Le grand chambardement ne vient pas non plus quand le rejoignent ses acolytes (flûte, viole, violon) de l’Ensemble Nevermind (en français « peu importe ») pour un nouveau Bach (Sonate en trio en ré mineur BWV 527) et un Telemann de circonstance (Nouveau Quatuor Parisien n° 6), joués avec une sobre élégance. « Pas de jazz alors ? », regrette pendant les saluts un monsieur qui a lu le programme. Hasard ou volonté ? Pour la seconde partie, Jean Rondeau arbore un brushing plus discipliné.
François Lafon
En différé sur Mezzo et Mezzo Live HD, vendredi 26 juin à 20h30 Photo © DR

A l’Opéra Bastille, nouvelle présentation, importée de Londres via Vienne, Milan, Barcelone et San Francisco, d’Adriana Lecouveur de Francesco Cilea, avec Angela Gheorghiu en vedette. Un point final à l’ère Nicolas Joël, lequel tout au long de son quinquennat a tenté de réhabiliter un répertoire italien mal-aimé. Mise en scène conservatrice de David McVicar : éventails et robes à panier, buste de Molière sur la cage du souffleur (on est à Paris, sous Louis XV), théâtre tournant plateau-coulisses pour raconter l’histoire, à la scène comme à la ville, de la tragédienne amoureuse victime d’une méchante rivale. Agitation perpétuelle, pantomime sur ressorts tenant du théâtre de boulevard et permettant au spectateur distrait (par la musique ?) de suivre sans peine l’action, elle-même tirée d’un mélodrame signé Scribe et Legouvé, créé par Rachel et repris par Sarah Bernhardt avant de ne survivre qu’à travers sa version lyrique. Objectif dramaturgique : brosser un portrait de femme émouvant et crédible, contrastant avec la convention ambiante. C’est en cela que quelques grandes interprètes – Magda Olivero jadis, Renata Scotto naguère, Mirella Freni en 1993, déjà à Bastille – ont marqué le rôle. Angela Gheorghiu, pourtant belle et chantant à ravir, ne sort pas du tableau, elle s’y fond même, comme absente à elle-même sitôt qu’elle cesse de jouer les séductrices de théâtre. Pour elle, l’orchestre (chef : Daniel Oren) fait patte de velours, se remusclant pour faire passer les longues plages de remplissage entre airs et duos. Efficacité en revanche de Luciana D’Intino (la méchante rivale), Marcelo Alvarez (l’amant dépassé par les événements) et Alessandro Corbelli (le régisseur amoureux). Et dire qu’Adrienne Lecouvreur, la vraie, s’est rendue célèbre par son jeu sans afféterie au milieu de partenaires au style ampoulé.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, jusqu’au 15 juillet. En différé sur France Musique le 26 juillet Photo © C. Ashmore

Nouveau Pelléas et Médisande à l’Opéra de Lyon, mis en scène par Christophe Honoré. Deux façons de saisir l’insaisissable fable de Maeterlinck : la symboliste - château fort, forêt, propos lourds de sens (mais lequel?) - et l’actuelle - ... actualiser justement, jouer le réalisme pour mieux aiguiser, par contraste, l’ambivalence des sentiments et l’étrangeté des situations. C’est sans surprise celle qu’a choisie Honoré, expert à l’écran de ces décollements de réalité, où les acteurs chantonnent leurs états d’âme sur des airs d’Alex Beaupain. Mais Maeterlinck est plus insistant et Debussy plus présent. Dans une lettre aux chanteurs, le metteur en scène explique que "Pelléas et Mélisande est une oeuvre vive et obscure. Le livret n’oppose jamais le mystère et l’ordinaire mais révèle la présence permanente de l’un et de l’autre." Il déplace dans un paysage post-industriel ces personnages qui disent la (leur) vérité tout en ne faisant pas ce qu’ils disent, et trouve dans ce décalage du mot et de l’image une sorte de vérité de l’ouvrage à l’usage de notre temps, comme le trop oublié Pierre Strosser avait sur la même scène (mais avec plus de rigueur encore et de cohérence), croqué le Pelléas des années 1980. C’est - chassez le naturel - à la caméra (qu’il ne tient pourtant pas lui-même : la vidéo, habilement utilisée, est signée Michael Salerno) qu’il va le plus loin, faisant du petit Yniold le diabolus in machina de l’histoire et induisant un jeu beaucoup plus pervers qu’il n’y paraît entre les protagonistes. Bel équilibre de la distribution, avec en Mélisande protéiforme l’excellene Hélène Guilmette, femme unique et toutes les femmes (belle idée du metteur en scène), comme une soeur de Lulu. Beauté de l’orchestre, où Kasushi Ono jongle avec l’allusif et la modernité debussystes, ajoutant à la subtilité de cet abyssal jeu de l’envers.
François Lafon
Opéra National de Lyon, jusqu’au 22 juin Photo © Jean-Louis Fernandez

A l’Athénée dans le cadre du festival Manifeste 2015 (Ircam) : La Métamorphose, opéra de Michaël Levinas d’après Kafka. Une recréation, quatre ans après la première à Lille dans une mise en scène de Stanislas Nordey. Cette fois, Maxime Pascal et ses musiciens du Balcon font équipe avec le vidéaste-plasticien Nieto pour raconter l’histoire du jeune homme qui se réveille un jour métamorphosé en vilain insecte. Une histoire aussi inmontrable (Kafka ne voulait pas de cancrelat sur la couverture du livre) que difficile à mettre en musique, eu égard à la trivialité « ni fantastique, ni pré-surréaliste » (Levinas) du texte. Habile subterfuge : le ton est donné dans le prologue, où trois bouches carmin (on pense à Pas moi de Beckett sur la même scène – voir ici) profèrent un étrange poème (Je, tu, il) du dramaturge Valère Novarina, sur une musique venue de partout et de nulle part (technique Ircam), ponctuée de non moins étranges jaillissements vocaux (« une musique qui n’arrêtera plus de chuter », dit Levinas). Autour de ce leitmotiv s’organise un univers sonore aussi inouï (au sens propre : jamais ouï) que sont à la fois « in-vues » et truffées de références picturales et cinématographiques les images de Nieto : métamorphosé à la plastique d’athlète sous une gangue poisseuse (le formidable contre-ténor Rodrigo Ferreira, dont la voix se mêle – toujours la technique Ircam - à celle du créateur Fabrice Di Falco), famille plus inquiétante encore que le monstre qu’elle rejette (avec soeur à visage multiple, telle Roberte dans Jacques ou la soumission de Ionesco), musiciens-lucioles cernant l’aire de jeu. Tout cela exaltant et au bord de l’insoutenable, impeccable binôme kafkaïen. Une réussite de plus pour Le Balcon, depuis trois ans en résidence à l’Athénée (lequel ferme pour travaux la saison prochaine), et obligé de procéder à un appel aux dons pour poursuivre son excellent travail (www.lebalcon.com).
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 16 juin

Concert d’ouverture du festival Manifeste 2015 (Ircam) à la Philharmonie de Paris : le Requiem pour un jeune poète de Bernd Alois Zimmermann (photo). Le grand œuvre d’une époque (1969), testament d‘un compositeur au bord du suicide. En vedette : Beethoven, Wagner et les Beatles, Maïakovski, Camus et Joyce, Hitler, Mao et Churchill, l’Ecclésiaste et la Déclaration des droits de l’homme. En 1995 au Châtelet (création française, direction Michael Gielen), ce collage-montage baptisé « lingual » (quelque chose comme « pièce parlé ») évoquait un passé pas mort, un éternel retour selon le principe du « temps sphérique » cher à Zimmermann. Aujourd’hui, dans la grande salle toute neuve de la Villette, dirigé par Michel Tabachnik à la tête d’un ensemble géant (Orchestre de la Radio de Stuttgart, choeurs de l’Armée française, Les Eléments, Les Cris de Paris, deux chanteurs, deux récitants, un jazz-band), impression d’être au-delà du temps, bien loin après le point de non-retour. Impression surtout, à voir l’énorme effectif musical écrasé par la partition des voix, cris, bruits et détonations déversées par les enceintes, que l’oeuvre raconte l’impossibilité de la musique seule à appréhender le réel, sa condamnation à ressasser sa propre histoire. Public enthousiaste, le même qui en première partie, après Photoptosis - ouverture orchestrale inspirée à Zimmermann par les monochromes d’Yves Klein et traversée de réminiscences beethovéniennes -, avait chahuté un récitant venu lire en français les textes et poèmes « lingualisés » en sept langues dans le Requiem. Une façon de rendre hommage à rebours au génie de Zimmermann à faire musique de tout, comme Antoine Vitez parlait, à la même époque, de faire théâtre de tout.
François Lafon
Philharmonie de Paris 1, 2 juin. En différé sur France Musique le 15 juin à 20h - Festival Manifeste 2015, jusqu'au 2 juillet
Photo © DR

Ouverture aux Bouffes du Nord du 3ème festival Palazzetto Bru Zane avec Le Ventre de Paris, comédie musicale philosophico-burlesque signée Arnaud Marzorati et Florent Siaud sur la gastronomie française. Un thème qui parcourt la musique légère – française en particulier -, bien éloigné - mais pourquoi pas ? – de Georges Onslow, le « Beethoven français », héros de l’année. Comme toujours - signature du Centre de musique romantique française basé à Venise - le travail de recherche est impressionnant pour donner une nouvelle chance à des musiques, des styles, des personnalités oubliés. Mais comme souvent – revers de la médaille – au miracle nul n’est tenu. Au menu : Lecocq, Audran, Hervé, Offenbach, mais aussi les plus sérieux (enfin, pas toujours) Bizet, Spontini, Thomas (Ambroise), et même des inconnus célèbres en leur temps, tels Panard, Bugnot, Serpette et Pradels. L’idée de réunir chanteurs (quatre) et musiciens (trois) autour d’une table servie va de soi, celle de jouer mi-opérette mi-cabaret – c'est-à-dire complice et décalé – aussi. Frustration pourtant de ne comprendre que par intermittences des textes qui bien souvent aident la musique à passer, dans la bouche de chanteurs-acteurs qui par ailleurs jouent juste et sont drôles. Il faut que Mélanie Flahaut, flageolettiste hors pair, fasse passer un vent de folie sur le primesautier Boléro d’Hippolyte Monpou (1804-1841) pour que l’on se persuade (vieux débat) que la musique n’a pas forcément besoin de paroles pour déchaîner l’hilarité.
François Lafon
3ème festival Palazzetto Bru Zane à Paris (Bouffes du Nord et … Opéra Royal de Versailles), jusqu’au 5 juin. Photo © Palazetto Bru Zane/Michele Crozera

Au théâtre de l’Athénée, doublé lyrique contemporain par le Balcon, ensemble en résidence : Lohengrin de Salvatore Sciarrino et Avenida de Los Incas 3518 de Fernando Fiszbein. Un doublé sucré-salé, dans la tradition de ce collectif à géométrie variable mais à audace constante, le tout pimenté par une double mise en scène de Jacques Osinski, lui aussi résident privilégié cette saison à l’Athénée, où il a donné un Don Juan revient de guerre d’Ödön von Horvàth passé trop inaperçu. Constante salée : l’ironie, voire le sarcasme, méchant chez Sciarrino montrant sur un scénario de Jules Laforgue une Elsa aliénée à laquelle Lohengrin a préféré son cygne, plus bon enfant chez Fiszbein nous faisant entrer dans un immeuble de Buenos Aires (pour l’adresse, voir le titre) dont la vie des habitants est mise sens dessus dessous par trois lurons interventionnistes. Constante sucrée-salée chez Osinski et son remarquable vidéaste Yann Chapotel : le jeu virtuose et hilarant de références et de correspondances d’un étage à l’autre de l’immeuble buenos-airien ; l’univers très Exorciste (le film) de Lohengrin, au bord du rituel satanique. Beaucoup de salé tout de même dans ce second opéra (« action invisible » selon Sciarrino), où Elsa est jouée par l’excellent acteur belge Johan Leisen, voix subtilement déraillante et visage marqué sous le voile de mariée. Pour le sucré (mais jamais le mièvre) : le travail au petit point (et sonorisé de façon signifiante) de Maxime Pascal et de ses musiciens et chanteurs, lesquels arrivent à faire passer un peu du génie de l’étrange propre à Sciarrino dans la musique impeccable mais pas toujours assez « dragées au poivre » de Fiszbein.
François Lafon
Au théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 23 mai Photo © DR

Entrée du Roi Arthus d’Ernest Chausson au répertoire de l’Opéra de Paris, cent-onze ans après sa création à la Monnaie de Bruxelles. Un Tristan et Isole à la française auquel André Messager avait à l’époque trouvé « bien des inégalités », lui fermant ainsi les portes des théâtres parisiens. Non seulement on y tristanise, mais on y tétralogise, sans oublier d’y berlioziser, et même d’y debussyser. « On perçoit dans Le Roi Arthus un bouquet d’influences (…) … mais aussi enfin… beaucoup d’Ernest Chausson », se rattrape Philippe Jordan, lequel parvient, à la tête d’un Orchestre de l’Opéra en grande forme, à conférer à l’ouvrage de la grandeur, et même de la cohérence. Sur scène, un brelan d’as - Thomas Hampson (Arthus), Sophie Koch (Genièvre), Roberto Alagna (Lancelot) – entouré d’un cast sans faiblesse (mention aux ténors Stanislas de Barbeyrac et Cyrille Dubois, deux anciens qui font leur chemin de l’Atelier Lyrique maison). Mais aussi une mise en scène signée Graham Vick, dont le King Arthur (de Purcell) entre enluminures et Monty Python a laissé un grand souvenir (Châtelet – 1995). Cette fois, plus de chevaliers ni de Table ronde, mais un univers bucolique avec verdure-plastique, canapé-sky et maison en kit évoquant Les Sims (jeu vidéo personnalisable), ramenant la geste héroïco-sentimentale sublimée par Jordan et ses troupes à un vaudeville qui tourne mal entre le mari, la femme et l’amant. Un nouvel enterrement donc, un an après une version Grande Guerre, à l’Opéra du Rhin, qui avait déjà commencé de compromettre la deuxième vie de l’ouvrage.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille jusqu’au 14 juin. En direct le 2 juin sur Mezzo et Culture Box, le 6 juin sur France Musique. Photo © Andrea Messana/Opéra de Paris

Aux Bouffes du Nord, La Mort de Tintagiles, pièce (originellement) pour marionnettes de Maurice Maeterlinck. Pour se libérer de l’emprise, dix-huit ans après, du spectacle culte de Claude Régy (TGP de Saint-Denis, 1997), Denis Podalydès a fait appel, pour raconter le passage d’un enfant de la vie à la mort, aux musiciens Christophe Coin et Garth Knox. Bonne idée : Maeterlinck lui-même qualifiait d’opératiques ses pièces pour marionnettes, et cet ouvrage en particulier a inspiré plusieurs musiciens, dont Ralph Vaughan-Williams. A la viole d’amour et à la nickelharpa, à la basse de baryton et au violoncelle d’amour, Knox et Coin ponctuent de Bartok et de Lutoslawski, de Satie et de … Knox-Coin (improvisations) ce texte succinct et sophistiqué (Pelléas et Mélisande n’est jamais loin), précédé d’une lecture par Podalydès du magnifique Pour un Tombeau d’Anatole, adieu de Mallarmé à son fils disparu. Le souvenir de Régy n’est pas pour autant conjuré. On le retrouve dans la lenteur des mouvements, dans l’éclairage minimal. Mais alors que chez Régy les mots et les corps semblaient flotter dans un espace infini, chez Podalydès le jeu psychologique des acteurs (par ailleurs fort bons) est d’autant moins sauvé par le halo d’au-delà des cordes vibrant « par sympathie » que, cédant à une mode qui fait actuellement fureur, voix et musiques sont sonorisées et retravaillées façon showbiz, ce qui ne va pas vraiment avec le sujet.
François Lafon
Bouffes du Nord (Paris) jusqu’au 28 mai. Du 5 au 7 novembre au Trident (Cherbourg), le 19 janvier 2016 à l’Espace Legendre (Compiègne) Photo © Pascal Gély

Option radicale à l’Opéra de Dijon pour l’opération Tous à l’opéra (portes ouvertes annuelles dans vingt-huit théâtres de l’hexagone) : Wozzeck d’Alban Berg. Une façon peut-être plus efficace de séduire de nouveaux publics – notamment les jeunes – rebutés pas l’opéra de papa. Grand Auditorium aux trois-quarts plein pour cette troisième et dernière représentation (La Traviata, évidemment, aurait fait mieux), ateliers, rencontres et animations assez largement fréquentés. Un Wozzeck austère et esthétique en même temps, une plongée, selon la metteur en scène Sandrine Anglade, dans le cerveau de l’opprimé-meurtrier, plutôt qu’une analyse brechtienne (dépassée) ou expressionniste (antédiluvienne). Lutte des classes tout de même, damné de la terre que ce prolétaire en col blanc regardant à travers d’immenses panneaux translucides un monde fantasmé dont il est exclu. Limite de l’expérience : un certain statisme, comme une progression en eaux troubles freinant la perception recherchée de « temps circulaire » bergien. Superbes instantanés tout de même que la danse de mort des soldats rouges dans le cabaret, ou que l’enfant orphelin seul au milieu des sacs-déchets d’une société invivable. Sandrine Anglade répondant aux questions du public : « A l’opéra, quand la musique va, tout va ». Une réussite donc : plateau sans faute avec le Français Boris Grappe très présent en Wozzeck pas si fou, et la Britannique Allison Oakes, voix grand format et personnalité émouvante. Plaisir surtout d’entendre une fois encore l’Orchestre de la SWR Baden-Baden und Freiburg, Philharmonique de Berlin de la musique du XXème siècle, bientôt démantelé – officiellement fusionné « économiquement » avec l’Orchestre de la Radio de Stuttgart. Grand écart entre romantisme et modernité finement entretenu par le chef Emilio Pomarico, héritier de Hans Rosbaud et Michael Gielen, figures tutélaires de cette phalange irremplaçable.
François Lafon
Photo © Gilles Abegg

Comme Macbeth est une pièce d’une profonde noirceur sur fond de folie meurtrière, une suite de huis clos aussi bien naturels qu’intellectuels, Mario Martone a axé la mise en scène sur un espace dégagé de tout élément matériel inutile, où l’impression de vide est supplantée par celle de l’inconnu, où les lumières, enfin, directes ou par jeux de filtre ou de réflexion, guident sans faillir l’action : elle centre toute l’attention sur la musique et sur les voix. Et quelle musique ! Daniele Gatti démarre en force, on imagine même qu’il y a deux orchestres en fosse. Mais non, un seul suffit bien sûr, et c’est l’Orchestre National de France, qui montre qu’on peut être tonique et subtil à la fois. On se demande même si les voix passeront. Mais dès le début, les chœurs s’en donnent à pleine gorge, avec jubilation, à l’unisson, et une belle diction. Chaque membre paraît prendre plaisir à cette débauche vocale : c’est à s'interroger sur cette métamorphose du chœur de Radio-France. Arrivent Macbeth (Roberto Frontali), Lady Macbeth (Susanna Branchini), puis Branquo (Andrea Mastroni), qui passent l’épreuve de force de façon stupéfiante, rugueux à souhait pour les deux premiers, plus en rondeur pour le troisième, même si Susanna Branchini souffre quelque peu dans les aigus : à cette intensité, cela se comprend. Cette production va jusqu’à présenter (acte IV) un Macduff palot et un Malcom caricatural dans le style du ténor rondouillard à la voix d’or mais aux semelles de plomb. Ce parti, sans doute non voulu, a pour effet de renforcer plus encore la présence tutélaire des Macbeth/Branco, et n’enlève rien à la magie délirante de l’ensemble.
Albéric Lagier
Théâtre des Champs-Élysées, 4, 7, 11, 13 et 16 mai 2015. Sur France Musique le 16 mai. Photo © Vincent Pontet/TCE

Au Théâtre de Caen, reprise du Vaisseau fantôme monté la saison dernière en conclusion du très réussi Wagner Geneva Festival (voir ici). Une recréation plutôt, le spectacle du metteur en scène Alexander Schulin (une plongée dans la tête de Senta la rêveuse, étreignant un doudou à l'effigie du Hollandais maudit, évoluant dans un souterrain - couloir de la mort, enfermement en soi-même? - laissant à filtrer des vagues, des yeux, du sang) soutenant cette fois une utopie musicale : la résurrection par François-Xavier Roth et son ensemble Les Siècles du son et de la couleur orchestrale de la toute première version de l'ouvrage, refusée à l'époque par l'Opéra de Paris, lequel lui préféra un Vaisseau fantôme ou le Maudit des mers vite oublié, dû à l'obscur compositeur Louis Dietsch. Orchestre à la française, timbres un peu acides, surexposition des influences (de Meyerbeer à Gounod) subies par le jeune Wagner lors de son calvaire parisien : une dichotomie risquée entre l'oeil et l'oreille, accentuée par un plateau de grandes voix wagnériennes ... telles qu'il n'en existait pas encore du temps de Wagner. Un alliage réussi pourtant, parce qu'une heureuse connivence se fait entre les images postmodernes de Schullin et cette interprétation à l'ancienne mettant en lumière l'intrusion de la "musique de l'avenir" dans le vieil opéra romantique, parce qu'Ingela Brinberg (Senta), Alfred Walker (le Hollandais) et Liang Li (Daland, appelé ici Donald, cette première version se passant en Ecosse) brûlent les planches. Gros succès auprès des habitués d'un théâtre qui a été, avant le changement de majorité municipale et les restrictions dues à la crise, le laboratoire des expériences philologiques de William Christie et de ses Arts Florissants.
François Lafon
Caen, Théâtre, 30 avril. Au Grand Théâtre du Luxembourg les 9 et 11 mai. Diffusion ultérieure sur France Télévisions Photo © Gregory Batardon

Ouverture du week-end pascal à la Philharmonie 1 : la Messe en si mineur de Bach par John Eliot Gardiner, avec les English Baroque Soloists et le Monteverdi Choir. Pour un ensemble rompu notamment à l’intégrale des Cantates, une sorte d’accomplissement que ce chef-d’œuvre équilibré comme une cathédrale, recyclant pourtant nombre de pièces antérieures, réunissant vingt ans de création. Fidèle au Bach humain avant tout qu’il décrit dans son livre Musique au château du ciel (Flammarion – voir ici), Gardiner jongle avec le sacré et le séculier, la danse et la méditation pour construire, en effet, un château céleste, grandiose et divers. Effet de l’acoustique peu réverbérée (rien d’une église) de la Philharmonie : l’oreille doit se faire à la présence écrasante du Monteverdi Choir, précis comme jamais, et volant la vedette aux instrumentistes, pourtant admirables (deux flûtes transcendantes, en particulier). Elle doit se faire aussi aux voix solistes issues du choeur, disciplinées mais anonymes, bien loin des guest-stars habituelles. Ovation finale, bravos scandés, interminables.
François Lafon
Philharmonie de Paris, 3 avril Photo © Philharmonie de Paris

A la Philharmonie de Paris, Maria Joao Pires joue le 4ème Concerto de Beethoven avec Tugan Sokhiev et l’Orchestre du Capitole de Toulouse. Une version de chambre, sans effets mais respirant large, un piano porté sur la confidence mais avec tout le panache nécessaire, comme retenant l’orchestre sans pourtant le brider. Les musiciens, déjà rompus à l’acoustique claire mais encore piégeuse de la salle (ils y ont joué le Requiem de Berlioz en février), se sont chauffés avec l’Ouverture des Hébrides (ou La Grotte de Fingal, initialement L’Ile solitaire) de Mendelssohn, pièce en demi-teinte, pré-impressionniste où tout effet descriptif (la mer, les vagues) serait déplacé. C’est dans cet esprit qu’après l’entracte Sokhiev, à la manière de son maître Yuri Temirkanov, laisse circuler l’air entre les pupitres dans une 4ème Symphonie de Tchaikovski angoissée comme il le faut (c’est la première des trois Symphonies « du Destin »), notablement mûrie depuis son disque « de mariage » avec l’orchestre (Naïve - 2008). Grand moment des cordes dans un Scherzo en pizzicati digne des meilleures phalanges russes, ce qui n’indique en aucun cas une quelconque altération de la personnalité si française de l’Orchestre.
François Lafon
Philharmonie de Paris, 2 avril Photo © DR

Affluence au Palais Garnier pour Le Cid de Massenet avec Roberto Alagna. Un rôle sur mesures que la pop star des ténors a étrenné à Marseille (2011), d’où le spectacle est importé. L’ouvrage, composé entre Manon et Werther, n’est pas mémorable. On pense en l’écoutant à Anny Duperey vantant des appareils auditifs (« Son opéra le plus bruyant ? » « Non, le plus brillant »). Mais il y a quelques beaux airs (« O Souverain, ô juge… » pour Rodrigue, « Pleurez mes yeux » pour Chimène), quelques vers de Corneille surnagent au milieu d’un océan de platitudes, et Michel Plasson, comme dans Faust qu’il vient de diriger à l’Opéra Bastille (voir ici), s’emploie avec autant de succès à mettre en valeur les finesses de la musique qu’à en gommer les trivialités. L’effet Alagna fait le reste : tout le monde (avec un bémol pour Chimène - Sonia Ganassi, seule non-francophone de la distribution) chante sans effets, articule à la perfection, donne une leçon de style. Le plateau est luxueux, avec Annick Massis en Infante (rôle superbe dans la pièce, sacrifié dans l’opéra) et l’imposant Paul Gay en Don Diègue. Une fois ses aigus chauffés (et Dieu sait s’il en a, dès son entrée en scène), le héros de la soirée ne fait qu’une bouchée d’un rôle redoutable et fait presque oublier à force d’énergie et de naturel la banalité du spectacle (l’action est transposé sous Franco, so what ?) et l’absence de direction d’acteurs. C’est la première fois qu’il chante à Garnier, après de nombreuses apparitions à Bastille. On dirait pourtant que le théâtre a été construit rien que pour lui.
François Lafon
Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 21 avril. En direct sur France Musique le 18 avril Photo © DR

Mort prématurément, le compositeur français Gérard Grisey (1946-1998) fut, avec Hugues Dufourt, Tristan Murail et d’autres, le cofondateur en 1975 de l’ensemble L’itinéraire. Il s’agissait d’inventer une nouvelle modernité hors de la musique sérielle, restituant au son et à son évolution dans le temps leur primauté. Etait associé à cette démarche le terme de musique « spectrale » : il importait de « faire passer le son aux rayons X » pour mettre en évidence son spectre harmonique. Tout cela est bel et bon, mais quid de la musique ? Une des dernières œuvres de Grisey, créée un an après sa mort, est Quatre chants pour franchir le seuil pour soprano et quinze instruments, ce seuil étant la mort justement : quatre mouvements séparés par de courts (et un vaste) interludes instrumentaux, sur des textes relevant de quatre civilisations (chrétienne, égyptienne, grecque et mésopotamienne). L’œuvre, d’une durée d’une cinquantaine de minutes, est de celles qui tiennent de bout en bout l’auditeur en haleine. On est subjugué par son alchimie sonore, ses épisodes aux limites du silence, ses formidables explosions, sa mise en jeu très personnelle du « percussif ». Surtout, si des « instants » se succèdent, on est saisi par un sens très sûr de la forme, ou plutôt de la direction : on s’oriente, on suit. Quatre chants pour franchir le seuil, un chef-d’œuvre, deux fois enregistré, vient d’être porté au triomphe par Julie Fuchs et Le Balcon, dirigé par Maxime Pascal.
Marc Vignal
Athénée, Théâtre Louis--Jouvet, 28 mars 2015 Photo © DR

Au Théâtre des Champs-Elysées, récital Beethoven par le pianiste russe Andrei Korobeinikov. Deux sonates seulement, mais deux Himalaya : la « Hammerklavier » et l’Opus 111, dernière des trente-deux et débouchant sur un fascinant outre-monde. Un défi à la mesure de l’artiste, trente ans à peine, bardé de prix (Concours Scriabine, Rachmaninov, etc.), sorti du Conservatoire de Moscou avec la mention « Meilleur musicien de la décennie », adoubé en France par le clan « Folle Journée » (Festival de la Roque d’Anthéron, disques Mirare, etc.), par ailleurs avocat et auteur d’ouvrages qui font autorité sur le droit de la propriété intellectuelle. Parallélisme du son et de l’image : éclairage parcimonieux, silhouette émaciée arcboutée sur le clavier, technique imparable et toucher précis, aucune volonté apparente de séduire ni de se donner en spectacle. Sonorités rêches, angles aiguisés pour la « Hammerklavier », supérieurement architecturée, jouée comme une prémonition du XXème siècle, et dont l’immense Adagio prend des airs de concentré de philosophie spéculative. Tout autant d’intransigeance mais plus de moelleux dans l’Opus 111, sans tout de même que l’Arietta finale évoque jamais le « sourire presque immobile de Bouddha » cher à Romain Rolland. Deux bis plus aimables, mais pas moins exigeants. En comparaison, les deux Ievgueni - Kissin, dont on donne Korobeinikov comme le successeur (en quoi ?), et le transcendant et trop peu connu Sudbin - feraient presque figure d’hédonistes du clavier.
François Lafon
Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 26 mars. Diffusion sur France Musique le 7 avril à 14 h Photo © DR

A l’Athénée, Kafka-Fragmente de Gyötgy Kurtag, mis en scène par Antoine Gindt. Rien de moins scéniques a priori que ces quarante fragments du Journal, de la Correspondance, de Méditations sur le péché et de quelques autres textes de Kafka, que Kurtag, de 1985 à 1987, a mis en sons pour chanteuse et violoniste, « presque par accident, (…) comme un gamin qui se délecte d’un petit plaisir défendu ». Rien de plus réaliste pourtant que ce dialogue à la fois minimal et « concentré à un si haut degré qu’il ne peut supporter un long développement » (Pierre Boulez), dans lequel (4ème fragment, Ruhelos, « sans répit ») la chanteuse doit « suivre les acrobaties et l'emportement du violoniste avec une tension croissante », et où interviennent des interlocuteurs cachés entre les notes, tels Eusebius et Florestan, les doubles de … Schumann. Un plateau nu, une arrière-scène où un couple (Franz et Milena, sa bien-aimée lointaine ?) et quelques silhouettes apparaissent en contrepoint, un écran reflétant une réalité décalée et surtout les formidables Salome Kammer (soprano) et Carolin Widmann (violon) font théâtre de ces notes et de ces mots (« Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde ») mystérieux et rayonnants. Une heure de presque rien d’où, en effet, naît tout un monde.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 22 mars Photo © Pascal Victor ArtComArt

A l’Athénée, récital de Romain Descharmes, extension parisienne du 36ème festival Piano aux Jacobins de Toulouse. A l’occasion aussi de la sortie du CD Vers l’Extase chez Atalinna. Salle huppée, nombreux représentants des sponsors et partenaires du festival. Programme ambitieux – Schumann, Fauré, Scriabine, Ravel – pour ce pur produit du Conservatoire de Paris à la carrière en plein essor. Abordé à la hussarde, « Sus aux Philistins » plutôt que « Scènes mignonnes sur quatre notes » (son véritable sous-titre), le Carnaval (Schumann) surprend. Rêve éveillé et plus large respiration pour les raffinés Barcarolle n° 1 et Nocturne n° 4 de Fauré, avant la tempête des Poème tragique et Poème satanique de Scriabine enlevés comme dans un accès de rage, le tout débouchant sur une Valse de Ravel (version piano solo) plus revancharde qu’ironique, plus brûlante que sensuelle. Mais que veut dire cet artiste qui sait d’ordinaire si bien se faire poète ? Réponse en bis, dans Winnsboro Cotton Mill Blues de Frederic Anthony Rzewski (né en 1938), pièce inhumaine (Descharmes dixit) où le martellement de la machine manque avoir raison du chant des esclaves dans les champs de coton. A moins qu’il ne s’agisse d’autre chose…
François Lafon
Athénée, Paris, 16 mars Photo © DR

Nouveau ciné-musical au Châtelet après Un Américain à Paris : Singin’in the Rain (Chantons sous la pluie) ou comment – thème de la saison - fabriquer un spectacle de notre époque avec un film d’un autre temps, cette fois celui de Stanley Donen avec Gene Kelly, Debbye Reynolds et Donald O’Connor (1952). Le metteur en scène Robert Carsen, déjà signataire in loco d’un Candide controversé et d’une My Fair Lady incontestée (voir ici), y décline toutes les références cinématographiques possibles, à commencer par The Artist : l’origine de l’œuvre le justifie et le sujet - la naissance du film sonore - s’y prête. Il nous fait passer derrière l’écran (bel effet de projection à l’envers) pour suivre les aventures du couple de stars du muet candidat au parlant – lui reçu, elle recalée pour cause d’ingratitude vocale – et de la jeune première au ramage à la hauteur de son plumage. Résultat sans bavure, plateau d’acteurs-chanteurs-danseurs britanniques capables d’en remontrer à leurs homologues américains, Orchestre de Chambre de Paris en grande formation (un luxe que Broadway ne permet pas). Difficile pourtant de ne pas sourire à l’idée que le film de Donen est plus moderne, qu’il dynamite bien plus sûrement - façon Helzapoppin - les codes du genre que cette grande machine somme toute bien sage (chorégraphie comprise). Qu’importe, le public adore : quinze représentations sold out, reprise d’un mois et demi annoncée pour les fêtes 2015-2016, standing ovation quand toute la troupe revient, sous une pluie battante, chanter et danser "Singin’in the Rain" en cirés jaunes, référence tous publics à l’affiche (culte) du film (idem).
François Lafon
Châtelet, Paris, jusqu’au 26 mars. Reprise du 27 novembre 2015 au 15 janvier 2016 Photo © Patrick Berger

Au théâtre de l’Athénée, Not I, Footfalls et Rockaby, trois monodrames pour femme seule de Samuel Beckett, par la comédienne irlandaise Lisa Dwan. Obscurité totale, d’où se détache une bouche débitant un flot de paroles longtemps retenues (Not I), une silhouette faisant les cent pas tandis que sa mère se meurt (Footfalls), un buste de femme apparaissant et disparaissant dans le balancement d’un rocking-chair (Rockaby). Pas de sous-titres, le rythme commandé par les lèvres, les pas, le fauteuil, les hauteurs commandées par les différentes voix (la mère, la fille, le souvenir, le cri) en direct ou traitées électroniquement suffisant (?) à donner le sens. « Le plus important, c’est de lire le texte comme une partition musicale », explique Lisa Dwan. « C’est comme de la musique, une sorte de Schoenberg dans sa tête », disait de Not I sa créatrice Billie Whitelaw. « Vous diriez peut-être que c’est du Bach, si vous parlez de musique ancienne, mais je vous dirai que c’est aussi bien du Webern ou du Boulez », ajoutait Madeleine Renaud, première interprète française de l’oeuvre. « Une sonate pour voix d’actrice », disait de Rockaby le critique Ned Chailley. Insistance, au-delà de la précision et de la virtuosité exigée (et en ces domaines, Lisa Dwan est prodigieuse), sur la forme musicale de ces textes que Beckett, lui-même musicien et excellent pianiste, ne supportait pas d’entendre autrement que « chantés juste » (il s’est brouillé à ce propos avec quelques comédien(ne)s, Madeleine Renaud en tête) et sur lesquels il ne voulait pas qu’un compositeur déposât des notes, fût-ce Pierre Boulez, lequel, après la disparition de l’écrivain, aurait caressé l’idée de porter En attendant Godot à l’opéra.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 15 mars

Les compositeurs Tristan Murail (Le Havre 1947) et Hugues Dufourt (Lyon 1943) sont de ceux qui en janvier 1973 participent à la fondation de l’ensemble de musique contemporaine l’Itinéraire, avec comme objectif esthétique et théorique la poursuite d’une réflexion et d’une recherche sur le son musical et son rapport à l’écriture. D’où des sonorités et un style de jeu très différents de ceux de la musique sérielle de la génération précédente. Quarante ans plus tard, l’intéressant concert donné à Radio France par l’Orchestre philharmonique dirigé par Pierre-André Valade, avec Pierre-Laurent Aimard au piano, a confirmé qu’à partir de l‘analyse électroacoustique et spectrale et de la lutherie acoustique, on pouvait aboutir à des résultats fort divers. Le concerto symphonique pour piano et orchestre Le Désenchantement du monde de Tristan Murail (2012), donné en création française, se veut la négation des fondements harmoniques rêvés jusqu’aux révolution du XXème siècle. Dans cette œuvre souvent véhémente, parfois aux limites du silence, les références à Liszt sont bien présentes, par son côté virtuose mais aussi lorsqu’à la richesse harmonique des longes tenues de l’orchestre font écho, au piano, des notes délicatement égrainées. Ouvrage plus personnel, Le passage du Styx d’après Patinir de Hugues Dufourt (2014), référence à un tableau de ce peintre des alentours de l’an 1500 exposé au musée du Prado, procède par grandes vagues sonores, statiques d’apparence mais dynamisées par de constantes modifications harmoniques et de couleur. Cela d’un bout à l’autre, alors qu’ailleurs chez Dufourt, des explosions finissent par se produire. Un peu plus d’une heure de musique d’aujourd’hui donnant matière penser, ce qui n’est pas toujours le cas.
Marc Vignal
Auditorium de Radio France, 6 mars 2015 Photos : Tristan Murail - Hugues Dufourt © DR

A l’Opéra Bastille, Faust de Gounod dans une « nouvelle mise en scène » signée Jean-Romain Vesperini, remplaçant la reprise annoncée du spectacle contestable et contesté de Jean-Louis Martinoty (voir ici), dont Vesperini était l’assistant. Nouvelle mise en scène en effet, en ce qu’au trop plein d’idées et de références initial succède une mise en place sommaire, une vague transposition de l’intrigue dans les années 1930 (allusions, si l’on cherche bien, à René Clair et Marcel Carné), le tout écrasé par la gigantesque bibliothèque-galerie qui servait de décor au spectacle initial, posée là comme un remords encombrant. Pourquoi ne pas avoir élagué l’original (refus de Martinoty?), comme cela se fait couramment, en conservant les bonnes idées - il y en avait - et en supprimant les mauvaises ? Distribution de luxe, dominée par Piotr Beczala, Faust stylé, Ildar Abdrazakov, Méphisto dans la tradition slave, et Krassimira Stoyanova, Marguerite au look improbable mais à la voix de miel. Direction lente, pas toujours précise mais habitée du spécialiste Michel Plasson, déjà au pupitre en 1975 du Faust « de » Jorge Lavelli, lequel a tenu, lui, l’affiche au Palais Garnier puis à l’Opéra Bastille trente-six ans durant, et qui aurait très bien pu jouer les prolongations.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille, jusqu’au 28 mars Photo : Krassimira Stoyanova et Piotr Beczala avant une répétition © DR

Débuts à la Philharmonie de Paris de Simon Rattle et du Philharmonique de Berlin, de retour d’une semaine de concerts à Londres. Programme tel que les aime le chef : la 2ème Symphonie « Résurrection » de Mahler, précédé de Tableau pour orchestre d’Helmut Lachenmann, pièce courte qu’il associe dans d’autres concerts à la 9ème du même Mahler, parce que cette musique-là « oscille entre son et forme, émergence et disparition ». Pas mal vu, même si ce Tableau parcourant toute la dynamique de l’orchestre prend des airs d’acclimatation à une salle perfectible mais déjà excellente - ni trop sèche ni trop réverbérée - pour ce genre de musique. On n’en écoute pas moins différemment la Todtenfeier (Cérémonie funèbre) qui ouvre la 2ème, dirigée assez lentement, découpée alla Rattle, c’est à dire avec un sens de l’architecture qui fait apparaître l’étrangeté de cette musique en son temps (1888) et renvoie à sa descendance, Lachenmann en tête. Mêmes motifs d’étonnement dans les mouvements n° 2 (« très modéré ») et 3 (« tranquille et coulant »), auxquels le chef, toujours là où on ne l’attend pas, nous persuade qu’ils recèlent le secret de l’œuvre entière. Après un « Urlicht » chanté de manière assez confidentielle par la mezzo Magdalena Kozena, la longue montée vers la Résurrection évoque davantage l’intimisme géant des Gurre-Lieder de Schoenberg que la préfiguration de la BO de western que tant de maestros s’obstinent à y voir. Triomphe final, pour Rattle, pour le superbe Chœur de la Radio Néerlandaise et pour l’orchestre, d’une sûreté, d’une ductilité, d’une musicalité - quoi qu’on en dise - inaltérées.
François Lafon
Philharmonie de Paris, 18 février Photo © DR

Entracte contemporain au Châtelet : Le Petit Prince de Michaël Levinas, gros succès à Lausanne en novembre dernier. Un opéra pour les enfants, mais pas seulement, comme le conte de Saint-Exupéry dont il s’inspire. Là est évidemment la difficulté : créer une musique à la fois évidente et riche de prolongements (« Le mythe théâtral du Petit Prince a une dimension quasi mozartienne », remarque Levinas), pour illustrer un spectacle fidèle au trait et à l’univers pictural de l’auteur (seule exigence des ayants droit de l’écrivain). En ce sens, le pari est tenu : en mêlant les styles et les époques du gré des rencontres terrestres du Petit Prince venu d’ailleurs, en projetant – clavier numérique aidant - l’orchestre classique dans l’espace contemporain, Levinas donne-là son Enfant et les Sortilèges personnel, à peine moins déstabilisant que celui de Ravel et Colette (« Tu auras de la peine. J’aurai l’air d’être mort et ce ne sera pas vrai… »). Dans la salle, le jeune public réagit aux inventions musicales (l’Ivrogne et ses glouglous) et aux images simples de la metteur en scène Lilo Baur. Dommage seulement qu’à vouloir faire court (1 h 20) et éviter d’être lourd, Levinas assèche quelques thèmes et se prive de quelques prolongements (… « Mais le Petit Prince ne répondit pas », chapitre VI). Exécution optimale (Arie van Beek et l’Orchestre de Picardie), distribution choisie, même si la soprano Jeanne Crousaud est trop adulte pour faire croire au « Petit bonhomme » demandant à l’auteur-aviateur de lui dessiner un mouton.
François Lafon
Châtelet, Paris, du 9 au 12 février. Opéra Royal de Wallonie, Liège, du 17 au 21 octobre Photo © Théâtre du Châtelet

Ouverture à l’Auditorium de Radio France du 25ème festival de musiques contemporaines Présences, sur le thème « Les deux Amériques ». Cinq compositeurs, deux créations mondiales, avec en unique tête d’affiche Gautier Capuçon pour créer le Concerto pour violoncelle écrit sur mesure par l’Argento-français Esteban Benzecry. A côté de cette œuvre complexe et évocatrice, où les échos très anciens de l’Amérique précolombienne croisent notre époque et ses peurs immémoriales, le Concerto pour hautbois et orchestre du Franco-suisse Richard Dubugnon, latino-américain de ton si ce n’est d’origine, paraît en retrait en dépit de la performance du hautboïste Olivier Doise, son dédicataire sorti des rangs de l’Orchestre Philharmonique qui officie ce soir. Autour de ces deux nouveautés, un portique en trois volets fortement contrastés pour illustrer les divers états du thème et introduire les treize concerts du festival : quel autre rapport entre Conlon Nancarrow, disciple de John Cage et Elliott Carter, Darwin Aquino, jeune chef et compositeur dominicain aimant empiler les tempos les plus variés, et Evencio Castellanos, figure historique de l’acclimatation du folklore sud-américain aux formes classiques ? Direction précise et animée du jeune Manuel Lopez Gomez issu du Sistema vénézuélien, public motivé mais cette fois encore pas assez nombreux.
François Lafon
Présences 2015, du 6 au 21 février Photo : Manuel Lopez Gomez © DR

Débuts de l’Ensemble Intercontemporain, pensionnaire de longue date de la Philharmonie 2 (ex-Cité de la Musique) dans la grande salle de la Philharmonie de Paris. Programme XXL, en collaboration avec les jeunes instrumentistes de l’Orchestre du Conservatoire : Pli selon pli (portrait de Mallarmé) de Pierre Boulez et Amériques d’Edgar Varèse. Un double test - du murmure à la déflagration -, pour apprécier l’acoustique du lieu, si l’on ne savait que les réglages définitifs sont encore à faire. Tel quel, entendu du premier balcon jardin (juste au-dessus de l’orchestre), le son est clair, mais aléatoire, et différent d’une place à l’autre. L’extraordinaire jeu de timbres de Pli selon pli se déploie, somptueux et soyeux, mais la voix trop lointaine de la soprano Marisol Montalvo (vue et entendu de dos) a du mal à évoquer l’au-delà du poème (« Si vous voulez comprendre le texte, alors lisez-le ») recherché par Boulez. Avec Amériques, géniale Symphonie du Nouveau Monde de l’ère industrielle, l’alliage Conservatoire-Intercontemporain continue de jeter des étincelles, même si le chef Matthias Pintscher, précis et véhément mais respirant moins naturellement cette musique saturée de rythmes et de couleurs que celle, à la fois dense et raréfiée, de Boulez, ne parvient pas jusqu’à la dimension panique (un Sacre du Printemps explosé) trouvée par Esa-Pekka Salonen en 2011 au Châtelet (festival Présences). Salle pleine, public plutôt jeune : curiosité pour la nouvelle salle ou, déjà, succès du pari Philharmonie ?
François Lafon
Philharmonie de Paris, grande salle, 3 février Photo Marisol Montalvo © DR

Ça commence comme un récital, ça continue par une pochade, se poursuit avec des guignolades et s’achève par une hispaniolade : c’est lorsqu’elle est en scène qu’on apprécie le mieux Patricia Petibon dont l’abattage est digne des spécialistes du one-man-show. Dans cet exercice, la belle excentrique est éclectique, joue superbement la mélancolie avec Les Berceaux de Gabriel Fauré avant de se mettre à aboyer pour chanter Fido, Fido, l’histoire du « chien vraiment ridicule dont on n'sait jamais s'il est su' l'dos, ni s'il avance ou s'il recule » l’une des Chansons du Monsieur Bleu de Manuel Rosenthal. Et sa complice pianiste Erika Guiomar n’est pas en reste, qui se voit affublée d’une trompe d’éléphant, d’un petit chapeau toc, ou d’oreilles de lapin pour Civet à toute vitesse extrait de La Bonne Cuisine de Leonard Bernstein. Au Granada final lancé à pleins poumons, Patricia Petibon triomphe. On se souvient alors qu’elle a eu le même triomphe dans un récent Dialogue des Carmélites de Francis Poulenc, qu’à ses débuts, elle a chanté Rameau avec le même succès et qu’elle fut acclamée l’an dernier pour la création d’Au Monde l’opéra de Philippe Boesmans repris le mois prochain à l’Opéra-Comique. Mazette !
Gérard Pangon
Théâtre d’Arras 24 janvier 2015

Nouveau chapitre de l’excellente série Les Pianissimes dans la chapelle élégamment décatie - et comble pour l’occasion - du Couvent des Récollets (Paris 10ème) : Romain David. Un pianiste multitâche, bardé de prix et très respecté par ses pairs, membre fondateur de l’Ensemble Symtonia (quintette avec piano) et directeur du festival du Croisic (il est lui-même natif de Guérande). Un pianiste peu médiatisé pourtant, bien que représentatif de l’embellie du piano en France depuis une vingtaine d’années. « Pas facile de l’avoir », commente Olivier Bouley, directeur des Pianissimes. Programme à sa mesure, qu’il commente généreusement : Granados après Scarlatti, l’Espagnolissime et l’Italien émigré à Madrid, Massenet en entremets, Liszt et Chopin enfin, dans leurs habits belcantistes (Un Sospiro pour le premier, le Nocturne op. 62 n° 2 pour le second) et romantiques (2ème Ballade, 3ème Ballade). Etonnante péroraison que cette 3ème Ballade de Chopin, jouée rageusement, avec véhémence, sans hédonisme aucun, à l’image du style David : de la technique, de la réflexion, de la musicalité, beaucoup d’imaginaire mais peu d’abandon. Logiquement, la sombre Ballade de l’amour et de la mort (Granados – Goyescas) et la vaste 2ème Ballade de Liszt comptent parmi les points forts de ce concert sans temps mort.
François Lafon
Couvent des Récollets, Paris, 26 janvier

Douzième et dernier opéra italien destiné par Haydn à la cour d’Eszterháza, créé le 26 février 1784, Armida reprend - à partir de la Jérusalem délivrée du Tasse - un thème déjà utilisé par maints compositeurs dont Lullly (1686), Haendel (1711 et 1731) et Gluck (1777), en attendant Rossini et Dvorak : les amours impossibles du paladin chrétien Renaud (Rinaldo) et de la magicienne sarrasine Armide. De ces archétypes, Haydn - aidé par son librettiste Nunziato Porta - fait des personnages de chair et de sang. La psychologie prend le pas sur le surnaturel, les péripéties spectaculaires cèdent dans l’intrigue devant les déchirements intérieurs. On est en pleine ère des Lumières ! Armida vient d’être donné, sous l’égide de l’Arcal (Compagnie nationale de théâtre lyrique et musical), dans une sobre mise en scène de Mariame Clément qui heureusement ne traite pas le sujet par la dérision, comme c’est trop souvent le cas ces temps-ci, mais très sérieusement. Costumes neutres, ce qui ne permet pas toujours (sans doute est-ce voulu) de distinguer les Croisés des gens de Damas, et belles prestations vocales, en particulier des deux principaux protagonistes, Chantal Santon et Juan Antonio Sanabria. Mention spéciale au Concert de la Loge Olympique, orchestre nouvellement créé issu du Cercle de l’Harmonie, et à son chef Julien Chauvin, notamment pour leurs pianissimos haletants aux limites du silence. Un regret : l’omission des cinq premières minutes de l’acte III, durant lesquelles on aurait dû voir Rinaldo pénétrer dans la forêt « terrifiante » où se déroulera la plus grande partie dudit acte. « On dit que c’est ma meilleure oeuvre [dramatique] jusqu’ici », écrivit Haydn à propos d’Armida à son éditeur Artaria. A en juger par cette belle production devant une salle archi-comble, ce « on » n’avait pas tort.
Marc Vignal
Opéra de Massy, 23 janvier 2015 Photo © DR

Au Châtelet, Il re pastore, opéra de l’année entre deux comédies musicales. En fait une « sérénade en deux actes », dernier ouvrage de jeunesse de Mozart (19 ans) avant le chef-d’œuvre Idomeneo. Une musique très mûre quand même, sur un livret « Siècle des Lumières » traitant du pouvoir et de la légitimité, de la raison et du sentiment, du roi caché et du despote éclairé. Du royaume de Sidon (Liban), le scénographe, costumier et co-metteur en scène Nicolas Buffe transpose l’action au pays des mangas et du jeu vidéo. Au Châtelet déjà, ce Franco-japonais (d’adoption) avait en 2012 (voir ici) relooké façon Star Wars et Monty Python le non moins rare Orlando Paladino de Haydn. Cette fois encore, la greffe prend : dans l’univers du Dr Robotnic, Super Mario (le roi pasteur) est amoureux d’une princesse kawaii (= lapin), Alexandre le Grand, en armure dorée sortie de X-OR, a pour gardes du corps des soldats-acrobates échappé du jeu Halo. En filigrane - pour les initiés - la grande bataille dans les années 1980 des deux géants du jeu vidéo Nintendo et Sega : une manière de retrouver le roi caché de Mozart. Distribution jeune et disponible, direction relativement disciplinée de Jean-Christophe Spinosi, bruitages réussis (pendant les récitatifs seulement). Public éclectique de 7 à 77 ans, gros succès au rideau final. L’effet Châtelet, décidément.
François Lafon - Olivier Debien
Châtelet, Paris, jusqu’au 1er février Photo © Marie-Noëlle Robert

A l’Athénée, rareté de l’année par l’Opéra Studio de l’Opéra du Rhin. Après Blanche-Neige de Marius Felix Lange (2013 – voir ici), La Belle au dois dormant d’Ottorino Respighi. Un petit ouvrage, originellement pour marionnettes, du compositeur des Pins et Fontaines de Rome, inusables machines à jouer de l’orchestre. Là aussi, l’orchestre est soigné, mais minimal, accompagnant une adaptation habile du conte de Perrault signée Gian Bistolfi, scénariste connu à Cinecitta. Collaboratrice du collectif catalan La Fura dels Baus, la metteur en scène Valentina Carrasco habille de voiles mouvants, « étoffe dont sont faits les rêves » selon Shakespeare, l’histoire de la belle endormie réveillée par le Prince charmant telle la Walkyrie sur son rocher. Fluide et malicieux comme la musique de Respighi, son spectacle s’adresse aux enfants, lesquels, nombreux dans la salle, rient beaucoup et ont peur quand la méchante fée émerge du sol telle une araignée maléfique. La saison dernière à l’Opéra de Lyon, Valentina Carrasco a monté Le Tour d’écrou de Benjamin Britten d’après Henry James (voir ici), une histoire de rêve éveillé aussi, mais maléfique, avec enfants plutôt que pour enfants. Elle y jouait sur le reflet, y tissait une inquiétante toile d’araignée. « Rien à voir, dit-elle, avec la magie blanche de Blanche Neige ». Et pourtant… Jeunes chanteurs de l’Opéra Studio très concernés, accompagné par le décidément excellent ensemble Le Balcon – en résidence à l’Athénée – dirigé non par son chef Maxime Pascal, mais par le solide Vincent Monteil.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 22 janvier. 30, 31 janvier et 1er février, La Sinne, Mulhouse Photo © Alain Kaiser

Festivités d’ouverture de la Philharmonie de Paris : après l’Orchestre de Paris, Les Arts Florissants, deuxième des cinq formations en résidence. William Christie : « Heureux de vivre l’aventure de ce lieu, même s’il n’est pas terminé » ; le directeur Laurent Bayle : « Il fallait ouvrir, malgré les retards, les réticences, les contestations ». Une formation baroque dans le nouveau temple du symphonique : les noces de la carpe et du lapin ? Escaliers roulants, espaces vides, terrasses nues ouvertes sur le périphérique, et enfin la grande salle, à la fois vintage et futuriste, parterre et corbeille cernés de balcons comme des nuages en suspension, volutes de bois vernis miel et chocolat, cocon enfantin et sophistiqué cernant le plateau. Programme festif et sérieux, comme savent en faire les anglo-saxons. Flottements au démarrage du Te Deum de Charpentier (celui de l’Eurovision) : appréhension des musiciens ou spécificité d’une acoustique qui ne pardonne pas, à laquelle manquent quelques mois de réglages ? Bel équilibre voix-instruments dans le superbe motet de Mondonville In exitu Israel, clarté du chœur et proximité des chanteurs, sensation de rencontre imminente mais pas tout à fait mûre de la pompe versaillaise et (ce qu’on imagine) du génie du lieu. En deuxième partie, avant un très baroque « Bon anniversaire » à Christie (70 ans) dirigé par son lieutenant Paul Agnew, l’entrée des Sauvages extraite des Indes galantes de Rameau – avec la mini-bombe lyrique Danielle De Niese - confirme l’impression. Ce week-end, concerts et ateliers divers, stars et orchestres invités en perspective. La ruche doit vivre, à la fois proche et luxueuse, et justifier sa dispendieuse existence. Quand le vin est tiré…
François Lafon
Les Arts Florissants, concert d’ouverture, disponible pendant 6 mois sur concert.qrte.tv et live.philharmoniedeparis.fr

A l’Auditorium de la toute neuve Fondation Louis Vuitton (Bois de Boulogne, à la lisière du Jardin d’acclimatation), premier récital de la saison « Piano nouvelle génération » : Rémi Geniet. Un prodige de vingt-et-un ans formé par Brigitte Engerer, laquelle n’aura pas eu le temps de le voir rafler les prix (Concours Reine Elisabeth de Belgique, etc.), et élève à Hambourg du très renommé Evgeni Koroliov. Programme ambitieux - de Bach à Ligeti, suivi des Kreisleriana de Schumann - pour un lieu impressionnant, mais pas facile à apprivoiser, à la proue du vaisseau amiral de verre et d’acier voulu par Bernard Arnault. Son clair et présent du piano (acoustique signée Nagata, comme à Radio France et à la Philharmonie de Paris) mais assez froid et comme décoloré : particularité de l’artiste ou influence physico-psychologique des immenses baies vitrées donnant sur une monumentale (et très belle) cascade en escalier ? Aucune scorie dans le jeu de Rémi Geniet, que ce soit dans le vertigineux Escalier du diable (Etudes, Livre II) de Ligeti ou dans le dépouillement de la 1ère Suite anglaise de Bach, mais une maîtrise qui, dans les cyclothymiques Kreisleriana comme dans les transcriptions de Rachmaninov d’après… Kreisler, bride encore sa personnalité. Public sage comme une image : l’esprit du lieu, là aussi ?
François Lafon
Fondation Louis Vuitton, Paris, 19 décembre Photo © DR

Au théâtre de l’Athénée, Et le Coq chanta…, d’après les Passions de Bach (Matthieu, Jean, et les fantômes de celles de Marc et Luc). Une mise en scène, ou plutôt une allégorie (signée Alexandra Lacroix et François Rougier) pour tenter d’incarner ces monuments de dramatisme qui échappent à tout théâtre. Un repas de famille qui dégénère, douze convives plus un (le Père), parmi lesquels cinq chanteurs, deux comédiens et six instrumentistes. Fil conducteur : la trahison, et pas seulement celle de Judas. D’une Passion à l’autre, d’une version (il y en a plusieurs) de chacune de ces Passions à l’autre, l’éclairage change, le sens se précise et échappe à la fois. Un formidable travail collectif, une façon impressionnante de mettre en avant les corps (mangeant, buvant, souffrant, se baignant, dormant) pour mieux saisir les mots et la musique. Adaptation inventive des airs, chorals et récitatifs à cet effectif de chambre à géométrie variable, dirigé avec sûreté par Christophe Grapperon, plus connu pour son travail dans le répertoire léger avec la compagnie Les Brigands. Une prémonition de Pâques en période de Noël : pas étonnant de la part d’un spectacle qui n’a de cesse de mettre à mal les idées reçues.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 17 décembre Photo © DR

Il est des metteurs en scènes qui, angoissés par le vide, l’accusent ou au contraire cherchent à tout prix à le combler par des mouvements de foule, la mise sur le ventre de chanteurs et autres performances plus ou moins inspirées. Pour La Clémence de Titus, Denis Podalydès tourne le dos à ces modes, conçoit une mise en scène classique au sens le plus noble du terme, lisible, élégante, un écrin idéal pour cet opéra sérieux et éminemment politique, sous-estimé pour avoir été prétendument bâclé entre deux chefs d’œuvres (La Flûte et le Requiem). Sa direction d’acteurs met en valeur l’épaisseur dramatique des protagonistes ici servis par des interprètes exemplaires par la technique, la clarté de la diction et le sens dramatique. Tous... à l’exception d’un Titus qui ne craint rien, pas même la posture du ténor trompétant et fébrile, au service d’un empereur pourtant clément par contrition et non par générosité, homme plein de doutes, mû par les appeaux du pouvoir et la libido (il n’est pas précisé si toute ressemblance avec un ou des régnants actuels est fortuite). Qu’importe, cette Clémence et ses sommets resteront dans les mémoires. Kate Lindsay (Sextus) et Karina Gauvin (Vitella), en particulier, ont suspendu le souffle d’un auditoire toussotant, la première dans le Parto, parto de l’acte I (en dialogue avec la clarinette) et seconde dans le Non piu di fiori de l’acte II (en dialogue avec le cor de basset). Les trois autres interprètes principaux (Julie Fuchs, Julie Bouliane et Robert Gleadow), Jérémie Rohrer, le Cercle de l’Harmonie et l’ensemble vocal Aedes ont été justement salués (contrairement à Denis Podalydès qui a été hué à cette première, ce qui peut être pris pour un compliment) pour la beauté, la tension et la cohérence de cette Clémence.
Albéric Lagier
Théâtre des Champs-Élysées,10, 12, 14 16, 18 décembre 2014. Sur France Musique le 27 décembre Photo © DR

Au Châtelet, première officielle d’Un Américain à Paris, après trois semaines de previews (représentations de rodage) dans la tradition de Broadway. Deuxième volet du triptyque « de l’écran à la scène » (et non le contraire), entre Les Parapluies de Cherbourg (septembre 2014) et Chantons sous la pluie (mars 2015). Coût de la production : 13 millions d’euros. But de l’opération : retrouver le parfum de l’original sans chercher à le copier. Un pari risqué dans le cas de cet Américain, exercice de style à grand spectacle signé Vincente Minelli, reposant sur une intrigue d’opérette et recyclant quelques tubes de Gershwin pour peindre un Paris de carton-pâte où Gene Kelly et Leslie Caron dansent leur idylle entre toiles de maître et autochtones en béret basque. Bons sentiments, clichés sur la France (celle, quand même, de la fin des années 1940, à peine sortie de la guerre), décoration fluide et ballets convenus : un spectacle de Noël, élégant et sans aspérités, à mille lieux des musicals roublards et torturés de Stephen Sondheim (Sweeney Todd, Into the Woods – voir ici et là) dont le Châtelet s’est fait une spécialité. Professionnalisme à l’anglo-saxonne, troupe tous terrains de chanteurs-danseurs-acteurs de laquelle se détache la jeune première Leanne Cope. Triomphe, sold out jusqu’aux fêtes. En mars, le spectacle est repris à New York, où il a été répété. Pour le Châtelet, une consécration. Pour le Palace Theatre (Broadway), une série inespérée de previews.
François Lafon
Châtelet, Paris, jusqu’au 4 janvier. Palace Theater, New York, à partir du 13mars. En direct sur France Musique le 20 décembre à 20h Photo © Théâtre du Châtelet

Série « Turbulences » à la Cité de la Musique : l’Ensemble Intercontemporain invite le DJ et compositeur Marko Nikodijevic. Deux concerts sur le thème du clair-obscur, de Gesualdo l’assassin musicien à Claude Vivier le musicien assassiné pour le premier, de Mozart à … Nikodejevic pour le second. Un pot-pourri postmoderne que cette dernière soirée (quatre heures d’horloge), en trois parties séparées par des entractes où l’artiste aux platines mixe et improvise en compagnie de quelques membres de l’Intercontemporain. Fil conducteur : de la lumière aux ténèbres, du grand jour de Mozart et Stravinsky à l’intrusion du jour dans la nuit et vice-versa selon Thomas Adès, Helmut Lachenmann mais aussi Schubert (Adagio de l’Octuor), pour finir, après les collages détonants de Fausto Romitelli et les réminiscences purcelliennes de George Benjamin, à la création de K-hole/Schwarzer horizon.Drone (with song), une sorte de trou noir musical (avec technique IRCAM) dans lequel Nikodejevic évoque l’antichambre de la mort (le K-hole) où mène l’absorption de kétamine, un anesthésique utilisé comme stupéfiant. Assez hypnotique d’ailleurs ce marathon où les œuvres, judicieusement choisies et appariées, se succèdent sans solution de continuité dans un espace d’ombre et de lumière, et où les virtuoses de l’Intercontemporain jonglent comme jamais avec les styles et techniques. Un spectacle aussi que Nikodejevic à la console, fine silhouette aux gestes précis, roi des dancefloors internationaux et disciple de Marco Stroppa, que Matthias Pintcher, directeur de l’Intercontemporain et compositeur lui-même, décrit comme « un anarchiste merveilleusement poétique ».
François Lafon
Cité de la Musique, Paris, les 5 et 6 décembre

Premier concert à la Cité de la Musique des Lauréats HSBC de l’Académie du festival d’Aix-en-Provence : Andreea Soare et Sabine Devieilhe, accompagnées par François-Xavier Roth à la tête des Siècles. Cinq airs de concert de Mozart parmi les plus virtuoses pour la première, parmi les plus nobles pour la seconde. Cadre approprié (700 places) pour la voix légère mais égale et expressive de celle-ci, triomphe après le double contre-sol (plus haut que la Reine de la Nuit) de l’air Popoli di Tessaglia. Beau succès aussi pour Andreea Soare, timbre doré et style impeccable, pur produit de l’Atelier d’Art Lyrique de l’Opéra. Final en beauté avec le duetto Suzanne-Comtesse du 3ème acte des Noces de Figaro. Première partie incongrue dans ce contexte : la 7ème Symphonie de Beethoven, lecture philologique, tempos d’enfer mais respirant large, factuellement perfectible : si CD il y a, attendons-le, Roth et ses musiciens y tirent en général les leçons de leurs essais en concert. Prochains manifestations Aix-HSBC-Cité (qui s’appellera à l’époque Philharmonie 2) : le Quatuor Bela le 31 mars et, le 4 avril, Trauernacht, le spectacle Bach vedette du festival 2014, mis en scène par Katie Mitchell et dirigé par Raphaël Pichon.
François Lafon
Cité de la Musique, Paris, 2 décembre. 29 décembre à 14h sur France Musique Photo : Andreea Soare © DR

Ante-ante-ante-pénultième concert de l’Orchestre de Paris à Pleyel avant d’émigrer à la Philharmonie : Christian Zacharias dirige Mozart et Schubert, avec le jeune pianiste canadien Jan Lisiecki en soliste. Un Mozart juvénile (Symphonie n° 31 « Paris », Concerto pour deux pianos), un Schubert de dix-sept ans (Symphonie n° 2), fou de Beethoven mais encore attaché au classicisme. Deux mondes tout de même, de part et d’autre de la faille creusée par la vague baroqueuse. Curieuse dichotomie entre la gestique sobre du chef et le son massif de l’orchestre dans la Symphonie « Paris », rappelant l’époque (trente ans déjà) du festival Mozart de Daniel Barenboim. Les musiciens ont pourtant marché avec leur temps, comme ils l’ont montré il y a peu sous la baguette de Giovanni Antonini (voir ici), et comme ils le rappellent après l’entracte dans une 2ème de Schubert bondissante et finement mélancolique. Entre temps, dialogue en porte-à-faux entre Zacharias (dirigeant du clavier) et Lisiecki dans le ludique Concerto pour deux pianos. Double bis opportun : le Presto final dudit Concerto, cette fois plus musclé, plus ludique justement, et en fin de concert, la version allégée (par l’orchestre autant que par Mozart) de l’Andante de la Symphonie « Paris », contribution de l’Orchestre à la Semaine de sensibilisation organisée par la FIM (Fédération Internationale des Musiciens) aux dangers courus par les institutions musicales et lyriques en ces temps de restrictions budgétaires.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 26 et 27 novembre Photo : Christian Zacharias © DR

Au Théâtre des Champs-Elysées, Vadim Repin (violon) et Boris Berezovsky (piano) jouent Debussy, Chostakovitch, Stravinsky et Strauss (Richard). Programme pour happy few, mais public nombreux et extraordinairement attentif. Aucun spectacle pourtant, pas de lutte à mort entre les deux virtuoses, une entente parfaite au contraire, et une sorte de modestie commune : pas besoin de surjouer pour faire apparaître l’énergie du désespoir de la 3ème Sonate d’un Debussy aux portes de la mort, ni d’accentuer le clin d’œil de Stravinsky à Tchaikovski dans le Divertimento tiré du ballet Le Baiser de la fée. Pas la peine non plus de crooner dans la très lyrique Sonate de Strauss, pièce de jeunesse contenant déjà l’orchestre de Don Juan et les voix du Chevalier à la rose. Repin dispense le plus beau son de violon depuis David Oistrakh, Berezovsky met ses immenses moyens au service d’œuvres qui exigent beaucoup du piano sans être toujours payantes : rien que de normal. Deux sourires pourtant, quand le public ne sait s’il est temps d’applaudir après les Préludes op. 34 de Chostakovitch, et quand Repin annonce en bis l'ébouriffant Tambourin chinois de Fritz Kreisler, qu’il joue comme si de rien n'était.
François Lafon
Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 22 novembre Photo : Vadim Repin et Boris Berezovsky © DR

Au Bouffes du Nord : Mimi, scènes de la vie de bohème, librement inspiré de Giacomo Puccini. Même équipe (Frédéric Verrières, compositeur, Guillaume Vincent, metteur en scène, Bastien Gallet, librettiste), même principe que The Second woman, il y a trois ans sur la même scène (voir ici), sauf que le référent n’est cette fois plus le cinéma, mais l’opéra. « Ce que nous voudrions faire, ce n’est pas une transposition de La Bohème, c’est l’arracher au XIXème pour la faire résonner ici et maintenant », déclare Vincent. Un argument souvent entendu, sauf que cette fois, il donne lieu à une véritable réécriture de l’original, à un jeu de sens et de sons, de dérapages et d’anachronismes visant à non pas à dissoudre le vernis du mélodrame, mais à se servir de lui pour faire apparaître l’essentiel sous le périssable. Vaste programme, risquant de perdre en route qui ne connait pas son Puccini sur le bout des doigts. La musique de Verrières est habile, très savante, souvent payante (le numéro Puccini-Alban Berg de la comtesse Geschwitz échappée de Lulu) mais n’évite pas toujours l’effet attendu, et le spectacle – danse de mort d’une jeunesse à la fois idéaliste et désabusée – se prend par moments les pieds dans les matelas de récupération qui couvrent le plateau. Proche de nous pourtant cet univers néo-puccinien - expliqué par Marcello le peintre, joyeux drille et philosophe - où les grandes causes chères à Verdi n’ont plus leur place, et dont le seul sujet est l’amour. Excellent Ensemble Court-circuit dirigé par Jean Deroyer, distribution virtuose, voix lyriques et chanteurs de variétés mêlées. Public jeune, venu en partie pour Camélia Jordana, pop star à la carrière en flèche, assez effacée pourtant en Mimi, éclipsée en tout cas par l’explosive rockeuse franco-allemande Caroline Rose.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 26 novembre. Tournée en janvier-février 2015, puis en 2015-2016 Photo © DR

Concert d’inauguration du nouvel Auditorium de Radio France, deux mois exactement avant l’ouverture de la Philharmonie de Paris. Une arène de 1461 places tout en bois (merisier, bouleau, hêtre) pour remplacer l’ancien « Aquarium » (ainsi nommé en raison de ses murs bronze et de son atmosphère brumeuse). Parterre de VIP ministres (ex- et actuels) compris, mais aussi vrai public profitant de l’opération de réouverture « Passez quand vous voulez » (14-16 novembre). Affiche partagée par les deux orchestres maison, le National dirigé par Daniele Gatti et le Philharmonique par Myung-Whun Chung, l’un avant l’entracte, l’autre après : pas de mélange festif réveillant le spectre d’une fusion toujours redoutée. Programme fleuve, pas festif lui non plus, mais propice aux comparaisons : Boléro (National) et Daphnis et Chloé (Philharmonique) de Ravel, suite du Chevalier à la rose de Strauss (National) et de Roméo et Juliette de Prokofiev (Philarmonique), plus l’ouverture de Tannhäuser de Wagner (National) et l’Ave Verum Corpus de Mozart (Philharmonique), incongru dans un tel contexte mais mettant en valeur le Chœur de Radio France. Un test acoustique grandeur nature aussi : son très présent mais comme à l’étroit, analytique plutôt que synthétique, plus flatteur pour le Philharmonique entraîné par un Chung vif-argent que pour le National lesté par Gatti. Un peu de fête tout de même en bis, où Chung lance à tombeau ouvert le prélude de Carmen, annoncé comme « le véritable hymne national de la France ».
François Lafon
Auditorium de Radio France, Paris, 14 novembre. En replay sur Culture Box, Arte Concert et Dailymotion Radio France. Diffusé ultérieurement sur France 2 Photo © DR

Au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis : Erik Satie, mémoires d’un amnésique, "un petit opéra comique sans lyrics". Connue comme dramaturge et rewriteuse du metteur en scène Laurent Pelly, son auteur Agathe Mélinand note qu’ « il est troublant de faire le portrait d’Erik Satie. Où se diriger, de quel Satie parler ? » En une heure et quart, deux acteurs, deux actrices, deux pianistes-acteurs, des accessoires (bien choisis), des projections (pas envahissantes), beaucoup de musique et pas moins de mots font le tour de la question. Le tour ? Impossible justement. Pour approcher l’inconnu d’Arcueil, ses provocations biaisées et ses multiples personnalités, tout juste peut-on procéder par petites touches, confronter la mélancolie (fût-elle sautillante) de ses musiques faussement simplistes à celle (fût-elle potache, grinçante, surréaliste avant l’heure) de ses déclarations, aphorismes et incongruités, et recycler les stéréotypes (chapeau melon, parapluie, cheval signé Picasso dans le ballet Parade) tout en les cassant. Ce que fait très bien ce spectacle inventif et élégant.
François Lafon
Théâtre Gérard Philipe, Saint-Denis, jusqu’au 24 novembre - Théâtre National de Toulouse, du 2 au 20 décembre – Théâtre Olympe de Gouge, Montauban, le 10 janvier Photo © DR

A L’Athénée avant tournée (jusqu’en 2016), Sur le fil, spectacle inclassable. Pour résumer, un récital du guitariste Philippe Mouratoglou plongé dans un univers de sons (signés Claire Thiébault) et d’objets signifiants : Fernando Sor (L’Enfance), Leo Brouwer (Le Temps vertical), Villa-Lobos (La Vie), Dowland revu par Britten (L’Epure), colonne de sable et pluie de pétales, éventail géant et fantôme de tulle (objets de José Pedrosa). Hélène Thiébault, musicienne et adepte des arts réunis, a conçu ce « conte sans texte pour guitares, lumières, son et objets animés » comme une « alchimie secrète » suivant « l’Homme qui prend conscience d’exister sur le fil qui sépare en même temps qu’il les relie, la réalité et le rêve ». Un fil si ténu, un univers si léger, si fragile que la seule guitare y sert de garde-fou. Mais quelle guitare que celle de Mouratoglou, interprète, improvisateur, compositeur (cinq des douze sections du spectacle sont de lui) et impressionnant funambule des sons !
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, 23, 24 octobre ; Théâtre Jean Vilar, Saint-Quentin (02), 21 avril ; tournée jusqu’en 2016

A Pleyel, l’Orchestre de Paris étrenne le programme Richard Strauss qu’il s’apprête à emporter en Chine (31 octobre – 7 novembre). Au jeu des a priori, on parierait davantage sur Paavo Järvi dans le sérieux Ainsi parlait Zarathoustra que dans la ludique Suite d’orchestre du Chevalier à la rose, avec en simple intermède la Burlesque pour piano. Erreur : Zarathoustra annone et même bégaie (nombreux accrocs), alors que le best of du Chevalier trouve l’orchestre à son meilleur et son chef déchaîné. Quant à la Burlesque, morceau de bravoure pour pianiste casse-cou, elle devient sous les doigts de Nicholas Angelich une grande pièce néoromantique, une folie digitale parsemée d’ineffables abandons que ni Liszt ni Rachmaninov n’auraient osé composer. Salle comble (beaucoup de jeunes) acclamant le pianiste comme une rock star et conquise par les dissonances sucrées du Rosenkavalier. Qui eût dit, il n’y a pas si longtemps, que ce Strauss-là volerait à ce point la vedette à son homonyme Johann ?
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 22, 23 octobre

Nouvelle présentation de L’Enlèvement au sérail au Palais Garnier, la première in loco depuis celle – formidable symphonie d’ombre et de lumière – signée Giorgio Strehler il y a presque trente ans (1985). « J’aime beaucoup jouer avec la convention », annonce Zabou Breitman, qui fait là ses débuts de metteur en scène d’opéra. En effet. Dans une forêt d’arabesques de carton et de fleurs en plastique imaginée par Jean-Marc Stehlé (disparu en août dernier), évoluent des personnages échappés de La Rose pourpre du Caire (le film de Woody Allen) et des Folies Bergère canal historique. Un antidote, selon le chef Philippe Jordan, aux « mises en scène particulièrement sombres » de l’ouvrage « que l’on a pu voir ces derniers temps ». Mais cette version optimiste du singspiel à la turque de Mozart souffre d’un manque d’idées et surtout de rythme que ne rattrape pas la direction raffinée mais majestueuse, résolument anti-baroqueuse de Jordan. Et comme le plateau est correct mais dépourvu de personnalités marquantes (une seconde distribution prendra le relais en janvier 2015), on a du mal à suivre sans ennui cette curieuse tentative de retour à l’opéra de papa.
François Lafon
Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 8 novembre, et du 21 janvier au 15 février. Diffusion en direct le 27 octobre sur Culturebox et le 1er novembre sur France Musique, en différé dans les cinémas UGC dans le cadre de la saison « Viva l’opéra ! » Photo © Agathe Poupeney/Opéra national de Paris

Ouverture de la saison à l'Opéra de Lyon : Le Vaisseau fantôme de Wagner mis en scène par Alex Ollé (La Fura del Baus), déjà artisan in loco (2011) d'un Tristan et Isolde de grande mémoire. Après les Vaisseaux psychanalytiques (Harry Kupfer à Bayreuth), sociologiques (Willy Decker à l'Opéra Bastille), financiers (Jan Philipp Gloger à Bayreuth - voir ici), retour au mythe. Retour ? A voir ce livre d'images en 3D (vidéos virtuoses de Franc Aleu) empruntant à l'heroic fantasy, à la BD d'Enki Bilal ou de Dan (Soda), on a plutôt la sensation d'un retour vers le futur. On y retrouve en tout cas une ouverture au rêve, une dimension mythique ces derniers temps refusées à ce Wagner de jeunesse, proche encore du fantastique alla Weber (Carl Maria). Hantés et hantant, ce cargo d'acier battu par la tempête enfermant dans sa cale le vaisseau fantôme et son équipage, ce cimetière de bateaux où le Hollandais volant demande l'impossible à sa fiancée rêvée, ces spectres de marins infiltrant la société des vivants. Tim Burton non plus n'est pas loin, et l'on imagine Johnny Depp en damné de charme, grand ordonnateur de ce ballet d'ombres. Direction d'acteurs travaillée (Ollé ne se contente pas de produire de belles images), plateau équilibré où une Senta vocalement problématique mais dramatiquement impliquée (Magdalena Anna Hofmann) ne dépare pas un ensemble ou brille Simon Neal (le Hollandais), Falk Struckmann (ex-Hollandais illustre jouant désormais les pères) et le ténor Tomislav Muzek en chasseur (ou combattant ?) égaré dans ce monde voué à l'incertitude des flots. Tout un art de l'insaisissable que, curieusement, l'excellent chef Kasushi Ono ne rejoint que par moments. La force des images, peut-être.
François Lafon
Opéra National de Lyon, jusqu'au 26 octobre Photo © Opéra de Lyon

Le génie de Rameau est d’avoir réussi, dans Castor et Pollux, une alliance rarement aussi achevée entre les trois éléments que sont le chant soliste, le chant choriste et la danse. Mais Christian Schiaretti, le metteur en scène de la production des Champs-Élysées, a peur du vide et du silence, les remplit par de l’action et de la violence, et au lieu de mettre ces trois éléments en sympathie, les oppose avec un parti pris systématique. Aux chanteurs, qu’il laisse désespérément sans direction de scène, il demande de chanter vite et fort. La consigne, peu baroque et donnée à une distribution plus à l’aise dans le bel canto verdien que dans la tragédie lyrique, fait voler en éclat diction, prosodie, et affects de l’opéra à la française. A ce rythme, l’interprétation d’Hervé Niquet tient de la performance physique. Le Concert Spirituel, ses bois et ses vents superbes, ne mérite pas un tel traitement, inhabituel certes. Même précipitation et agitation continues en matière de danses, quelles que soient les circonstances : la chorégraphie pourtant inventive d’Andonis Foniadakis sacrifie l’expressivité à la performance. Alors, que reste-t-il de ce Castor et Pollux ? Des chœurs, ceux du Concert Spirituel, en force eux aussi, mais qui parviennent à restituer les subtilités ramistes. Et comme Rameau leur a fait la part belle, sous leur souffle inspiré, Castor et Pollux se transforme en un opéra pour chœur avec intermèdes solistes. Pour notre plus grand plaisir, même si on s’attendait à autre chose.
Albéric Lagier
Théâtre des Champs Elysées 15, 17, 19 et 21 octobre Photo © TCE

Au Théâtre des Champs-Elysées, Julia Fischer (violon) et Yulianna Avdeeva (piano) parcourent trois siècles de sonates : Bach (Sonate BMW 1016), Brahms (Sonate n°3), Prokofiev (Sonate n° 1), plus le Scherzo signé Brahms de la Sonate FAE (Schumann-Brahms-Dietrich). Un tandem nouvellement constitué pour des œuvres réclamant une entente de vieux couple. Deux personnalités contrastées surtout, la rigoureuse violoniste allemande – vedette des estrades depuis une bonne décennie – rencontrant la lauréate réputée volcanique du Concours Chopin de Varsovie en 2010. Pas de rivalité apparente dans Bach : violon chantant, piano tricotant selon une tradition ignorant les canons actuels d’interprétation. Le dialogue s’instaure avec Prokofiev : atmosphère menaçante pour cette 1ère Sonate, challenger austère de la plus célèbre 2ème. Impression déjà que Julia Fischer, qui joue sans pupitre ni partition, occupe l’espace, la pianiste restant en retrait. Impression confirmée dans le Scherzo FAE, où le son du piano ne « sort » pas (comme on dirait d’une voix), infirmée dans la Sonate de Brahms, où le tempérament de Yulianna Avdeeva s’impose enfin face au violon rayonnant de Julia Fischer. Equilibre presque parfait dans les bis (Mélodie de Souvenir d’un lieu cher de Tchaikovski, Intermezzo de Schumann pour la Sonate FAE). Aux saluts, Julia Fischer embrasse chaleureusement sa partenaire tétanisée. A la ville comme à la scène…
François Lafon
Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 14 octobre Photo © DR

Nouvelle Tosca de Puccini à l’Opéra Bastille, remplaçant la version Werner Schroeter (1994) maintes fois reprise (voir ici). Vœux pieux du metteur en scène Pierre Audi : faire affleurer la tragédie grecque sous le mélodrame, ritualiser la fable emblématique de la diva sacrifiée, exalter la symbolique des objets (fleurs, éventail, chandeliers, crucifix). Résultat curieux, dichotomie entre action « comme d’habitude » (conventions comprises) et scénographie décalée : croix géante omniprésente, lascives Oréades de Bouguereau remplaçant la Marie-Madeleine peinte par Mario, intérieur de Scarpia façon garçonnière chic, dernier acte sur une grève (bords du Tibre, plage d’Ostie, là où Pasolini a été assassiné ?) Absence de direction d’acteurs surtout, figeant le spectacle, laissant une impression d’inachevé. Sous la baguette plus solennelle que sensible de Daniel Oren, Martina Serafin (Tosca) a du mal à briser la glace, Marcelo Alvarez (Mario) place ses effets, Ludovic Tézier (Scarpia) reste sur son quant-à-soi. On les a tous les trois entendus autrement concernés. Plusieurs distributions sont prévues jusqu’à fin novembre.
François Lafon
Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 28 novembre - En direct au cinéma le 16 octobre, sur Culturebox à partir du 17 octobre puis en différé sur France 2 – Sur France Musique le 25 octobre Photo © C. Duprat-Opéra national de Paris
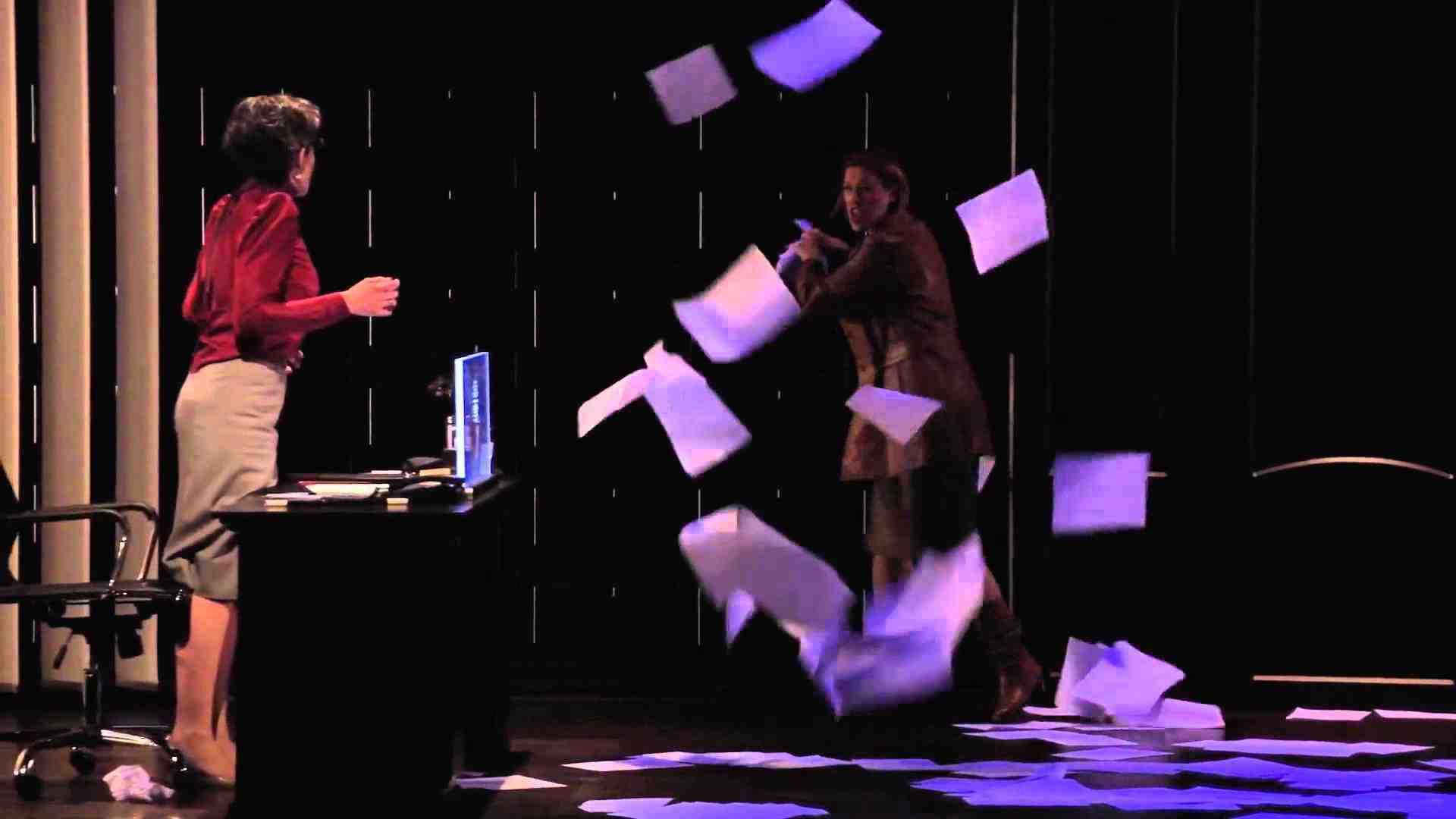
Rareté à l’Athénée : The Consul de Gian-Carlo Menotti. Un opéra créé à Broadway (1950), comme son auteur américain mais attaché à ses racines italiennes. Ambitieux aussi : livret à thèse (c’était l’époque de Sartre et de Camus), musique « néo » (on l’a beaucoup reproché à Menotti) mais complexe. A l’époque, un triomphe (prix Pulitzer, etc .) : « C’est mon histoire que vous racontez » écrivait une spectatrice, bouleversée par le drame de cette épouse de dissident, entre régime totalitaire et bureaucratie généralisée. Bérénice Collet, la metteur en scène de ce spectacle créé au printemps dernier au Théâtre Roger-Barat-Ville-d’Herblay (Val d’Oise) remarque qu’« aujourd’hui, les peuples (européens notamment) ne sont plus tant oppressés par des régimes politiques que par le pouvoir des multinationales ». Bien vu, et pas trop visible : pas plus que Menotti, elle ne situe nettement l’histoire dans le temps et l’espace. Rien de plus daté pourtant que cette musique où passent Puccini, Moussorgski et Kurt Weill (période américaine), que ce livret bien ficelé mais aux effets téléphonés (sans jeu de mots : à la fin, l’appel fatidique sonne dans le vide). Mieux qu’un exercice de style quand même pour une impeccable troupe française de laquelle se distinguent Valérie MacCarthy (Magda Sorel, l’héroïne) et Béatrice Dupuy (la Secrétaire pas si inflexible), sous la direction du jeune Inaki Encina Oyon. Salle comble, triomphe final : « C’est très moderne », affirme un connaisseur approuvé par ses voisins.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 12 octobre Photo © DR

Dans le cadre de France-Chine 50 (1964, établissement de relations diplomatiques entre les deux pays), Long Yu, directeur artistique de plusieurs grandes formations chinoises, dirige un programme tout XXème siècle avec l’Orchestre de Paris. Un festival de tubes en fait : Adagio pour cordes de Barber, Variations sur « I got Rhythm » de Gershwin, Roméo et Juliette (suites) de Prokofiev. Hiatus entre la gestique agitée du chef et le son tout confort qu’il obtient de l’orchestre. Rien de mou cependant, si ce n’est une "Marche des Montaigu et des Capulets" (tube suprême) étrangement lente, plus lourde que martiale. Clou de la soirée : la création française du Concerto pour piano et orchestre « Er Huang » de Qigang Chen avec Jean-Yves Thibaudet en soliste. Naturalisé français, élève d’Olivier Messiaen, le compositeur est aussi connu pour avoir mis en musique la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin : l’homme de la situation, d’une certaine manière. Son Concerto, inspiré d’un air célèbre de l’Opéra de Pékin, commence comme du Ravel et finit comme du Rachmaninov, le tout parsemé de références à la musique traditionnelle chinoise. Qu’en aurait dit Messiaen, lequel remarquait en Qigang Chen une « parfaite assimilation de la pensée chinoise aux conceptions musicales européennes » ? Intéressant en tout cas de comparer cette musique consensuelle aux inventions débridées de Gershwin (lequel était d’ailleurs fasciné par Ravel). Comme le prouve Prokofiev revenu, avec le réaliste et socialiste Roméo et Juliette, de ses incartades musicales en terre capitaliste, la modernité n’est pas seulement affaire de chronologie.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 1er et 2 octobre En photo : Qigang Chen © DR

Rentrée musicale au théâtre de l’Athénée : Canti d’amor, musique de Monteverdi, par l’Ensemble des jeunes du Muziektheater Transparant (Antwerpen, Belgique). Wouter Van Looy, le metteur en scène, a imaginé un montage d’extraits de madrigaux à partir de l’Arianna, considéré à son époque comme le plus bel opéra de Monteverdi, dont le livret nous est parvenu mais pas la musique, si ce n’est un Lamento célèbre. Belle idée a priori que cet opéra en creux, nourri de pièces qui sont comme un atelier du théâtre en musique. « Certains chanteurs ont ce talent incroyable de rendre leur imagination visible avec leur voix et la présence de leur corps, presque sans rien faire. Les jeunes ont fréquemment ce talent, qu’ils perdent souvent quand ils veulent approfondir les techniques de chant et de dramaturgie », explique Van Looy dans sa déclaration d’intention. Mais l’exercice est un peu ardu pour la quinzaine de stagiaires à la technique encore verte, ayant pour tout bagage un scénario assez incompréhensible fondé sur l’idée que l’on ne ressent ni n’exprime mieux l’amour et ses tourments que lorsqu’on est jeune et inexpérimenté. Autre atmosphère, autre monde dans la fosse, où le chef Nicolas Achten dirige un ensemble non moins jeune mais remarquablement au point, accréditant l’idée que le madrigal est un théâtre pour l’oreille auquel la scène ne peut offrir qu’un complément redondant.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 28 septembre. Le 26 septembre à 19h : présentation par le musicologue Philippe Cathé Photo © DR

Nouvelle présentation du Barbier de Séville de Rossini à l’Opéra Bastille, empruntée au Grand Théâtre de Genève. Pourquoi pas - en ces temps de restrictions budgétaires - une reprise de la mise en scène plutôt réussie de Coline Serreau, au répertoire depuis 2002 ? Volonté de Stéphane Lissner, nouveau directeur de la maison, de rompre avec le passé ? On jurerait en tout cas que le spectacle signé Damiano Michieletto a été conçu pour le plateau géant de Bastille, avec sa maison tournante de trois étages, où l’on suit comme au cinéma les courses poursuites et les parties de cache-cache des protagonistes, mais aussi la vie très animée de tout un petit peuple. « Je préfère appréhender les œuvres de Rossini en m’appuyant sur des références modernes », explique Michieletto, qui ne fait en cela que suivre la mode. De fait, son actualisation mi-Pedro Almodovar mi-Dino Risi, inventive, souvent drôle, débouche sur une interprétation plutôt traditionnelle de l’ouvrage (rien n’empêche la jeunesse de s’émanciper), là où celle de Coline Serreau (l’Afrique du nord, une fille échappant à un mariage forcé) posait des questions plus actuelles, en tout cas plus aigues. Plateau équilibré, où l’on retrouve quelques grands titulaires (Karine Deshayes en Rosine, Dalibor Jenis en Figaro), direction vivante et précise du spécialiste Carlo Montanaro. Deux distributions en alternance : peut-être à l’usage le spectacle acquerra-t-il le grain de folie alla Marx Brothers qui lui manque encore et le rendra totalement irrésistible.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, jusqu’au 3 novembre. Diffusion en direct au cinéma le 25 septembre et sur Culturebox à partir du 26 septembre. En différé sur France 3. Photo © Opéra de Paris - B. Coutant

A l’Oratoire du Louvre, Skip Sempé dirige le Requiem de Gilles revu et augmenté à l’occasion du service funèbre de Rameau (même lieu le 27 septembre 1764). Même plateau que pour le disque (voir ici), mais version encore plus étoffée d’ajouts ramistes. Un beau monstre pour un chef-d’oeuvre qui en a vu d’autres, utilisée pour les funérailles de Louis XV ainsi que pour celles, entre autres, de Campra, Stanislaw Leszczynski et Gilles lui-même, lequel s’en était réservé la primeur après l’avoir refusé à un commanditaire mauvais payeur. Etrange choix tout de même que cette musique typiquement XVIIème - bien que réinstrumentée et carrément postdatée dans les années 1760 - pour honorer un des compositeurs les plus novateurs du XVIIIème, provocation même lorsque la soprano (la charmante Judith van Wanroij) se lance dans un Pie Jesu mis en musique à l’italienne par Domenico Alberti, comme si Rameau n’avait pas représenté le parti français dans la Querelle des Bouffons. L’ensemble se tient pourtant, parce que le plateau est somptueux (magnifique Collegium Vocale de Gand, le choeur de Philippe Herreweghe), et que Skip Sempé s’entend à y faire souffler l’esprit qui réunit l’église et l’opéra.
François Lafon
Oratoire du Louvre, Paris, 17 et 18 septembre, dans le cadre de Terpsichore 2014. Autres concerts les 25 et 26 octobre, salle Erard (Skip Sempé - Pierre Hantai - Olivier Fortin, clavecin) - www.terpsichore-festival.com

Jouer dans un même concert du pianoforte et du piano moderne, pourquoi pas ? Cela se pratique assez couramment, avec des œuvres de la même époque, c’est-à-dire de la fin XVIIIème, ou d’époques très différentes. Dans le cadre des Journées romantiques qui ont lieu sur la Péniche Anako amarrée dans le bassin de la Villette à Paris, Daniel Isoir et Michel Benhaïem ont interprété la transcription pour piano à quatre mains, du Sacre du Printemps de Stravinski, réalisée par le compositeur lui-même. Ce dernier ne chercha pas tant à reproduire au piano les timbres de l’orchestre, ce que pourtant en certains passages il réussit brillamment, qu’à en mettre en valeur les possibilités harmoniques et percussives. L’œuvre est d’une force telle que l’auditeur reconstitue aisément. Avant Stravinsky, Carl Philipp Emanuel Bach et Mozart étaient prévus au programme avec une des très capricieuses fantaisies du premier et la vaste sonate pour quatre mains en fa majeur KV 497 du second. Elle aurait pu faire contrepoids au Sacre, mais elle fut remplacée par les plutôt sages variations en sol majeur KV 501, probablement sur un thème de Mozart lui-même, et complétée par le rondo en la mineur qui apporta une touche de poésie.
Marc Vignal
Péniche Anako, 14 septembre 2014. La programmation de ces Journées est étalée sur une bonne semaine, avec des formations et des compositeurs très divers. Photo © DR

Concert de rentrée de l’Orchestre de Paris à Pleyel – en attendant la Philharmonie début 2015 : Maxim Vengerov joue le Concerto pour violon de Brahms. Curiosité : adulé il y a vingt ans, talonné par son condisciple Vadim Repin- comme lui élève du maître Zakhar Bron à Novossibirsk -, accusé d’abuser des défauts de ses qualités (précocité/facilité, brillant/superficialité, émotion/sentimentalisme), il a redoré son blason, entre autres en pratiquant la direction d’orchestre. Tel qu’en lui-même cependant : le cœur sur la main, la sonorité à peine moins riche qu’à ses débuts, il prend tous les risques, néglige par moments la justesse mais emporte son public. Curieux attelage que ce grand lyrique face à Paavo Järvi, brahmsien cérébral, menant un orchestre impeccable comme un général ses troupes, sans pourtant entraver le soliste, lequel se lance à la fin du premier mouvement dans une cadence à haut risque, véritable pièce de concert au sein du concerto, et se défoule en bis en annonçant « un cadeau. Jules Massenet, Thaïs, pas tout : la Méditation ». Dix minutes de kitch succulent, ovation de la salle. Une façon d’annoncer la seconde partie française : 3ème Symphonie de Roussel, La Valse de Ravel. Järvi parfait pour déchaîner la folie rythmique de la première sans oublier de mettre en valeur les solistes qui sont la force de l’orchestre, un peu trop rationnel pour aller jusqu’au bout des dérapages grinçants du trois temps ravélien.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 10 et 11 septembre Photo © DR

"Grande ouverture festive" du Festival Berlioz à La Côte Saint-André. Cette année : "Berlioz en Amérique, au temps des révolutions industrielles". Rutilantes à l'entrée de l'usine-pensionnat Girodon de Saint-Siméon-de-Bressieux - vestige du temps où les soyeux faisaient vivre la région -, les deux cloches de la Symphonie fantastique fondues l'année dernière. Pour commencer, jeux anciens, cavalière en amazones, machines d'époque; pour finir, envol de montgolfière (préparée par un Montgolfier pure souche), bal cajun et feu d'artifice. Foule compacte sous la grande verrière et dehors devant un écran géant pour la reconstutution du "concert monstre" imaginé par Berlioz en 1844 à l'occasion de l'Exposition à Paris des produits de l'industrie. En honorant Berlioz novateur, inventeur du concept de festival, agitateur d'idées autant que musicien, le directeur Bruno Messina traite le sujet, et tout le sujet. Berlioz n'est jamais allé en Amérique ? Non, mais il en a rêvé, et a été tout autant un enfant de l'ère industrielle qu'un romantique cheveux au vent. A concert monstre, programme monstre, mélange de tubes de l'époque et de déjà grands classiques, de chefs-d'oeuvre universels et d'hymnes cocardiers, terreau commun du mélange shakespearien (ou hugolien) de grotesque et de sublime, de concessions et d'innovations qui font le génie berliozien. Pas loin de mille participants, orchestres Symphonique de Mulhouse et des Pays de Savoie, choeur (professionnel) Emelthée et choeurs amateurs de la région réunis sous la baguette de Nicolas Chalvin, assez ferme pour fédérer les troupes et organiser le choc de Spontini avec Beethoven, de Gluck et de Meyerbeer, d'Auber et de Mendelssohn, et bien-sûr de Berlioz avec Berlioz, dont l'Hymne à la France rejoint le choeur du Charles VI d'Halévy ("Jamais l'Anglais ne règnera"), et dont la Marche au supplice de la Symphonie fantastique sonne comme un pied-de-nez dans un tel contexte. Deux Marseillaise (orchestration Berlioz) pour finir. Pièce de concert ou hymne national? Le public, édiles compris, ne s'est levé que la seconde fois.
François Lafon
Festival Berlioz, La Côte Saint-André, du 21 au 31 août. www.festivalberlioz.com Photo © DR

Parmi les nombreuses tâches que doit remplir Bach en tant que cantor à Saint-Thomas de Leipzig, il a celle d’assurer la musique des services funèbres. Les musiciens et lui-même doivent être sur place un quart d’heure à l’avance, et c’est lui qui doit choisir les chants et motets entendus durant la cérémonie. En général, il puise dans le recueil de motets imprimé « Florilegium portense ». Si au contraire on désire des textes tirés entièrement ou en partie de l’Ecriture, Bach doit, sur commande de la famille et des proches, composer et faire étudier un nouveau motet : terme désignant à l‘époque un morceau polyphonique de caractère religieux, alors qu’au Moyen-Age, le motet relevait du répertoire profane. Des six motets de Bach ayant survécu, tous en langue allemande, cinq semblent avoir été destiné à de telles circonstances, le premier d’entre eux, Singt dem Herrn ein neues Lied (Chantez au Seigneur un chant nouveau) pour double chœur, étant peut-être une musique de nouvel an. La Maîtrise Notre-Dame-de-Paris et la Maîtrise de Radio France avaient à remplir le vaste espace de la cathédrale, et peu à peu cela s’est produit, l’oreille s’y est faite. En particulier à la fin, avec le jubilatoire Lobet den Herrn, alle Heiden (Louez le Seigneur, toutes les nations), d’authenticité parfois discutée. Fascinant était de constater la façon différente qu’avaient de diriger Lionel Sow (sobriété, peu de gestes) et Sofi Jeannin (enthousiasme, engagement). Le bref et subtil Immortal Bach du Norvégien Knut Nystedt, né en 1915, concluait dans l’émotion ce beau concert.
Marc Vignal
Notre-Dame-de-Paris, 1er juillet 2014 Photo © DR

Aux Bouffes du Nord, L’Annonce faite à Marie de Paul Claudel (3ème version – 1911 – la plus mystique). En 1948, lors de la création de la 4ème et dernière version, l’auteur poussait les acteurs à la grandiloquence, alors que le metteur en scène insistait sur l’aspect terrien de ce concentré de claudelisme : moyen-âge de convention, baiser au lépreux, résurrection de l’enfant mort pendant la nuit de Noël, sacrifice de la jeune fille Violaine. Yves Beaunesne, qui a monté le spectacle, parle de « l’intuition d’un opéra sans paroles », et a lui aussi voulu prendre en compte le grand écart entre le sublime et le trivial qui fait le verbe claudélien. Il a demandé au compositeur Camille Rocailleux de musicaliser la pièce, ou tout au moins d’en concentrer le sublime dans des intermèdes à deux violoncelles, ou dans des pauses vocales étranges, à la fois grégoriennes et folkloriques, tandis que le texte est joué « moderne », sans emphase, la « force de profération » (dixit Antoine Vitez) remplaçant les envolées poétiques. A la fois personnages et officiants, les acteurs évoluent sur une corde raide : formidable Judith Chemla – qui a joué et chanté Didon et Enée sur la même scène (voir ici) – tonnant Jean-Claude Drouot, sorte de roi Lear portant sa fille morte, émouvant Thomas Condemine, réussissant « O ma fiancée parmi les branches en fleurs » comme un véritable chant parlé, violoncelles extraordinairement expressifs de Myrtille Hetzel et Clotilde Lacroix. Un équilibre que n’ont pas toujours trouvé les musiciens (et pas des moindres, de Darius Milhaud à Philippe Boesmans) qui ont tenté d’apprivoiser cette pièce magnifique et un peu effrayante.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 19 juillet. Tournée d’octobre à décembre (Luxembourg, Lattes, Niort, Saint-Etienne, Meyrin, Nîmes, Perpignan) Photo © Guy Delahaye

Aux Bouffes du Nord, Le Saphir, opéra comique en trois actes de Félicien David, final du 2ème festival parisien du Palazzetto Bru Zane, centre de musique romantique française établi à Venise. L’oeuvre la plus oubliée de celui à qui Berlioz disait : « Ce que vous avez fait est très grand, très neuf, très noble et très beau », mais qu’on ne connaissait plus que pour avoir mis à la mode l’orientalisme musical (Le Désert, 1844). Un ouvrage maudit que ce Saphir, tiré de la comédie peu connue de Shakespeare Tout est bien qui finit bien (cela ne s’invente pas) : grave maladie du compositeur pendant qu’il y travaillait, incendie sur scène le jour de la première, critique acerbe (« Il n’aurait pas dû descendre de son chameau »). Contre toute attente, un temps fort de l’entreprise de réhabilitation de David le disparu entreprise par le Palazzetto, après Le Désert et Herculanum ce printemps et avant Christophe Colomb cet été. Présentée comme un ouvrage de salon, avec neuf excellents instrumentistes venus du Cercle de l’Harmonie (parce qu’en plus, la partition d’orchestre a été perdue) accompagnant un sextuor vocal de luxe (Cyrille Dubois et Gabrielle Philiponet en tête), cette proto-opérette pleine de mélodies pimpantes et d’ensembles pétaradants confirmera les thuriféraires de David dans l’idée que « qui peut le plus peut le moins », et les autres dans celle qu’il aurait dû cultiver davantage ce genre de répertoire.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, 19 juin Photo © Palazzetto Bru Zane - Michele Corsera

Salieri (1799), Nicolai (1849), Verdi (1893) et Vaughan Williams (1929) ont tous composé un opéra d’après Les Joyeuses Commères de Windsor de Shakespeare, seul celui de Nicolai reprenant le titre de la pièce. Otto Nicolai (1810-1849) a survécu dans les mémoires grâce à cet ouvrage, créé à l’Opéra de cour de Berlin deux mois avant sa mort soudaine, et comme fondateur des Concerts philharmoniques de Vienne. Die lustigen Weiber von Windsor est un des meilleurs opéras bouffes qu’ait produit l’Allemagne au XIXème siècle. L’Italie (que Nicolai connaissait bien) est présente, en particulier dans les ensembles, mais aussi Carl Maria von Weber (évocation de la forêt de Windsor et du légendaire chasseur Herne), sans oublier, dès la célèbre ouverture, l’opérette naissante. L’Opéra de Lausanne joue le jeu, avec une mise en scène des plus vivantes du franco-germanique David Hermann. Chant dans la langue originale, mais avec interpolations de dialogues en français actualisant non sans humour les situations. Sir John Falstaff (le baryton-basse Michael Tews) est à Lausanne moins un personnage de chair et de sang que le fantasme insaisissable aussi bien des deux « commères » qu’il poursuit en vain de ses assiduités que du mari jaloux qu’est M. Fluth (chez Shakespeare Mr Ford). Un « Psy » se mêle de la partie, et un vent de folie souffle, par-delà la solide présence scénique de la troupe, en particulier de la soprano roumaine Valentina Farkas (Mme Fluth). Ce qu’on voit et entend à la fin, quand les masques sont supposés tomber, est une réjouissante bacchanale : tout le monde, y compris l’orchestre dirigé par Frank Beermann, s’en donne à cœur joie. Un beau séjour à Windsor, sous le signe de la verve et du charme mélodique.
Marc Vignal
Opéra de Lausanne, 15 juin 2014 Photo © M. van Appleghem

Dernier musical de la saison au Châtelet : Le Roi et moi de Richard Rogers et Oscar Hammerstein II. Le Roi et moi sans Yul Brynner, à la scène comme à l’écran (et même à la télévision, en feuilleton) le roi du Siam séduit par une institutrice galloise venue faire la classe à sa nombreuse progéniture ? Qui se souvient du remake Anna et le roi, avec Jodie Foster et… qui déjà ? Comme d’habitude au Châtelet, ce fleuron de Broadway fait l’objet de soins rares à Broadway même : mise en scène fastueuse, orchestre symphonique, distribution de premier ordre. Le musical élevé au rang de classique : aussi bonne comédienne que grande chanteuse, Susan Graham (en alternance avec Christine Buffle) ferait passer la musique de Rogers pour ce qu’elle n’est pas tout à fait. Le metteur en scène Lee Blakeley – régisseur maison du cycle Stephen Sondheim – ne nous épargne aucune chinoiserie (pardon, siamoiserie), mais après tout l’ouvrage est ainsi, traitant un sujet riche (une civilisation peut-elle se donner comme dominante ?) avec un mélange de rouerie et de naïveté qui agace d’abord, amuse ensuite, et finit par attendrir. L’adaptation locale de La Case de l’oncle Tom, offerte au deuxième acte par le Roi pour prouver aux Anglais qu’il n’est pas un barbare, en dit long sur la question (excellente chorégraphie de Peggy Hickey). Et le Roi justement ? Cheveux peroxydés, plus torturé qu’autoritaire, s’autorisant du fait que le véritable Rama IV avait une dégaine d’intellectuel, Lambert Wilson ne cherche pas à concurrencer le charme brutal de Yul Brynner. Comme il le dit lui-même : « Lorsqu’on parle de Brynner à des jeunes de vingt ou trente ans, ils ne le connaissent pas. C’est un peu triste, mais cela me libère ».
François Lafon
Châtelet, Paris, jusqu’au 29 juin Photo © DR

Excursion annuelle à l’Athénée de l’Opéra Studio de l’Opéra du Rhin : La Colombe de Gounod et Le pauvre Matelot de Darius Milhaud. Deux raretés, deux exercices de chant français de haute école, à part cela aussi différents que possible, si ce n’est que dans le genre opéra-comique Second Empire pour le premier (d’après Boccace et La Fontaine tout de même), drame concentré façon Groupe des Six pour le second (livret de Jean Cocteau), ils traitent du même sujet éternel : on tue toujours ce qu’on aime, et parfois même on le mange (mais chut…). Mise en scène par Stéphane Vérité, dont Les Enfants terribles (Cocteau déjà, Phil Glass pour la musique) avaient confirmé, à l’Athénée il y a deux ans, le talent de créateur d’images scéniques, la promotion 2014 de l’Opéra Studio fait preuve d’enthousiasme, de discipline et d’un louable effort de diction. Bien malin qui pourrait pronostiquer la réussite de l’un ou de l’autre, même si l’on est tenté de miser sur la mezzo Lamia Beuque, vif-argent en travesti de comédie. L’Orchestre Lamoureux, fermement tenu par Claude Schnitzler, fait sans douleur le grand écart entre les rondeurs de Gounod et les escarpements de Milhaud.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée jusqu’au 15 juin. Strasbourg, Opéra, 1er et 3 juillet Photo © DR

Au Palais Garnier, Le Couronnement de Poppée dans la mise en scène de Bob Wilson, en co-production avec la Scala de Milan. Au prologue de ce chef-d’œuvre fleuve, dernier de Monteverdi (aidé de quelques confrères) et premier (1642) à s’inspirer de l’Histoire, on voit la Fortune et la Vertu coiffées au poteau par l’Amour, moteur des passions humaines. Or Wilson et le chef Rinaldo Alessandrini semblent s’employer à prouver le contraire. Le premier séduit toujours par son génie de scénographe et d’éclairagiste, mais son spectacle est figé dans la stricte observance de sa doxa personnelle : chanteurs face à la salle, gestuelle codée, déplacements symétriques. Aucune folie, très peu d’érotisme, plus rien de l’hystérie qui mènent Néron et sa cour revus par le Seicento, plus grand-chose non plus du mélange des styles qui a valu à l’ouvrage le qualificatif de shakespearien. Reste une démonstration clinique de la leçon - toujours actuelle : « Fréquenter les princes est affaire périlleuse. L’amour et la haine n’ont pas de prise sur eux : seul les affecte leur intérêt ». A la tête de son très raffiné Concerto Italiano, Alessandrini opte lui aussi pour le régime minceur : orchestration minimale, élans lyriques bridés, mise en avant du texte. Les chanteurs trouvent plus ou moins leurs aises dans un tel carcan : Néron éteint (le ténor Jeremy Ovenden), Poppée concentrée sur ses beautés vocales (Karine Deshayes), Sénèque ni très philosophe ni très politique (Andrea Concetti), mais Drusilla rayonnante (Gaëlle Arquez) et Octavie délicieusement venimeuse (Monica Bacelli).
François Lafon
Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 30 juin. En direct sur France Musique le 14 juin Photo © DR

Concert russe à Pleyel, par l’Orchestre du Capitole de Toulouse et son directeur musical Tugan Sokhiev. Mise en train avec la Suite Katerina Ismaïlova, musique débridée qui valut à l’opéra dont elle est tirée le qualificatif « pornographique » décerné par Staline lui-même. Arêtes tranchantes, rythmes frénétiques dont un Nino Rota fera son miel, orchestre impeccable. Un ton plus haut, les Variations rococo de Tchaikovski avec le jeune violoncelliste Narek Hakhnazaryan : archet sûr, grand son, large palette expressive, orchestre aux petits soins. Plus haut encore les bis, où le strict virtuose se transforme en Jimi Hendrix du violoncelle, et met la salle à ses pieds en jouant et chantant du Giovanni Sollima (compositeur sicilien pétri de jazz et de rock). Seconde partie un ton en-dessous avec une Symphonie « Pathétique » collant aux instruments, où l’on ne retrouve pas - tant s’en faut - le vif-argent de la première. A l’entracte, salve d’applaudissements pour Narek Hakhnazaryan venant assister à la suite du concert. C’est sa soirée, décidément.
François Lafon
Halle aux Grains, Toulouse, 4 juin, Salle Pleyel, Paris, 5 juin. Photo © DR

Nouvelle Traviata à l’Opéra Bastille, mise en scène par le cinéaste Benoit Jacquot. Deux options pour appréhender ce tube de l’art lyrique : rédemption par l’amour de la Dévoyée – angle de vue qui a enfanté et enfante encore toute une littérature lacrymale et bien-pensante – ou portrait d’une irrécupérable, dont la mort seule peut satisfaire la société, et dont la clé réside dans le cri de l’agonisante : « Mourir si jeune ! ». En décembre dernier à la Scala de Milan, Diana Damrau dirigée par le metteur en scène Dmitri Tcherniakov incarnait jusqu’au malaise cette femme broyée. La voilà aujourd’hui à Paris en Traviata première option, dans un spectacle qui se veut à la fois respectueux et signifiant, mais finit par ne plus signifier grand-chose. Jacquot, dont le Werther sur la même scène (voir ici) était comme réanimé de l’intérieur, se contente cette fois de laisser les chanteurs faire comme d’habitude, dans un décor réduit à quelques éléments encombrants (dont un lit géant, au cas où l’on n’aurait pas compris que…) perdus dans un espace ouvert où se perd aussi le son. Est-ce pour cela que le chef Daniel Oren dirige à gros traits ? Damrau – voix aérienne aux aigus filés alla Caballé – n’exprime rien que de conventionnel mais enchante les amoureux de belles notes, tandis que le ténor Francesco Demuro s’égosille et que le baryton Ludovic Tézier campe un père noble dans la grande tradition. Triomphe collectif au rideau final, comme si La Traviata n’était pas aussi un chef-d’œuvre de théâtre en musique.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, jusqu’au 20 juin. En direct le 7 juin sur France Musique et le 17 à 19h30 dans des salles UGC et indépendantes dans le cadre de la saison Viva l’opéra Photo © Opéra de Paris

Né en 1928, Einojuhani Rautavaara est sans doute le doyen des compositeurs finlandais vivants, et un de ceux dont la personnalité est la plus diverse : c’est à la fois un romantique, un mystique et un intellectuel, et il a connu une période sérielle. La célébrité lui vient tôt, avec Requiem in Our Time pour orchestre à vents (1953), et grâce à Sibelius, il obtient une bourse pour étudier deux ans à Tanglewood et à New York, où il apprend ce que veut dire « Etre européen ». Dans une production abondante, on relève notamment neuf opéras (le dernier en 2003) et huit symphonies (la dernière en 1999). Son compatriote Mikko Franck, qui deviendra en septembre 2015 directeur musical du Philharmonique de Radio France, a dirigé à la tête de cet orchestre deux de ses partitions. Cantus Articus (1972), « Concerto pour oiseaux et orchestre », est son ouvrage le plus joué dans le monde. Les oiseaux ne sont pas ceux de Messiaen, Rautavaara les a enregistrés dans le Grand Nord, la source sonore est une bande magnétique. Le Concerto pour violon (1976), musique souvent arachnéenne, exige du (ou de la) soliste et de l’orchestre une virtuosité non tapageuse et surtout un sens développé des nuances et des sonorités. Hilary Hahn a remporté un triomphe, y compris de la part de l’orchestre, lui aussi plus qu’à la hauteur. Le Prélude à l’Après-Midi d’un Faune et La Mer de Debussy par Mikko Franck ? Maîtrise de la durée, belle alchimie sonore.
Marc Vignal
Salle Pleyel, 23 mai 2014. Prochain concert avec les mêmes et la Symphonie 8 de Rautavaara le 30 mai Photo © DR

Au théâtre de l’Athénée, Le Balcon de Peter Eötvös par l’ensemble Le Balcon, dirigé par Maxime Pascal. Hasard ou prédestination ? L’ouvrage revient de loin. Lors de sa création en 2002 au Festival d’Aix-en-Provence dans une mise en scène tirée au cordeau de Stanislas Nordey, il avait fait un flop : pourquoi ajouter une couche de musique au mille-feuilles imaginé par Jean Genet – rituel, masques, faux-semblants, faux représentants de l’autorité retranchés dans un bordel tandis qu’au-dehors gronde une vraie (?) révolution. Douze années et quelques remaniements plus tard, le metteur en scène Damien Bigourdan s’affranchit de la malédiction jetée par Genet sur quiconque (sauf Roger Blin) osait monter son théâtre, et s’appuie autant sur la musique – où passent Boulez et Weill, Bizet et le baroque, le son IRCAM (superbe traitement de l’électronique) et la chanson – que sur le texte, finement adapté par Françoise Morvan. A l’image de la maquerelle et maîtresse de cérémonie Madame Irma, distribuée au formidable contre-ténor Rodrigo Ferreira, le spectacle transforme l’essai impossible fantasmé par Genet : « Avec Le Balcon, c’est du délire rappelé à l’ordre par un professeur de danse classique, et qui prend la pose ». Cagoulés de cuir noir, les jeunes musiciens du Balcon (l’orchestre) participent à ce « délire jugulé et qui se cabre » (Genet encore) avec la justesse et l’enthousiasme qui font leur succès : grâce à eux, et à une formidable troupe de chanteurs-acteurs, la musique d’Eötvös va aussi loin qu’on peut aller pour rendre plus fascinant encore ce jeu infini de miroirs brisés.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 24 mai

De ce Tancrède là, toute émotion est bannie. En fait d’exotisme (la Sicile du XIème siècle menacée par les Sarrasins), le metteur en scène Jacques Osinski se complaît dans l’univers morne de ces bureaux et salles de réunions que la plupart des spectateurs du TCE viennent de quitter, et de héros engoncés dans des costards de cadre moyen – on échappe tout de même aux chaussettes blanches. L’entreprise de cryogénisation est efficace et la barrière de glace ainsi dressée empêche toute empathie. Antonino Siagusa (Argirio), à la technique époustouflante, fait le ténor léger tant de la voix que du cerveau, et en abuse. Patricia Ciofi (Amenaïde), sans doute pas au meilleur de sa forme ce soir là, ne parvient pas à se réchauffer : les aigus sont aigres et les fioritures rigides. Il faut tout le talent d’une Marie-Nicole Lemieux à la barbe adolescente, première victime de l’entreprise d’enlaidissement, pour créer de la sympathie, et encore n’y parvient-elle que dans la longue scène finale, celle de sa mort, qu’elle franchit sans ridicule : chapeau bas. Les deux rôles seconds (Josè Maria Lo Monaco/Isaura et Sarah Tynan/Roggiero) s’en sortent à merveille, n’étant pas la cible première du metteur en scène. A la tête du Philarmonique de Radio-France, Enrique Mazzola imprime une direction heurtée, ignorant tout de la suavité rossinienne. Tout était prêt pour une production de référence, le rendez-vous est volontairement manqué. Restera le finale du premier acte, un sextuor magistralement rossinien : ce délice fait figure de rescapé et justifie à lui seul le déplacement.
Albéric Lagier
Théâtre des Champs-Elysées jusqu'au 27 mai Photo © DR

A l’Opéra Bastille, Bruckner (2ème Symphonie) et Schubert (8ème Symphonie « La Grande ») par Philippe Jordan et l’Orchestre maison. Un programme plus pensé qu’il n’en a l’air : au « second Beethoven » appelé de ses vœux par Wagner répond le chef-d’œuvre prophétique de celui qui n’osait se rêver en successeur de Beethoven. Surtout dans cet ordre (le cadet avant l’aîné), les similitudes apparaissent : divines longueurs (comme disait Schumann) chez l’un et l’autre, ressassement des thèmes, mouvement perpétuel brisé par de soudains éclats, de brusques changements d’atmosphère. Avec un orchestre selon ses vœux – fusion des timbres, larges respirations, attaques gommées « alla Karajan » - Jordan impose un Bruckner au long cours, exigeant, fatiguant presque. C’est pour mieux, après l’entracte, donner un Schubert déjà brucknérien là où nombre de chefs actuels, surfant sur la vague baroque, auraient tendance à regarder vers le passé, à alléger le son et le ton. Cette « Grande » Symphonie péremptoire, violente, contrastée, massive et ciselée en même temps, ferait pour un peu figure de provocation. Le charme viennois y est même réduit à la portion congrue. L’affirmation d’une contre-réforme, d’un retour au grand geste orchestral ? Le public qui applaudit entre les mouvements, fusillé du regard par les spécialistes, donne une réponse dérangeante mais sans ambiguïté.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, 16 mai. Diffusion sur France Musique le 3 juin à 20h Photo © DR

Huitième édition de Tous à l’opéra. Concerts, ateliers, répétitions, visites et rencontres : deux journées portes ouvertes dans les théâtres français et européens, pour démontrer que l’art lyrique n’est pas réservé aux happy few. Un élitisme pour tous qui s’arrête aux représentations d’opéra, trop onéreuses pour figurer dans un programme gratuit. Au Théâtre des Champs-Elysées, Philippe Jaroussky, parrain de l’opération, répare l’injustice à sa manière. Au lieu du récital qu’on lui avait demandé, il offre un condensé du genre, de Monteverdi à Verdi, avec quelques collègues chanteurs et instrumentistes. Animateur, interprète et même percussionniste à l’occasion d’une ouverture de La Pie voleuse façon Marx Brothers, il ravit ses fans (salle comble) sans tirer la couverture : duo Néron-Poppée (Monteverdi) en apesanteur avec la soprano Julie Fuchs, quelques Handel en solo, un air de Chérubin volé aux mezzos. Moments de folie avec Marie-Nicole Lemieux, voix de bronze et entertaineuse née : un Tancrède de Rossini façon vieux théâtre (un test du rôle qu’elle répète sur la même scène), un Duo des chats gagné d’avance avec Jaroussky, une Carmen fracassant son éventail sur « Prend garde à toi ». Aucun temps mort, pas de présentateur jonglant avec les superlatifs, joie dans la salle. Une pédagogie de luxe, mais diablement efficace.
François Lafon
Tous à l’opéra, 10 et 11 mai. www.tous-a-lopera.fr – www.operadays.eu Photos © DR
Dans la musique tchèque du XIXème siècle existent au moins deux grands quintettes avec piano, l’opus 81 d’Antonin Dvorak (1841-1904) et l’opus 8 de son gendre Josef Suk (1874-1935). Ils sont moins distants qu’on pourrait le supposer, car l’un est de maturité (1887), l’autre d’extrême jeunesse (1893). Les présenter ensemble va de soi, ce à quoi s’est livré Syntonia, aussi bien en concert qu’en CD. Fondé en 1999, cet ensemble est aujourd’hui - en France en tout cas - l’unique quintette avec piano constitué, avec à sa disposition un vaste et passionnant répertoire qui ne demande qu’à s’accroître. Le célèbre quintette de Dvorak séduit par sa richesse mélodique, celui de Suk est une rareté : encore dans la descendance de son beau-père (et de Brahms), avant la tragédie qui le frappera en 1905 - la perte de sa femme - et son évolution vers un style plus tourmenté. Par ce quintette, Suk met fin à ses années d’apprentissage, après deux autres ouvrages de chambre. La musique tchèque se distingue à l’occasion par sa frénésie rythmique, trait que Syntonia sait rendre évidemment. On s’en est aperçu aussi dans le scherzo du quintette de Schumann, joué en bis. Le piano a souvent la conduite du discours, en particulier chez Suk. Appréciable était le fait que Romain David, toujours bien présent, ne couvrait jamais ses partenaires aux cordes, dans une salle à l’acoustique un peu sèche. Une anomalie : tout nous était dit sur Syntonia, mais aucune information sur les œuvres elles-mêmes, sinon leurs dates. Passe encore pour Dvorak, mais Suk est-il vraiment si connu ?
Marc Vignal
Théâtre de l’Athénée, 5 mai 2014 - 1 CD Syntonia SYN 001

Suite du cycle John Adams au Châtelet : A Flowering tree (Un Arbre en fleurs). Une œuvre de circonstance, commandée par le New Crowned Hope Festival et créé à Vienne à l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de Mozart (2006). Avec son co-librettiste Peter Sellars, Adams a adapté un conte indien où l’on suit le parcours initiatique d’un prince charmant amoureux d’une jeune fille pauvre capable de se transformer en arbre. Un avatar de La Flûte enchantée, si l’on veut, empruntant au mythe de Daphné. Un sujet étrangement allégorique en regard des préoccupations politiques (Nixon in China), sociales (I was looking at the ceiling … – voir ici) et philosophiques (Doctor Atomic, actuellement donné à l’Opéra du Rhin) d’Adams et Sellars. Comme la mise en scène du shakespearien de Bollywood Vishal Bhardwaj ne fait qu’ajouter à l’abstraction sans parvenir à nous entraîner dans un monde de rêve, on se demande d’autant plus à quoi riment cette fable déconnectée, ce texte alambiqué, cette musique charriant trivialités et jolies choses tintinnabulantes. On admire les marionnettistes (que ne se chargent-ils de l’ensemble du spectacle !), on salue l’Orchestre Symphonique Région Centre-Tours et son chef Jean-Yves Ossonce, on oublie les voix, ni très belles, ni aidées par la prosodie (n’est pas Britten qui veut). Alors on danse ? Même pas.
François Lafon
Châtelet, Paris, jusqu’au 13 mai Photo © DR

Trois veines lyriques de Benjamin Britten à l’Opéra de Lyon, avec en alternance Peter Grimes (grand opéra), The Curlew River (parabole d’église) et Le Tour d’écrou (opéra de chambre). Pour ce dernier, univers fantasmatique de l’Argentine Valentina Carrasco, collaboratrice des Catalans de la Fura dels Baus. Génie de Britten : incarner scéniquement et musicalement la ghost story de Henry James sans la priver de son mystère, en épaississant celui-ci même. Dans le programme de salle, répertoire d’énigmes : « Pourquoi ce titre ? » ; « Que signifie de chant de Peter Quint ? » ; « Qu’est-ce que la Cérémonie de l’innocence ? » ; « Qui a tué le petit Miles ? » ; « La Gouvernante est-elle folle ? » Toutes questions que le spectacle doit poser en évitant d’expliquer l’inexplicable. Peut-être parce qu’elle s’est davantage attachée à l’atmosphère qu’à la direction des acteurs-chanteurs - très justes au demeurant -, la metteur en scène y parvient, mais au prix d’une certaine froideur. On est fasciné, pas effrayé. Belles idées que ce salon bourgeois pris dans une toile d’araignée, que ce jardin souterrain, comme un monde inversé où les méchants revenants pervertissent les enfants, à moins que tout cela ne se passe dans la tête de la Gouvernante, elle-même pas aussi claire qu’elle en a l’air. Le chef Kazushi Ono dirige à l’unisson : pas ou presque de montée de l’angoisse, de « serrage de l’écrou », mais un jeu de timbres très raffiné (quatorze excellents instrumentistes) menant à un quasi-silence. Comme si rien n’était arrivé, ou autre chose. Encore une question sans réponse.
François Lafon
Opéra de Lyon, jusqu’au 29 avril Photo © Jean-Louis Fernandez

A Pleyel, Nicholas Angelich joue en deux soirées les deux Concertos de Brahms, avec l’Orchestre de Paris dirigé par Paavo Järvi. Le Second n’a plus rien de la symphonie avec piano principal qu’on lui reproche (ou le félicite) d’être. Arcbouté sur son tabouret, effleurant le clavier, le caressant presque avant de lui demander l’impossible – des phrases incroyablement sculptées, des nuances infinies -, déployant une dynamique - du pianissimo au fortissimo « au fond du clavier » - ressuscitant l’époque des grands monstres - les Backhaus, les Richter, les Guilels -, il fait de cet Himalaya pianistique un poème fou, entre Keats et Hölderlin. Comme dans leur enregistrement commun (Virgin, 2010, avec l’Orchestre de la Radio de Francfort), Järvi rationnalise le discours, au risque de le banaliser. C’est ce Brahms volontariste qu’il imposera en seconde partie dans une 1ère Symphonie parfaitement structurée, mais privée du « développement organique » si difficile à rendre, et qui fait le génie de cette musique. On ne retrouve l’univers créé par le pianiste qu’au détour d’une intervention soliste – flûte, cor, lumineux premier violon (Roland Daugareil) -, comme pour montrer que le Brahms d’Angelich et celui de Järvi ne sont pas inconciliables.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, les 23 et 24 avril. Concert du 23 accessible sur Arte Concert, orchestredeparis.com et citedelamusique.tv. Photo © DR

Au Théâtre des Champs-Elysées, récital de Yo Yo Ma avec Kathryn Stott au piano. Programme cassant savamment les codes, dans la lignée de son Silk Road Project, « organisation d’art et d’éducation à but non lucratif ». Première partie latino-russe, enchaînant sans respirer des transcriptions pour violoncelle de Villa-Lobos, Piazzolla et Camargo Guarnieri dans la foulée de la Suite italienne de Stravinsky, elle-même transcrite pour violoncelle et piano de la suite d’orchestre Pulcinella. Phrasés généreux, sonorités miroitantes, énergie inépuisable de Ma, jonglant avec ces univers proches et complémentaires. Seconde partie plus sérieuse, sans hiatus pourtant avec la première : chant infini, archet interminable dans la "Louange à l’éternité de Jésus", extraite du Quatuor pour la fin du temps de Messiaen, fabuleuse richesse expressive de la 3ème Sonate de Brahms, où l’on aurait aimé un engagement plus net de l’impeccable Kathryn Schrott, partout ailleurs efficace accompagnatrice. Série de bis se terminant par un ineffable Cygne de Saint-Saëns, danse improvisée de l’artiste déchaîné en guise de salut. Spectateurs très jeunes, particulièrement enthousiastes dans les loges du dernier balcon : beaucoup de violoncellistes en herbe certainement, qui n’auraient pas manqué une telle leçon pour un empire.
François Lafon
Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 23 avril Photo © DR

Le Platée de Robert Carsen souffre d’un mal fatal, celui d’être inévitablement jugé à l’aune de la version Pelly/Minkowski produite à l’Opéra Garnier voilà 15 ans, version devenue mythique et faisant résolument le pari du comique. Robert Carsen, conscient de la chose, fait un choix diamétralement opposé, celui d’un Platée grinçant et bourré de vices de conception. Son monde cruel, fait de Liaisons dangereuses entre gens qui ne sont pas du même milieu, est celui de la mode. Si la satire de ce microcosme fonctionne jusque dans les moindres détails, c’est sans craindre que ces détails ne froissent et Cybèle et Melpomène. On se plait alors à l’idée, réfutable, que ces faiblesses sont calculées : toujours est-il qu’elles collent au propos. Une foule compacte danse avec à peu près autant de grâce que les fashion victims au Queen. Les danseurs et danseuses « professionnels » pastichent un art contemporain abscons – hormis une brochette masculine qui détonne en qualité – scènes ennuyeuses comme le souhaitait Rameau. Car c'est là tout le problème : cette Jet-set s'ennuie terriblement. Du coup, La Folie est massacrée par Simone Kermès qui nous rappelle que Madonna, eh oui, est inimitable, et laisse libre cours, c’est aisé, à une diction calamiteuse. De belles images se succèdent : la scène du nuage (début de l’acte II), par exemple, provoque un silence ému dans la salle. Les clins d’œil appuyés aussi s'accumulent (l'ennui, toujours l'ennui), dont le Jupiter/Lagerfeld convenu tant il est criant de vérité, et ainsi de suite, jusqu’au final. Ce final vers lequel Marcel Beekman en Platée nous aura menés par un sans faute à la fois vocal et scénique. Un grand coup de chapeau à ce ténor chaplinesque, quand, il y a quinze ans, Paul Agnew lorgnait du côté de Buster Keaton. Paul Agnew, justement, qui dans ce Platée dirige les Arts Florissants. Alors saluons William Christie, grand pédagogue, tant l’élève a su au moins égaler son Maître : c’est tout dire.
Albéric Lagier.
Paris, Opéra Comique, les 20, 22, 24, 25, 27 et 30 mars 2014. Photo © DR

Des trois opéras d’Albéric Magnard (1865-1914), le dernier, Bérénice, est celui qui cerne le mieux sa personnalité. L’influence de Wagner est inexistante, c’est dans la descendance des Troyens de Berlioz que l’ouvrage se situe. Le sujet s’inspire de Racine, mais pas uniquement. Magnard, auteur du livret, supprime tout personnage et toute intrigue subsidiaires, ne laissant en scène, sauf rares exceptions, que Titus et Bérénice. Les duos d’amour qu’ils chantent dans chacun des trois actes sont au centre de tout, et si à la fin ils se séparent, c’est largement dû à la couardise de Titus, qui a préféré à l’amour, valeur suprême, les impératifs de la raison d’Etat. Depuis la création de Bérénice en 1911, ses représentations sur des scènes françaises ne se comptent même pas sur la moitié des doigts d’une seule main. L’Opéra de Tours a relevé le défi, en cette année du centenaire de la fin tragique du compositeur, et le succès était au rendez-vous. On se trouvait à Rome, l’intrigue n’était pas déplacée dans on ne sait quelle catastrophe des temps à venir, et le chef Jean-Yves Ossonce - il a enregistré les quatre symphonies de Magnard - est un fin connaisseur. Les deux principaux protagonistes, Catherine Hunold, qui tenait là un des plus beaux rôles de soprano dramatique, et Jean-Sébastien Bou, ont été ovationnés comme il se doit, et la représentation a montré combien était vaine l’accusation portée à l’époque contre Magnard d’avoir travaillé « en dehors de toute préoccupation dramatique » justement. On s’étonne aussi que cette musique ait pu être qualifiée d’hermétique. Traduisant le côté intime de Magnard, elle révèle à qui sait entendre des tensions psychologiques intérieures mais bien réelles.
Marc Vignal
Opéra de Tours, 6 et 8 avril 2014

A Pleyel, Radu Lupu joue le 1er Concerto pour piano de Beethoven avec Paavo Järvi et l’Orchestre de Paris. Calé sur sa chaise, totalement immobile pendant l’introduction, il ne détend les bras qu’au dernier moment : étrange dichotomie entre cette fulgurance et le son Lupu, doux et perlé jusque dans les fortissimos. Les trois mouvements filent ainsi, entre rêve et réalité, accompagnés par un orchestre lui aussi entre ciel et terre : une revanche, dix-huit ans après un cycle Beethoven où Lupu et Wolfgang Sawallisch n’étaient pas arrivés à faire cause commune. En bis, L’Oiseau Prophète, des Scènes de la forêt de Schumann. Même détente des bras, même intimité sonore, même impression de dilettantisme, et pourtant cet Oiseau vole très haut, et traverse des régions rarement atteintes. En ouverture, le Mouvement lent (Langsamer Satz) du jeune Webern (22 ans) marchant dans les pas de Brahms et Mahler ; en seconde partie, la 4ème Symphonie de Mahler, dirigée à la pointe sèche par Järvi - et d’autant plus inquiétante sous ses airs de gentil répit entre les écrasantes 3ème et 5ème. Autre apparition magique : la mezzo Katija Dragojevic, entrant au moment où le « tranquille » (Ruhevoll) Adagio éclate en mille couleurs et chantant le lied final avec le mélange d’innocence et de sensualité qui en fait le mystère.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 2 et 3 avril Photo © DR

Au Châtelet, nouveau hit (le quatrième en quatre ans) de la Stephen Sondheim mania : Into the Woods, créé à Broadway en 1987. Idée alla Sondheim : réunir dans un bois – lieu de tous les fantasmes et de toutes les transgressions (voir Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare) – Cendrillon et le Petit Chaperon-Rouge, la Sorcière et le Loup, Raiponce et Jack (celui des haricots magiques). James Lapine, le librettiste, voyait là la manifestation de l’inconscient collectif théorisée par Jung. Sondheim, lui, n’excluait pas l’approche freudienne de Bruno Bettelheim dans La Psychanalyse des contes de fées. Résultat : un univers plus proche de Tex Avery que de Walt Disney, sur une musique raffinée, mâtinée de Ravel et de Satie mais toujours optimiste et melliflue, et par là même savamment décalée. Quand le rideau tombe sur le premier acte, on a bien ri, on a vu ces héros qui n’auraient pas dû se rencontrer se marier (tant bien que mal) à défaut d’avoir beaucoup d’enfants, mais on imagine que le pire est à venir, et l’on a raison. Au second acte, le rêve tourne au cauchemar. Les couples ne s’entendent plus, les princes charmants sont infidèles, une géante (voix de Fanny Ardant en VO, très chic) terrorise la contrée, les peurs et bassesses prennent le pas sur les grands sentiments. Pas tout à fait cependant : comme si la production avait imposé une fin propre à rassurer le public familial, nos auteurs font marche arrière, tournent en rond, versent dans la sentimentalité. La troupe, vaillante (c’est un musical « choral », sans vedette, si ce n’est peut-être la Sorcière, fort bien jouée par Beverly Klein), n’y peut mais, pas plus que le tandem Lee Blakeley (mise en scène) – David Charles Abell (direction musicale), toujours aux commandes de ce cycle Sondheim dont, à ce jour, le cynique Sweeney Todd (voir ici) reste le fleuron.
François Lafon
Châtelet, Paris, jusqu’au 12 avril. Diffusion sur France Musique le 15 avril à 20h Photo © Marie-Noëlle Robert - Châtelet

A Pleyel, l’Orchestre de Paris joue baroque sous la direction de Giovanni Antonini. En trois jours de répétitions, le leader de l’explosif Giardino Armonico a obtenu l’effet « Nikolaus Harnoncourt - Concertgebouw d’Amsterdam », application réussie du jeu à l’ancienne à la grande machine symphonique. Démonstration avec l’Ouverture "Olympia", musique de scène pour une pièce de Voltaire de Joseph Martin Kraus, exact contemporain de Mozart (mort quelques mois après lui, à trente-six ans), parfait exemple du Sturm und Drang (Orage et Passion) alliant l’équilibre classique et les turbulences du romantisme à venir. Articulations marquées et archets allégés pour le Concerto pour basson de Mozart, avec en soliste l’étonnant Giorgio Mandolesi, chef de pupitre de l’Orchestre mais aussi professeur de basson historique au Conservatoire de Paris. Accompagnement aérien du 2ème Concerto pour violoncelle de Haydn avec la flamboyante mais incontrôlable Sol Gabetta, timbres chatoyants et harmonie éclatante dans la « Messe de l’orphelinat », où Mozart fait à douze ans une entrée solennelle (c’est une « missa solemnis ») dans un genre qui le conduira à la Grande Messe en ut mineur et au Requiem. Une nouvelle chance en tout cas pour l’Orchestre, dont l’expérience baroque, il y a quinze ans avec Frans Brüggen, n’avait pas donné le résultat espéré.
François Lafon
Salle Pleyel Paris, 26 et 27 mars. Concert en famille Kraus-Mozart, 30 mars Photo © DR

A la MC 93 de Bobigny, Don Giovanni de Mozart par l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris. Le saut de l’ange, le test qui ne pardonne pas, qui plus est sur ce plateau panoramique où il y a un quart de siècle, le Don Giovanni « de » Peter Sellars a changé la face du lyrique. Double idée force du metteur en scène Christophe Perton : Don Giovanni est dès le début blessé à mort (une citation de la mise en scène de Claus Guth au festival de Salzbourg), et il est animé, protégé par Mozart lui-même, lequel, installé en fond de scène, tient le continuo. Une échappée dans l’espace-temps qui justifie la fuite immobile du héros toujours poursuivi, jamais attrapé, si ce n’est par la mort. Une ouverture à un jusqu’auboutisme qu’autoriserait la jeunesse de la troupe (deux distributions où personne n’a plus de trente ans), mais qui probablement mettrait celle-ci en danger. Admirable déjà la maîtrise Michel Partyka, Don Juan prédateur plutôt que séducteur, de Pietro di Bianco, Leporello plus complice que valet, d’Andreea Soare, Elvira au timbre somptueux, d’Adriana Gonzalez, Zerline de vingt-et-un ans, tous novices dans des rôles où se sont illustrés les plus grands. Exemplaire l’équilibre fosse-plateau obtenu par Alexandre Myrat, chef-pédagogue à la tête des jeunes de l’Orchestre-atelier Ostinato. Un bâton de maréchal en tout cas pour cette institution qui fêtera bientôt ses dix ans d’âge et d’où sont issues nombre de voix parmi les plus prometteuses.
François Lafon
MC 93, Bobigny, jusqu’au 31 mars. 24 - 26 mai Théâtre de la Piscine, Châtenay-Malabry Photo © Cosimo Mirco Magliocca

Aux Bouffes du Nord, Les Méfaits du tabac, concert en un acte. Concert, le monologue de Tchékhov, où l’on voit un vieux professeur martyrisé par sa femme profiter d’une conférence pour épancher sa bile ? Concert parce que le vieux professeur a sept filles (ou six, il ne sait plus) et que l’institution où il officie est une école de musique. Concert parce que ce spectacle d’une heure a été conçu de concert par Denis Podalydès (metteur en scène) et Floriane Bonanni (violoniste), et que les digressions tchékhoviennes sont mêlées de musiques de Bach, Tchaikovski et Berio, interprétées, autour de Floriane Bonanni, par Muriel Ferraro (soprano) et Emmanuelle Swiercz (piano). Théâtre pourtant, car la scène est éclairée de la présence étrange, minérale et animale (c’est Podalydès qui le dit) de Michel Robin, aussi fabuleux en victime de la vie que le fut – dans un autre registre – Robert Hirsch en son temps. Il y a un moment extraordinaire, vers la fin, où Robin écoute, sans presque bouger, Floriane Bonanni jouer la Sequenza VIII de Berio. On regrette d’autant plus que l’alternance texte-musique ne soit pas plus naturelle, comme si, pour arriver à une heure de spectacle, il avait fallu par moments céder au remplissage. Les costumes de Christian Lacroix, à la fois chics et usagés, sont des merveilles.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, du 18 au 22 mars, et du 1er au 12 avril. Tournée à Namur (25 - 29 mars), à Arras (17 - 18 avril) et en Roumanie (11 – 29 juin) Photo © V. Tonello

Récital de Boris Berezovsky au Théâtre des Champs-Elysées. Salle pleine pour un programme musclé : Rachmaninov, Debussy, Ravel. Trop musclé peut-être : les doigts d’acier tarabustent le piano dans les Etudes-Tableaux et la 2ème Sonate de Rachmaninov. Pas de sentimentalité déplacée, mais le mélange, évident comme jamais, de rage et de nostalgie qui caractérise le compositeur. Pas davantage de brume ni de rêverie dans les huit Préludes du Livre 1 de Debussy, mais une angoisse presque, marquant à peine le pas le temps d’une Fille aux cheveux de lin enfin « entre deux mondes ». Rage et piétinements en revanche dans Gaspard de la nuit, ou l’inquiétant Ravel devient machine à broyer du noir. Sensation finale d’avoir été roué de coups, d’avoir été précipité dans un bain musical dérangeant, par moments abusif, adouci en bis par deux extraits de la Petite Suite de Debussy où le pianiste joue les papas fiers avec sa fille Evelyne (23 ans) : un quatre mains tendre cette fois, accord parfait sur le clavier (joli toucher de la demoiselle) et désaccord charmant à propos de qui tournera le premier les pages de la partition.
François Lafon
Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 18 mars Photo © DR

A Pleyel, Richard Strauss et Schubert par Marek Janowski et l’Orchestre de Paris. Un programme tout Strauss au départ, chamboulé par la défection de la soprano Anja Harteros. Amusant de retrouver là le chef qui, seize ans durant, a fait du Philharmonique de Radio France le plus allemand des orchestre français. Amusant est-il le bon terme ? Plus austère que jamais, le geste efficace mais parcimonieux, le maestro semble animer une nuit de la déprime. Une exaltante déprime, tout de même. Basses puissantes, sombres colorations, attaques estompées, le son Janowski va bien à Mort et transfiguration, poème de jeunesse d’un Strauss prévoyant la fin de toutes choses à travers un thème mélodique que l’on retrouvera cinquante-neuf ans plus tard dans les Quatre derniers Lieder. Atmosphère proche, émouvante mais sans lumière dans la Symphonie inachevée. Etat de grâce en revanche - 23 cordes en apesanteur et chef inspiré – pour les Métamorphoses, chef-d’oeuvre hors du temps du vieux Strauss célébrant un monde parti en fumée. Une demi-heure comme jamais, qu’il aurait presque été dommage de prolonger par la pourtant superbe scène finale de Capriccio, déprogrammée faute d’une chanteuse disponible au pied levé.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 12 et 13 mars Photo © DR

A l’Opéra Bastille, quatrième Flûte enchantée depuis celle de Bob Wilson (1991), cette fois importée de Baden-Baden et signée Robert Carsen. Il y a vingt ans, Carsen avait monté au festival d’Aix-en-Provence une Flûte simple, colorée, pleine de charme à défaut de regorger d’idées. Celle-ci reprend le même principe – à savoir que Sarastro et la Reine de la Nuit se sont aimés un jour, et qu’ils travaillent ensemble à l’initiation de Pamina et Tamino – mais le charme est moins évident. Question de format, de moyens sans doute. La distribution, soignée mais sans personnalités marquantes – si ce n’est Julia Kleiter, assez lumineuse Pamina – ajoute à cette impression de produit de série, luxueux et sans aspérités. Dans la fosse, Philippe Jordan dirige lent, avec de beaux phrasés, mais ne s’impose pas comme il sait le faire dans Wagner ou Strauss. Avant le lever du rideau, Nicolas Joël, directeur de l’Opéra pour quelques mois encore, vient dédier la représentation à la mémoire de son prédécesseur Gerard Mortier. Un curieux hommage à celui qui ne détestait rien tant que le consensuel en matière d’art lyrique.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, jusqu’au 15 avril Photo © Pierre Andrieu

Au théâtre de l’Athénée, centenaire Marguerite Duras avec Un Barrage contre le Pacifique, mis en scène par Juliette de Charnacé. En réalité L’Eden Cinéma (Théâtre d’Orsay - 1977), variation scénique sur le roman fondateur de la légende durassienne : le Cambodge, la concession inondée, la Mère « hurlante, terrible », le fils, la fille et son riche amant indigène. Une symphonie dramatique avec voix et musique de scène. Souvenir de la création : les timbres très particuliers du trio Madeleine Renaud - Bulle Ogier - Michael Lonsdale et la musique de Carlos d’Alessio : sons d’ailleurs, rengaines entêtantes. Un monde immatériel et très présent. A l’Athénée, musique nouvelle de Ghédalia Tazartès, belle, étrange, prolongeant les affects là où celle d’Alessio les cernait. Une manière peut-être de donner corps aux voix plus anonymes de Florence Thomassin (la Mère), Julien Honoré (le Fils) et Lola Créton (la Fille). Sensation que la légende durassienne se renouvelle, ce qui est bien, mais que la tonalité originelle s’est perdue. Mais qui, déjà, se souvient de celle-ci ?
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 22 mars Photo © Anne Gayan

Aux Bouffes du Nord, Te craindre en ton absence, monodrame pour une actrice, un ensemble de douze instrumentistes et électronique, texte de Marie Ndiaye, musique d’Hector Parra, mise en scène de Georges Lavaudant. Un objet théâtro-musical dans la lignée de Cassandre de Michael Jarrell et Christa Wolf (voir ici), avec les mêmes interprètes Astrid Bas et l’Ensemble Intercontemporain (CD Kairos). Le texte, distribué à l’entrée, est riche et souvent beau. Une femme rapporte à ses parents les cendres de sa sœur. Elle marche - superbe idée - sur un sol brûlé traversé d’un chemin de plumes blanches : « Notre mère se meurt par-delà les blés, et les dures saisons l’ont faite à leur image ». La musique est riche elle aussi, efflorescente même, mêlant avec science la nostalgie et la brutalité. Qu’est-ce qui fonctionnait alors dans Cassandre, qu’on ne retrouve pas ici ? Au-dessus de l’ensemble instrumental, impeccable sous la direction de Julien Leroy, des phrases s’inscrivent, dédoublées, avant que l’actrice ne les prononce. Une union naturelle se fait entre les sons et ces mots écrits, rares, répétés, comme des notes sur une portée, alors que dans la bouche de l’actrice, pourtant impeccable elle aussi, le texte parasite la musique et est parasité par elle. « Prima la musica, dopo le parole » … ou le contraire : la Querelle des Bouffons ne sera jamais terminée.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, 4, 5, 7, 8 mars. En tournée saison 2014/2015, dont le 4 octobre au Festival Musica / Strasbourg. Photo © DR

A la Cité de la musique, Haendel et Purcell par Teodor Currentzis et son ensemble MusicAeterna. Atmosphère électrique pour le Dixit Dominus du premier : chef survolté, tempos d’enfer, chœur frôlant le précipice, solistes prenant tous les risques. La Currentzis touch appliquée au Didon et Enée du second est déjà classique : c’est avec ce chef-d’œuvre ovni (créé où, par qui, dans quelles circonstances ?) que ce Grec aux allures de Paganini pratiquant la musique au fond de l’Oural (voir ici) s’est fait connaître au disque, fascinant les uns, rebutant les autres. Là encore, photo surexposée, exacerbation du mélange de pompe française, de souplesse italienne et de violence anglaise concentrés en à peine une heure. Version de concert mais éclairages étudiés, image étonnante que ces instrumentistes véhéments, ces cordes jouant debout, ces chœurs mouvants, véritables héros du drame, plus concernés que les solistes menés par une Anna Prohaska sous-dimensionnée en reine suicidaire. Bis extrait de la Musique pour la reine Marie, annoncé par le chef dans un anglais sibyllin, avec chœurs exécutant une étrange chorégraphie, comme un rituel baroque revu par Peter Sellars. Plus de fascination que d’émotion, mais sensation, comme souvent avec Currentzis, d’entendre mieux des oeuvres que l’on croyait connaître.
François Lafon
Cité de la musique, Paris, 21 février Photo © DR

Deux premiers, au Châtelet et à Pleyel, des treize concerts du 24ème festival Présences (Radio France), sur le thème Paris-Berlin. Sur sept œuvres, cinq de compositeurs vivants, donnant un aperçu plutôt haut de gamme de quelques tendances actuelles. Passion des références : WuXing/Water d’Oliver Schneller (création mondiale) s’inspire de la Chine mais traite l’orchestre alla Richard Strauss, Hérédo-Ribotes pour alto solo et 25 musiciens d’orchestre de Fabien Lévy déconstruit sans le reconstruire le rapport soliste-ensemble du concerto classique, Nähe Fern (Proximité lointaine) I et III de Wolfgang Rihm se veut un palimpseste des 2ème et 3ème Symphonies de Brahms. Outsiders : Philippe Manoury, dont Zones de turbulences pour deux pianos et orchestre lance un défi à la brièveté d’une Bagatelle de Beethoven (n° 10, op. 19) mais s’amuse surtout à mettre la pagaille dans une structure savamment élaborée, et la très inventive Elégie pour clarinette et orchestre, de Jörg Widmann - divine surprise du lot -, avec le compositeur en (superbe) soliste. Grands ancêtres, modèles évidents de leurs cadets : Hans Werner Henze, avec Le Rêve de Sébastien, poème nocturne aux textures orchestrales compactes, et la Symphonie vocale Die Soldaten de Bernd Alois Zimmermann, version fragmentaire et simplifiée de l’opéra du même nom, créée deux ans (1963) avant celui-ci, et donnant une idée assez fracassante de son incroyable richesse dramatique et musicale. Exercice de haute école de l’Orchestre National dirigé au cordeau par Ilan Volkov (Châtelet), et du Philharmonique de Radio France sous la baguette plus souple mais un peu moins précise de Peter Hirsch (Pleyel), solistes impeccables. Public clairsemé, surtout au Châtelet : peur de la grande méchante musique contemporaine ou manque de vedettes à l’affiche ? Peut-être est-ce aussi parce que les concerts "service public" de Présences ne sont plus gratuits.
François Lafon
Radio France, salle Pleyel, Châtelet, Cité de la musique, jusqu’au 25 février Photo : Philippe Manoury © DR

Aux Bouffes du Nord, The Raven (Le Corbeau), monodrame pour mezzo-soprano et douze musiciens d’après Edgar Poe. Une seule représentation, salle comble pour la mezzo Charlotte Hellekant - sculpturale, présence irradiante, timbre d’or sombre – et pour la musique néo-Darmstadt mêlée de tradition japonaise de Toshio Hosohawa. Un désespéré pleurant son amour perdu, un corbeau prédisant « nevermore » (jamais plus), une chanteuse-récitante ajoutant à l’étrangeté : le poème de Poe, connu en français dans les traductions de Baudelaire (« Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur maint précieux et curieux volume d’une doctrine oubliée … ») et de Mallarmé (« Une fois, par un minuit lugubre, tandis que je m’appesantissais, faible et fatigué, sur maints et curieux volumes de savoir oublié… »), rejoint le théâtre Nô, où les frontières sont moins nettes que chez nous entre l’humain, l’animal et le végétal. Interprétation impeccable de l’ensemble luxembourgeois Lucilin, mise en images efflorescentes du vidéaste Jan Speckenbach. Mais à trop illustrer, l’image rivalise avec la musique, elle-même ouvertement illustrative. Un match nul compensé par quelques éclairs d’étrangeté, comme cette porte fermée contre laquelle la chanteuse semble se dématérialiser.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, 10 février Photo © Bohumil Kostohryz

La Première Symphonie de Sibelius (1899-1900) s’inscrit dans la tradition austro-allemande, à cause notamment de la maîtrise formelle de son mouvement initial, et dans la tradition russe, à cause de sa sauvagerie et d’un lyrisme parfois expansif. Sibelius avait entendu la Pathétique de Tchaikovsky, sans en faire son modèle, mais sûrement pas Mahler, contrairement à ce que d’aucuns s’obstinent à nous faire croire. Cette Première terminait le concert donné cette semaine par le jeune chef russe Vasily Petrenko (37 ans), étoile montante s’il en est, à la tête de l’Orchestre philharmonique de Radio France. Plutôt qu’étoile montante, astre déjà au firmament ou presque ! L’ouvrage n’est plus une rareté. Il faut oser dire qu’on a eu là, par-delà quelques précieux souvenirs, une interprétation vraiment extraordinaire, comme on en entend, pour une œuvre donnée, une fois par décennie. Petrenko prend cette musique à bras-le-corps, en sachant exactement imposer ce qu’il veut, sans jamais se perdre en route, y compris dans les épisodes rhapsodiques : rythmes percutants, gestique des plus efficaces permettant au discours de se projeter sans cesse en avant, contour sonores très nets, y compris dans la périlleuse apothéose terminale, fin dans la nuance inattendue mezzo forte donnant l’impression d’une musique s’abîmant soudain dans une trappe : faut-il applaudir ? Hésitation, puis déchainements d’enthousiasme amplement mérités. En début de programme, le Concerto pour violon n°2 de Bartók : soliste de haut niveau (Sergej Krylov), mais pour le chef moins de pièges et de défis à surmonter que chez Sibelius.
Marc Vignal
Salle Pleyel, vendredi 7 février 2014 Photo © DR

Au théâtre de l’Athénée, King Arthur de Henry Purcell (musique) et John Dryden (livret) par l’Ensemble BarokOpera d’Amsterdam. Dix musiciens dirigés par Frédérique Chauvet, cinq chaises, cinq chanteurs – trois hommes, deux femmes –, une panière remplie d’objets hétéroclites (rapières, gantelets, débouche-lavabo, etc). Note d’intention du metteur en scène Sybrand van der Werf : « J’ai choisi un style théâtral très prisé aux Pays-Bas et en Flandre, mais encore tout à fait original et méconnu en France : le jeu « transparent ». Dans ce style « épique néerlandais », l’acteur ou le chanteur interprète son personnage tout en restant lui-même en tant qu’individu ». On se rappelle quand même que les Branquignols en France ou les Monty Python en Angleterre en ont fait autant, mais en beaucoup plus drôle et plus inventif, et que le procédé bien connu de la panière à accessoires était mieux amené dans La Vie parisienne d’Offenbach mis en scène par Alain Sachs au théâtre Antoine (2009). Les chanteurs chantent comme ils jouent, c'est-à-dire plus ou moins bien, et l’on a du mal à suivre l’histoire de ce semi-opera dont le texte parlé, ouvertement patriotique (il s’agissait de faire remonter aux Chevaliers de la Table ronde une dynastie anglaise aux racines peu profondes), est réduit au minimum. Au moins l’ensemble instrumental tient-il le choc et le célèbre « Air du froid », immortalisé par le regretté Klaus Nomi, est-il fort bien interprété par la basse Pieter Hendriks.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 12 février. Enregistrement intégral chez Ligia Digital Photo © DR

Rareté italienne de l’année à l’Opéra Bastille : La Fanciulla del West. A New York en 1910, Puccini innove. Il a écouté Pelléas et Mélisande et s’intéresse à l’Ecole de Vienne, laquelle le lui rend bien : « Chaque mesure de cette Fanciulla est une surprise », écrit Webern à Schoenberg. L’ouvrage est rarement donné (dernière à Paris : Opéra Comique, 1969) : pas de grands airs, récitatif permanent, orchestre virtuose, multitude de petits rôles. Idée originale : c’est un western (pas encore spaghetti), avec tenancière de saloon, chercheurs d’or, shérif amoureux et bandit au grand cœur. Mais le mariage du mélo italien et de la mythologie du Far West – inspiré, comme Madame Butterfly, d’une pièce de David Belasco – donne un résultat curieux, par moments franchement comique. Le metteur en scène Nikolaus Lehnhoff, spécialiste de Strauss et Wagner, pratique le clin d’œil appuyé : lever de rideau à Wall Street, deuxième acte dans la loge-caravane de la Fanciulla superstar, troisième dans un cimetière de voitures façon Mad Max, avec happy-end sur fond de lion MGM. Mouvements divers de la salle, report des applaudissements sur les chanteurs - pourtant décevants à commencer par Nina Stemme, à la voix puissante mais raide -, un peu moins sur le chef Carlo Rizzi, lequel dirige gros cette musique qui mérite mieux.
François Lafon
Diffusion en direct le 10 février dans cinémas UGC et salles indépendantes. En direct sur France Musique le 22 février Photo © Chrales Duprat/Opéra de Paris

Existe-t-il deux symphonies du même compositeur jouables à la suite l’une de l’autre sans interruption, sans applaudissements entre les deux, avec comme résultat non une simple juxtaposition mais une nouvelle entité organique ? Paavo Järvi et l’Orchestre de Paris ont montré que oui, mais cela constitue, dans le grand répertoire, un cas unique. Il s’agit des deux dernières de Sibelius, les Sixième (1923) et Septième (1924). Elles sont contemporaines, mais cela ne suffit pas. En quatre mouvements, la Sixième évite tout extrême et procède par touches transparentes, non sans quelques accès de violence. Elle se termine aux limites du silence dans un extraordinaire retrait en soi. « L’ombre s’étend », déclara Sibelius à ce propos. La Septième, bloc monolithique en un seul mouvement, surgit des profondeurs et prend fin sur une affirmation de sobre grandeur. On passe sans heurt d’une symphonie à l’autre et surtout, la Septième - une vingtaine de minutes sur un total de seulement une cinquantaine - apparaît comme l’imposant finale d’une structure cohérente en cinq mouvements. Expérience d’autant plus convaincante que Paavo Järvi s’est confirmé comme un interprète hors pair de cette musique difficile. Il s’est aussi révélé comme n’hésitant pas à jouer des tours à son public. Dans le finale de la symphonie l’Ours (n°82) de Haydn, qui ouvrait le programme, il a marqué bref un temps d’arrêt, sans pour autant baisser les bras, après un épisode à l’arraché. Réaction immédiate : applaudissements interrompant le discours musical, redoublés après la vraie conclusion du morceau. Un concert où, décidément, on ne s’est pas ennuyé.
Marc Vignal
Salle Pleyel, 30 janvier 2014 Photo © DR

Au Théâtre des Champs-Elysées dans le cadre du 30ème Printemps des Arts de Monte-Carlo, trois Sonates de Beethoven par François-Frédéric Guy. C’est à Monaco que cet adepte du piano extrême a commencé en 2008 ses marathons beethovéniens : 32 Sonates en dix concerts. Ce soir, « Clair de lune », « Pastorale » et « Hammerklavier », du tube grand public au monument pour happy few. Typique d’un artiste qui, tout jeune déjà (il a aujourd’hui 45 ans) ne se sentait chez lui que dans la cour des grands. Spectacle étonnant que de le voir aux prises avec cette « Hammerklavier » qu’il a enregistrée trois fois (1998, 2006 et 2012, dans le cadre de son intégrale chez Zig-Zag Territoires), et dont il dénoue et renoue les fils avec une sorte de rage : le capitaine Achab luttant avec Moby Dick, mais d’égal à égal. Même dialogue - plus détendu - avec une « Clair de lune » pourtant traversée d’éclairs inattendus, et une « Pastorale » chantante comme il le faut, mais que l’on perçoit après coup comme l’antichambre des tempêtes hammerklavieresques. Bis apaisés – l’Andante de la 25ème Sonate, une ineffable « Lettre à Elise" - suivis, en hommage à Claudio Abbado, d’une Mort d’Isolde (Wagner/Liszt) tendue comme un arc. Toujours la fascination des grands espaces, décidément.
François Lafon
Théâtre des Champs-Elysées, Paris, le 28 janvier Photo © DR

Escale à l’Athénée de L’Empereur d’Atlantis ou le Refus de la Mort de Viktor Ullmann (musique) et Petr Kien (livret), un spectacle de l’Arcal (Compagnie nationale de théâtre lyrique et musical). Forme courte (une heure), livret allégorique, musique composite, instrumentation idem (quatuor à cordes classique mais guitare, clavecin et banjo). Un objet contemporain ? En apparence seulement : redécouvert en 1975, régulièrement joué depuis, cet Empereur de bric et de broc a été composé en 1943 (mais censuré) à Theresienstadt, camp de concentration modèle réservé à l’élite des déportés, néanmoins antichambre d’Auschwitz, où Ullmann et Kien ont été gazés. Sujet : la Mort se met en grève dans l’empire du tyran Overall (Uber Alles ?), où règne la guerre totale. Belle idée du metteur en scène Louise Moaty : présenter cette histoire comme un moment arrêté où tout devient possible, entre échafaudages dont on fait les miradors et toiles de parachutes propices à l’évasion. Direction musclée - avec juste ce qu’il faut de dérision - de Philippe Nahon avec son ensemble Ars Nova, quintette vocal impeccable dominé par Vassyl Slipak, Mort de cabaret à l’inquiétante élégance.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 30 janvier. En tournée (Niort, Poitiers, Massy, Saint-Quentin-en-Yvelines) jusqu’au 9 avril Photo © THéätre de l'Athénée

Alexander Raskatov, compositeur russe né en 1953 et installé en France depuis 2004, compose en 2008-2009, suite à une commande de l’Opéra National des Pays-Bas, Cœur de Chien, d’après le récit éponyme de Mikhaïl Boulgakov, l’auteur du Maître et Marguerite. Interdit par la censure, ce récit de 1925 n’est publié à l’étranger qu’en 1968, et en URSS en1987 seulement. Créé à Amsterdam en 2010, donné à la Scala de Milan, l’opéra de Raskatov - deux actes, seize tableaux, un épilogue - vient de connaître sa première française, à Lyon. Il fait sienne la satire politico-sociale au vitriol de la science et surtout du soviétisme en ses débuts concoctée par Boulgakov par le biais d’une histoire loufoque et sarcastique : un chien est métamorphosé en homme par un chirurgien spécialiste du rajeunissement et, après avoir plongé son entourage dans un véritable enfer, en particulier en poursuivant les chats, est ramené de force à sa condition d’animal. L’homme nouveau se révèle incontrôlable. Le second acte, sombre, tue en quelque sorte le premier, burlesque : les prolétaires peuvent se montrer tyranniques, et l’épilogue dû au compositeur - un juge d’instruction se présente chez le chirurgien muni d’un mandat d’arrêt - met en garde contre la déshumanisation ambiante. Sans tomber dans les « à la manière de », Cœur de Chien parcourt de façon kaléidoscopique l’histoire du genre opéra, avec de nombreux personnages dont aucun n’est secondaire, un orchestre fourni doté de balalaïkas amplifiées et d’une énorme percussion, et des effets vocaux surprenants, le plus souvent du type staccato. La mise en scène de Simon McBurney est des plus efficaces. D’aucuns ont cru déceler chez le « Chef haut placé » un accent géorgien : serait-ce déjà Staline ?
Marc Vignal
Opéra National de Lyon, 22 janvier 2014 Photo © Opéra de Lyon

A l’Opéra Bastille, reprise de Werther dirigé par Michel Plasson et mis en scène par le cinéaste Benoit Jacquot, une des seules réussites parmi les nouveaux spectacles (quoiqu’importé de Londres) de l’ère Nicolas Joël. A Jonas Kaufmann, Werther sombre et magnétique, capable d’ouvrir des abîmes schubertiens sous la musique de Massenet, succède Roberto Alagna, annoncé comme souffrant mais retrouvant vite la forme : aigus triomphants, diction toujours impeccable, présence solaire. C’est peut-être là que le bât blesse : ce Werther ne porte pas la mort en lui, ce qui rend plus interminable encore l’agonie finale. Le spectacle tout entier est d’ailleurs comme désenchanté : ce mur en carton-pâte, cette fontaine qui fait glouglou, cette chambrette sur roulettes étaient vraiment là, il y a quatre ans ? Distribution différente, mais toujours de premier ordre : bien dirigés, Karine Deshayes (Charlotte) et Jean-François Lapointe (Albert) ne sont pas qu’une prude et un mari trompé. Plasson caresse la partition, en exalte les parfums bon marché mais capiteux, acclamé par le public de ce dimanche en matinée, fans d’Alagna et nostalgique de l’opéra de papa.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, jusqu’au 12 février. En DVD (version 2010, avec Jonas Kaufmann, Sophie Koch et Ludivic Tézier) chez Bel-Air Classiques. Photo © Chantal Navarre

Au théâtre de l’Athénée, Le Viol de Lucrèce de Benjamin Britten, mis en scène par Stephen Taylor (reprise de 2007, même lieu) et dirigé par Maxime Pascal à la tête de son ensemble Le Balcon. Le premier opéra de chambre (huit chanteurs, treize instrumentistes) de Britten, et déjà une maîtrise parfaite de l’exhibition/camouflage de ses obsessions, d’après une pièce française d’André Obey : innocence bafouée avec le viol par le roi Tarquin de la Romaine inflexible, autopunition avec le suicide de ladite Romaine peut-être pas si inflexible, le tout décrypté à la lumière du christianisme à venir par un Chœur male and female. Déjà un chef-d’œuvre de dramaturgie musicale : chaleur, cavalcades, grillons au lointain, plages lyriques et accès de violence, apparition tardive de l’objet du désir, catastrophe sur un chant sensuel et éthéré à la fois. Peu d’action, des présences : octuor de voix superbes de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris (deux distributions en alternance), mise en scène allant à l’essentiel. On pense à Claude Régy, mais aussi à Pierre Strosser, grand artiste méconnu (son austère Tétralogie au Châtelet est désormais culte) dont Stephen Taylor a été le disciple. Même esprit dans la fosse, où Maxime Pascal relit Britten comme il a relu Strauss (Ariane à Naxos - voir ici), avec un sens très fin de la rigueur et de la transgression.
François Lafon
Théâtre de l'Athénée, Paris, jusqu’au 19 janvier Photo © Cosimo Mirco Magliocca

A la salle Pleyel avec l’Orchestre de Paris, le pianiste Boris Berezovsky, grippé, est remplacé par Valentina Lisitsa. Programme inchangé – 1er Concerto et Totentanz de Liszt - l’Ukrainienne ne redoutant pas plus que le Russe les folies digitales. La coqueluche du Web (62 millions de visites, 108 000 abonnés – voir ici) est égale à elle-même : technique d’acier, relative monochromie sonore tempérée par des phrasés assez personnels, mais surtout le don d’occuper le terrain, de communiquer le plaisir qu’elle prend à être là, à se dépenser sans compter. Chauffée par la diabolique Totentanz, elle s’installe pour un quadruple bis – Schubert/Liszt, Paganini/Liszt, Prokofiev, Chopin – qui achève de bousculer les conventions, secondée par des musiciens un peu déconcentrés, mais visiblement ravis, le chef Paavo Järvi en tête. En début de concert (la seconde partie sera occupée par la 4ème Symphonie de Tchaikovski), création d’Affetuoso, « In memoriam Henri Dutilleux » d’Eric Tanguy. Une pièce d’un quart d’heure, affectueuse en effet, ne cherchant pas à imiter la musique du maître mais assez « dutilleusienne » par son refus de prêter allégeance à aucune chapelle, par sa volonté de sonner française sans exclure aucune influence extérieure. Comme pour se rassurer avant la tempête Lisitsa.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 8 et 9 janvier Photo © DR

A l’Opéra Bastille, Philippe Jordan annonce la nouvelle année à sa manière vec la Symphonie n°2 « Résurrection » de Gustav Mahler. Un test pour le chef. Virages dangereux : l’alternance de guerre et paix (intérieure) du premier mouvement Totenfeier (Fête des morts), la respiration très particulière de l’Andante (bonheur ambigu, silences menaçants), les ricanements orchestraux du Scherzo, l’ascension finale (une bonne demi-heure) vers la Résurrection, alternance de tensions-détentes risquant périodiquement de déraper dans la musique de film. Moments forts : l’Andante et le Scherzo, transparents, étonnants, vraiment personnels. Totenfeier narrative mais pas trop, Finale retenu mais fervent. Une forme de sans-faute, avec un orchestre irréprochable, des chœurs et des solos vocaux tirés au cordeau (la mezzo Michela Schuster extravertie mais convaincante dans l’Urlicht). Léger sentiment de frustration pourtant : trop beau, trop léché, trop pensé ? Jordan, jeune chef surdoué, n’est jamais meilleur que quand il est au bord du gouffre.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille, 30 décembre. Photo © Opéra de Paris

Création annuelle de la Compagnie Les Brigands au Théâtre de l’Athénée : La Grande-Duchesse d’Offenbach. Celle de Gerolstein bien-sûr, qui a perdu son patronyme, ainsi qu’une partie de sa musique. Un Offenbach qui n’a rien de philologique (voir les travaux du musicologue Jean-Christophe Keck), mais pas non plus complaisant façon feu Jérôme Savary. C’est - mis en scène par le cinéaste Philippe Béziat - un festival de faux-semblants, de balles coupées, de dérapages contrôlés, d’allusions détournées à l’actualité : le beau militaire est gay, le baron Grog est une femme, le Général Boum mène la danse à coups de trompette. Tout le monde, chanteurs et musiciens (ces derniers sur scène, sans cesse en mouvement, dirigés par Christophe Grapperon), jongle, pour mieux les mettre à mal, avec les codes du théâtre, de l’opérette, de l’opéra. Ils pourraient aller plus loin, jusqu’au burlesque pur, mais la charge est déjà assez violente, assez offenbachienne en somme. Même inconfort pour les oreilles : couacs et finesse, musique de chambre et bastringue, chant châtié et parodie jusque chez Isabelle Druet, Grande-Duchesse à l’abattage pourtant idéal. Salle « de Fêtes », comble et ravie, mais un peu interloquée : pas innocent du tout, ce réjouissant jeu de massacre.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 5 janvier. En tournée jusqu’au 21 janvier Photo © DR

Succès, au Théâtre des Champs-Elysées, de Dialogues des Carmélites de Georges Bernanos et Francis Poulenc mis en scène par Olivier Py. Le temps est loin où Maurice Fleuret, dans Le Nouvel Observateur, se demandait s’il fallait encore monter un ouvrage aussi réactionnaire : traditionnelles (Mireille Delunsch à Bordeaux) ou revisitées (Christophe Honoré à Lyon), les productions se bousculent, et font salle comble. Bonne idée de Py : l’intemporalité. Révolution française, nazisme, stalinisme ? Tout cela esquissé, pour raconter l’histoire des Carmélites de Compiègne, guillotinées sous la Terreur. Très précise en revanche la direction d’acteurs, comme pour mieux incarner l’idée force – et intemporelle elle aussi – que « l’on ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres » (en langage chrétien : la Communion des Saints). Scènes choc : l’agonie de la vieille Prieure vue en plongée, comme un insecte épinglé sur un mur, et le Salve Regina final, où les soeurs gagnent un ciel étoilé à mesure que tombe le couperet. Quatuor gagnant de divas made in France - Patricia Petibon, Sandrine Piau, Sophie Koch, Véronique Gens -, avec en guest star l’exotique mais incandescente Rosalind Plowright ; direction attentive à défaut d’être inspirée de Jérémie Rhorer à la tête du somptueux Philharmonia de Londres. Clé du spectacle, présente aux moments cruciaux : une sorte de lampadaire sans abat-jour, traditionnellement utilisé pour éclairer les plateaux vides, appelé servante. C’était le titre de la pièce qui a lancé Py en 1995, c’est le seul dont se glorifient les Carmélites. Tout un symbole.
François Lafon
Théâtre des Champs-Elysées, Paris, jusqu’au 21 décembre. Le 21 : en direct sur France Musique et en streaming direct sur le site du Théâtre, en collaboration avec Arte Live Web et France Télévisions. Photo © TCE

Pour les concerts de célébration du huit cent cinquantième anniversaire de la cathédrale, " Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris " a commandé une œuvre à Philippe Hersant : Les Vêpres de la Sainte Vierge pour « grand effectif vocal » traité le plus souvent en triple chœur, chœur d’enfants, baryton solo, orgue de tribune et orgue de chœur, cloches et ensemble de cuivres anciens (deux cornets et trois sacqueboutes). L’ouvrage, divers et attachant, d’une durée d’environ 75 minutes, vient d’être donné en première audition sous la direction de Lionel Sow. Le titre, audacieux, ne peut manquer de rappeler Monteverdi. Philippe Hersant ne s’en cache pas : il s’agit d’un hommage à ses Vêpres de 1610, avec d’autres références au passé : Ave, dulcissima Maria de Gesualdo, Livre Vermeil de Montserrat, thèmes grégoriens, fanfares et jeux de cuivres évoquant les musiques italiennes du XVIIe siècle, voire Heinrich Schütz. Est suivi de près l’Office des Vêpres tel qu’il est célébré en la cathédrale : Ave Maris Stella et Magnificat en latin, Psaumes 125 et 126 et Cantique aux Ephésiens en français dans la belle traduction de Lemaîstre de Sacy, janséniste du XVIIème siècle. L’espace même de Notre-Dame a présidé à beaucoup de choix « compositionnels », notamment pour la deuxième des trois toccatas pour orgue, avec ses sources sonores - les deux orgues et les deux cornets - très éloignées les unes des autres. L’ultime verset du Magnificat débute dans le mystère, malgré les paroles « Gloria Patri et Filio », pour se conclure (et les Vêpres avec lui) dans la splendeur sonore du « Et in saecula saeculorum Amen ».
Marc Vignal
Cathédrale Notre-Dame de Paris, 10 décembre 2013 Photo © DR

A l’Ircam (Centre Pompidou) : Trio. Trios plutôt : trois compositeurs (Marc Monnet, Liszt, Bartok), trois interprètes : (Tedi Papavrami – violon -, François-Frédéric Guy – piano -, Xavier Phillips - violoncelle), plus deux informaticiens, Carlo Laurenzi et Thierry Coduys. Atmosphère alla Monnet, rêve de temps aboli : modernité de Pensées des morts de Liszt (matrice des Harmonies poétiques et religieuses), audace en référence aux classiques de la Sonate pour violon seul de Bartok. Monnet en ouverture et en point d’orgue : Imaginary Travel pour piano et informatique (1996), inspiré par des clichés de Wim Wenders projetés sur grand écran, et Trio n° 3, créé ce soir, dédié « aux musiciens créateurs, mais aussi au vent, à l’ombre et au chaos humain ». Une pièce dure - glas, bourrasques, plaintes et soupirs « en temps réel » -, défendue comme un classique par des musiciens non spécialisés contemporain : « Leur jeu, leur travail du son me semblent plus recherchées » (Monnet). Une gageure, entre Liszt et Bartok, morceaux de bravoure pour Guy et Papavrami. Un test plutôt concluant, en tout cas, pour cette œuvre hors cadre d’un compositeur hors normes.
François Lafon
Ircam (Paris), Espace de projection, 9 décembre Photo © DR

Reprise au Châtelet, trois ans après, de My Fair Lady dans la mise en scène de Robert Carsen (voir ici). Un cadeau en v.o. pour les fêtes : cast impeccable (excellent Alex Jennings en Pr Higgins), décoration chic, sonorisation (presque) indétectable. Luxe que ni Londres ni New York ne se permettent : un orchestre symphonique dans la fosse (Pasdeloup, très en forme, fort bien dirigé par le jeune Américain Jayce Ogren), selon la tradition maison « mieux qu’à Broadway ». A revoir ce sans faute, on rêve pourtant d’une vision plus nerveuse, plus insolente de cette fable inspirée du Pygmalion de George Bernard Shaw, où il est question de machisme, de manipulation sociale, d’émancipation de la femme au son de mélodies délicieusement désuètes. « Voilà la doxa de la comédie musicale, que le public français a mis si longtemps à accepter », semble dire Carsen. Une prochaine fois peut-être… Mais l’équilibre subtil qui fait de My Fair Lady un chef-d’œuvre du genre y résistera-t-il ?
François Lafon
Châtelet, Paris, jusqu’au 1er janvier 2014 Photo © DR

A Pleyel, Bertrand de Billy dirige l’Orchestre de Paris. Programme rare pour chef rare : à la Symphonie en la majeur d’un Saint-Saëns de quinze ans rendant hommage à Mozart et Mendelssohn dans une France folle de Gounod et Meyerbeer succède la Messe n° 6 de Schubert, chef-d’œuvre testament, contemporain des dernières Sonates pour piano, de la Symphonie « La Grande », du Quintette avec deux violoncelles. Au pupitre - petites lunettes et gestique sobre -, le chef chéri de Vienne et de Salzbourg, ex-directeur musical du Liceo de Barcelone, Parisien qui ne passe qu’en coup de vent dans son pays natal. Avec lui, le devoir sage du surdoué Saint-Saëns devient une fête de fraîcheur et de couleur, un exercice de style, mais quel style ! Quant à la Messe, œuvre difficile car à la fois solennelle et intime, facilement monotone sous une baguette plus distraite, elle sonne ici comme l’antithèse de l’écrasante Missa Solemnis de Beethoven, elle aussi sa contemporaine. Orchestre sur son trente-et-un, chœur impeccable, solistes (cinq, dont l’excellent ténor Werner Güra) finement assortis. Plus occupé à mettre en avant ses musiciens que lui-même, De Billy a quelque chose de Pierre Monteux : au moment où l’on se dit « Ah, l’élégance française ! », on s’aperçoit qu’il a mis le feu à l’orchestre, et que la musique prend une dimension insoupçonnée.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, les 28 et 30 novembre. Accessible jusqu'au 28 mai 2014 sur Medici.tv, Orchestredeparis.com et Citedelamusique.tv Photo © Marco Borggreve

Enième reprise au Palais Garnier de La Clémence de Titus de Mozart, mis en scène par Willy Decker. Depuis la première en 1997, chefs et chanteurs se sont succédé (voir ici). Le spectacle, lui, n’a pas bougé, mais on le voit de plus loin. Ces Romains en perruque et jabot, ce buste officiel qui émerge du marbre à mesure que le despote est plus éclairé, ce mouvement permanent, entre réalisme et pantomime, destiné à clarifier l’action tout en animant les longues plages de chant pur propres à l’opera seria témoignent de l’époque où l’opéra avait découvert le théâtre, où il savourait les délices de la dramaturgie et les vertiges de la distanciation, assez loin encore des tentations trash du Regietheater. On n’a pas pour autant l’impression d’être au musée, tant les chanteurs, jeunes pour la plupart, s’impliquent dans l’action, tant le public a intégré ces codes qui ne le dérangent plus depuis longtemps. Tamar Iveri a la classe, mais pas toujours l’endurance de la terrible Vittelia, Saimir Pirgu est impeccable à défaut d’être mémorable en Titus, tous deux sont distancés par Stéphanie d’Oustrac, Sextus enflammé. Un luxe ordinaire, mais un luxe quand même.
François Lafon
Opéra National de Paris Palais Garnier, jusqu’au 23 décembre

A l’Opéra Bastille, Les Puritains de Bellini, mis en scène par Laurent Pelly. Un spectacle conçu autour de Natalie Dessay et Juan Diego Florez, dans la lignée de La Fille du régiment de Donizetti (voir ici) mis en scène par le même Pelly. Mais les deux stars ont déclaré forfait, laissant l’Opéra aux prises avec un ouvrage à la distribution introuvable, sauf à retenir d’autres stars plusieurs années à l’avance. Résultat honorable : sous la direction fluide du spécialiste Michele Mariotti, les jeunes Maria Agresta et Dmitri Korchak escaladent cet Everest vocal sans accident notable, solidement secondés par les vétérans Mariusz Kwiecien et Michele Pertusi. A court d’idées, Laurent Pelly s’en tire moins bien,enfermant les chanteurs dans une carcasse de château Tudor où les voix se perdent. Au moins n’a-t-il pas essayé de transposer (en Amérique pendant la guerre de Sécession, aujourd’hui dans la bande de Gaza ?) cette improbable histoire d’amour contrarié et de folie subite, dont le cadre historico-politique (l’Angleterre sous Cromwell, Puritains contre Royalistes) n’est que la toile de fond d’un combat où l’on se bat à coups de contre-ut et où l’on applique sur les blessures des kilomètres de cantilènes éthérées.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, jusqu’au 19 décembre. En direct sur grand écran le 9 décembre : salles UGC dans le cadre de la saison « Viva l’opéra » et cinémas indépendants. Photo © Opéra de Paris

Au théâtre de l’Athénée, doublé rabelaisien avec Pantagruel et C’est la faute à Rabelais. L’urtext et ses avatars : dans Pantagruel, Benjamin Lazar - pour une fois sans éclairage à la bougie ni prononciation restituée – raconte à travers l’histoire du géant voyageur le passage du Moyen Age à la Renaissance. Un spectacle à la fois bricolé et magique, où le formidable Olivier Martin-Salvan, géant-narrateur à l’étonnante palette expressive, évolue dans un monde de peaux de bêtes et de raffia, se nourrit (au sens propre) de culture et nous entraîne jusqu’au fond de la mer … et des entrailles du héros. Avec C’est la faute à Rabelais, dans la petite salle Christian Bérard, l’auteur-acteur Eugène Durif et le musicien-acteur Pierre-Jules Billon - clowns très cultivés et un peu beckettiens (on pense à En attendant Godot) - explorent sous forme de cabaret plus bricolé encore l’héritage du grand homme, de Villon à … Durif en passant par Clément Marot et Jehan Rictus. Musique dans les deux spectacles : cornet et flûte, guitare et luth, sons d’époque recomposés par David Colosio pour le premier, capharnaüm d’instruments vieux et neufs, refrains dans l’esprit chansonnier pour le second. Second degré musical - très réussi - dans les deux cas : difficile de jouer à jeu égal avec de tels textes.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 30 novembre. Pantagruel : tournée en janvier (Saint-Dizier, Saint-Nazaire, Quimper, Blagnac, Périgueux, Le Perreux) Photo : Pantagruel © N. Baruch

Créé à Paris en 1933, le ballet Les sept péchés capitaux des petits bourgeois, dernière œuvre commune de Kurt Weill et Bertolt Brecht, résulte d’une commande de George Balanchine. Hier, à la salle Pleyel, l’ouvrage inaugurait un concert de l’Orchestre philharmonique de Radio France entièrement consacré à Weill, chose rare. Le personnage d’Anna I, raisonnable et pratique, voix de la conscience, se dédouble en Anna II, un peu folle, beau reflet dansant de la première. Sa mission est de parcourir les grandes villes en se faufilant à travers les sept péchés capitaux pour ramasser de l’argent et secourir le reste de la famille (quatuor vocal). Tableau sombre et grinçant de la société capitaliste, beau succès. Sous le nom de Petite musique de Quat’sous, Weill réalisa en 1928 une adaptation, en huit numéros pour orchestre d’instruments à vent, de quelques pages de son opéra le plus célèbre : belle occasion de faire sonner la chanson de cabaret et la revue berlinoises de l’époque. La triomphatrice de la soirée ? Anne Sofie von Otter dans une série de Songs tirés de comédies musicales de la période américaine de Weill. Prestation extraordinaire de la part d’une chanteuse qui brille aussi dans le baroque, et dont les accents et la gestique transportaient à Broadway : on avait là - pourquoi pas ? - une sorte de seconde Marlène Dietrich. Pour la plus grande joie de l’assistance, Anne Sofie von Otter fut pour finir rejointe en duo par l’excellent chef viennois Karl-Heinz Gruber. Kurt Weill est un compositeur aux facettes multiples. Connaissant à fond son métier d’homme de théâtre, il sut s’adapter pour le meilleur aux lois et à l’esthétique du show-business.
Marc Vignal
Salle Pleyel, 15 novembre 2013 Photo © DR

A l’Auditorium du Louvre, Lecture of Nothing de John Cage, dans le double cadre du Festival d’Automne et du "Louvre invite Robert Wilson". En scène, Wilson himself, face blanche, vêtements blancs, attablé à une table blanche cernée de panneaux blancs couverts de mots noirs. Au sol, une mer de journaux froissés. Lumière Bleu Wilson, comme on dit Bleu Klein. Cette « Conférence à propos de rien », prononcée par Cage en 1949 et insérée dans le recueil culte intitulé Silences, parle en réalité de beaucoup de choses, entre autres de musique. En cinq parties de quarante-huit unités comptant chacune quarante-huit mesures, elle est en elle-même une partition, qui ne commence ni ne finit, que l’on peut donc prendre et laisser où l’on veut, et où Wilson décèle « un mode de pensée radicalement différent ». « Je suis ici, et il n’y a rien à dire », commence celui-ci, calme, suivant du doigt les mots sur la page blanche. Il ira ensuite se coucher (lit blanc), ira jusqu’au cri, se calmera, et nous laissera sur « Il est tout à fait clair que je ne sais rien. » Des mots, des rythmes, des silences : tout le portrait du compositeur de 4 minutes 33 secondes (de silence). Celui de Wilson aussi, qui , envoie des clins d’œil au public et revient saluer en dansant, de nouveau le jeune homme désarticulé qu’il était dans Overture (Opéra Comique - 1972). Et tout cela, aussi, pour nous consoler – ou pas – de vivre dans un monde ou « Life, time and Coca-Cola » cachent de plus en plus mal qu’ « une structure est comme un pont de nulle part à nulle part ».
François Lafon
Louvre, Auditorium, 11-14 novembre – Le Louvre invite Robert Wilson, 11 novembre – 17 février Photo © Wonge Bergmann

Au Châtelet, The End, vocaloid opéra. Débuts parisiens de Hatsune Miku, seize ans, 1,58 m, 42 kg, jambes interminables et couettes bleues. Une star internationale, surnommé la « Net-Age-Diva », plus cliquée sur Internet que Lady Gaga, convaincue par le compositeur Keiichiro Shibuya de se lancer dans l’art lyrique. Histoire personnelle (la disparition de son épouse), culturelle (il a vu, en 1992, Wozzeck … au Châtelet dans la mise en scène de Patrice Chéreau), nationale (Fukushima) : Shibuya parle de la mort. Et qui peut incarner, pour un Japonais de notre temps, la femme dont on rêve, sinon Hatsune Miku (en français : « Premier son du futur »), artiste sans âme et créature parfaite puisque vocaloid (logiciel de synthèse vocale, version musicale d’humanoïde), d’autant plus vraie qu’elle est totalement virtuelle, et dont la mort prend des allures d’aventure cybernético-métaphysique ? Quatre écrans, sept projecteurs, cinquante enceintes et le compositeur lui-même aux manettes pour rendre plus présente et plus absente en même temps cette femme en 3D frappée par un virus (informatique ?), habitant un univers de manga truffé de références (avis aux fans). Salle comble, grosse couverture de presse mais trois représentations seulement : les producteurs ont-ils sous-estimé le charisme de la Miku ? Pour le néophyte : prouesse technique, invention visuelle assez bluffante (mise en scène du cinéaste YKBX), mais musique étrangement commerciale (un peu de John Adams, pas mal de Jean-Michel Jarre) et voix monocorde autant que métallique de la diva. Les initiés ont bien sûr une tout autre perception du phénomène.
Olivier Debien - François Lafon
Châtelet, Paris, 12, 13, 15 novembre.

90ème anniversaire (anticipé, ce sera le16 décembre) de Menahem Pressler à Pleyel. Deux heures et demie de musique pour le pianiste du Beaux Arts Trio, devenu soliste sur le tard et admis vivant au panthéon des grands ancêtres. Programme composite, où l’artiste, jamais seul, ne se ménage pas pour autant : Schubert à quatre mains avec Wu Han (Fantaisie) et à deux mains et quatre archets avec le Quatuor Ebène et le contrebassiste Benjamin Berlioz (La Truite), des extraits du Voyage d’hiver avec le ténor Christoph Prégardien, Dvorak (Quintette) avec les Ebène. Allocution finale de Mathieu Herzog, l’altiste du quatuor : « Jouer comme cela à cet âge-là, ce n’est pas normal. » Toucher de rêve, musicalité transcendante, zénitude inentamée (un exemple pour les agités du clavier), le héros de la soirée donne le change, et tant pis pour les inévitables flottements dont le Quatuor fait les frais. Moments forts : Prégardien, fabuleux chanteur, calquant ses phrasés sur ceux de son accompagnateur, les Ebène jouant (superbement cette fois) le mouvement lent du Quatuor de Debussy, Pressler remerciant par un Chopin magique avant d’être enseveli sous une pluie de confettis dorés. Un nouveau CD (voir ici), un Mozart avec l’Orchestre de Paris (29, 30 janvier) : pour quelques élus, le secret est de savoir ne pas s’arrêter.
François Lafon

Festival d’Automne à la Bastille : Matthias Pintscher dirige Webern, Stravinsky et lui-même avec l’Orchestre de l’Opéra. Œuvres de jeunesse : Im Sommerwind est la première pièce pour orchestre de Webern, une « idylle » mahlero-strausso-debussyste où les prémisses de la raréfaction sonore à venir sont encore cachées. De même L’Oiseau de feu (ballet intégral) est un dernier coup de chapeau de Stravinsky à son maître Rimski-Korsakov. « Ma réflexion de chef d’orchestre est enrichie par mon propre processus d’écriture, et vice versa », remarque Pintscher. Cela se sent lorsqu’après Im Sommerwind, il dirige sa pièce Chute d’étoiles pour deux trompettes et orchestre, inspirée d’une installation du plasticien Anselm Kiefer mêlant argile et plomb, gravats et arbre déraciné. Le soin qu’il met à éviter le grand spectacle dans Webern se retrouve dans sa musique, à la fois description d’un paysage d’apocalypse et tentative de redonner une forme à un monde dévasté. Même impression dans L’Oiseau de feu, où la grisaille guette, balayée de soudains éclairs de poésie. L’Orchestre de l’Opéra y perd de sa superbe : fatigue entre Aida et Elektra actuellement à l’affiche, ou étonnement d’être dirigé comme la réunion de solistes de l’Ensemble Intercontemporain, dont Pintscher est le nouveau directeur (voir ici) ?
François Lafon
Opéra National de Paris - Bastille, 42ème Festival d’Automne à Paris, 30 octobre Photo © DR

A l’Opéra Bastille, Elektra de Richard Strauss dans la mise en scène de Robert Carsen (Tokyo, 2005, Mai Musical Florentin, 2008). Une arène de sable noir cernée de hauts murs, un ballet de servantes-clones d'Elektra formant chœur antique, un hommage à Pina Bausch sans Pina Bausch, esthétiquement séduisant, ponctué de moments forts, comme l’apparition de Clytemnestre sur son lit blanc porté comme un linceul. Pas de danse hystérique, pas de rires fous ni de dérapages gores, si ce n’est l’étrange scène d’amour d’Elektra avec un Agamemnon nu aux allures de Christ au tombeau. Impression tenace pourtant que le sujet n’est qu’effleuré, que les personnages ne sont que des motifs dans le tapis, que le cérémonial tient lieu d’analyse dramaturgique. Difficile, après la lecture au scanner de Patrice Chéreau (voir ici - Arte Live Web, jusqu’au 29 octobre. Bientôt, on l’espère, en DVD) de revenir à ces stéréotypes, fussent-ils artistement relookés. Perdues dans l’immensité, les voix sont désincarnées, elles aussi, comme abstraites. Dommage pour Irène Theorin, Ricarda Merbeth, Waltraud Meier surtout, si impressionnante dans le spectacle de Chéreau. Tout le théâtre est dans la fosse, où Philippe Jordan dirige un orchestre somptueux, traversé du souffle tragique et de la densité psychologique que la scène nous refuse.
François Lafon
Opéra National de Paris, Bastille, jusqu’au 1er décembre. En différé sur France Musique le 20 novembre Photo © Opéra

Pour la 850e anniversaire de la cathédrale, Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris - structure créée en 1991 conjointement par l’Etat, la Ville de Paris et l’Association diocésaine de Paris - a passé commande à quinze compositeurs d’autant de pièces d’église, à savoir une messe brève et douze motets. L’ensemble, d’une durée de près d’une heure et demie et qui se situe dans la lignée séculaire des musiques de maîtrise, a été donné en création mondiale, cinq jours après un colloque au Collège des Bernardins, avec comme titre Le Livre de Notre-Dame. Il s’agit de pièces de difficulté moyenne et d’esthétiques très différentes pour chœur d’enfants avec accompagnement d’orgue, les compositeurs choisis n’ayant pas forcément une grande habitude de la musique liturgique. Certaines pièces sont en latin, d’autres en français, elles suivent le déroulement de l’année liturgique, et l’on espère qu’elles résonneront au fil des saisons en des lieux multiples. On pouvait craindre au début une certaine monotonie, mais on s’est vite senti rassuré, envahi par un sentiment sinon de piété, du moins d’élévation. Emilie Fleury était à la direction, Yves Castagnet et Denis Comtet à l’orgue de chœur. Les compositeurs ? Il faut les citer tous, ou n’en citer aucun. Impressionnante, la longue file d’attente à l’extérieur avant le concert, avec comme résultat une cathédrale archicomble. Faut-il s’en étonner ?
Marc Vignal
Notre-Dame de Paris, 22 octobre Photo © DR

Tout comme Lully puis Gluck, Spontini jeta en son temps les fondements de l’Opéra à la française. Admiré par Wagner et Berlioz, il confiait lui-même au premier que « depuis la Vestale, il n’a point été écrit une note qui ne fût volée à mes partitions. » De cet opéra entre deux époques, le Théâtre des Champs-Elysées offre une représentation entre deux eaux. Avec une mise en scène dépouillée à l’extrême, des décors et des costumes intemporels, ainsi qu’un beau travail de lumières, le metteur en scène Eric Lacascade privilégie la dimension sensuelle de l’œuvre – difficile de ne pas penser parfois, à l’Extase de Sainte Thérèse (du Bernin), visible à jet de pierre du temple de Vesta – et en oublie les tourments et les fureurs. Ermonella Jaho, en Vestale vers qui tous les regards se tournent, est à l’unisson : elle fait merveille dans les pianissimi (et aigus), mais manque de densité dans les passages en puissance (et graves). En revanche, son alliance avec la grande prêtresse (interprétée par Béatrice Uria-Monzon) fait de l’acte II le moment fort de la représentation. Côté homme, l’univers macho et bellâtre voulu sans subtilité par Eric Lacascade cultive à contre-emploi le ridicule. Si Jean-François Borras (Cinna) et Konstantin Gorny (Le Souverain Pontife) ont pour eux le timbre, la diction et le sens dramatique, Andrew Richard se contente de faire invariablement le cabotin, avec peu du reste. Les chœurs (Chœur Aedes) sont, avec le face à face du deuxième acte, la deuxième clé magique de cette soirée, laissant dans l’ombre une direction orchestrale (Jérémie Rhorer ; Le Cercle de l’harmonie) flottante, notamment dans les solos de vents.
Albéric Lagier
Théâtre des Champs Elysées, les 15, 18, 20, 23, 25 et 28 octobre 2013. Rediffusion sur France Musique le samedi 2 octobre à 19h00. Photo © Théâtre des Champs-Elysées
Pour le 200ème anniversaire exactement de la naissance de Verdi (10 octobre 1813), retour d’Aida à l’Opéra de Paris. Malédiction des pharaons ? En 1968, la mise en scène de Chéreau (Pierre), datant de 1939, donne lieu à un chahut historique. Bis repetita, quarante-cinq ans plus tard, avec celle d’Olivier Py, lequel vient courageusement saluer sous les huées. Sabres et goupillons, treillis et uniformes Risorgimento, architectures mussoliniennes en cuivre étincelant, charnier sous l’arc de triomphe de la Scène … du triomphe : au cas où on ne l’aurait pas compris, Aida est une mise en garde (certes très actuelle) contre le totalitarisme. Pour transformer le cuivre en or, de belles voix feraient l’affaire. Mais hormis Marcelo Alvarez, Radamès impeccable, les chanteurs sont ordinaires, les dames surtout, ce qui, en l’occurrence, est rédhibitoire : silence de mort accueillant l’ « Air du Nil » par la soprano ukrainienne Oksana Dyka. Etonnant de la part du directeur Nicolas Joël, dont les distributions sont le point fort. Etonnant aussi de celle du chef Philippe Jordan, attaché à faire ressortir les finesses de cette partition moins clinquante qu’on ne le pense encore, mais assez loin du naturel souverain qu’il affiche dans Strauss ou Wagner.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, deux distributions en alternance jusqu’au 16 novembre. En direct le 14 novembre à 19h30 dans des salles UGC et cinémas indépendants de France et du monde entier. Diffusion ultérieure sur Orange et Mezzo Live HD

Concert Britten–Beethoven à Pleyel, avec l’Orchestre de Paris dirigé par le peu médiatique mis très respecté David Zinman. Britten (né en 1913) pour le centenaire, Beethoven pour remplir la salle. Car si Le Tour d’écrou ou Billy Budd ont leur public, la Sinfonia da Requiem - hymne à la paix aux accents mahlériens (Le Chant de la Terre) commandé en 1940 par le très belliqueux Japon et refusé parce que trop chrétien – n’a rien d’un tube. On en retrouve des accents cinq ans plus tard dans les plus connus Interludes marins tirés de l’opéra Peter Grimes, mais plus incisifs, plus dramatiques, plus habilement placés. Zinman - gestique précise et présence évoquant son maître Pierre Monteux - s’y interdit tout sentimentalisme, comme le faisait Britten quand il dirigeait ses propres œuvres, mais s’entend à faire monter la pression quand il le faut. L’orchestre, impeccable, sonne clair et net. On s’étonne de ne pas retrouver la Zinman touch dans un Concerto pour violon de Beethoven où le soliste Nikolaj Znaider - violon superbe, nuances infinies – semble évoluer dans un monde parallèle. Pas un dialogue de sourd, mais une légère impression de rendez-vous manqué.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, les 9 et 10 octobre Photo © DR

A la Cité de la Musique, rentrée de l’Ensemble Intercontemporain dans le cadre du cycle Rêves. Quatre rêves musicaux sous la baguette de Matthias Pintcher, qui commence sa deuxième saison à la tête de l’Ensemble : la Fuga (ricercata) a sei voci, extrait de L’Offrande musicale de Bach instrumenté par Webern, Two Interludes and a Scene for an Opera de Johnathan Harvey, la Sonate pour violoncelle seul de Bernd Alois Zimmermann et Bereshit de Pintscher lui-même. Quatre œuvres aussi différentes que possible : « Mon instrumentation essaye de mettre à nu les relations motiviques, » annonce Webern à propos de Bach ; « Mon travail sur Wagner Dream, qui évoque l’instant de la mort du compositeur, a précisément commencé par l’écriture de ces deux Interludes, » explique Harvey pour présenter ce concentré d’un opéra créé en 2006, où il exploite l’informatique Ircam avec le sens du spectacle qu’on lui connaît ; « Rêves, pensées et réalité apparaissent et alternent avec les souvenirs, les attentes et l’irréalité, » proclame Zimmermann, justifiant le caractère à la fois éclaté et concentré de sa Sonate ; « Bereshit est le premier mot de la Torah. Ce mot parle d’un à peu près d’un commencement - et non du commencement –, d’une césure, » précise Pintcher. Rêve d’un « état sonore originel », sorte de prélude de L’Or du Rhin contemporain mais nettoyé des tics répétés depuis un siècle par la « musique nouvelle », sa pièce rejoint dans l’esprit Bach par Webern. Il la dirige, comme les trois autres, avec le sens de l’économie qui caractérise son travail de compositeur. Solistes (les chanteurs Claire Booth et Godron Gietz, le violoncelliste Pierre Strauch) et tuttistes (mais tous les membres de l’Intercontemporain sont des solistes) participent de cette quête de l’essentiel. A méditer en ces temps de commentaire généralisé.
François Lafon
Cité de la Musique, Paris, 27 septembre. sur France Musique le 14 octobre à 20h Photo : M. Pintcher

A Pleyel avec l’Orchestre de Paris, les sœurs Labèque jouent un de leurs tubes : le Concerto pour deux pianos de Poulenc. Public de fans, énergie intacte des duettistes de charme (Katia en rouge, Marielle en noir) dans cette œuvre faussement pagaille, où l’auteur de Dialogues des Carmélites envoie des clins d’œil à Stravinsky et Ravel (le Concerto en sol) tout en tirant son chapeau à Mozart. En bis, la version à deux pianos de « When you’re a Jet » de Leonard Bernstein (West Side Story) achève de mettre la salle en joie. Effet Labèque garanti, rien de nouveau. Le nouveau, c’est Andris Poga, trente-trois ans, chef assistant au Symphonique de Boston et à l’Orchestre de Paris, remplaçant Georges Prêtre initialement prévu. Air jovial et geste rond, ce premier prix du Concours Evgeni Svetlanov est un « bras », comme on dit en jargon de métier. La suite d’orchestre tirée du ballet Les Animaux modèles (du petit Poulenc, créé en 1942 au Palais Garnier) passe comme l’éclair, le Concerto file droit. Après l’entracte, la 5ème Symphonie de Tchaikovski est plus éruptive que métaphysique : une fête pour l’orchestre, qui lui déroule le tapis rouge en jouant comme avec les plus grands. Un adoubement, en quelque sorte.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 25 et 26 septembre. Sur Arte Live Web, orchestredeparis.com et citedelamusique.tv jusqu’au 25 mars 2014 Photo © DR

Au théâtre de l’Athénée, Pierrot Lunaire de Schoenberg et Paroles et musique de Samuel Beckett/Morton Feldman par l’Ensemble Le Balcon « en résidence ». Sonorisation sophistiquée, mise en image de l’artiste multi-foncions Nieto. Particularité du Balcon : il ose tout, et peut se le permettre depuis le succès, à l’Athénée la saison dernière, d’un étonnant Ariane à Naxos de Strauss (voir ici). Donné en français (Albert Guiraud, auteur du texte était Belge francophone), sprechgesangué par un homme (le bluffant comédien-chanteur Damien Bigourdan) et non plus une femme, illustré avec un sens de l’économie qui met en valeur quelques images choc (la bouche sanglante, la chute des oiseaux), Pierrot Lunaire n’est plus seulement le manifeste sacro-saint de la nouvelle musique. Paroles et musique – rencontre de Beckett, qui n’aimait pas qu’un musicien tourne autour de ses textes, et de Feldman, qui se méfiait de l’opéra et de tout ce qui lui ressemblait – va plus loin : à pièce radiophonique, noir dans la salle, si ce n’est un projecteur braqué sur un spectateur-récitant de rouge vêtu. Quelques personnes sortent, le plus bruyamment possible. Applaudissements nourris quand le rideau de fer se lève sur le chef Maxime Pascal et ses musiciens, mettant une fois encore sens dessus dessous le rituel du concert.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 28 septembre. Photo © DR

Passage à la Cité de la Musique de Que Ma Joie Demeure!, de et avec Alexandre Astier, créé l’année dernière au Théâtre du Rond-Point, en tournée jusqu’en novembre. Public jeune, mélange de fans de la série Kaamelott (M6), dont Astier est l’auteur-scénariste-interprète, et d’élèves du Conservatoire tout proche. Au clavecin, au tableau noir, au confessionnal, à l’église, à la maison, jonglant avec ses béquilles (il s’est blessé pendant une représentation à Bordeaux), Astier-Bach donne une master-class et raconte sa vie. Atmosphère de cabaret, blagues de potache, bagout pas toujours raffiné : « Les ouvrages que Gilles Cantagrel a consacrés à Bach donnent une large part au trivial », se justifie-t-il. Grands moments parmi d’autres qui le sont moins : l’expertise d’un orgue à moitié démonté (Bach en a réalisé beaucoup), la répétition avec la maîtrise de Saint-Thomas, l’explication des commodités du cantus firmus. Car Astier est musicien, il connait son sujet, tâte de la viole et touche le clavecin. « Ma présence ici consisterait à dire qu’il n’y a pas de mauvaise façon de parler de la musique », se justifie-t-il encore. Les trivialités dont il ne se prive pas valent bien, en effet, les superlatifs lénifiants qui fleurissent dès qu’il s’agit de parler de grande musique au grand public.
François Lafon
Cité de la Musique, Paris, jusqu’au 22 septembre. A Genève, Valencienne, Lyon jusqu’au 11 novembre. Photo © DR

Reprise à l’Opéra Bastille de Lucia di Lammermoor de Donizetti dans la mise en scène désormais historique (1995) d’Andrei Serban. Un univers d’hommes, mi-corps de garde mi-amphithéâtre de la Salpêtrière, où le public bourgeois venait assister aux expériences de Charcot sur l’hystérie. Une salle de torture, avec passerelles, balançoire et espaliers, pour l’amoureuse persécutée au chant vertigineux. Un spectacle conçu pour June Anderson et Roberto Alagna, double présence magnétique. Les distributions suivantes étaient plus déséquilibrées : Mariella Devia, belcantiste consommée mais apparemment sujette au vertige, Sumi Jo impeccable et glaciale, Andrea Rost économe de ses moyens, toutes flanquées de ténors faire-valoir, jusqu’à Natalie Dessay (2006), spectacle à elle seule, et seule depuis Anderson à déchaîner un vent de folie. Aujourd’hui, deux distributions en alternance, rapports de force opposés. Yin et yang avec Patricia Ciofi - parfaite styliste et équilibriste mesurée - face à Vittorio Grigolo - chant débraillé mais sex-appeal affiché -, yang et yin avec Sonya Yoncheva - timbre somptueux et interprète casse-cou -, et Michael Fabiano - look ténébreux et chant de haute école. Troisième dimension : Ludovic Tézier (trop ?) élégant en méchant frère, cédant le pas au plus fruste mais plus efficace George Petean. Que du beau monde, cela s’entend.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille, jusqu’au 9 octobre. Journée spéciale sur Radio Classique le 26 septembre en direct du Studio Bastille, suivie de la représentation à 19h30. Photo © Opéra de Paris

Reprise à l’Opéra Bastille de L’Affaire Makropoulos de Janacek dans la mise en scène de Krzysztof Warlikowski, spectacle phare de l’ère Gerard Mortier. Salle de première, ovation au rideau final : visage fermé du metteur en scène, trublion devenu icône. Sept ans après, le spectacle ne choque plus, il fait même figure de mètre étalon d’un Regietheater désormais généralisé, de condensé des standards du genre, entre discours induit et démonstration appuyée : brillante, l’assimilation de la diva victime d’un élixir de longue vie à une star d’Hollywwod, d’autant plus fragile à la ville qu’elle est immortelle sur l’écran ; virtuose, l’utilisation de l’image – Marilyn qui rit, Marilyn qui pleure en guise d’ouverture, Gloria Swanson dansant pour l’éternité dans Sunset Boulevard de Billy Wilder ; superbe la mort tant désirée de l’héroïne au fond de sa piscine, passant le relais à sa cadette déjà marilynisée ; mais convenus les airs maffieux des hommes d’argent qui entourent la vedette, démonstratives les scènes de séduction dans les toilettes publiques. Question récurrente : une telle transposition donne-t-elle au public actuel les clés d’une œuvre déjà complexe ou achève-t-elle de le dérouter ? Respirant au rythme particulier de la somptueuse musique de Janacek, la chef Susanna Mälkki répond à sa manière, secondée par un plateau musicalement précis et dramatiquement concerné, même si l’excellente Ricarda Merbeth est moins crédible en diva névrosée qu’Angela Denoke en 2007.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille, jusqu’au 2 octobre Photo © Opéra de Paris

Première nouveauté de la saison à l’Opéra Garnier : Alceste de Gluck par le tandem Marc Minkowski - Olivier Py. Un rêve pour le chef, un pensum pour le metteur en scène. A musique noble et pathétique, action minimale, tirée d’Euripide : le roi Admète va mourir, à moins qu’un de ses sujets se sacrifie à sa place. Ce sera son épouse Alceste, laquelle sera sauvée par Hercule. En acclimatant son ouvrage viennois (1767) à la scène parisienne (1776), Gluck a posé les principes de sa « réforme » : plus de folies vocales comme dans l’opéra italien, plus de ronds de jambes comme dans la tragédie lyrique française. Du naturel, du vécu, de l’émotion. Pour animer cette édifiante déploration, Py a imaginé un univers sans couleur, un Palais Garnier dessiné en temps réel sur un immense tableau noir, une coiffeuse où l’on se grime et un lit où l’on agonise, des enfants royaux qui figurent la mort et la résurrection, des sentences effacées sitôt écrites, un orchestre qui passe de la fosse au plateau (après l’entracte) en vertu du fait que « Seule la musique sauve » Une allégorie de l’opéra selon Gluck, qui meurt pour renaître plus pur et plus vrai (sentence finale : « La mort n’existe pas »), ou seulement un habillage habile d’une fable qui a moins bien franchi les siècles que celles d’Electre ou d’Antigone ? Occupés à soigner leur style sous la baguette musclée de Minkowski, les chanteurs, la superbe Sophie Koch en tête, sont démonstratifs là où on les attend sensibles. Alors, à défaut d’essuyer une larme, on étouffe un bâillement.
François Lafon
Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 7 octobre. En direct sur France Musique et sur les radios associées de l’Union Européenne le 28 septembre Photo © Opéra de Paris/A. Poupeney

Les Gurrelieder de Schönberg n’avaient jamais été entendus en Roumanie. C’est chose faite depuis le 7 septembre : concert-événement qui fut l’un des points forts du Festival Enesco. L’œuvre, entreprise en 1900, ne fut créée en 1913. Elle valut à Schönberg son plus grand triomphe public, mais ce triomphe fut en quelque sorte posthume : il avait dans l’intervalle radicalement évolué et produit une série d’ouvrages à scandale, alors que par leur sujet (une légende danoise relatant avec ses funestes conséquences l’amour d’un roi pour une jeune fille nommée Tove), le gigantisme de leurs effectifs instrumentaux et vocaux et leur durée de plus d’une heure et demie, les Gurrelieder s’inscrivaient dans la grande tradition romantique. Bertrand de Billy devait diriger. Il a été remplacé par le Britannique Leo Hussain, qu’on avait entendu le 5 à la tête de la Philharmonie de Moldavie dans des pages de Maxwell Davies et Birtwistle. Hussain, qui souhaitait depuis longtemps s’attaquer aux Gurrelieder, n’eut que très peu de temps pour se préparer. Il s’en est tiré avec les honneurs, comme aussi bien le chœur que Janina Baechle dans le Lied der Waldtaube (Chant du Ramier). Avant d’être interprété « normalement » en Sprechgesang, le texte de l’épisode suivant la fantastique « Chasse sauvage du vent d’été », juste avant le grandiose chœur final, a été simplement récité en roumain par l’acteur Victor Rebengiuc, vétéran des scènes du pays, dans un souci de meilleure compréhension. Il va de soi que les bruyantes manifestations d’enthousiasme du public à l’issue du concert se seraient produites en tout état de cause.
Marc Vignal
Photo © DR

5 septembre, grande Salle du Palais, 3 000 personnes. Paavo Järvi dirige l’Orchestre de Paris : pour commencer, une ouverture du Corsaire de Berlioz menée tambour battant au détriment de l’imagination ; pour finir, une Symphonie avec orgue de Saint-Saëns des grands jours ou presque, avec en soliste (si l’on peut dire) un Thierry Escaich soucieux, par sa retenue, de ne pas maltraiter le fragile instrument à sa disposition. Entre les deux, le concerto pour violon de Britten, sans grande substance mais admirablement servi par la Norvégienne Vilde Frang.
6 septembre, dans la même salle, second concert de l’Orchestre de Paris, clos par une phénoménale Cinquième Symphonie de Prokofiev, après une Première Symphonie d’Enesco. Celle-ci fut créée en 1905 à Paris, où, sans trop y croire, on espère l’entendre bientôt, d’autant que Järvi sait la diriger : musique aux relents brahmsiens, wagnériens et berlioziens mais s’imposant surtout par sa rudesse. Elle ne coule pas toujours de source, et c’est fort bien ainsi.
Ailleurs, dans la salle de l’Ateneul, l’excellent Ensemble Profil fit entendre six œuvres d’autant de compositeurs roumains, dont l’un nommé Adrian Enescu, témoignant d’une heureuse concision et d’un savoir-faire certain. Succès mérité aussi pour l’Allemand Jörg Widmann grâce à son éblouissant concerto pour trompette et aussi à sa vaste Messe (2005), dernier volet d’un trilogie transférant des formes vocales à l’écriture pour grand orchestre. La Philharmonie de Cluj était de la fête. (à suivre)
Marc Vignal
Photo © DR

Radu Lupu habite aujourd’hui en Suisse, mais le 4 septembre au soir, il était revenu doublement chez lui : à Bucarest, son pays d’origine, pour jouer Schubert un compositeur devenu au fil des ans sa « patrie pianistique. » Son interprétation des deux dernières sonates, avec un souci des nuances, une miraculeuse indépendance des mains et un sens des « divines longueurs » tint la salle en haleine. Et quatre bis - Schubert évidemment - ont sanctionné et prolongé ce triomphe, l’un des grands moments du Festival International George Enescu (Enesco est la francisation du patronyme roumain du compositeur) qui se tient tous les deux ans et dont la 21ème édition a lieu du 1er au 28 septembre à Bucarest et dans dix autres villes roumaines. Le programme global de cette manifestation est comparable par son ampleur et sa variété à ceux de seulement quelques rares festivals, comme Salzbourg ou surtout Lucerne. Plus de 80 manifestations à Bucarest, avec de prestigieuses formations venant du monde entier alors que le budget est de 8 millions d’euros contre 64 millions pour Salzbourg. La vente des billets assure 10% des recettes, 20 000 billets sont vendus à l’étranger, et comme il se veut populaire, le festival propose par exemple un forfait de 350 euros pour 29 concerts. Ce qui équivaut malgré tout à un salaire mensuel… (à suivre)
Marc Vignal
Photo © DR

Le festival de La Chaise-Dieu possède depuis cette année un nouveau directeur général, Julien Caron, le plus jeune en France à occuper un tel poste, mais Bach conserve dans la programmation une place de choix. Le faire coexister avec Mondonville (1711-1772), auteur de dix-sept grands motets composés de 1754 à 1758 et dont huit sont perdus, et le sublime compositeur tchèque Zelenka, actif à la cour de Dresde (Allegro de la Sinfonia a 8), est dans l’ordre des choses. Avec Mondonville, on n’est plus à Versailles mais dans le Paris de Louis XV : ses motets - on a entendu le dernier (In exitu Israel) puis le premier (Dominus regnavit) - sont d’essence à la fois religieuse et profane, avec leurs ritournelles et leur esprit d’ouverture à la française. L’ensemble Les Nouveaux Caractères, fondé en 2006, et son chef Sébastien d’Hérin, se sont également imposés dans le Magnificat de Bach, avec d’extraordinaires fondus du chœur et de l’orchestre avec trompettes et timbales. A Leipzig, sans pour autant pratiquer la dévotion mariale, on savait rendre hommage à la mère de Dieu. Le soir, Raphaël Pichon et son Ensemble Pygmalion donnaient une mémorable Passion selon saint Jean, chambriste mais remplissant sans peine l’espace. On l’a ressenti dès le chœur initial et plus encore dans les airs, quand seuls deux instruments de la même famille s’ajoutent à la basse continue. On atteignait là un rare degré d’émotion, et dans certains chorals, comme celui terminant la première partie, un bienfaisant sentiment d’éternité.
Marc Vignal
Abbatiale Saint-Robert, 29 août Photo : Les Nouveaux caractères

En 1713 sont signés les traités d’Utrecht, ville de Hollande, qui mettent fin à la guerre de Succession d’Espagne : ce pays est relégué au second rang, l’Angleterre de la reine Anne Stuart réaffirme sa puissance maritime et prend possession du rocher de Gibraltar. Le prédécesseur d’Anne sur le trône de Londres, son beau-frère Guillaume III d’Orange-Nassau, disparu en 1702, militaire dans l‘âme, adversaire acharné de Louis XIV, aurait-il comme elle commandé de la musique à Haendel pour marquer l’événement ? Sans doute, mais c’était également affaire de gouvernement. Quoi qu’il en soit, le festival de La Chaise-Dieu pouvait sans chercher loin célébrer ce tricentenaire : le Te Deum (en neuf sections toutes avec choeur) et le Jubilate de Haendel sont des œuvres grandioses, créées à Saint-Paul de Londres le 7 juillet 1713, et par-dessus le marché ses premières en langue anglaise. L’excellent RIAS Kammerchor de Berlin et l’Accademia Bizantina se sont également tournés vers William Croft (1678-1727), organiste à l’abbaye de Westminster à partir de 1708 comme successeur de John Blow, fait docteur en musique à Oxford en 1713 après avoir présenté deux odes pour la paix d’Utrecht, dont With Noise of Cannon (Avec le bruit du canon) : musique moins monumentale, moins impressionnante au premier abord que celle de Haendel, mais plus attachante et plus variée. Décidément, le malheur des peuples fait le bonheur des mélomanes. De Croft, une Ode funèbre sera exécutée aux funérailles aussi bien de la reine Anne (1714) que de Haendel (1759). (à suivre)
Marc Vignal
Abbatiale Saint-Robert, 28 juin

Cette année au festival de La Chaise-Dieu (21 août - 1er septembre), beaucoup de concerts ont fait revivre la première moitié du XVIIIème siècle : Angleterre de la reine Anne et des premiers rois George, Allemagne luthérienne, cour catholique de Dresde, France du jeune Louis XV. Imaginer comment aurait pu se dérouler en 1727 à l’abbaye de Westminster le couronnement de George II permet d’en restituer sans détours l’apparat, à grand renfort de fanfares, de processions et de vivats, et de programmer non seulement Haendel, Purcell et Blow mais aussi, en remontant dans le temps, Orlando Gibbons ou Thomas Tallis : près d’une trentaine de numéros instrumentaux ou vocaux, total confirmant l’adage « Abondance de biens ne nuit pas ». Le maître des cérémonies était Robert King, à la tête de « son » King’s Consort de Cambridge. On l’a retrouvé le lendemain, tout aussi en situation, dans Bach (brefs morceaux et Oratorio de l’Ascension) et dans le très italianisant Dixit Dominus (Psaume 109) de Haendel, célèbre page de jeunesse transportant de vingt ans en arrière (Rome 1707). Sans oublier sa jubilatoire ouverture pour The Occcasional Oratorio. (à suivre)
Marc Vignal
Abbatiale Saint-Robert, 27 et 28 juillet Photo : King's consort

Modernité (du siècle dernier) en trois volets à Pleyel par Simon Rattle et le Philharmonique de Berlin : juste avant la révolution atonale (Schönberg : La Nuit transfigurée), juste après (Berg : Trois fragments de Wozzeck), voie de traverse (Stravinsky : Le Sacre du printemps). Peut-être plus l’orchestre de Karajan, mais toujours une sorte de perfection. Pendant La Nuit transfigurée, un jeune homme, au dernier rang derrière l’orchestre (c'est-à-dire face à la salle), est pris d’une crise d’angoisse. Toxique en effet, sous ses dehors raffinés, cette musique que Rattle dirige comme un opéra sans paroles (aveu d’infidélité, rédemption par l’amour, d’après un poème de Richard Dehmel), où Brahms et Wagner (ennemis jurés) se retrouvent avant de céder la place à un autre monde. Le chef romantise aussi, sans pourtant en émousser l’électricité, le best of de Wozzeck destiné - un an avant sa création - à promouvoir l’opéra, trouvant en Barbara Hannigan une soliste à l’expressivité aiguë mais à la voix légère. Le Sacre du printemps (voir ici) - énième exécution en cette année anniversaire – souffre davantage de cet arrondi généralisé : à trop s’attarder sur les passages méditatifs, Rattle compromet la fête sauvage. Pour être d’une efficacité à toute épreuve, cette musique « écrite gros » (Pierre Boulez) serait-elle la plus fragile des trois ?
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 1er septembre. En différé sur France Musique le 1er octobre à 20h Photo © DR

20ème Festival Berlioz à La Côte-Saint-André : première tentative, avec Béatrice et Bénédict, d'opéra mis en scène au théâtre éphémère (et couvert) du château Louis XI. Restaurant de plein air, public assez chic, atmosphère feutrée, assez éloignée des réjouissances telluriques de la fonte des cloches (voir ici). Mis en scène n'est pas vraiment le terme : mise en espace place plutôt par Lilo Baur, disciple de Peter Brook, de cet ouvrage comico-mélancolique fragmentairement inspiré de la comédie de Shakespeare Beaucoup de bruit pour rien. Choeurs enthousiastes, bons solistes emmenés par la mezzo Isabelle Druet (Béatrice), dispensés des dialogues parlés par un récitant dont la présence accentue l'aspect oratorio de l'ensemble. La vedette de la soirée, qui occupe l'essentiel du plateau, est le Jeune Orchestre européen Hector Berlioz, émanation de l'Académie du festival, et dirigé avec entrain par François-Xavier Roth. Pas mal vu : dans cet ovni scénique composé sur le tard, Berlioz dynamite une fois encore les codes de l'opéra, et se délecte à donner aux musiciens ce qui revient aux chanteurs (et vice-versa). L'après-midi dans l'austère église où a été baptisé Berlioz, début de l'intégrale en neuf concerts des Sonates pour piano de Beethoven, où François-Frédéric Guy fait mentir sa réputation de ne s'intéresser vraiment qu'aux oeuvres les plus ardues. Aux (encore) classiques trois premières Sonates, il confère désormais une dimension qui est la marque des très grands. Là aussi nous sommes loin de la fonte des cloches. Quoique...
François Lafon

Au château de Bressieux (Isère), dans le cadre du festival Hector Berlioz, "Grande Ouverture festive et fonte traditionnelle de cloches". Atmosphère de rituel médiéval sur fond de ruines illuminées, grondement du feu jaillissant de terre, ballet des fondeurs masqués coulant le métal dans le brasier, lueurs méphistophéliques dans la nuit. Les deux cloches (320 et 600kg) du Dies Irae de la Symphonie Fantastique seront démoulées dimanche à midi : après l'oeuvre au noir, l'oeuvre au blanc. Toute la soirée sur le site : musiques et danses traditionnelles, artisans en action (rémouleurs, scieurs de long, fabricants de cordes), jeux d'adresse d'un autre temps (grenouille, passe-boule). Selon Bruno Messina, ethnomusicologue et directeur du festival, Berlioz n'a pas rejeté autant qu'il s'est plu à le répéter sa ville natale de La Côte-Saint-André, et sa musique tout entière témoigne de la nostalgie des sons et des couleurs de sa jeunesse, de même que la Fantastique porte la marque de M. Berlioz père, médecin respecté mais opiomane et un peu sorcier, pratiquant l'acuponcture en un temps où cela ne se faisait pas. Les cloches fondues ce soir seront paraît-il telles que les a rêvées Berlioz (mais accordées au diapason moderne), davantage que les cloches tubulaires ou les pianos (!) généralement utilisés, davantage même que celles détenues - et données comme authentiques - par l'Orchestre Colonne ou que celles fondues à Strasbourg et inaugurées par l'Orchestre Les Siècles ... au festival Berlioz 2009. Samedi 24 août, Leonard Slatkin dirige la Symphonie Fantastique avec l'Orchestre de Lyon au château Louis XI de La Côte-Saint-André. La veille du démoulage donc. Les cloches de Bressieux feront leurs débuts avec l'Ensemble Le Balcon le 1er septembre. Ellesont l'éternité devant elles.
François Lafon

Construit à partir de la fin du XVème siècle, le Logis de la Chabotterie est un haut-lieu des guerres de Vendée : le dernier chef vendéen, Charette, y fut arrêté le 23 mars 1796. Il s’agit maintenant d’un beau musée aménagé avec des meubles et objets antérieurs à 1790. Pour sa deuxième manifestation de la saison, le 17e festival de musique baroque « Musiques à la Chabotterie » s’est délocalisé dans une salle aux dimensions adéquates pour une magnifique exécution de concert de l’opéra-ballet Les Indes galantes de Rameau, menée avec une conviction de tous les instants par son directeur artistique Hugo Reyne. La partition - avec comme thème l’exotisme, la découverte de pays imaginaires hors d’Europe - est géniale de bout en bout, tant en ce qui concerne les parties vocales que les danses, mais c’est un exploit que de la donner en concert sans coupures, en une soirée d’une durée de quatre heures, entracte compris. Il faut un orchestre incisif et discipliné (c’était le cas de la Simphonie du Marais), un chœur plus qu’à la hauteur et surtout - qualité essentielle dans le répertoire baroque français - des chanteurs capables de faire ressortir les perpétuelles inflexions dramatiques du texte et d’en articuler clairement les paroles. Mention spéciale, dans la mesure où ils n’ont « pris » leur rôle qu’au dernier moment, à la soprano Chantal Santon Jeffery et au baryton-basse Marc Labonnette. Une aventure passionnante jusqu’à la chaconne finale, la plus belle de toute la musique française.
Marc Vignal
Saint-Georges-de-Montaigu, Salle Dolia, 26 juillet 2013

Au Théâtre Ephémère du Palais-Royal dans le cycle "Voyage en Afrique du Sud", Paris Quartier d’été importe Refuse the Hour, le spectacle de William Kentridge qui avait décontenancé le festival d’Avignon 2012. Autour de l’illustre artiste (peintre, vidéaste, sculpteur, comédien, etc.) des musiciens, des chanteuses, des danseuses, des objets, des films, des trompe-l’œil. Son sujet : nier le temps. Dans un anglais oxfordien, il convoque la science, la littérature, la philosophie, les souvenirs personnels, périodiquement interrompu par son turbulent entourage : métronomes géants, cuivres hurlants, corps désarticulés, cantatrices reprenant Le Spectre de la rose (Berlioz – Nuits d’été) en canon, comme un incoercible leitmotiv. On attend du grand homme qu’il nous transporte dans le monde fou qu’il avait inventé au festival d’Aix (voir ici) pour raconter l’aventure folle du Nez de Chostakovitch, mais il tourne en rond, se répète, collectionne les clichés. Idem pour les images, les cris, les onomatopées. Mais que manque-t-il ? On pense à Méliès, aux Monty Python, mais ce n’est pas ça. Trois porte-voix multifonctions - autres leitmotive - donnent la réponse : ce sont les Shadoks qu’il nous faudrait. Eux n’avaient pas besoin de jouer les conférenciers pour manier la philosophie des trous noirs et plonger dans les abîmes de la pensée en vrille.
François Lafon
Théâtre Ephémère du Palais-Royal, Paris, jusqu’au 27 juillet Photo © DR
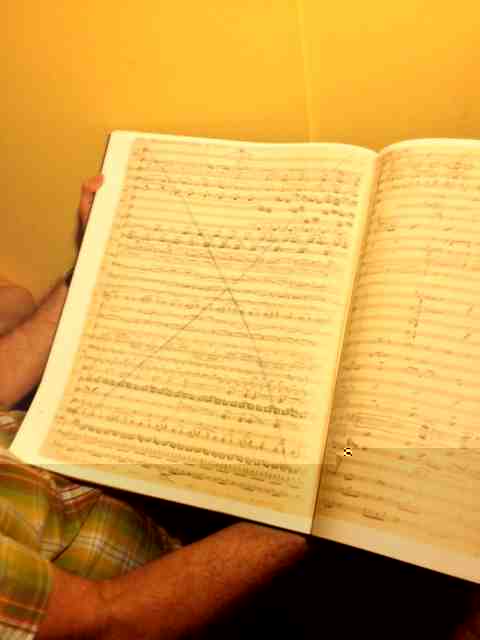
Danses pour l'oreille au festival de Montpellier, avec Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth. Instruments baroques pour Lully (Le Bourgeois gentilhomme) et Rameau (Les Indes galantes), romantiques poiur Delibes (Coppélia) et Massenet (Le Cid), début XXème pour Stravinsky (Le Sacre du printemps). Tour de force technique et signature de l'ensemble, plus à son affaire tout de même dans la seconde partie du programme : grisante Coppélia et Sacre fauve, joué tel qu'il a été créé et non dans une des habituelles simplifications. Raccourci saisissant de quatre cents ans de ballet français aussi, où l'on pressent chez Lully (dirigé par Roth avec une canne frappant le sol, comme celle qui fut fatale au compositeur) les violences calculées de Stravinsky. Plaisir, en plus, d'entendre ce Sacre "à l'ancienne" dans de meilleures conditions qu'au printemps dernier dans la Grande Halle de La Villette (voir ici). Plus tôt dans la journée, masterclass technique et compétente de Renaud Capuçon suivie par un public (nombreux) de fans, mais surtout récital du jeune pianiste russe Yevgeny Sudbin, artiste fascinant qui mériterait la gloire d'Evgeny Kissin ou de Nikolaï Lugansky, confrontant Liszt et Debussy avec une puissance expressive rappelant Emil Guilels pour mieux nous entraîner dans les folies mystiques de la 5ème Sonate de Scriabine.
François Lafon
Photo : la partition du Sacre dans les mains de François-Xavier Roth

Ouverture du festival de Montpellier avec Mass de Leonard Bernstein. Une messe de l'époque de Jésus-Christ Superstar et de la guerre du Vietnam, composée pour l'ouverture du Kennedy Center de Washington (1971). Une messe étrange, provocante, mêlant au texte latin des poèmes pas très catholiques et convoquant un orchestre symphonique, des claviers électroniques, des guitares électriques, un célébrant sachant chanter (baryton), danser et soulever les foules, un grand choeur, une maîtrise et une chorale de rue. Un pied de nez officiel à Richard Nixon, alors président (républicain) lequel boycotta l'événement, laissant la place d'honneur à Jackie Kennedy, veuve du dédicataire (démocrate et catholique). Un monstre musical aussi, illustrant la conviction de Bernstein que l'avenir de la musique n'était pas dans l'avant-garde néo-Ecole de Vienne mais dans le mariage du classique et de la pop, du rock et du gospel, du savant et du populaire. Quarante-deux ans plus tard, salle en délire pour Jubilant Sykes (le Célébrant, extraordinaire), pour le chef James Judd, pour les deux-cent cinquante exécutants, pour cette fête musicale imparfaite et inspirée, où l'on brise un calice, où l'on apprend que "la moitié des gens est stoned et l'autre attend les élections", et que " l'heure des gens de pouvoir est venue". Dans un premier état, la musique de Mass devait servir de bande originale au Saint-François d'Assise sulpicien de Franco Zeffirelli (François ou le chemin du soleil - 1972). Les voies du Seigneur... En prélude, une heure avec l'étonnant Imani Winds de New-York, cinq souffleurs virtuoses passant en douceur de Gershwin à Elliott Carter, de Bernstein à la musique Klezmer. Là aussi, nostalgie d'une certaine innocence.
François Lafon

Première, au festival d'Aix-en-Provence, d'Elektra de Richard Strauss dirigé par Esa-Pekka Salonen et mis en scène par Patrice Chéreau. Deux généralités : 1 - Les événements les plus attendus sont souvent les plus décevants - 2 - Les oeuvres qui paraissent le mieux convenir à un interprète sont les plus traîtres. Double démenti : la standing ovation finale n'est pas volée, et Chéreau se garde bien de faire du Chéreau. Il arrive même à une sorte d'ascèse : plus d'effets, rien que le sens et la lisibilité de l'action. " Si j'ai une qualité, dit-il, c'est de savoir lire un texte. " Même qualité chez Salonen, qui lit à livre ouvert entre les lignes compactes de la partition et fait sonner l'Orchestre de Paris comme un ensemble de chambre aux dimensions des Atrides. Résultat : l'habituel bloc d'hystérie éclate en mille diamants. Quelques flashes : les servantes s'affairant au son d'un balai sur les marches de pierre, avant que ne claque le premier accord, Clytemnestre (Waltraud Meier, très belle, pas du tout mégère fardée) revivant ses cauchemars en caressant la tête d'Elektra (Evelyn Herlitzius, juvénile, vocalement ahurissante), Oreste (Mikhail Petrenko, Monsieur Tout le Monde investi d'un destin tragique) et son précepteur (Franz Mazura, chanteur " chéreauien " historique) apparaissant tels les Inconnus dans la maison, Elektra hagarde, privée de son désir de vengeance, tandis que se répète le thème d'Agamemnon. Elektra, " son analogie et son opposition à Hamlet, " pointait Hugo von Hofmannsthal écrivant la pièce que Strauss allait mettre en musique. Et tant d'autres choses, si souvent noyées dans le bruit et la fureur...
François Lafon
Festival d'Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence, 10, 13, 16, 19, 22 juillet. En direct sur Radio Classique le 13 et Arte Live Web le 19 Photo © Pascal Victor/Artcomart

Au Châtelet, première en France de la Banda Sinfonica Juvenil Simon Bolivar, sœur cadette de l’Orchestre Symphonique de Gustavo Dudamel et tête de pont bis du Sistema vénézuélien (400 000 jeunes de toute l’Amérique latine, des centaines d’orchestres, chorales, jazz-bands et harmonies). Cent-vingt bois, cuivres, percussions, violoncelles et contrebasses dirigés par Sergio Rosales - vingt-quatre ans et une technique phénoménale, produit-type de cet impressionnant ascenseur social. Atmosphère de fête, chorégraphie d’instruments en folie et lancers de blousons aux couleurs du Vénézuéla pendant les bis, selon la tradition maison. Mais avant cela, concert sérieux, et des leçons à méditer. Extreme MakeOver de Johan de Meij (auteur de la Symphonie « Seigneur des Anneaux ») et la 3ème Symphonie "Circus Maximus" de John Corigliano (disciple de Leonard Bernstein, adulé aux USA) sonnent cross-over aux oreilles européennes, mais renvoient dos à dos néo- et avant-gardistes. Même remarque pour la Rhapsodie for Talents, hymne jazzy de circonstance commandé à Giancarlo Castro D’Addona par Buffet Group, pourvoyeur français du Sistema en instruments haut de gamme, et que la Banda bisse avec entrain. La maturité et l’introspection viendront plus tard, à l’exemple de Dudamel (voir ici).
François Lafon
Tournée en Belgique, Suisse, Hollande, Espagne, jusqu’au 21 juillet.
Aux Docks, beaubourienne Cité de la mode et du design entre la Seine et la gare d’Austerlitz, Valentina Lisitsa joue sur un des quarante-huit pianos droits décorés par des artistes contemporains et installés dans divers lieux publics, selon la formule anglaise Play Me, I’m Yours (Jouez-moi, je suis à vous). Hier, elle jouait l’ « Appassionata » de Beethoven en peine rue, dimanche elle sera sur les marches du Sacré-Cœur. La Reine de la Toile (voir ici) fait à sa manière la promotion des quatre Concertos de Rachmaninov, son premier album chez Universal. Toutes ses interventions seront bien sûr en ligne, prêtes à êtres dégustées par ses 77 000 abonnés. Haute voltige (Liszt) et introspection (Chopin) dans les conditions les plus improbables : un paradoxe qui fait le succès de cette Ukrainienne à la technique phénoménale et à la concentration hors du commun, voire une démonstration par l’absurde de la provocation que représente la musique savante dans le monde contemporain. Une provocation qui atteint des sommets quand une touche reste dans la main de l’artiste, qui la dépose délicatement sur le bord de son tabouret sans interrompre les folies digitales d’une Rhapsodie hongroise de Liszt.
François Lafon
Play Me, I’m Yours, jusqu’au 8 juillet - Valentina Lisitsa : mini-récitals 6 juillet (19h) place des Abbesses et 7 juillet sur les escaliers du Sacré-Cœur.

Retour aux Bouffes du Nord d’Une Flûte enchantée (voir ici) de Peter Brook, deux ans et demi, vingt-six pays et deux-cent soixante représentations plus tard. Fraîcheur intacte de cette Flûte de poche, ni résumé ni ersatz de l’original, tentative typiquement brookienne d’extraction de la quintessence d’une œuvre que tous croient connaître. Salle bondée, beaucoup d’enfants, applaudissements nourris. Aucune frustration, apparemment, devant les ellipses de l’action, les coupes claires dans la partition, habilement réduite pour piano seul par Franck Krawczyk. Jeu plus sobre, plus intériorisé, pourtant, des jeunes et excellents chanteurs-acteurs, faisant ressortir l’ascétisme du propos. Une belle occasion, en tout cas, de faire l’expérience de l’ « espace vide » créé par Brook dans cette carcasse de théâtre selon ses rêves, qu’il a dirigée trente-six ans durant. Le spectacle est donné tout le mois de juillet, ce qui, dans le quasi-désert culturel qu’est Paris en été, est une véritable aubaine.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 31 juillet Photo © Pascal Victor

Il Mondo della Luna (1777), sur un livret d’après Carlo Goldoni, est un des opéras de Haydn les plus joués depuis sa résurrection dans sa version originale aux festivals de Hollande et d’Aix-en-Provence de 1959. L’Atelier lyrique de l’Opéra national de Paris s’en empare à son tour. Mise en scène très convaincante de David Lescot, qui pour une fois ne tourne pas l’argument en dérision, malgré sa volonté de le mettre en relation avec notre époque : récitatifs prolongés à l‘occasion par des bruits de synthétiseur, premier acte dans un bidonville, sur un terrain vague avec pneu de voiture et roulotte bien en évidence (référence à l’univers cinématographique d’Ettore Scola), deuxième acte sur une lune aride, à l’opposé d’un monde rêvé, encombrée des détritus du précédent. Surtout, personnages des plus crédibles, parfois agités et désarticulés mais ne sombrant jamais dans le ridicule. Mention spéciale au jeune baryton portugais Tiago Matos en barbon Buonafede, chargé d’ans tant par son grimage que par ses gestes, à la mezzo-soprano Anna Pennisi en servante Lisetta, rôle en or s’il en est, et à l’Orchestre Atelier-Ostinato dirigé par Guillaume Tourniaire, remarquable en particulier dans les épisodes en nuance piano. Mais il ne saurait être question ici de distribution des prix. L’essentiel ? Mission remplie pour l’Atelier Lyrique : présenter un spectacle qui se tient, offrir aux habitués de l’opéra, à ceux qui y font leurs premiers pas et à tous les intermédiaires imaginables une soirée dont ils se souviendront.
Marc Vignal
MC 93 (Bobigny), jusqu’au 28 juin Photo © Opéra de Paris/M. Magliocca

Aux Bouffes du Nord, En deuil/Trauerzeit, mise en scène de Johan Leysen, composition et direction musicale Dominique Pauwels. Un heure-vingt de… quoi au juste ? Il y a un petit garçon qui vit, depuis la mort accidentelle de son père, dans un monde de poésie, une chanteuse qui exprime ce qu’il refoule, quatre violoncellistes transportant leurs instruments dans des poussettes, une comédienne qui décrit la situation et un comédien (le petit garçon longtemps après ?) qui répète inlassablement le poème en prose de Rainer Maria Rilke Le Chant d’amour et de mort du cornette Christophe Rilke. Comme le reste, la musique est à la fois indispensable et insaisissable, traits d’archets rageurs, effluves romantiques ou répétition en boucle de la Coda de Rilke : « Der Tod ist gross » (La Mort est grande »). On ne voit le petit garçon que dans un film étrange, surgi du passé, qui rappelle le film qui rend aveugle de l’étonnant roman de Franck Thilliez Le Syndrome E (Fleuve Noir - 2010). On peut d’ailleurs penser que la musique a la même fonction que le film : acte fondateur et refus de la réalité. Créé au Luxembourg le 6 juin, le spectacle part en tournée la saison prochaine. Guettez-le.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 15 juin

Au Châtelet, I was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky, songplay de John Adams sur un livret de l’écrivain et militante June Jordan. Une variation à chaud sur le tremblement de terre de Los Angeles (1994), mis en scène à l’époque par Peter Sellars. Cette fois, c’est le metteur en scène et scénographe Giorgio Barberio Corsetti qui s’y colle : immeubles pivotants et incrustations savantes pour suggérer (efficacement) la ville-prison devenue ville-piège, où s’accomplit le destin modeste d’une petite société multiethnique. Sept solistes (excellents) et groupe de rock pour ces vingt-deux chansons enchaînées, où Adams opère le tour de force d’inventorier les genres populaires (pop, jazz, gospel, blues) sans cesser de faire du John Adams, rompant avec style grand opéra de Nixon in China et The Death of Klinghoffer. Livret malin mais univoque, maniant à la truelle poncifs et bien-pensance. En 1994, Sellars avait monté un formidable Marchand de Venise transposé à Venice (Californie), où s’affrontaient asiatiques, noirs et latinos. Même principe, efficacité décuplée. Mais le scénario et la musique (des mots) étaient signés Shakespeare.
François Lafon
Châtelet, Paris, jusqu’au 19 juin Photo © Théâtre du Châtelet

Pour Esa-Pekka Salonen, il était dans l’ordre des choses de célébrer au même concert le centenaire du Sacre du Printemps et celui de Witold Lutoslawski - un compositeur qu’il affectionne - avec sa Musique funèbre pour orchestre à cordes de 1958, à la mémoire de Bartók. Après un concerto en sol de Ravel largement centré sur le rythme (avec Hélène Grimaud), c’est bien dans leSacre qu’on attendait Salonen. On peut exécuter l’ouvrage de façon « moderniste », en insistant sur ses débauches de rythmes et ses arêtes sonores dures. Tout cela était très présent, mais Salonen ne s’en est pas tenu là. Il en a fait ressortir aussi la dimension harmonique, le côté « tachiste » : accords dissonants appuyés, utilisés comme des couleurs tranchées. Et si les solos instrumentaux ont reçu tout leur dû, grâce notamment à des timbales tonitruantes lâchant des notes aussi bien que des sons, l’orchestre dans sa plénitude est plus que jamais apparu comme une extension de l’orchestre symphonique classique, par-delà son abondance de bois et de cuivres et ses percussions si actives. Cet orchestre - en l’occurrence le Philharmonia - résonnait en profondeur, agité de l’intérieur, multidimensionnel, dépassant en quelque sorte l’argument du ballet, dont pourtant Salonen rappelait l’existence par certains gestes du corps, par exemple se penchant en avant. Un spécimen de la maîtrise du chef ? Cette sonorité de cor coupée net à la fin de la première partie, qui tint la salle en haleine. Un Sacre vraiment impressionnant, accueilli avec un enthousiasme rare.
Marc Vignal
Théâtre des Champs-Elysées, 10 juin 2013 Photo © DR

Bicentenaire Verdi à l’Opéra Bastille : le Requiem. Deux concerts sold out, public des grands soirs. Pari gagné pour Philippe Jordan, qui crée l’événement sur l’estrade autant que dans la fosse. Plus que pour Chostakovitch (voir ici), la nouvelle conque acoustique fait son effet. Trop, presque : les tempêtes du Dies irae saturent l’espace, les chœurs sont assis sur les genoux des auditeurs. Jordan ne se demande pas si le Requiem est une messe opératique ou un opéra spirituel. Il le dirige comme un sixième acte de Don Carlos : la mort comme transcendance, la terreur comme instrument de pouvoir, avec une habileté particulière à opposer véhémence et méditation. L’orchestre et les chœurs (bravo au chef Patrick-Marie Aubert) sont à la fête, les solistes compensant par leur enthousiasme des disparités stylistiques évidentes : superbe duo masculin (Piotr Beczala, Ildar Abdrazakov), voix féminines plus inégales (Violeta Urmana enfin revenue à sa tessiture de mezzo, mais soprano – la nouvelle venue Kristin Lewis – en difficulté). Enregistrement live à paraître chez Virgin. A comparer, pour les mordus, avec Daniele Gatti/Orchestre National, au Théâtre des Champs-Elysées les 16 et 18 juin.
François Lafon
Opéra de Paris – Bastille, les 10 et 11 juin En photo : Patrick-Marie Aubert

A Pleyel, Gustavo Dudamel dirige l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam. La carpe et le lapin, le choc du latino flamboyant et de la machine de haute tradition. Mais le « Dude » s’est discipliné et les musiciens jouent le jeu. Première partie contemporaine : Colores de la Cruz del Sur (Couleurs de la croix du sud) de l’Argentin Esteban Benzecry, et les Neruda Songs de Peter Lieberson. Tonalité, atonalité, polyrythmie, gammes pentatoniques pour le premier, technique métissée pour un folklore imaginaire. Ecriture sage, voire passéiste pour le second, cinq sonnets amoureux dédiés par le compositeur à son épouse, la mezzo Lorraine Hunt. Du contemporain grand public, comme on l’aime outre-Atlantique. Le chef fait monter la pression, l’Orchestre déploie ses plus belles couleurs, la mezzo Christiane Stotijn chante avec émotion. Applaudissements mesurés. Après l’entracte : Symphonie « Du Nouveau Monde » de Dvorak. Le public (salle presque pleine) attend le chef, et le trouve : tempos extrêmes, effets de manche bien placés. On écoute l’orchestre, superlatif. Standing ovation : le Dudamel circus n’a pas pris en France, place au surdoué de la baguette. Les musiciens applaudissent aussi, chaleureusement.
François Lafon
Photo © DR

Oeuvres des XXème et XXIème siècles à Pleyel dans le cadre du festival de l’Ircam Manifeste 2013. Règle du jeu : replacer la musique au centre des arts du temps (théâtre, danse, cinéma, arts numériques). Ce soir, avec le Philharmonique de Radio France dirigé par Jukka-Pekka Saraste, création de Reflets de l’ombre, pour grand orchestre et électronique live, du compositeur et scientifique Carmine Emanuele Cella. Propos de Cella compositeur : « Il y a deux façons de reproduire la réalité : mimétique ou cathartique. Le cathartique s’obtient au moyen d’un filtre personnel qui nous donne l’image véritable que nous nous faisons de la réalité ». C’est là qu’intervient Cella chercheur, personnalité culte dans le monde de l’informatique, en produisant des « nuages de sons » qui ne sont plus seulement le traitement en temps réel d’un son physique. L’ennui est que son œuvre, qui convoque Platon et le Mythe de la caverne, s’entend comme une houle orchestrale façon musique de film, d’où s’échappe à un moment, alors que l’orchestre est soudain plongé dans l’ombre (bel effet visuel), un nuage électronique évoquant … ce qui se fait à l’Ircam depuis son ouverture. La voix stratosphérique (mais, hélas!, sonorisée) de Barbara Hannigan dans les Songs from Esstal I, II et III de Philippe Schoeller, autre création de la soirée, nous emmène plus sûrement dans les étoiles, et la 3ème Symphonie de Witold Lutoslawski, très efficace machine à « jouer de l’orchestre » dédiée au Symphonique de Chicago, déploie un univers sonore autrement plus riche. On peut en dire autant de Métaboles, ajouté au programme en hommage à Henri Dutilleux, dont Saraste et l’Orchestre donnent une interprétation qui fera date.
François Lafon
Festival Manifeste 2013, jusqu’au 30 juin. Photo © Jean Radel

A Pleyel, Yutaka Sado dirige l’Orchestre de Paris dans un programme Ibert-Rachmaninoff-Verdi. La carpe et le lapin en apparence, en réalité des variations sur le brillant en musique. Galops années 30 pour le Divertissement de Jacques Ibert tiré d’une musique de scène pour le galopant Chapeau de paille d’Italie de Labiche, funambulisme pianistique dans la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninoff (superbement joué par le funambulesque Boris Berezovsky), ouvertures et chœurs de Verdi, cadeau de fin de saison et occasion de briller pour le Chœur de l’Orchestre et son chef Lionel Sow. Sado, bouillant disciple de Leonard Bernstein, est a priori l’homme de la situation : l'orchestre est idéal (en formation de chambre) dans Ibert et solide dans Rachmaninoff, mais il ne parle pas le Verdi avec autant de naturel, pas plus que le Chœur, qui chante comme un ange d’oratorio mais ne se lâche que dans le bis : le Triomphe d’Aïda (trompettes comprises - sans couacs, ce qui est rare). Pas mal de places vides après l’entracte : passe pour Rachmaninoff et son romantisme attardé, moins pour Verdi et ses élans lyrico-patriotiques.
François Lafon

Dans la série Convergences à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille, la jeune pianiste franco-arménienne Varduhi Yeritsyan joue en deux soirées les dix Sonates d’Alexandre Scriabine. Austère, a priori : des premières Sonates liszto-rachmaninoviennes aux dernières, « ponts jetés entre le visible et l’invisible » brouillant tous les repères de forme et de tonalité, le voyage mystico-symboliste peut prendre des allures de bad trip. Pour baliser le chemin et permettre à la pianiste de souffler entre chaque pièce, un acteur lit des textes, parfois abscons, souvent trop longs, mais toujours en sympathie avec la musique : Pasternak, Maïakovski, Andreiev (le magnifique « Rire rouge »), Blok, Mandelstam, Zamiatine, Akhmatova, Scriabine lui-même. Plus en phase avec l’exubérant Olivier Py, le second soir, qu’avec le trop neutre Pascal Greggory, qui le remplaçait (presque) au pied levé la veille, Varduhi Yeritsyan tient le choc, plus motivée encore par les folies digitales de « Messe blanche », « Messe noire » ou de la « Sonate des insectes » (n° 7, 9, 10). Pourquoi le piano de Scriabine à l’Opéra ? « Une cosmogonie non moins ambitieuse que celle de Wagner », répond le programme. La consécration, en tout cas, d’une diva du clavier.
François Lafon

Reprise de La Tétralogie bouclée à l’Opéra Bastille avec Le Crépuscule des dieux, en attendant le cycle complet du 18 au 26 juin. Toujours le volet le plus faible pour la mise en scène, même partiellement revue : fête foraine cheap chez les Gibichungen, corps astral holographique s’échappant du cadavre de Siegfried (peu d’effet mais sûrement très cher à réaliser), finale en doom-like (jeu vidéo première génération) insinuant que le monde actuel est virtuel et ne mérite que son triste sort. Deux ans après (voir ici), Philippe Jordan revoie lui aussi sa copie - tempos plus serrés, élimination de quelques tunnels, tissu orchestral plus chatoyant encore – et achève d’imposer son style : équilibre subtil entre conception symphonique et sens du théâtre. Un Wagner tenant compte du passé – école Knappertsbusch-Barenboim plutôt que Böhm-Boulez - sans être passéiste à la Christian Thielemann. Plateau sans faute mené par Hans-Peter König, basse de choc en méchant Hagen, et Petra Lang (Brünnhilde), ex-mezzo au fort tempérament et aux aigus bien accrochés.
François Lafon
Photo © Elisa Haberer/Opéra de Paris

Mahler et Chostakovitch pour l’inauguration de la nouvelle conque modulable de l’Opéra Bastille. Une immense boite de bois, assez belle et acoustiquement performante, comme pour rivaliser avant l’heure avec la Philharmonie de Paris. Grands effectifs et musiques de l’extrême : des antidotes peut-être, pour Philippe Jordan, au Crépuscule des dieux actuellement au programme. Entre rêve d’harmonie universelle et kafkaïenne « course incessante, comme contre un mur » (Eberhardt Klemm), l ’Adagio de la Xème Symphonie de Mahler ressemble moins que jamais à un adieu, mais perd en transparence ce qu’il gagne en étrangeté. Timbres superbes, quand même, de l’Orchestre de l’Opéra, auquel s’ajoutent, pour la XIIIème Symphonie « Babi Yar » de Chostakovitch, les somptueuses voix graves des chœurs maison et du Chœur Philharmonique de Prague. Là, Jordan ose le grand spectacle et le travail au petit point, et emporte la partie en compagnie de la basse solo Alexander Vinogradov, physique de jeune homme sage mais voix de bronze et émotion maximale pour détailler les poèmes d’Evgueni Evtouchenko maniant l’horreur collective (le carnage nazi de Babi Yar) autant que l’autodérision, et finissant sur fond de musique doucement céleste par un credo minute qui pourrait être celui de Chostakovitch : « Ma façon de faire ma propre carrière, ce sera de ne pas la faire ». Public jeune, tapant des pieds comme au Zénith. L’Opéra Bastille, enfin théâtre populaire ?
François Lafon

Reprise à l’Athénée de L’Autre Monde ou les Etats et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac (le vrai) par Benjamin Lazar et l’ensemble La Rêveuse. L’archétype du style lazariste : gestique baroque, prononciation à l’ancienne, éclairage à la chandelle. Presque un classique, créé en 2004, déjà donné à l’Athénée en 2008 par Lazar lui-même (sans faux nez), toujours avec les très fins Florence Bolton (dessus et basse de viole) et Benjamin Perrot (théorbe, guitare, luth). Respirations musicales au gré de ce texte génial et visionnaire, qui a probablement contribué à abréger la vie de son auteur (le « coup de bûche » évoqué par Rostand) : Sainte-Colombe, Marais, Kapsberger, Dufaut, Ortiz, Hume, tout un théâtre musical qui ajoute à l’étrangeté du jeu de l’acteur. Bien loin en apparence de l’explosif Ariane à Naxos « mis en concert » ce mois-ci par Lazar dans ce même théâtre (voir ici), mais dégageant pourtant un charme proche, insaisissable. « Bon vin vieillit bien », aime à dire Lazar à ses acteurs. Son ovni scénique (faire théâtre de tout, à la Vitez) va être filmé et diffusé en DVD. Presque dix ans d’âge, un grand cru.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 8 juin Photo © Romain Juhel

Reprise au Palais Garnier de Giulio Cesare de Handel dans la mise en scène « Une Nuit au musée » de Laurent Pelly (2011 – voir ici). Un spectacle monté tout exprès pour Natalie Dessay, qui « volait le show » en Cléopâtre survoltée, d’autant que son César, le contre-ténor Lawrence Zazzo, était en méforme, et peinait à chanter autant qu’à exister face à elle. Sandrine Piau, qui lui succède, marche scrupuleusement sur ses brisées : même gestes, même silhouette, mêmes tenues suggestives. Et pourtant cela donne tout autre chose. Avec ses moyens à elle, elle chante aussi bien que Dessay, elle est même plus à l’aise dans ce festival d’airs superbes mais épuisants, sollicitant constamment le médium de la voix. Surtout, elle ne vole pas le show, et c’est tout le spectacle qui s’en trouve rééquilibré, Zazzo ayant par ailleurs retrouvé son assurance naturelle et sa facilité à vocaliser. Troupe homogène (jusqu’à l’inénarrable Dominique Visse, titulaire-maison du rôle de Nireno depuis… 1987), chef (Emmanuelle Haïm) moins enclin à chalouper que d’habitude. Comme disait Jean Giraudoux dans La Guerre de Troie n’aura pas lieu : « Un seul être vous manque et tout est repeuplé ».
François Lafon
Opéra de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 18 juin. Photo © Opéra de Paris/Agathe Poupeney

Au théâtre de l’Athénée, Ariane à Naxos de Richard Strauss, version de concert mise en scène par Benjamin Lazar. Des musiciens partout, habillés comme tous les jours, sur scène et dans la salle - les trente-sept solistes (pouvant sonner comme cent) requis pour cet opéra étrange, version refondue d’un divertissement d’abord destiné à accompagner … Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Sur une chaise à l’avant-scène : le Compositeur (rôle travesti). En ligne, les autres personnages, les yeux fermés. But apparent : faire naître l’action de la musique, ou plutôt des musiciens, qui finiront, entraînés par les chanteurs, par entrer dans le jeu, par danser avec eux. Point fort : montrer à la loupe, dans un espace confiné, cet ouvrage gigogne – théâtre dans le théâtre, intimité et grands épanchements, sentiments sublimes et réparties canailles, dialogue permanent des voix et des instruments. Mené par le jeune Maxime Pascal, l’ensemble Le Balcon, habitué aux paris fous (voir ici) dégage une énergie communicative, comme les chanteurs, qui n’ont pas tous le format straussien, mais sont à la fois proches et étranges, avec leur gestique étudiée. Gros succès, salle bondée, public conquis. L’opéra, fût-il le plus sophistiqué, est avant tout un théâtre des sens.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 19 mai. Photo © Théâtre de l'Athénée

Récital à la salle Pleyel de Yefim Bronfman. Public averti, beaucoup de jeunes, mais rangs clairsemés : cet Américain né Ouzbek et formé en Israël est peu médiatisé en France, où l’on se méfie de ces virtuoses grand format soupçonnés d’hollywoodiser le piano. Le programme va à l’encontre de cette idée reçue : 60ème Sonate de Haydn, une des dernières, tendant la main à Beethoven, la 3ème du jeune Brahms (approuvée par Schumann), et la 8ème de Prokofiev, sonate « de guerre » (1944), dont le classicisme officiel débouche sur des flambées rappelant le passé avant-gardiste du compositeur. Point commun de ces trois pièces : le mystère, l’ambiguïté, la finesse l’emportant sur la violence. Même contraste entre l’aspect massif du pianiste, son refus de toute sentimentalité, sa dynamique phénoménale (les forte claquent comme des drapeaux) et la légèreté naturelle de son toucher. On pense aux grands Russes, Richter, Gilels (créateur de la 8ème de Prokofiev), la folie visionnaire en moins. C’est peut-être cet « en moins » qui empêche Yefim Bronfman d’être une légende du piano.
François Lafon

Récital de David Violi, au Cercle suédois de Paris, dans la série Les Pianissimes. Grand salon rouge bondé, atmosphère étouffante. Les Pianissimes est une affaire qui marche : en ne programmant que de jeunes artistes, son animateur Olivier Bouley prend des risques, et ne se trompe pas beaucoup. David Violi, trente-deux ans, connu pour sa collaboration avec le Quatuor Ardeo, n’a pas choisi la facilité : Déodat de Séverac et Mel Bonis en hors-d’œuvre, suivis de Debussy (Six Epigraphes Antiques) et Schumann (Kreisleriana). Pour les interprètes modernes habitués aux grandes salles, l’exercice est périlleux : son vite saturé interdisant les déchaînements, sièges qui grincent dès que l’attention se relâche. C’est justement ce qui arrive pendant les Debussy. La fausse antiquité (façon Pierre Louÿs) est bien là, et le mélange de distance et de fascination qui va avec, mais il manque la sensation que cette musique est phénoménale, qu’elle ne vient de rien et ne va nulle part. Les Kreisleriana aussi se heurtent aux murs, mais plus violemment. David Violi maîtrise les oeuvres, il lui reste à les laisser s’envoler. Le lieu, en fin de compte, n’y est pas pour grand-chose.
François Lafon

Création à l’Opéra de Paris de La Gioconda d’Amilcare Ponchielli (1876). Un nouveau chapitre de la dédiabolisation, entreprise par le directeur Nicolas Joël, de séries B italiennes pré-, post- ou pur véristes. La Gioconda, tiré par Arrigo Boito, dernier librettiste de Verdi, d’un drame peu connu de Victor Hugo (Angelo, tyran de Padoue) est tout cela, Ponchielli ayant été le professeur de Puccini et Mascagni. C’est le royaume du trop : trop de mélo, trop de sanglots, trop de lagune (de Venise), trop de ballet (la Danse des heures, immortalisée par Walt Disney dans Fantasia). Six grandes voix, six personnalités comme on n’en fait plus ne sont pas de trop pour venir à bout de cette musique qui fait penser à tout le monde, en moins bien. Ce soir, on reste à mi-gué, avec une mention spéciale pour Maria José Montiel (contralto) et Luciana d’Intino (mezzo-soprano). Direction milieu de gamme de Daniel Oren, mise en scène basique de Pier Luigi Pizzi, empruntée à Barcelone et Vérone. Gros succès à la fin, ovation pour la Danse des heures – pourtant kitchissime, mais moins drôle que les crocodiles et hippopotames de Disney. Dont acte. L’opéra régressif a ses charmes, et d’ailleurs tout opéra l’est un peu. Question de degré.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille jusqu’au 31 mai. En direct le 13 mai dans 26 salles UGC (France et Belgique), 45 salles indépendantes en France et 200 en Europe. Diffusion ultérieure sur France Télévisions Photo © Opéra de Paris

Ce Don Giovanni-là, mis en scène par Stéphane Braunschweig, est tout entier sorti des souvenirs de Leporello. Don Giovanni est montré gisant pendant l’ouverture, et les deux actes se déroulent comme un seul et cinglant mouvement vers la mort. Une marche irrésistible animée par la force centrifuge du désir charnel et celle centripète de la morale, qui balaie tout dans sa progression. La génération des années 60 - mais pas seulement elle -, revivra les années 80 avec ce Don faisant office de charge virale insidieuse. Décors dégraissés de tout superflu, plateau tournant répondant aux visions de ce Leporello axial dont la tête n’aura jamais autant tourné. La froide sensualité d’un Hopper et celle, acide, d’un Hogart se côtoient dans une même célébration de l’énergie destructrice de la libération sexuelle, et la crispation de ceux qui, même tentés, s’y refusent. Cette danse macabre et lumineuse est servie par une distribution jeune et unie. Elle est animée par une direction orchestrale (Jérémie Rhorer et Le Cercle de l'Harmonie) elle aussi moins soucieuse de grâce que d’efficacité. Tous naviguent dans les extrêmes en évitant les écueils de l’excès. Le sextuor final affirme achève de poser l’ouvrage comme un Requiem de la Liberté doublé d’un Magnificat de la Morale.
Albéric Lagier
Théâtre des Champs-Elysées, les 25, 27 et 30 avril, 3, 5 et 7 mai 2013. Rediffusé sur France Musique le 4 mai à 19h00.
Photo © Théâtre des Champs Elysées

L’Aiglon, « grand opéra » en cinq actes relativement bref (une heure et demie), a été créé à l’Opéra de Monte Carlo le 11 mars 1937. Le livret de Henri Caïn est une adaptation - un habile montage des vers - de la pièce en six actes d’Edmond Rostand (1900) relatant d’un ton parfois cocardier la destinée tragique à Vienne du duc de Reichstadt, fils de Napoléon. La musique provient de deux compositeurs différents, sans qu’il y ait vraiment rupture de style : Jacques Ibert (actes I et V) et Arthur Honegger (actes II à IV), liés d’amitié depuis leurs études au Conservatoire. L’Opéra de Lausanne vient de reprendre une production de celui de Marseille (2004), avec des décors (Christian Fenouillat), des costumes (Agostino Cavalca) et une mise en scène (Renée Auphan) efficaces, ne cherchant pas midi à quatorze heures : on se trouve sans conteste dans un salon et dans le parc de Schönbrunn, non sans les inévitables rythmes de valse, puis dans la plaine de Wagram et enfin dans une chambre mortuaire. Les deux moments les plus forts de la partition, la destruction morale du duc par le chancelier autrichien Metternich (fin de l’acte II) et l’évocation hallucinée, au son de la Marseillaise et du Chant de départ, de la bataille de Wagram (fin du IV), ont reçu tout leur dû. Les personnages sont au nombre de onze, moins que dans la pièce. Carine Séchaye, originaire de Genève, chantait le duc (l’Aiglon), rôle créé par Sarah Bernhardt, et Marc Barrard le vieux grognard Flambeau. Ibert et Honegger voulaient une œuvre au langage direct, « simple, facile à interpréter, accessible à tous ». Pari tenu, à en juger par la réaction de la salle. L’Aiglon visait le « grand public » de 1937 : l’ouvrage parle aussi à celui d’aujourd’hui.
Marc Vignal
Opéra de Lausanne, 28 avril 2013 Photo © Marc Vannapelghem

Au théâtre de l’Athénée, Blanche Neige de Marius Felix Lange par L’Opéra Studio de l’Opéra National du Rhin. Le contraire de Hänsel et Gretel au Palais Garnier (voir ici), où la metteur en scène Mariame Clément passe le conte des frères Grimm revu par Humperdinck au sérum de vérité (?) de la psychanalyse. Ici, Lange (livret et musique) et le metteur en scène Waut Koeken s’en tiennent à la lettre du conte des mêmes Grimm, tout en maniant un second degré propice à la réflexion : jeux de miroirs très réussis (« Dis-moi si je suis la plus belle… »), costumes de music-hall, sept Nains pas nains du tout (et vexés qu’on le leur fasse remarquer). Les enfants sont ravis, les parents sourient finement. Le bonheur serait parfait si la musique de Lange, plutôt enlevée, bien chantée, bien dirigée par Vincent Monteil à la tête de l’Orchestre Lamoureux en formation réduite, ne drainait une bonne partie des poncifs hérités du théâtre musical des années 1970. Mais cela ne gênera que ceux qui ont connu cette époque aussi ancienne que les contes de fées.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 26 avril. Livre illustré pour les enfants : www.operanationaldurhin.eu
Photo © Alain Kaiser - Opéra National du Rhin

A l’Auditorium du Louvre, soirée de Lieder par l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris, en parallèle avec l’exposition De l’Allemagne 1800-1839. S’ouvrant sur Olympia de Leni Riefennstahl et se refermant sur L’Enfer des oiseaux de Max Beckmann, l’exposition est accusée de mettre l’accent sur la part d’ombre (élément de langage à la mode) de la culture allemande. Schubert, Schumann, Loewe et Wolf, mais aussi Kurt Weill et Richard Strauss sont-ils passibles du même reproche ? A écouter les versions Schubert et Loewe du Roi des Aulnes de Goethe (génialement détourné par Michel Tournier dans un roman qui a fait scandale), on se pose la question. On se la pose aussi, mais différemment, lorsque se succèdent Es regnet (Il pleut) de Weill sur un texte de Cocteau et Im Abendrot, dernier des Quatre derniers Lieder de Strauss : désespoir avant la catastrophe, apaisement après. Exercice à haut risque pour sept chanteurs et quatre pianistes de la promotion 2013 de l’Atelier. Les barytons Tiago Matos et Michal Partyka, la basse Andriy Gnatiuk réussissent le saut de l’ange en faisant vivre les mots autant que les notes. Mais comment résister à la voix somptueuse de la soprano Andreea Soare chantant Strauss ?
François Lafon
Exposition De l’Allemagne (1800-1839), de Friedrich à Beckmann. Musée du Louvre, jusqu’au 24 juin Photo © DR

Au Châtelet, Sunday in the park with George, troisième volet du cycle Stephen Sondheim après A little night music (voir ici) et Sweeney Todd (voir ici). Même metteur en scène (Lee Blakeley), même chef (David Charles Abell) et le Philharmonique de Radio France dans la fosse. Sujet : la création. Quand le rideau se lève sur le premier acte : écran blanc, apparition du peintre néo-impressionniste Georges Seurat (1859-1891). Quand il tombe, le tableau Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte (maintenant à l’Art Institute de Chicago) est terminé. Contre-sujets : la vanité humaine, le lien entre les générations, le Carpe diem selon Horace, illustrés au second acte (beaucoup plus lourdement) par les affres dans lesquels se débat l’arrière-petit fils du peintre, artiste américain et conceptuel. On comprend qu’avant de devenir le patriarche du musical made in Broadway, Sondheim ait été considéré comme un dangereux intellectuel. Rien que sa façon de mêler le parlé et le chanté a de quoi donner la migraine aux fans de La Mélodie du bonheur. Distribution de spécialistes, luxueuse mise en images (le sujet d’y prête) du décorateur et vidéaste anglais William Dudley. Standing ovation au rideau final pour Sondheim, qui partage avec Woody Allen la particularité d’avoir trouvé en France le public de ses rêves.
François Lafon
Photo © Théâtre du Châtelet

Première à l’Opéra de Paris (Garnier) de Hänsel et Gretel d’Engelbert Humperdinck, cent-vingt ans après sa création. En Allemagne et dans les pays anglo-saxons, cet « opéra-conte » inspiré des frères Grimm est traditionnellement donné à Noël pour un public d’enfants. Pas ici. C’est d’ailleurs aux adultes que s’adresse la mise en scène très mode de Mariame Clément. Plus de pauvre masure, plus de forêt profonde, plus de maison de pain d’épices, mais un appartement bourgeois 1900 vu en double, ou en miroir, lieu de vie vraie et univers fantasmatique : Humperdinck, wagnérien militant et assistant du maître à la création de Parsifal, avait intitulé « Festival scénique sacré pour chambre d’enfants » un premier état de son opéra. Le procédé fonctionne assez bien : vrais enfants vs chanteurs-adultes, Sorcière vs mère redoutée, Petit Bonhomme Rosée en costume Disneyland vs amie de la famille en Marchand de sable, etc. Le chef Claus Peter Flor canalise autant qu’il le peut les tempêtes wagnéro-straussiennes (c’est Strauss qui a dirigé la première à Weimar) et les chanteurs sont impeccables, à commencer par Anja Silja (73 ans), à bout de voix mais grandiose en Sorcière-meneuse de revue. Sifflets insistants au rideau final : tout cela manque de féérie. Comme si, trente-sept ans après Bruno Bettelheim (Psychanalyse des contes de fées - 1976) la question n’était pas résolue.
François Lafon
Opéra National de Paris – Garnier, jusqu’au 6 mai. Diffusion en direct le 22 avril dans des salles UGC et des cinémas du monde entier. Photo © Opéra de Paris

Créé à Eszterháza en 1779, L’isola disabitata (L’île déserte) occupe une place spéciale parmi les opéras de Haydn : quatre personnages seulement (deux couples), durée sans entracte d’une heure et demie, livret mi-sérieux mi-comique et chargé de symboles dû au célèbre Métastase, récitatifs accompagnés uniquement par l’orchestre, jamais par le seul clavecin ou pianoforte. Cet ouvrage peu mozartien - mais oui ! - est donc assez souvent monté, ni trop long ni trop court pour des soirées en famille en des lieux divers, et surtout idéal pour les atelier lyriques, d’autant que ses difficultés vocales et instrumentales sont grandes. L’atelier lyrique de l’Opéra national de Paris s’est donc penché sur L’isola disabitata, ce qui avait déjà été le cas en 2005. Dans la brochure de programme, un plaisant résumé de l’action en bande dessinée, et dans la scène finale, au lieu de quitter enfin l’île, les protagonistes se transforment en touristes passant du bon temps sur une plage, un peu au détriment de la musique il est vrai. Pour le reste, la mise en scène de Dominique Pitoiset et Stephen Taylor se distingue par sa sobriété, et des quatre chanteurs-acteurs se détachent les deux dames, Anna Pennisi en émouvante Costanza et Armelle Khourdoïan en espiègle Silvia. Dirigé par Inaki Encine Oyón, l’Orchestre Atelier-Ostinato s’est essentiellement distingué dans les épisodes expressifs des récitatifs. On peut critiquer ceci ou cela, mais on est toujours heureux de retrouver L’isola disabitata.
Marc Vignal
La Ferme du Buisson, 6 avril Photo © DR

A la Grande Halle de La Villette, Stravinsky en mode hip-hop avec l’orchestre sur instruments d'époque Les Siècles (direction François-Xavier Roth), la compagnie Melting Spot (direction Farid Berki) et un « corps de ballet » d’une quarantaine de jeunes issus du nord-est francilien. Public ravi : parents, amis, professeurs, responsables d’associations. Attention extrême (enfants compris) pour Petrouchka (pourtant sans danseurs), le Scherzo Fantastique (trois hip-hopeurs burlesques alla Jacques Tati) et Le Sacre du printemps (toute la troupe). Dans cet espace impressionnant à l’acoustique étonnement claire en dépit de l'amplificaiton du son, Roth et Les Siècles, pourtant réputés pour leur punch et leur faculté d’adaptation à tous les styles et toutes les situations, marchent sur des œufs dans Petrouchka et en cassent quelques-uns dans Le Sacre. Comme la chorégraphie oscille entre la cour d’école et un West Side Story relooké, la fête orgiaque prend des allures de fête de fin d’année, ce qui rend l’atmosphère plutôt sympathique. Pour les ados danseurs, c’est une victoire (hurlements de joie derrière le rideau); pour l’orchestre, un peu moins. Le Sacre, « musique sauvage avec tout le confort moderne » (Debussy) a besoin d’une autre précision pour éveiller le grand désordre salvateur.
François Lafon
Cité de la Musique, cycle Schönberg/Stravinsky. Stravinsky en mode hip-hop, les 6 et 7 avril Photo © Compagnie Melting Pot

A l’Auditorium du Louvre dans la série "Clip & clap, une exploration de la musique en images" : l’improvisation. Deux animateurs, trois membres de l’Orchestre National de Jazz, et de nombreux documents filmés. Donnée de départ, le mépris de Pierre Boulez envers l’improvisation, qu’il juge primaire, en-deçà de l’acte de création. Témoins (pas toujours volontaires) de la défense : Georges Cziffra, Ella Fitzgerald, Led Zeppelin, le violoniste Gilles Apap, les rappeurs Supernatural et Craig G et quelques autres, parmi lesquels Charlie Chaplin improvisant sur « Je cherche après Titine » dans Les Temps modernes, Miles Davis accompagnant Jean Moreau dans Ascenseur pour l’échafaud, et le free-jazzeur Cecil Taylor mettant KO Boulez lui-même en direct sur TF1. Public très jeune mêlé d’institutionnels (Christiane Taubira partant précipitamment en cours de séance), sage, presque studieux, entre conférence au musée et soirée thématique sur Arte. Un peu plus que cela en réalité, grâce au présentateur Clément Lebrun, qui donne à la salle une leçon-minute soundpainting (langage musical par gestes, Woodstock 1974) et aux trois jazzmen improvisant sur une course-poursuite tirée du court métrage de Carl Theodor Dreyer Ils attrapèrent le bac (1948). Prochaine séance Clip & Clap (en décembre) : Rire en musique, rire de la musique. Un sujet plus sérieux qu’il n’en a l’air.
François Lafon
www.louvre.fr/musiques Photos © DR

A Pleyel, cast français pour programme franco-allemand avec l’Orchestre de Paris. Bonne idée que de mettre en regard la sombre Ouverture tragique de Brahms et la Symphonie de César Franck, longtemps accusée d’être trop germanique. Bonne idée aussi que de confronter ces deux œuvres de poids au tout léger Concerto pour deux pianos en mi majeur, composé par Mendelssohn à quatorze ans. Bonne idée enfin que de faire jouer ce Concerto par Bertrand Chamayou et Jean-Frédéric Neuburger, deux poids lourds au toucher léger du jeune piano français. Le chef Louis Langrée, dont le nom désormais pèse son poids sur la scène internationale, fait rutiler l’orchestre de tous ses ors. Lourd ? Non, charnu, s’appuyant sur des basses solides et sculptant dans la masse des figures d’une exceptionnelle légèreté, comme il l’avait fait il y a deux ans dans un Pelléas et Mélisande d’anthologie avec le même orchestre (voir ici). Français, en somme, au meilleur sens du terme.
François Lafon
Photo © DR

Aux Bouffes du Nord dans la série « Maestro and Kids » : master-class et concert de Viktoria Mullova. « Votre Paganini est excellent, je n’ai rien à dire. Ah si : ne jouez surtout pas Bach de la même manière ». « Pensez que le Bach est une langue qui se parle : posez les questions, attendez les réponses, aidez-vous du contrepoint, soyez libres ». « Dans la musique baroque et classique, résistez au romantisme ». Métamorphose presque immédiate du jeune Coréen Da-Min Kim, un peu moins évidente du non moins jeune et très virtuose Chinois Chi Li. Une conseillère plutôt qu’un maître, en rien une show-woman. Concert avec le pianofortiste Paolo Giacometti : trois sonates de Beethoven (n° 4, n° 5 « Le Printemps », n° 9 « A Kreutzer »). Mullova joue, comme elle le fait dans Mozart et Vivaldi, un violon monté en boyau : « Je ne crois pas, après y avoir goûté, pouvoir jamais rejouer Beethoven avec des cordes en métal ». Visage austère, technique transcendante, style dépouillé. Une certaine raideur aussi, tempérée par les phrasés souples de Giacometti. Elle met exactement en œuvre les conseils qu’elle donnait, deux heures plus tôt, aux « Kids ». Jusque dans Beethoven, elle résiste au romantisme. Enfin pas tout à fait : sous ses dehors hautains, elle sait étonnement en restituer le feu et le miel.
François Lafon

A l’Opéra de Dijon-Auditorium, Don Giovanni mis en scène par Jean-Yves Ruf. Cinq représentations sold out, un public jeune (30% de moins de 26 ans), une troupe qui ne l’est pas moins, le solide Orchestre de Chambre d’Europe (en résidence) dans la fosse, un positionnement international pour cette structure ambitieuse (Auditorium : 1611 places ; Opéra historique : 694 places) gérée depuis cinq ans par Laurent Joyeux, le plus jeune directeur d’opéra de France. Spectacle jeune en effet, et accessible à qui ne connaît pas l’œuvre par cœur : costumes modernes mais pas trop, décor à tout faire (une pelouse accidentée), fable racontée au premier degré. Mais ni le chef Gerard Korsten ni le metteur en scène ne viennent à bout du « problème Don Giovanni » : comment suggérer la fuite en avant du séducteur poursuivi que personne n’attrape – ou ne veut attraper – sinon la Mort elle-même ? L’horlogerie musicale est précise mais statique, l’action scénique tourne en rond. Silhouette de voyou chic et voix de velours, le Don (Edwin Crossley-Mercer) pâlit devant les deux autres voix graves, Leporello (Josef Wagner) et Masetto (Damien Pass), eux-mêmes des Don en puissance. Même déséquilibre chez les dames, dominées par la petite Zerline (la jeune et fraîche Camille Poul). Il s’en faudrait de peu (un autre chef, un autre Don ?) pour que vienne la légèreté tragique apparemment recherchée. Autre gageure la saison prochaine (sous-titrée « Cap au nord »), une Tétralogie artistement condensée : deux soirées de six heures agrémentées de préludes dus au compositeur Brice Pauset. Mise en scène du décidément casse-cou Laurent Joyeux, direction de l’excellent et pas assez connu Daniel Kawka. Grand public et puristes rebutés par la version light à convaincre.
François Lafon
Opéra de Dijon-Auditorium, les 22, 24, 26, 28, 30 mars. Diffusion sur www.medici.tv et www.bourgogne.france3.fr à partir du 30 mars, lecture pendant 3mois sur Medici.tv Photo © Roxanne Gauthier

A l’Opéra Bastille, reprise de Siegfried, troisième volet de La Tétralogie mise en scène par Günter Krämer. Le spectacle a été artistement karchérisé, mais reste un concentré des contradictions de l’ensemble. A force de vouloir montrer qu’il a tout compris à Wagner et qu’il n’en est pas dupe, Krämer ne raconte que sa difficulté à créer un spectacle cohérent. On pense à Marguerite Duras expliquant qu’en tournant Le Camion, elle a « fait un film de l’impossibilité à filmer ce film-là ». Il y a deux ans (voir ici), Philippe Jordan déroulait un tissu symphonique séduisant mais assez peu théâtral et ne prenait les rênes que lorsque l’agitation scénique le lui en laissait le loisir. Aujourd’hui, il impose son tempo, crée un paysage sonore riche et varié, bref, fait le spectacle à lui seul, secondé par un orchestre aux sonorités de rêve et par des chanteurs valeureux à défaut (surtout Torsten Kerl en Siegfried pourtant impeccablement musical) d’être toujours audibles dans un espace aussi vaste.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille jusqu’au 11 avril, et le 23 juin Photo © Opéra de Paris

Au Châtelet, première française de Carousel, de Rodgers et Hammerstein, soixante-sept ans après sa création à Broadway. Curieux que cette célèbre version musical de la pièce hongroise Liliom, dont Fritz Lang a tiré en 1934 un film culte et … français (avec Charles Boyer et Madeleine Ozeray) ait mis tout ce temps à traverser l’Atlantique, ou tout au moins la Manche, puisque le spectacle est une coproduction avec Opera North (Leeds). A moins que cette version presque rose d’une histoire plutôt noire n’ait paru trop rose et trop noire en même temps, trop métaphysique et trop naïve. L’histoire du bonimenteur de foire qui meurt de façon crapuleuse et se voit proposer par l’administration céleste de revenir une journée sur terre pour réparer le mal qu’il y a fait est pour le moins édulcorée, et c’est pourtant ce côté mélo qui fonctionne le mieux : rien dans la mise en scène à la fois spectaculaire et toute simple de Jo Davies qui ne mène au happy end post mortem. Comme le chef et les chanteurs-acteurs sont impeccables, on oublie les tunnels du texte et la banalité de la musique – mis à part le tube « You’llnever walk alone » et la petite Carousel Waltz, étrangement prokofievienne –, sans pouvoir s’empêcher, quand même, de se demander ce que Liliom serait devenu si Puccini, Gershwin et Kurt Weill, qui s’y étaient intéressés, n’avaient cédé la place à l’entertainer Richard Rodgers.
François Lafon
Châtelet, Paris, jusqu’au 27 mars Photo © Richard Morgan

Dans le cadre de Piano aux Jacobins (Toulouse) délocalisé au théâtre de l’Athénée (Paris), Philippe Bianconi joue les 24 Préludes de Debussy. Noir dans la salle, lumière, l’artiste est en place, musique : typique de ce Français plus connu à l’étranger que dans son pays natal (il n’est pas le seul), reconnu comme un maître mais peu soucieux de vendre son image. Pris un par un, ces Préludes sont d’étranges paysages mentaux, rendus plus insaisissables encore par leurs titres : « Ce qu’a vu le vent d’ouest », « La Cathédrale engloutie », « Général Lavine-eccentric », « La Terrasse des audiences au clair de lune ». Donnés à la suite les uns des autres, ils ont des effets de drogue dure : éléphants roses et/ou bad trip. Dans l’enregistrement qu’il en a réalisé l’année dernière (voir ici), Bianconi ne joue ni les gourous ni les maîtres d’école : respect du texte, précision du dessin, mais aussi une étonnante liberté à se mouvoir dans ce monde sans repères apparents. Ce soir, après un début troublé par la pluie sur le toit du théâtre (un 25ème Prélude intitulé « Gouttes d’eau sur le Palais des illusions » ?), il faut attendre le 2ème Livre, après l’entracte, pour entreprendre le grand voyage. En bis : une explosive « Isle joyeuse », « pour dissiper les dernières vapeurs ». On revient de loin, en effet.
François Lafon

Puisque bicentenaire wagnérien il y a, le Grand-Théâtre de Genève n’a pas résisté à se lancer dans La Tétralogie et en a confié la mise en scène au vétéran Dieter Dorn. Celui-ci évite le piège dans lequel est tombé son confrère Günter Krämer à l’Opéra de Paris : se montrer plus malin que Wagner. N’aspirant ni à révolutionner Le Ring ni à en accumuler des lectures politiques, psychanalytiques ou autres, il s’attache à narrer au présent un conte épique, avec son entrelacs de prosaïsme et de merveilleux, avec un Wotan pusillanime et déjà défait. Malgré de menues banalités esthétiques et quelques hésitations mal résolues entre espace et architecture, il y parvient. Ingo Metzmacher dirige avec finesse et cursivité une cohérente équipe vocale, de laquelle se distinguent les deux ténors de comédie Corby Welch (Loge) et Andreas Conrad (Mime), le mordant John Lundgren (Alberich) et l’émouvant duo de sœurs, Elena Zhidkova (Fricka) et Agneta Eichenholz (Freia). Cet Or du Rhin sans fioritures donne en tout cas envie de voir la suite, dès l’automne prochain, en attendant le cycle complet au printemps 2014.
Frank Langlois
Genève, Grand Théâtre, 9, 12, 15, 24 mars Photo © C. Parodi

Récital, dans la série Les Pianissimes, de Benjamin Grosvenor au Conservatoire d’Art Dramatique. Bach-Kempff, Bach-Rummel, Bach-Siloti, Bach-Saint-Saëns (mais pas Bach-Busoni) pour commencer. Le poulain Decca la joue classique : toucher précis, phrasés sage, beaucoup de pédale. Puis vient Chopin, avec la Polonaise op. 44 et l’Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante. Là, le prodige britannique (21 ans) se déchaîne : phrasés étranges, foucades répétées, graves secs et aigus agressifs, ignorance systématique de l’art de l’enchaînement. Cinq Mazurkas et la Valse op. 38 de Scriabine dans la foulée : on admire la technique et l’audace, tout en se félicitant de ne pas être au premier rang. Ensuite des Valses poeticos de Granados ni très dansantes ni très poétiques, et pour finir un Beau Danube bleu feu d’artifice dans la transcription kitsch d’Adolf Schulz-Evler. Applaudissements nourris : on peut admirer ou détester, et même faire les deux en même temps. Benjamin Grosvenor a son monde, et déjà son système, mais n’a pas encore trouvé son assise. C’est en cela qu’il est inquiétant.
François Lafon

Bicentenaire Verdi à l’Opéra Bastille, avec la reprise de Falstaff dans la mise en scène de Dominique Pitoiset (1999). Un hommage modeste comparé à La Tétralogie donnée en parallèle, mais pertinent : ainsi transposée à l’époque victorienne, dans une arrière-cour de brique noircie, cette ultime « comédie lyrique » nous montre l’envers du décor, nous fait visiter l’atelier du peintre. A travers les déboires du gros chevalier vieillissant, Verdi règle ses comptes avec la séduction, qui a été une des clés de sa carrière : « Tous dupés! Chaque mortel se moque de l’autre ». On regrette tout de même de perdre, sur l’immense plateau, les finesses d’une des plus belles distributions actuellement disponibles, menée par Ambrogio Maestri - Falstaff énorme et en même temps aérien -, et Marie-Nicole Lemieux - craquante en entremetteuse de charme -, sous la direction avant tout énergique de Daniel Oren.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille, jusqu’au 24 mars. En direct le 12 mars dans des salles UGC et des cinémas du monde entier. Diffusion ultérieure sur France Télévisions (réalisation Philippe Béziat) Photo © Opéra de Paris

Aux Bouffes du Nord, Répertoire, théâtre musical de Mauricio Kagel mis en œuvre par Jos Houben et Françoise Rivalland. Des « Szenisches Konzertstück » datant de 1970, « autant de flash inspirés, cet instant décisif si cher à la photographie », typiques des recherches de cet Argentin installé en Allemagne et décédé en 2008, qui a fait musique de tout, et théâtre d’à peu près tout. Trombones, cymbales et tambourins – maniés de manière pour le moins particulière -, mais aussi balles, ressorts, aspirateurs, roulements à bille, tuyaux d’arrosage et ovnis domestiques sont actionnés pendant une heure d’horloge par cinq acteurs-manipulateurs impassibles ou/et empêtrés, créant des situations improbables, des images surréalistes et des sons qui ne le sont pas moins, dans le style des gags relayés par You Tube. La salle rit beaucoup au début, moins après, pour retrouver son hilarité lors d’un finale avec toute la troupe augmentée de quelques accessoires parmi les plus sonores. Un travail d’orfèvre digne des rêves fous du maître. Peut-être pas l’accession de celui-ci au rang de classique, mais le signe que son « tout musique » peut encore trouver un écho.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 2 mars Photo © Charles Mignon

Au théâtre de l’Athénée, L’Histoire du soldat de Stravinsky et Ramuz, mais pas la même présentation qu’en juin dernier sur la même scène (voir ici). Pas la même œuvre non plus, pourrait-on croire. Le soldat-violoniste-funambule rentrant de guerre (création : Lausanne, 1918), le Diable chef d’orchestre, le livre volant du spectacle de Jean-Christophe Saïs font place dans celui-ci, signé Roland Auzet, à des images inquiétantes (vidéos inventives de Wilfried Wendling), à des objets obsessionnels peuplant la tête et la voix de l’unique et protéiforme personnage : Diable dans un gant rouge, violon-revolver, souliers ne conduisant nulle part. Idée choc : confier le rôle à l’auteur-compositeur Thomas Fersen, forte présence, voix fêlée, diction modulée, flow subtilement musical. Fondus dans un mur-écran cachant des rouages compliqués, les instrumentistes-choristes, issus du Conservatoire de Lyon, lui renvoient les harmonies de Stravinsky comme un combustible à son enfer personnel. Plus rien à voir avec le spectacle de tréteaux originel : tel le Diable, L’Histoire du soldat se prête aux incarnations les moins attendues.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 2 mars Photo © Emmanuelle Murbach

Reprise de La Tétralogie à l’Opéra Bastille, suite : La Walkyrie. Après un Or du Rhin discrètement retouché, le metteur en scène Günter Krämer était censé « revoir sa copie », selon les termes du directeur Nicolas Joël. Il l’a revue en effet, en gommant certains effets les plus critiqués, comme pour mieux en accentuer d'autres : plus de tables de dissection pour les Walkyries charognardes, mais les fières guerrières essuyant le sang à quatre pattes. Direction d’acteurs resserrée, soulignant le parti-pris ironique : un anti-Chéreau, refusant toute empathie entre les personnages. N’empêche que la rupture avec la débauche BD-manga de L’Or du Rhin laisse, a fortiori dans cette version "nettoyée", une impression de vide mal comblé par des effets de figuration insistants, tels les Wotan-boys lobotomisés reproduisant en boucle une sorte de pas de l’oie. Ce qui, comme dans L’Or du Rhin, a vraiment changé, c’est la direction de Philippe Jordan, à la fois plus raffinée et plus dramatique, antidote bienvenu à la froideur revendiquée du spectacle. C’est la distribution aussi, avec un couple Sieglinde-Siegmund de rêve (Martina Serafin et Stuart Skelton), galvanisant une Brünnhilde (Alwin Mellor) et un Wotan (Egils Silins) qui ne sont que bons.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille, jusqu’au 10 mars, et le 19 juin Photo © Opéra de Paris

Aux Bouffes du Nord, Le Crocodile trompeur/Didon et Enée, d’après Didon et Enée de Henry Purcell et d’autres matériaux. Et quels matériaux ! S’autorisant du fait que ce chef-d’œuvre minute (même pas une heure) est un ovni lyrique peut-être créé dans le cadre d’un mask, spectacle total très prisée dans l’Angleterre du XVIIème siècle, Samuel Acache et Jeanne Chandel, les metteurs en scène, ont réuni un collectif d’acteurs-chanteurs-instrumentistes-clowns-tragédiens-danseurs-équilibristes (dans l’ordre que vous voudrez) pour raconter, en musique mais pas seulement, la mort d’amour et autres sentiments. Un bric-à-brac savamment agencé - inspiré du tableau de Breughel L’Ouïe -, des références aux Marx Brothers en même temps qu’à Tadeusz Kantor et James Thierrée, une invention visuelle trépidante, un sens du nonsense très développé, et voilà une mise en abîme, baroque dans l’esprit et contemporaine dans la forme, qui en dit plus que bien des dramaturgies et autres matériaux. Musicalement, tout Purcell est là, ou presque, baroque jusque dans les dérapages, nombreux et contrôlés, auxquels il est soumis. On rit beaucoup, pour mieux compatir au malheur de Didon (étonnante Judith Chemla, ex-de la Comédie Française aux beaux moyens de soprano) et pour admirer ces artistes qui savent tout faire, et en font quelque chose d’assez bluffant.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 3 mars Photo © V. Portelli

A Pleyel, Yuri Temirkanov dirige l’Orchestre de Paris dans Prokofiev, Tchaikovski et Moussorgski. Mise en scène sonore très personnelle, gestique unique, la plus étonnante depuis celle de Carlos Kleiber. Donnant les départs comme on jette une rose ou comme on lance une flèche, Temirkanov distribue les rôles, sculpte les phrases, suspend le temps, mime la musique. Contrastes détonants dans Lieutenant Kijé, où Prokofiev peaufine son art de musicien de cinéma, couleurs violentes des Tableaux d’une exposition, où l’orchestration de Ravel ne parvient pas, pour une fois, à franciser la véhémence moussorgskienne, raffinements capiteux des Variations rococo de Tchaikovski, dont la violoncelliste Alisa Weilerstein tient la partie soliste comme un funambule sur son fil. Temirkanov obtient de l’orchestre des sonorités un peu vertes, proches de celles du Philharmonique de Saint-Pétersbourg dont il est le directeur depuis la mort d’Evgeni Mravinski (1988). « La direction d’orchestre ? Un métier qu’on n’apprend pas », affirmait Carlo Maria Giulini. Un phénomène qu’on n’explique pas, en tout cas, que celui de ce chef dont l’art passe mal au disque, mais dont les concerts sont des expériences à nulle autre pareilles.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 13 et 14 février Photo © DR

Au théâtre des Champs-Elysées, Aldo Ciccolini joue le 3ème Concerto de Beethoven avec l’Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Louis Langrée. Salle bondée, chauffée en hors-d’oeuvre par une Ouverture "Coriolan" sous haute tension. Contraste entre la fragilité du pianiste (87 ans) et le son royal qu’il produit. Ses moyens sont presque intacts, son style l’est tout à fait, à la fois caressant et péremptoire, intériorisé et démonstratif, le tout nimbé du je ne sais quoi que le grand âge confère aux grands artistes, de cette légère distance - on n’ose dire de cette faiblesse - qui donne de la profondeur au moindre trait. Même impression dans le bis, une pièce de Grieg qui sonne bizarrement dans ce programme tout Beethoven. La seconde partie - les sépulcrales Equales pour quatre trombones joués ici par quatre violoncelles et la 8ème Symphonie, tenue à bout de baguette par un Langrée obligeant les musiciens à se surpasser -, abolit cette distance, sans pour autant que l’on revienne vraiment sur terre. « Je suis fier de penser qu’il a été un peu mon élève », dit Ciccolini de Langrée. Ceci explique peut-être cela.
François Lafon

Pour cette représentation de La Favorite, le Théâtre des Champs Elysées a fait le choix du minimalisme. La scénographie (Andrea Blum) pousse l’abstraction à un degré qui prive le spectateur de ses repères. Et la mise en scène (Valérie Nègre) donne dans le genre libertaire : tout le monde fait ce qu’il veut. Evidemment, c’est gênant dans les ensembles – c'est à dire la quasi-totalité de l'oeuvre - et seuls les airs solos donnent quelque plaisir. Bien que malade, Ludovic Tézier donne un « Viens Léonor, je suis à tes pieds » plein d’émotion (Alphonse XI). Alice Coote, complètement perdue dans les deux premiers actes, est d’un dramatisme ravageur dans le célèbre « Ô mon Fernand ». Malgré sa souplesse et sa diction exceptionnelles, Marc Laho, à force de camper, sur les pas de Jean Carmet, un Fernand cocufié et abusé par la vie ne parvient pas à émouvoir. Conscient des défauts de la scène, Paulo Arrivabeni dirige plus souvent pour le plateau que pour la fosse, ce qui naturellement nuit à la qualité de l’accompagnement orchestral.
Albéric Lagier
Théâtre des Champs-Elysées, du 7 au 19 février 2013 Photo © DR

Avatars de la modernité, dimanche soir au Théâtre des Champs-Elysées, pour la prise de fonction de Mattthias Pintscher à la tête de l’Ensemble Intercontemporain : Stravinsky (Huit miniatures, Concertino), Boulez (Le Marteau sans maître), Varèse (Octandre, Déserts). En 1954, même lieu, Pierre Henry, aux commandes des parties enregistrées de Déserts, poussait les manettes pour couvrir le plus beau chahut depuis celui, quarante-et-un ans auparavant, du Sacre du printemps. Aujourd’hui, public clairsemé, mais silence religieux. On écoute les solistes de l’Intercon, on apprécie la technique de chef de Pintscher, plus connu comme compositeur. Du classique, en somme. Le jeu de références de Stravinsky, les timbres miroitants de Boulez (« Du Webern qui sonne comme du Debussy », disait le musicologue Heinrich Strobel), les éruptions sonores de Varèse sont des moments d’histoire, que l’on reconnait comme des éléments fondateurs, mais banalisés par les innombrables « à la manière de » qu’ils ont engendrés. Les avant-gardes sont mortes, restent des oeuvres qui traversent le temps. Celles-ci le font sans problème.
François Lafon
Photo © DR

Lancement avec L’Or du Rhin, de la saison tétralogique à l’Opéra Bastille - huit cycles en kit jusqu’en juin – pour le bicentenaire de la naissance de Wagner. Très peu des changements annoncés dans la mise en scène manga-BD de Günther Krämer, créée en 2010 : c’est après, avec La Walkyrie, que le bateau a commencé à tanguer. L’image finale résume le propos et annonce les dérives : pendant que les dieux casqués gravissent l’escalier doré qui mène au Walhalla, arrive une équipe de gymnastes en shorts et débardeurs (Berlin, 1936?) portant des lettres géantes formant le mot Germania. C’est de la fosse que vient le changement : Philippe Jordan, lent et prudent en 2010, de plus en plus assuré jusqu’au Crépuscule des dieux un an plus tard, promet aujourd’hui une Tétralogie grand format : phrasés affinés, équilibre avec les voix, palette orchestrale démultipliée. Ses débuts à Bayreuth dans Parsifal, l’été dernier, ont apparemment porté leurs fruits. Plateau vocal plus homogène aussi, avec un nouveau Wotan - Thomas Johannes Meyer – vocalement assuré et très naturel en maffieux de série TV. Signe des temps : en attendant que les metteurs en scène – Krämer le premier – rechargent leurs accus tétralogiques, c’est aux musiciens de reprendre la main.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille, jusqu’au 12 février, et le 18 juin Photo © DR

Quatre représentations, au Châtelet, de Street Scene, « opéra américain » de Kurt Weill (1947). Ce n’est pas tout à fait une première parisienne : en décembre 2010, l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris en a donné une version de chambre, accompagnée au piano, où les jeunes chanteurs s’essayaient au style Broadway amélioré instauré par Weill exilé aux Etats-Unis, et dont se sont inspirés, entre autres, Leonard Bernstein et Stephen Sondheim. Cette fois, c’est l’Opera Group, une compagnie britannique pratiquant le lyrique décalé, qui officie, mais s’en tient à la tradition Broadway la plus fatiguée. Traitée façon opérette, sonorisée comme un show-télé, ce qui tue les voix et noie l’orchestre, cette peinture du petit peuple entassé dans un immeuble vétuste de Manhattan perd une grande partie de la charge contestataire qu’y a mis le compositeur de L’Opéra de quat’sous, et remise sa musique, pourtant formidablement écrite, au rang d’un à la manière de Gershwin, Irving Berlin et quelques autres. A voir la version modeste de l’Atelier Lyrique, on imaginait le grand spectacle que l’œuvre pouvait susciter. Ce n’est pas ce spectacle que nous voyons aujourd’hui.
François Lafon
Châtelet, Paris, 25, 27, 29, 31 janvier Photo © DR

Théâtre de la cruauté, au Palais Garnier, avec la reprise du Nain de Zemlinsky et de L’Enfant et les sortilèges de Ravel, mis en scène par les Britanniques Richard Jones et Antony McDonald (1998). Grand écart esthétique, stylistique et musical, « conte tragique » vs « fantaisie lyrique », mais trouble parenté entre la mortelle histoire (inspirée d’Oscar Wilde) du nain découvrant sa laideur dans le regard de la petite infante dont il est le cadeau d’anniversaire, et celle, apparemment plus douce, de l’enfant (livret de Colette) faisant l’apprentissage de la vie au cours d’un cauchemar se terminant en rêve bleu. Etrange parallélisme aussi, pointé sur le rideau de scène par un collage très années 1920, entre Zemlinsky, disgracié comme son personnage et poursuivi par une sombre fatalité, et Ravel, à jamais mystérieux sous ses dehors d’homme-enfant tiré à quatre épingles. Air de famille enfin entre la marionnette à l’effigie de Zemlinsky manipulée par le ténor qui lui prête sa voix, et les habitants du jardin enchanté de Ravel, lucioles et écureuils aux allures de rescapés de la Grande Guerre. Silence respectueux pendant Le Nain, rires plus ou moins nerveux pendant L’Enfant, applaudissements libératoires à l’adresse des nombreux et excellents interprètes : la légèreté, souvent, est plus insoutenable que la mise au jour des tréfonds de l’être.
François Lafon
Opéra de Paris Garnier, jusqu’au 13 février Photo © DR

Presse nombreuse, atmosphère de première à l’Opéra Bastille pour la reprise de La Khovantchina de Moussorgski dans la mise en scène pourtant peu mémorable d’Andrei Serban (2001). Beau plateau (Larissa Diadkova, Vladimir Galouzine, Orlin Anastassov), chœur valeureux (c’est lui le personnage principal), direction sans génie mais orthodoxe (si l’on peut dire) de Michail Jurowski, père de Vladimir et Dmitri, chefs eux aussi. Le spectacle n’a pour lui que de chercher à clarifier l’intrigue – en gros l’ouverture à l’ouest de la Russie, sous Pierre le Grand, par l’élimination des féodaux dissidents et des intégristes religieux. Mais qu’on en saisisse ou non les détails, ce monument imparfait, inachevé – donné ici dans la scrupuleuse mise au propre de Chostakovitch – est un champ de mines moins que jamais désamorcées : nationalisme, fondamentalisme, communautarisme, conspirationnisme. La dernière scène, où l’on voit les Vieux Croyants s’immoler par le feu, est d’autant plus dérangeante que la musique en est céleste. « Les personnages ne sont pas des nihilistes ni des partisans du chaos. Ils cherchent tous le bien et le salut de leur pays » note le metteur en scène dans sa déclaration d’intentions. C’est bien là le plus effrayant.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille, jusqu'au 9 février. En direct sur France Musique le 9 février. Photo © Opéra de Paris

Voyage d’hiver au féminin à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille. Un tandem étonnant que la jeune mezzo Janina Baechle et la légende du piano Elisabeth Leonskaja pour raconter l’histoire du désespéré schubertien. La première, voix d’opéra au timbre opulent, ne tente pas de faire croire que le cycle n’a plus de secrets pour elle. La seconde débute dans l’œuvre : toucher raffiné, musicalité éprouvée, mais pas encore de vision d’ensemble. Le duo fonctionne, mais pas jusqu’à la liberté, l’abandon qui font les Voyages d’hiver mémorables. Salle bondée, toux bruyantes, mais attention soutenue. Convergences, la saison de concerts et rencontres organisée autour de la programmation lyrique, a son public, comme l’Atelier d’art lyrique, Opéra-école souvent plus aventureux que l’autre, a le sien. C’est dans ce cadre que la basse Franz Josef Selig a donné un somptueux récital en novembre (voir ici). Le pianiste François-Frédéric Guy, la contralto Marie-Nicole Lemieux, une Belle Maguelone de Brahms avec le baryton Roman Trekel et la comédienne Marthe Keller sont annoncés. En prenant les chemins de traverse, il arrive qu’on voie mieux le paysage.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille, Amphithéâtre, les 14 et 18 janvier Photo © DR

Lionel Bringuier, le chef qui monte, Gautier Capuçon, Eric Tanguy, programme de musique française : soirée attrayante, parfois étonnante, pour le concert de rentrée 2013 de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. La surprise est venue du concerto pour violoncelle en la mineur de Saint-Saëns, de forme originale. La conception intimiste qu’en a Gautier Capuçon est tout au bénéfice de l’ouvrage, et lorsque Lionel Bringuier et l’orchestre s’y rallient, comme dans sa deuxième section, en l’occurrence très légèrement dansante, aux limites du silence, on vit un moment d‘exception. Eclipse d’Eric Tanguy (1999) n’était pas une création mondiale : depuis sa première audition aux Flâneries musicales de Reims, elle a été donnée, en particulier, en octobre dernier dans la nouvelle salle de concert d’Helsinki. Partition à la fois flamboyante et « d’une trame architecturale rigoureuse », elle justifie amplement sa durée de vingt-trois minutes, une de celles dont on « entend » qu’elle descend de « grands ancêtres » sans toujours percevoir exactement qui ils sont. Une partie du mystère demeure, et c’est très bien ainsi. Les symphonies de Roussel, notamment la Troisième, se font rares, ce qu’on ne saurait dire de La Valse de Ravel : leur succession est à sa manière source d’équilibre. Lionel Bringuier a largement répondu aux attentes, et sa complicité avec l’orchestre semble bien établie.
Marc Vignal
Salle Pleyel, 11 janvier 2013

Drôle de concert à Pleyel, où le violoniste Gil Shaham poursuit avec l’Orchestre de Paris son cycle « Concertos des années 1930 ». Il joue cette fois le Concerto de Stravinsky (1931), mélange de sport violonistique extrême et de raffinement néo-classique. Au pupitre : Nicola Luisotti, directeur du San Carlo de Naples et de l’Opéra de San Francisco. Concours de sourires - éclatant chez le chef, plus ambigu pour le soliste – et d’expressivité. Gestique lyrique de Luisotti, démonstrative et analytique de Shaham, qui transmet à l’orchestre la souplesse, la variété de son jeu. Trois bis, de Bach à l’Américain Bolcom, achèvent de rendre la soirée inoubliable. Luisotti reprend la main - et avec une certaine poigne -, dans la 3ème Symphonie de Prokofiev, recyclage orchestral de l’opéra L’Ange de feu considéré à l’époque (1929) comme injouable. L’Orchestre y conserve quelque chose de la pointe sèche stravinskienne : éternelle rivalité des deux compositeurs. Mais c’est dans l’ouverture de La Force du destin (début de l’année Verdi) et le Capriccio italien de Tchaikovski que le chef se déchaîne. Eternelle rivalité, cette fois, de la grande musique et de la grosse musique.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 9 et 10 janvier

Pour les fêtes au théâtre de l’Athénée, la compagnie Les Brigands (onze ans d’âge, d’abord composée de membres des Musiciens du Louvre en goguette) revient à ses fondamentaux avec Croquefer et L’Ile de Tulipatan, deux Offenbach de poche. Les principes maison – décalé, mais pas trop, subversif mais bon enfant – sont respectés. Salle bondée, rappelant que ce style so French ne demande qu’à être réactivé. Croquefer, parodie du style paladin (qui ne nous dit plus grand-chose), peine à trouver son rythme et sa folie, en dépit des clins d’œil répétés du metteur en scène Jean-Philippe Salério à Groland et aux Monty Python. L’Ile de Tulipatan, en revanche, marche tout seul. Musicalement sur-vitaminée, contemporaine (1867) des grands opéras-bouffes (La Périchole, La Grande Duchesse de Gérolstein), cette histoire de garçon élevé en fille qui en pince pour une fille élevée en garçon est faite sur mesure pour la troupe, menée par l’étonnant baryton à transformations Flannan Obé. Comme d’habitude, les voix passent ou cassent, et l’orchestre (dix musiciens) se démène comme cent. On vient aussi pour ce côté artisanal, artistiquement incorrect dans un monde lyrique obsédé par la perfection.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 13 janvier. Théâtre Municipal, Gray, 23 décembre. Le Fanal, Saint-Nazaire, 15 janvier. Photo © Claire Besse

Concert Ravel par l’Orchestre de Paris sous la pyramide du Louvre (mardi 18) et à la salle Pleyel (mercredi 19). Pierre Boulez, handicapé par une affection des yeux, est présent mais a passé la baguette au Finlandais Mikko Franck. Chaises musicales : Franck, qui lui-même annule souvent pour raisons de santé, est encore auréolé du succès d’un Tristan et Isolde, en octobre à Pleyel, où il remplaçait Myung Whun Chung. Son Ravel n’est pas boulézien : il est compact, coloré, spectaculaire. L’orchestre, sous haute tension, se surpasse. Entre un Alborada del gracioso électrique et un Daphnis et Chloé (ballet intégral, mais sans le choeur) en cinémascope, on oublie les efforts de la mezzo Nora Gubisch pour faire comprendre le texte de Shéhérazade. A la fin, Franck annonce le départ à la retraite du contrebassiste Bernard Cazauran, présent depuis 1967 (« Je n’étais pas né », précise-t-il). Fleurs, banderole : une fête de l’orchestre. Que le génie d’orchestrateur de Ravel cache un monde mystérieux, que les moments de tendresse ne soient pas des longueurs mais des pistes lancées par ce compositeur secret n’est pas à l’ordre du jour.
François Lafon
Concert (à Pleyel) diffusé en direct et accessible jusqu’au 19 juin 2013 sur Arte Live Web. Diffusé ultérieurement sur Mezzo. Photo © DR

Ouverture, avec les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, de la saison du jubilé (850ème anniversaire) de Notre-Dame de Paris. Vingt-cinq concerts jusqu’à la création, en décembre 2013, de nouvelles Vêpres signées Philippe Hersant. Nef bondée, présence conjointe de Monsieur le Cardinal et de Monsieur le Maire (de Paris). Lionel Sow, chef de la Maîtrise de la cathédrale (et, depuis un an, chef du Chœur de l’Orchestre de Paris) est aux commandes. Gestique onctueuse mais précise, maîtrise de l’acoustique du lieu : stéréo réussie du double chœur, effets d’écho réglés au millimètre, alchimie savante des cordes et des cuivres (les très bons Sacqueboutiers de Toulouse), ballet impeccable des voix solistes (parmi lesquels l’excellent baryton Marc Mauillon). Un prodige dans cette nef gigantesque, où la bouillie sonore menace sans cesse le néophyte. Mais tout cela au détriment du grand théâtre initié par cette œuvre révolutionnaire, où Monteverdi abandonne les abstractions polyphoniques pour appliquer à l’église les mêmes principes (« seconde pratique », ou nouveau style) qu’à l’opéra naissant (son Orfeo date de la même année 1610). Une manière peut-être de rappeler qu’à Notre-Dame, on vient pour vénérer, pas pour faire la révolution.
François Lafon
www.musique-sacree-notredamedeparis.fr Photo © DR

Pourquoi pas Mozart comme soutien de l’UNICEF ? Cela s’est produit à la mairie du VIème arrondissement de Paris : concert au profit du fonds des Nations Unies pour l’enfance et en particulier d’UNICEF France, avec au programme quatorze extraits de Cosi Fan Tutte allant de l’air au sextuor en passant par le duo, le trio et le quintette. Six chanteurs en tenue de ville évoluent dans la salle des fêtes, l’orchestre est réduit à deux violons, un alto, un violoncelle et un pianoforte, se produisent des membres de l’Atelier Lyrique d’Opera Fuoco. Créé en 2003 par David Stern, Opera Fuoco est en résidence à Saint-Quentin-en-Yvelines. C’est justement là qu’en mars 2013 sera représenté Cosi Fan Tutte. La musique de Mozart est telle que même dans la salle des fêtes du VIème, elle ne perd rien de son impact dramatique : superbe sextuor du Ier acte ! Il faut bien sûr, ce qui était le cas, des interprètes à la hauteur et surtout engagés. Il n’y a pas lieu ici de chanter les louanges de chacun des onze, mais bien de rappeler qu’une soirée comme celle-là ne saurait être considérée comme une préparation à un événement plus sérieux - ou plus officiel. Elle existe en soi, et dans une mairie comme dans une grande salle de concert, on peut ressentir fortement enthousiasme et émotion.
Marc Vignal
Paris, salle des fêtes de la mairie du VIème, jeudi 13 décembre 19h30

C’est la dolce vita dans la salle, sur fond de variétés des années 60 et d’une vidéo de souvenirs de vacances, deux enfants dansant sur l’avant-scène. Warlikowki l’annonce avant que le spectacle ne commence : il montrera ce que Cherubini et Hoffman ont laissé offstage, l’ambiance festive de cette journée de mariage dans une Corinthe transportée au Lido d’Ostia. Cet éclairage ne fera qu’accentuer, peu à peu mais avec quelle sûreté, la noirceur du drame qui se déroule sur scène et s’intensifie à mesure que le personnage de Médée s’épaissit. D’épouse trompée (Jason est alors ingrat) en mère dépossédée (Jason est dès lors cruel) sous la plume plus de plus en plus acérée du librettiste et celle, nerveuse, du compositeur, ces noces mortelles imposent une expérience physique au spectateur. Coup de maître pas seulement visuel, le dépoussiérage de l’œuvre est général. En fosse, Christophe Rousset s’empare de cette partition toute en tensions, aux ouvertures amples et riche en originalités, surtout du côté des vents où les bois dominent : quelle belle introduction à la flûte de cet Hymen, viens dissiper une grande frayeur (Dircé) et au basson, qui se transforme en basson obligé, de Ah! nos peines seront communes (Médée). Décapage côté texte, les dialogues parlés ayant été entièrement ré-écrits dans un français actuel et cru au point de déclencher des huées, divisant la salle entre applaudissements enthousiastes et lazzis dont on regrettera simplement qu’ils furent si dénués de panache. Dépoussiérage surtout côté interprètes. Car c’est une autre réussite de cette production que de se placer ainsi sous le culte du corps. Tous y participent, mais, soutenue par Vincent le Texier (Créon), John Tessier (Jason) et Varduhi Abrahamyan (une Néris bouleversante dans Ah! nos peines seront communes) Nadja Michael, ex-nageuse de compétition, ex-mannequin, incarne une forme achevée (et définitive ?) du jusqu’auboutisme sensuel et acéré. La scène finale, l’infanticide consommé, tonne comme une porte qui claque. C’est d’ailleurs ce claquement final qui laissera l’audience sans voix.
Albéric Lagier
Théâtre des Champs Elysées, 12, 14 et 16 décembre 2012. DVD paru chez Bel Air CLassiques Photo © DR
Reprise, à l’Athénée, du spectacle Cocteau-Poulenc déjà donné en février 2011 (voir Musikzen : Gare au blues !) Seule en scène avec le pianiste Pascal Jourdan, la mezzo Stéphanie d’Oustrac conjugue à trois temps le verbe abandonner : La Dame de Monte-Carlo, vieille joueuse lâchée par la chance, Lis ton journal, issu du monologue Le Bel Indifférent, La Voix humaine, ou comment l’invention du téléphone a enrichi l’arsenal de la torture amoureuse. Un univers sentant la naphtaline et le 5 de Chanel, un pendant aux Enfants terribles version Phil Glass, joué le mois dernier dans ce même théâtre. Comédienne (Lis ton journal est un monologue parlé) autant que chanteuse, Stéphanie d’Oustrac s’y révèle en tout cas de l’espèce des divas mutantes, dont Natalie Dessay est l’exemple plus médiatisé. Un rêve d’opéra que Poulenc avait réalisé en rencontrant Denise Duval, ex-pensionnaire des Folies-Bergère devenue son interprète de prédilection.
François Lafon
Au théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au décembre. Photo © DR

Nouvelle présentation de Carmen à l’Opéra Bastille. Les deux premières (1993 – 1997) étaient ratées, celle-ci semblait sans danger : chef aguerri à ce répertoire (Philippe Jordan), metteur en scène « du juste milieu » (Yves Beaunesne), protagonistes ayant fait leur preuves dans leurs rôles respectifs (Anna Caterina Antonacci, Nikolaï Schukoff). Idée phare de Beaunesne, transposer l’action à l’époque de la Movida, avec clins d’œil aux films d’Almodovar : costumes décalés, drag-queen imitant Rossy de Palma, Micaela en écolière à bicyclette, Carmen en Pénélope Cruz peroxydée montée sur talons aiguilles, Escamillo déguisé en Roberto Alagna chantant Luis Mariano. Mais n’est pas Almodovar qui veut et Carmen n’est pas La Loi du désir : dans un décor figurant un hangar à moitié construit (ou à moitié démoli ?) l’œuvre est jouée comme d’habitude, un folklore en remplaçant un autre. Bons points : l’orchestre, somptueux, Ludovic Tézier, Escamillo bien-chantant (une rareté), les petits rôles, bien tenus. Mauvais points : Schukoff en petite voix, Antonacci beaucoup moins à l’aise qu’avec John Eliot Gardiner dans le cadre intime de l’Opéra Comique, scène finale (Don José étranglant Carmen avec la robe de mariée de sa mère, qu’il a apportée dans une valise en carton) déchaînant les huées. A partir du 20 décembre, le rôle-titre sera repris par Karine Deshayes. Une nouvelle chance?
François Lafon
Opéra de Paris Bastille, jusqu’au 29 décembre. Retransmission sur France Musique le 22 décembre. Représentation du 13 décembre diffusée en direct dans 26 salles UGC (France et Belgique), 40 cinémas indépendants (France) et 150 cinémas en Europe. Photo © Opéra de Paris/Charles Duprat

Reprise, au Palais Garnier, de La Cenerentola de Rossini dans la production historique (1968) de Jean-Pierre Ponnelle, donnée pour la première fois à Paris la saison dernière. Distribution moyenne, direction sans tonus, scories multiples grippant la mécanique rossinienne. Du coup, la mécanique ponnellienne grippe elle aussi. Adulé de son vivant, ce Français de culture et d’esthétique germanique, musicien consommé (il avait été l’élève d’Alfred Cortot) avait pour idéal de traduire la musique en mouvement, d’être scrupuleusement en empathie avec elle. Cela pouvait être, selon les œuvres, fascinant ou fastidieux. Il représentait, en tout cas, l’antithèse du mouvement lancé à l’époque par des metteurs en scène venus du théâtre, souvent moins musiciens que lui, mais habiles à manier la dialectique, et soucieux avant tout de faire avouer aux œuvres leurs intentions cachées. C’est ce courant qui a gagné, jusqu’aux actuels tops et flops du regietheater. Ponnelle en héraut d’un opéra consensuel. Lui qui aimait tant bousculer les habitudes du public huppé des grands festivals...
François Lafon
Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 26 décembre, et du 27 février au 25 mars. Cette Cenerentola, filmée en 1981 à la Scala de Milan avec Claudio Abbado au pupitre, est disponible en DVD Deutsche Grammophon.
Photo © Opéra de Paris

Récital de Franz-Josef Selig à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille. Salle austère, silhouette austère, répertoire austère. Fil conducteur, la mort : "La jeune fille et la mort", "La Nostalgie du fossoyeur" (Schubert), "Tout ce qui est créé est condamné à finir" (Hugo Wolf – Michelangelo Lieder), Chants et danses de la mort (Moussorgski). Selig, basse allemande au grave abyssal, chante Wagner, Sarastro de La Flûte enchantée ou Arkel dans Pelléas et Mélisande sur les scènes internationales. Cela n’implique pas qu’il fasse partie du cercle fermé des grands récitalistes. C’est le cas pourtant : diction exemplaire, économie de moyens (et quels moyens !), faculté de suggérer un monde par la force du verbe. En passant de Schubert à Moussorgski, sa voix se fait moins rugueuse, plus égale. Il impose les Chants et danses de la mort comme le faisaient ses grands prédécesseurs Kim Borg ou Martti Talvela, avec une glaçante simplicité. Mêmes qualités chez son pianiste, Gerold Huber. L’austérité, en art, est un concept porteur.
François Lafon
Diffusion sur France Musique le 30 décembre à 18h Photo © DR

Tout au long du XIXème siècle, la romance de salon s’est volontiers parée des charmes et des sortilèges espagnols, et ce goût de l’exotisme, prétexte à virtuosité et sensualité, s’est largement poursuivi au XXème. En liaison avec l’actuelle production de Carmen, l’atelier lyrique de l’Opéra de Paris a organisé un concert-auditions de mélodies françaises et espagnoles pour permettre à de jeunes chanteurs et à des pianistes-chefs de chant en début de carrière de se faire mieux connaître et de rassembler les meilleurs atouts pour réussir dans la vie professionnelle. Quinze chanteurs ont ainsi interprété des pages d’autant de compositeurs : de Bizet (très à l’honneur) à Rodrigo et Monpou en passant par Saint-Saëns, Berlioz et autres Massenet. Sans vouloir distribuer des bons points en chant ou en prononciation, on se souvient de l’étonnante Havanaise de Pauline Viardot, des Filles de Cadix de Léo Delibes et d’El-Deschidado de Saint-Saëns, pour ne citer que des raretés, mais aussi des célèbres Siete canciones populares (Sept chansons populaires espagnoles) de Falla, ce qui n’était pas couru d’avance, et de l’inénarrable Châteaux en Espagne (pour ténor et baryton) de Gounod. De très bons moments pour qui n’a pas tellement l’habitude d’assister à des manifestations de ce genre.
Marc Vignal
Amphithéâtre Bastille, 23 novembre 2012

Au théâtre de l’Athénée, deuxième production en trois ans des Enfants terribles de Philip Glass d’après le roman de Jean Cocteau. Quatre chanteurs, trois pianos, une scénographie en images numériques signée Romain Sosso et Stéphane Vérité, aussi metteur en scène : un numéro de haute école, non moins « cocteauien » que le film célèbre de Jean-Pierre Melville (1950). La musique de Glass – ritournelles obsessionnelles et récitatifs à la Poulenc – peut paraître systématique, voire flagorneuse, elle fonctionne pourtant, comme une ronde enfermant l’histoire de ce couple frère-sœur mourant de devenir adulte. Obsédé par Cocteau (c’est là le troisième volet d’une trilogie dont les deux autres sont Orphée et La Belle et la Bête), fasciné par le Groupe des Six, élève de Nadia Boulanger (comme tant d’Américains, et des plus typiques), Glass donne là, toute proportion gardée, son Pelléas et Mélisande (le sujet, sinon la musique, n’est pas si éloigné). Même pertinence dans le spectacle, traversé d’images rassurantes et effrayantes – chambre cocon et nature hostile –, sans allusion facile à l’esthétique de Cocteau, plus proche des intérieurs-extérieurs à la fois légers et étouffants de Christian Bérard. Etonnant travail avec les interprètes aussi, très jeunes, chantant comme on parle (une qualité, en l’occurrence), mélange d’innocence et de cruauté propres à l’enfance. Un exemple, qu’on le veuille ou non, de ce théâtre en musique à côté duquel tant de nos compositeurs, et même les meilleurs, passent avec obstination.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 2 décembre Photo © DR

Au théâtre de l’Athénée, Ubü Kiraly (Ubu Roi) d’Alfred Jarry, joué en hongrois par le Théâtre magyar de Cluj (Roumanie) et mis en scène par le Français Alain Timar. Production minimaliste : deux bancs de bois, une herse lumineuse et un énorme et interminable rouleau de papier (hygiénique ?), avec lequel six Père Ubu et six Mère Ubu en collant et t-shirt couleur chair inventent décors, costumes, bedaines et couvre-chefs. Atmosphère de monôme étudiant, esthétique de théâtre de rue, images baroques rappelant les films d’animation faussement naïfs et vraiment grinçants venus de l’Est dans les années 1960. Les douze acteurs sont aussi munis d’instruments de musique, des cuivres usagés dont ils ponctuent l’action, en groupe ou individuellement. La musique qu’ils jouent est grossière, stridente, dissonante, provocante, une version gore de L’Histoire du soldat de Stravinsky ou des musiques de foire cultivées par le Groupe des Six. Une véritable musique de scène au demeurant, collant à l’action, enveloppant d’harmonies en folie les aventures plus que jamais actuelles de ce Macbeth pas ragoûtant résumant à coup de « merdre » et de « cornegidouille » (en hongrois dans le texte) les riches périodes shakespeariennes.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 18 novembre. Photo © DR
Création, à la salle Pleyel, du Concerto pour piano « La Vie antérieure » de Karol Beffa, par Paavo Järvi et l’Orchestre de Paris, avec Andreas Haefliger en soliste. Public des grands jours - presse internationale, gratin musical, sponsors et politiques - pour ce quart d’heure de musique au titre baudelairien, œuvre d’un surdoué bien ancré dans l’institution musicale, et point de mire d’un programme lui conférant une flatteuse antériorité : Le Tombeau de Couperin de Ravel et Le Sacre du printemps de Stravinsky (deux adieux opposées au « monde d’avant »), et le génial et ambigu 24ème Concerto pour piano de Mozart, joué aussi par Andreas Haefliger. Une antériorité dangereuse aussi : bien sonnante, jazzy alla Ravel mais n’oubliant pas de rendre hommage à Dutilleux et Ligeti (les modèles contemporains de Beffa), instaurant un jeu ambigu (revoilà Mozart) plutôt que conflictuel entre le soliste et l’orchestre, cette « Vie antérieure » passe un peu inaperçue. Succès fracassant pour l’orchestre – spécialement les percussionnistes – dans Le Sacre du Printemps, plus discret pour le pianiste – assez neutre dans Mozart, raffiné chez Beffa. « Les tout-puissants accords de leur riche musique » (Baudelaire) auront toujours raison des « couleurs du couchant » (idem).
François Lafon

Troisième et dernier concert du cycle Schumann dirigé par le jeune Québécois Yannick Nézet-Séguin à la Cité de la Musique. Après Gautier Capuçon (Concerto pour violoncelle) et son frère Renaud (Concerto pour violon), Nicholas Angelich joue le Concerto pour piano. Bel accord entre le chef et le soliste, le second transmettant au premier une poésie qui tempère sa fougue, le second maintenant le premier dans un dialogue d’égal à égal. Car Angelich, tel Sviatoslav Richter en son temps, est de plus en plus libre, personnel, inattendu, passionnant même quand il est contestable. Dans cet archétype du concerto romantique, il tient en tout cas son public sous le charme. Nézet-Séguin reprend la main dans une 2ème Symphonie conduite telle une Ferrari, où le discipliné mais toujours sec Orchestre de Chambre d’Europe fait preuve d’un à-propos qui manquerait à des phalanges plus prestigieuses. Les quatre Symphonies seront édités par Deutsche Grammophon, dont ce désormais VIP de la baguette (directeur de l’Orchestre de Philadelphie et du Philharmonique de Rotterdam, chef principal du London Philharmonic) est une des plus récentes locomotives. Un « bras » comme on dit, et non des moindres, en attendant que lui vienne la poésie.
François Lafon
Retransmission gratuite pendant quatre mois sur les sites www.citedelamusiquelive.tv et www.medici.tv. Diffusion sur France Musique le 6 décembre à 14h. Photo © DR

Reprise jusqu’aux fêtes de West Side Story au Châtelet, dans la production déjà donnée en 2007 dans le cadre du cycle Leonard Bernstein (Candide, On the Town). Grosse couverture médiatique, façon show biz. En 1981, déjà au Châtelet, première tournée all american cast du plus célèbre (en France) des musicals. Un dimanche soir, Bernstein est dans la salle, accompagné de George Chakiris. Standing ovation. « J’arrive de Munich, où j’ai terminé l’enregistrement de Tristan et Isolde" explique-t-il aux saluts. "Après cela, réécouter ma propre musique remet les pendules à l’heure ». Trente ans plus tard, un public familial (beaucoup de très jeunes) vient visiter le monument, qu’il connait pour avoir vu et revu le film de Robert Wise. Il retrouve ses marques : le spectacle d’origine, la chorégraphie de Jerome Robbins en particulier, n’a subi qu’un dépoussiérage de surface, ce qui lui donne d’ailleurs un côté propret pas très en situation. On rêve un moment à une relecture radicale de cette œuvre qui parle d’émigration, de racisme, de délinquance, puis l’on se dit que sa désuétude même la protège, et l’on se laisse entraîner par la machine Broadway : énergie de la troupe, fraîcheur des solistes. Il n’y a que l’orchestre qui pèche. Là, il aurait fallu un Leonard Bernstein pour remettre les pendules à l’heure.
François Lafon
Châtelet, Paris, jusqu’au 1er janvier 2013. Photo © DR

Avec Der ferne Klang (Le son lointain), créé à Francfort en 1912, Franz Schreker (1878-1934) inaugura l’une des plus fulgurantes carrières lyriques de l’histoire. L’œuvre lui valut d’être nommé professeur au conservatoire de Vienne. En 1920, il devint directeur de l’Ecole supérieure de musique de Berlin, d’où il fut chassé comme artiste « dégénéré » avant même l’arrivée de Hitler au pourvoir. Son audience dépassa celle Richard Strauss, d’aucuns le mirent au-dessus de Wagner. Puis oubli brutal, dont il émerge à peine. Un siècle après Francfort, l’Opéra du Rhin a assuré la création scénique française de Der ferne Klang : musique luxuriante, viennoise mais très personnelle, ne ressemblant ni à Strauss ni à Mahler. D’essence symbolique, le livret est de Schreker lui-même, non sans traits autobiographiques : la recherche de l’idéal est incompatible avec les bassesses de la vie quotidienne, le compositeur Fritz se lance dans la vaine poursuite du « son lointain » qui l’obsède, ce qui provoque la déchéance de celle qui l’aime, Grete, dont le personnage et d’autres font penser à Lulu. Mise en scène haute en couleurs au 2ème acte, sur une île du golfe de Venise fréquentée par le demi-monde, voix en situation. Ce sont les prestations de l’orchestre qui retenaient sans cesse l’attention, et l’on se disait une fois de plus qu’en France, en matière d’opéra, il fallait quitter Paris pour « découvrir » au sens fort. Der ferne Klang à l’Opéra national du Rhin restera dans les mémoires.
Marc Vignal
Helena Juntunen (Grete), Will Hartmann (Fritz), Geert Smits (le Comte)... Stéphane Braunschweig (mise en scène et scénographie), Thibault Vancraenenbroeck (costumes). Chœur de l’ONR, Orchestre philharmonique de Strasbourg, dir. Marko Letonja
Strasbourg, Opéra national du Rhin, 27 octobre Photo © Alain Kaiser

Directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg depuis septembre 2012, originaire de Slovénie, Marko Letonja sait captiver et surprendre. En programmant ensemble Rendering de Berio (1989-1990), composé d’après les fragments d’une audacieuse et parfois noire Dixième Symphonie laissés à sa mort par Schubert, et Le Chant de la Terre de Mahler, il a prospecté le crépusculaire. Rendering n‘est en rien un « achèvement » de Schubert : les esquisses sont trop parcellaires, et tel ne fut jamais le propos de Berio. Il a complété celles qui s’y prêtaient et surtout les a reliées par un « tissu connectif » de son propre cru, toujours pianissimo et lointain, entremêlé de réminiscences du dernier Schubert, démarche rappelant celle de sa Sinfonia : continuité et discontinuité, bonds de cent soixante années en avant et en arrière mais sans heurts, tant sont évidents chez Berio le sens et l’art de la transition. Aucun aller et retour dans Le Chant de la Terre, mais un adieu définitif - ou supposé tel - au monde tel qu’il est. Les chanteurs sont importants, mais l’orchestre peut l’être davantage. Plus encore que Christianne Stotijn et Simon O’Neill, ce sont les sonorités arachnéennes de hautbois, de flûte ou de clarinette grave de l’Abschied (l’Adieu) final, inimaginables sans une direction à la hauteur, qui ont provoqué l’émotion. On était concerné au plus haut point, comme il se doit, car pour Gustav Mahler, le péché le plus grave était celui d’indifférence.
Marc Vignal
Strasbourg. Palais de la Musique et des Congrès 26 octobre

A la Cité de la Musique, dans le cycle Hommages (d’un compositeur à un autre, d’une époque à une autre), Emmanuel Krivine dirige Debussy, Ravel et Stravinsky avec La Chambre Philharmonique. Drôle d’orchestre, fondé par Krivine en 2004 autour de la recherche du « son d’époque », d’abord tâtonnant, aujourd’hui très au point. Résultat sonore déroutant tout de même : puissance moindre que les formations modernes, mais solos surexposés, bois et cuivres claquants (on ne s’en plaint pas lorsqu’il s’agit de la trompette de David Guerrier ou de la flûte d’Alexis Kossenko). Au centre du concert, le Concerto en sol de Ravel - hommage à Mozart, Saint-Saëns, Prokofiev et quelques autres, le tout façon jazz - que Bertrand Chamayou joue sur un superbe Pleyel : impression paradoxale de douceur et d’agressivité mêlées, qu’on peut voir comme une certaine vérité de l’œuvre. Même sensation dans Ma mère l’Oye (Ravel) ou Pulcinella (Stravinsky), où l'entrelacs des références, emprunts et pastiches se suit comme un jeu (de l’oie ?). Krivine, toujours heureux lorsqu’il peut secouer les habitudes et idées reçues, est inspiré comme jamais.
François Lafon

Enième reprise de Tosca à la Bastille, dans la mise en scène à tout faire du cinéaste Werner Schroeter (1994). Atmosphère de première pourtant, pour les débuts locaux de Martina Serafin, la Tosca du moment. Grande voix, grandes manières : une Maréchale du Chevalier à la Rose, une Sieglinde dans La Walkyrie (à Bastille encore, cette saison), un rêve de chanteuse allemande. Aucune parenté avec Tullio Serafin, le chef de Callas (« Il faudra tout de même que je cherche dans mes origines vénitiennes », dit-elle dans une interview). Sa Tosca est dramatiquement sobre, vocalement impressionnante. Pas de sensiblerie : du style, de la présence, de l’allure. Autour d’elle, un Mario hurlant (Marco Berti, acclamé au rideau final, pourtant) et un Scarpia second couteau (Sergey Murzaev). N’importe, l’histoire d’amour, c’est avec l’Orchestre de l’Opéra qu’elle le vit, aux petits soins sous la direction efficace de Paolo Carignani. Comme pour rappeler que la magie de Puccini réside dans son génie d’orchestrateur.
François Lafon
Opéra de Paris – Bastille, 23, 26, 29, 31 octobre, 3, 7, 9, 13, 17, 20 novembre Photo © Opéra de Paris

Récital du jeune pianiste Guillaume Coppola, à l’Athénée, pour l’ouverture de la saison des Pianissimes. Principe de la série : casser le rituel du concert. Pas d’entracte, cocktail ouvert à tous, lieux inattendus (prochain concert au Couvent des Récollets, Paris Xème), ateliers pédagogiques, collaboration avec diverses associations. Public inaccoutumé en effet – tous âges, tous styles – pour ce programme Debussy-Chopin-Granados donné comme un parcours personnel ponctué de lectures par le journaliste et récitant François Castang. Promotion aussi de l’album Granados récemment sorti (Eloquentia - Soleil de Musikzen). Jeu séduisant de Coppola, et plus dérangeant qu’il n’y paraît : Debussy (cinq Préludes) à la fois cérébral et coloré, Chopin sérieux et aérien (une Polonaise op. 26 n°1, en particulier, débarrassée de l’hystérie habituelle), Granados épuré et nostalgique, avec un très élégant et tout naturel Allegro de concert, pièce pourtant redoutable sous ses airs aimables. Un ton en tout cas, des moyens, et déjà un public conquis : une graine de star, espérons, et pas seulement en mode mineur.
François Lafon

Au théâtre de l’Athénée, Miss Knife chante Olivier Py. Une version music-hall de Dr Jekyll et Mr (Mrs) Hyde : « Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que je réapparais dans les moments politiques où il n’y a plus d’autres solutions que de mettre un masque et de chanter ». Remercié à l’Odéon, désigné pour 2014 comme directeur du festival d’Avignon, Py profite de l’entre-deux pour remettre le masque. A quelques mètres de l’Athénée, au Palais Garnier, l’Opéra reprend sa mise en scène du Rake’s Progress de Stravinsky : music-hall et pacte avec le diable pour la chute d’un libertin. Fourreau lamé et bas rouge sang, Py le libertin a l’air de Mackie-le-Surineur dans L’Opéra de Quat’sous (Knife = couteau) déguisé en Marlène Dietrich. Entouré de quatre formidables instrumentistes, dont le pianiste Stéphane Leach qui a mis la plupart de ses textes en musique, il chante « Dans un théâtre noir », « Chanson des perdants », « Châtiment de la nuit », « Ne parlez pas d’amour ». La salle rit jaune, il jubile, la provoque (« Que ceux à qui leurs parents ont transmis leurs frustrations lèvent le doigt ») et s’en va dans un frou-frou de fourrure blanche (« J’étais bipolaire, je ne suis plus que polaire »). En juin 2013 à l’Opéra de Munich, il monte Le Trouvère de Verdi, une histoire où personne ne sait très bien qui est qui.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 27 octobre. Tournée en France et Belgique jusqu’à la fin de l’année. Photo © DR

« J’ai rêvé la nuit dernière que Josef Haydn nous avait rendu visite chez nous », note Sibelius dans son journal le 11 juillet 1912, un an après avoir fait entendre son ascétique Quatrième Symphonie. Pourquoi Haydn plutôt que Beethoven, son dieu ? Sibelius nous ne le dit pas. II arrivait jadis au chef Thomas Beecham de programmer Haydn et Sibelius au même concert, et c’est probablement le cas, de nos jours, de Simon Rattle. Paavo Järvi et l’Orchestre de Paris l’ont fait, en commençant leur programme par la moins pittoresque et la plus rare des six Parisiennes, la symphonie n°84. Sa vigueur et ses subtilités étaient au rendez-vous, grâce notamment à un beau sens des nuances, à de soudaines et très efficaces plongées dans la nuance piano. Rien d’ascétique dans la Première de Sibelius, mais un romantisme d’ordre légendaire et individuel, ponctué par des déchainements orchestraux aux sonorités tranchantes. Le timbalier peut s’en donner à cœur joie, et Frédéric Macarez ne s’en est pas privé, frappant dur mais parvenant également donner à certains traits une dimension mélodique qu'on imaginait pas. Entre les deux, dans le 27ème concerto de Mozart, le vétéran Menahem Pressler a montré que son jeu n’avait rien perdu de ses qualités de précision et de mystérieux lyrisme. Il s’est surpassé dans les deux bis consacrés à Chopin, tenant littéralement la salle en haleine.
Marc Vignal
Salle Pleyel, 18 octobre 2012 Photo Frédéric Macarez © DR

Week-end pluvieux, quoi de mieux que se noyer dans la musique. A la cité éponyme, Alexandre Tharaud fait son Bœuf sur le toit : du classique, du jazz, du cabaret, de 11h minuit. Et moi avec ma nièce (Myrtille, la savoyarde) on s’y pointe dès 11h00. Premier concert : Tharaud, Braley, Milhaud, Poulenc, Gershwin, Stravinski. A la fin, on joue au Kital+plu (Qui t’a le plus plu ?). Tharaud, Braley, et leur profonde complicité (c’est dans le programme, NDLR) c’est d’enfer, mais tu as vu les tourneurs de page ? Le paradis ! Humm… bon. 12h45, après le cabaret de Flannan Obé, Kital+plu ? Ah …Ramona, j’ai fait un rêve merveilleux... Alexandre Tharaud de nouveau à 15h00 : Wiener, Ravel, Milhaud. 16h15, Kital+plu : Milhaud, à cause de sa polytonalité ! Et ça continue ainsi, opéras, opérettes, cinéma, tout mélangé. 22h00, l’heure des reproches. On arrête le Kital+plu ! T’aurais pu me dire que c’était, un concert salade ! Et Tharaud avec des gants de boxe... Alors on se réconcilie chez madame Raymonde. On a attendu qu’elle s’en aille pour vous quitter, M. Tharaud, mais à bientôt ! Car des Bœufs comme ça, on en redemande, végétarien ou pas.
Albéric Lagier
Cité de la Musique 14 octobre Photo © DR

Reprise au Palais Garnier du Rake’s Progress de Stravinsky dans la mise en scène d’Olivier Py. Lumière noire, acrobates, Crazy Horse Girls : aucune référence aux gravures moralisantes de Hogarth (1697-1764) qui ont inspiré au compositeur ce vrai-faux pastiche de Mozart et de Pergolèse. « Il est toujours intéressant d’importer à l’opéra des esthétiques qui lui sont a priori extérieures » déclare Py, qui voit cette « Carrière du libertin » comme un avatar original du mythe de Faust, où un jeune homme à qui tout est donné convoque son démon personnel pour mieux précipiter sa perte. Dans la fosse, Jeffrey Tate ne surexpose pas non plus les références à l’opéra baroque. On peut voir dans sa façon de ne faire corps avec les personnages que dans les moments de désespoir, une ironie plus dure encore que dans l’habituel exercice de style. Distribution à l’avenant : grandes voix lyriques (formidable Charles Castronovo en Libertin sanguin) et non plus baroqueux recyclés. Tout cela donne au spectacle une cohérence qu’il n’avait pas lors de sa création en 2008, où l’on avait surtout vu la mise en avant des fantasmes personnels du metteur en scène.
François Lafon
Opéra de Paris – Garnier. 10, 12, 16 ; 19, 22, 25, 28, 30 octobre Photo © Opéra de Paris/J.M. Lisse

Depuis cinq ans que, partie de Londres, elle écume les scènes, La Fille du régiment fait enfin escale à Paris – Bastille. L’ouvrage, composé par Donizetti pour l’Opéra Comique, fonctionne à coups de contre-ut en cascade et de mélodies bien cirées, et deux gosiers d’or suffisent à enflammer les foules : June Anderson et Alfredo Kraus en 1986 à la salle Favart, Natalie Dessay et Juan Diego Florez aujourd’hui. Le metteur en scène Laurent Pelly y offre un copier-coller de La Grande Duchesse de Gérolstein qu’il avait monté au Châtelet en 2004 : poilus de 1914, patriotisme en bataille, dérision joyeuse. Mais Donizetti n’est pas Offenbach et le deuxième degré fonctionne moins bien, en dépit d’une mise au goût du jour des dialogues parlés. N’importe : Dessay charge son personnage mais est très en voix, Florez joue les bidasses avec charme (et quels aigus !) et Felicity Lott fait un tabac en guest star à l’accent british. Dialogue glané à la sortie : « Comment peut-on aussi bien chanter de telles fadaises ? - Ne te plains pas : c’est si souvent l’inverse… »
François Lafon
Opéra de Paris – Bastille, 15, 18, 21, 24, 27, 30 octobre, 2, 6, 8, 11 novembre.Photo © Opéra de Paris

Mais qu’est-ce qui pousse Emmanuelle Haïm à mener Médée à un rythme d’enfer ? A ce train-là, le prologue, Louis le triomphant, n'a rien de majestueux mais tourne à l’air de guinguette primesautier. Un pastiche ? Non pas, le premier acte débute avec un Pour flatter mes ennuis qu'on attend lamento mais qui est du même tabac. Ça joue vite et fort dans la fosse, et avec une raideur métronomique. Côté voix, la diction en prend un coup et le souffle court est éliminatoire. Prosodie ? Déclamation ? Aux oubliettes, même si Médée est précisément une tragédie, lyrique certes, mais avant tout une tragédie. Seuls Anders Dahlin (Jason) et Sophie Karthäuser (Créuse) épousent le style baroque et parviennent à émouvoir. Laurent Naouri (Créon) s’en tire en faisant sourire (bien que le Roi de Corinthe ne soit pas vraiment un rigolo) ; Michèle Losier (Médée) abandonne toute prétention à se faire comprendre. La mise en scène de Pierre Audi est d’un modernisme académique : chœur en grenouilles rampantes, interprètes sortis de chez Cyrillus (tout de même). Inscrit en fond de scène, un immense SOS ! – en anglais Mayday !, emprunté au français M’aider ! Médée… Mayday…M’aider…Voilà donc la métaphore ? Les transports d’hier ne pas sont ceux d’aujourd’hui …et la Médée d’Haïm/Audi vaut-elle ce déplacement ?
Albéric Lagier
Théâtre des Champs-Elysées 15, 17, 19, 21 et 23 octobre. Opéra de Lille 6, 8, 10, 13 et 15 novembre.

Ouverture de la saison lyrique à l’Opéra royal de Versailles avec Carmen importé de l’Opéra de Rouen. Mise en scène et direction de l’administrateur maison, Frédéric Roels, et du nouveau chef attitré, Luciano Acocella. Accroche médiatique : la baroqueuse Vivica Genaux dans le rôle titre, qu’elle avait jusqu’ici (prudemment) refusé. Drôle d’endroit pour une telle rencontre : une Carmen sans folklore ni espagnolade, au milieu des fleurs de lys et des marbres en trompe-l’œil. En fait, un bouquet bien composé : cadre intime et dépoussiérage du mythe, version opéra-comique avec dialogues parlés (sans coupures : trois heures de spectacle) et distribution jeune, vocalement et dramatiquement assortie. Seul hiatus : un orchestre brillant (bravo les solistes) mais un manque constant d’effervescence scénique. Genaux, voix de braise, diction exemplaire, sculpturale en mini short (l’action est transposée de nos jours, dans un pays contrôlé par les Casques bleus) offre une Carmen à la Teresa Berganza, femme libre et fragile sous la provocation. Elle aussi, sans ostentation, donne le coup de grâce à l’habituelle Bohémienne aux œillades assassines.
François Lafon
Versailles, Opéra royal, 14, 16, 18 octobre.

Dans la série « Œuvres » (des classiques et une création) à l’Auditorium du Louvre, Julian Rachlin joue Britten, Beethoven et Richard Dubugnon, avec Itamar Golan au piano. Une pièce avec alto (Britten : Lachrymae, Reflections on a song of John Dowland), une avec violon (Beethoven : 10ème Sonate), une avec alto et violon alternés (Dubugnon), cette dernière baptisée Violiana parce que (en anglais) violin, viola et Julian, plus le suffixe « ana », comme dans les Kreisleriana de Schumann. L’œuvre est énergique et chantante, du contemporain soft propre à mettre en valeur le son riche et la virtuosité transcendante de son dédicataire. Car Julian Rachlin est un artiste phénoménal. Sa 10ème Sonate de Beethoven est à la fois explication de texte (écoutez ses transitions) et grand moment de poésie, son Britten une démonstration des possibilités techniques et expressives de l’instrument mal aimé qu’est l’alto. Vous ne le connaissez pas, ou seulement de nom ? Normal : il n’a pas besoin d’être médiatisé à outrance pour être reconnu comme un des grands virtuoses de l’époque.
François Lafon
Photo © Julia Wesely

Au Théâtre de Caen, Vénus et Adonis de John Blow, premier opéra anglais (vers 1683). Chœur et orchestre locaux (Les Musiciens du Paradis), Maîtrise de Caen dirigés par l’excellent claveciniste Bertrand Cuiller, mise en scène archéologique de Louise Moaty. Un spectacle phare pour le plus baroqueux des centres régionaux : tournée nationale, dont l’Opéra Comique de Paris. Une gageure aussi : intrigue minimale (Vénus aime Adonis, lequel est tué par un sanglier), micro-numéros musicaux, dont Purcell s’inspirera pour Didon et Enée, le génie dramatique en plus. Comme l’ouvrage dure à peine une heure, il est précédé de l’Ode à sainte Cécile du même Blow, où sont énumérées les vertus de la musique. Le spectacle est raffiné : éclairage à la bougie, danseurs en pourpoint, colombes et chiens de race, « mise en rapport de la nature et de la connaissance, du précieux et de la nudité, du noir et de la couleur, de l’homme et du végétal » (Louise Moaty). Mais aux questions : A quoi cela sert-il ? Que nous raconte-t-on ?, pas de réponses. Même flou musical : hormis Céline Scheen (Vénus) et Marc Mauillon (Adonis), l’ensemble évoque un travail d’atelier, largement perfectible. Nous n’en sommes pas tout à fait au moment de douceur dans un monde de brutes dont notre époque a besoin.
François Lafon
Caen, jusqu’au 13 octobre. Tournée jusqu’au 20 janvier 2013 à Lille, Luxembourg, Paris, Grenoble, Angers et Nantes.

A Pleyel, Christoph von Dohnanyi dirige l’Orchestre de Paris dans Le Château de Barbe-Bleue de Bela Bartok. Opéra en concert ou opéra de concert, ce dialogue intime d’une heure sur fond de grand orchestre ? Opéra mental en tout cas, puisque ce château aux portes verrouillées n’est autre que l’âme du monstre. En Barbe- Bleue, Matthias Goerne, tourmenté comme il le faut ; en Judith, sa dernière épouse, Elena Zhidkova, plus extérieure. Dohnanyi, lui-même d’origine hongroise, rend hommage à Georg Solti, qui aurait eu cent ans le 21 octobre, et avait dirigé l’ouvrage pour sa prise de fonction à la tête de l’orchestre (1972) ainsi que pour ce qui devait être son dernier concert avec celui-ci (1995). C’est par ailleurs Solti qui lui avait mis le pied à l’étrier, en le choisissant comme assistant à l’Opéra de Francfort dans les années 1950. Une affaire de famille artistique ? Pas vraiment, car Dohnanyi a le geste souple et la fibre chambriste, là où Solti menait son orchestre comme une machine de guerre. En première partie, une Symphonie « Italienne » de Mendelssohn particulièrement lumineuse, comme pour conjurer les ténèbres bartokien. Un contraste risqué, bien dans l’esprit de Solti, lui.
François Lafon
Belà Bartok Photo © DR

Si les œuvres, le lieu, les musiciens et l’auditoire s’y prêtent, un concert de 25ème anniversaire peut se dérouler de façon extrêmement conviviale. Ce fut le cas de celui de La Simphonie du Marais, qui pour l’occasion a organisé trois manifestations exceptionnelles. La deuxième était consacrée à des Musiques festives à la cour du Roi Soleil. Au programme deux compositeurs, Lully et Philidor, pour un double parcours - Départ en campagne puis Retour à la cour - effectué à grands renforts de flûtes, hautbois, taille de hautbois, basson, trompettes et percussions. Il ne s’agissait pas de simplement faire défiler ces musiques souvent (mais pas toujours) d’apparat, mais de les situer clairement dans leur contexte : mariage du Roy à Saint-Jean-de-Luz, guerre (brève cacophonie), plaisirs de Versailles, chasse, coucher du Roy, cérémonies funèbres. Hugo Reyne et ses huit complices n’y sont pas allés de main morte, se déplaçant comme des acteurs, se déguisant parfois quelque peu, n’hésitant ni à parler brièvement pour annoncer ou expliquer ni à émettre des sons ou des bruits imitatifs dès qu’il était question de chiens ou de chevaux. Le public, conquis d’avance et tout disposé à obtempérer, était alors invité à en faire autant. Un sommet fut sans doute atteint avec la Mascarade du Roy de la Chine et ses bonnets, gongs et onomatopées. Concert-spectacle réalisé avec un minimum de moyens, mais d’une qualité rare.
Marc Vignal
Samedi 6 octobre. Paris, Eglise des Billettes Photo © Simphonie du Marais

 Rythme : Retour périodique des temps forts et des temps faibles, disposition régulière des sons musicaux (du point de vue de l’intensité et de la durée) qui donne au morceau sa vitesse, son allure caractéristique (Petit Robert). Au théâtre de l’Athénée, le Studio Théâtre d’Alfortville reprend en alternance La Mouette et Oncle Vania de Tchékhov, mis en scène par Christian Benedetti. Pas de décors, vêtements de tous les jours, salle éclairée pendant tout le spectacle. Les deux pièces durent respectivement 1h45 et 1h20, c'est-à-dire une heure de moins que d’habitude, sans que les textes soient notoirement coupés. Les acteurs parlent vite, ils sont sans cesse en mouvement, mais l’action se fige, périodiquement, en d’assez longs silences. Plus rien à voir avec la nostalgie russe, la langueur tchékhovienne. « Les conditions de frustration et d’ennui, au lieu de dévitaliser les gens, leur donne envie de dramatiser la moindre chose, et cela crée une immense vitalité », écrivait Peter Brook lorsqu’il travaillait sur La Cerisaie. Une question de rythme, donc, qui donne à ces classiques un sens, une couleur, une saveur nouveaux, que l’on pourrait dire « de notre temps » si l’expression n’était si vague et galvaudée. Un rythme serré et même sophistiqué, comme dans certaines musiques « de notre temps ». On rit pour ne pas pleurer, on court pour ne pas tomber. Très russe, en fin de compte.
Rythme : Retour périodique des temps forts et des temps faibles, disposition régulière des sons musicaux (du point de vue de l’intensité et de la durée) qui donne au morceau sa vitesse, son allure caractéristique (Petit Robert). Au théâtre de l’Athénée, le Studio Théâtre d’Alfortville reprend en alternance La Mouette et Oncle Vania de Tchékhov, mis en scène par Christian Benedetti. Pas de décors, vêtements de tous les jours, salle éclairée pendant tout le spectacle. Les deux pièces durent respectivement 1h45 et 1h20, c'est-à-dire une heure de moins que d’habitude, sans que les textes soient notoirement coupés. Les acteurs parlent vite, ils sont sans cesse en mouvement, mais l’action se fige, périodiquement, en d’assez longs silences. Plus rien à voir avec la nostalgie russe, la langueur tchékhovienne. « Les conditions de frustration et d’ennui, au lieu de dévitaliser les gens, leur donne envie de dramatiser la moindre chose, et cela crée une immense vitalité », écrivait Peter Brook lorsqu’il travaillait sur La Cerisaie. Une question de rythme, donc, qui donne à ces classiques un sens, une couleur, une saveur nouveaux, que l’on pourrait dire « de notre temps » si l’expression n’était si vague et galvaudée. Un rythme serré et même sophistiqué, comme dans certaines musiques « de notre temps ». On rit pour ne pas pleurer, on court pour ne pas tomber. Très russe, en fin de compte.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, en alternance jusqu’au 13 octobre. Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) du 24 au 27 octobre. Théâtre Studio d’Alfortville du 12 novembre au 1er décembre.

A Pleyel, Herbert Blomstedt dirige l’Orchestre de Paris dans la 8ème Symphonie de Bruckner. Atmosphère des grands soirs : Blomstedt, longtemps considéré comme un respectable mais peu glamour kappelmeister, fait figure aujourd’hui de témoin d’un âge d’or, tels en leur temps Karl Böhm ou Günter Wand, eux-mêmes parvenus au premier plan sur le tard, après la disparition des grands anciens. Rien d’un démiurge chez ce vieux monsieur souriant, pas d’effets de manche ni d’état de transe. Comme Böhm, il provoque des tempêtes d’une simple levée de baguette, et soulève le colossal Adagio (une demi-heure, le plus long du répertoire) comme il animerait un menuet de Mozart. L’Orchestre fait corps avec lui comme il le faisait avec Carlo Maria Giulini, longtemps son chef préféré. Comme disait Sergiu Celibidache, autre brucknérien confirmé : « Les concerts sont légions, mais la musique est rare ».
François Lafon

A la Cité de la musique, clôture par le pianiste Pierre-Laurent Aimard du cycle Bach/Kurtag. Six concerts en une semaine, dont un de György Kurtag lui-même au piano avec son épouse Marta. En exergue : « Je ne crois pas littéralement à l’Evangile, mais dans une fugue de Bach, la crucifixion est là, on entend les clous. Je cherche sans cesse, dans la musique, là où l’on enfonce les clous ». Aimard suit Kurtag à la lettre, enchaîne Capricioso-luminoso (Kurtag) et le Caprice sur le départ de son frère bien-aimé BWV 992 (Bach), enfonce comme des coins Versetti et pièces In Memoriam de Kurtag entre canons et ricercars de L’Art de la fugue ou de L’Offrande musicale. Le procédé se justifie, l’alliage se fait, le contemporain n’est pas ridicule face au grand ancêtre. La violence vient du jeu d’Aimard : du piano parfait, une technique sans faille, une puissance intellectuelle implacable, mais l’impression, depuis la salle, que l’interprète est dans sa tour d’ivoire, que l’univers des formes pures est au-delà des contingences du concert. Applaudissements timides. Un antidote, au moins, à la théâtrocratie dénoncée par l’ethnologue Georges Balandier.
François Lafon
Photo © DR

Au Théâtre des Champs-Elysées, débuts de Thomas Zehetmair - violoniste original, chambriste élitiste -, au poste de Chef principal de l’Orchestre de Chambre de Paris. Un va-tout pour cette institution - ex-Ensemble Orchestral de Paris, ex-ex-Ensemble Instrumental de France -, qui n’a jamais vraiment trouvé sa place dans un monde où les ensembles baroques ont annexé le répertoire des orchestres de chambre traditionnels. Un premier concert en forme d’examen de passage : « Dumbarton Oaks » de Stravinsky - concerto pour petit orchestre en référence aux Brandebourgeois de Bach -, la 1ère Symphonie de Mendelssohn - devoir prometteur d’un surdoué de quinze ans -, et le Concerto pour violon de Beethoven. Zehetmair chef fonctionne à l’énergie. Cela va tout seul dans les deux premières pièces, mais se complique dans Beethoven, où il tient aussi la redoutable partie solo. La salle applaudit très fort la prouesse collective.
François Lafon
Paris, Théâtres des Champs-Elysées, 24 septembre
Photo : © JB Millot

A Pleyel, Dvorak et Beethoven par Paavo Järvi et l’Orchestre de Paris. Du premier, les Variations symphoniques (peu connues) et la 8ème Symphonie (un tube). Public ravi, à juste titre, pour ces deux machines à jouer de l’orchestre. Du second, le 3ème Concerto pour piano, avec Rudolf Buchbinder en soliste. Curiosité pour cet artiste respecté, mais qui n’a pas la réputation de déchaîner les foules. Look Vienne éternelle : soixantaine épanouie, brushing inamovible, queue de pie et escarpins de velours. Rien de fantasque dans son jeu : grand son, phrasés naturels, nuances bien placées. Rien de raide non plus, ni d’excessivement sérieux : ce collectionneur d’autographes et de partitions originales joue comme il respire, l’œil heureux et le geste expressif. En bis, il annonce : « Trrranscription Johann Strrrauss », et se lance dans un pot-pourri échevelé de La Chauve-souris. On avait bien remarqué en lui quelque chose qui contredisait le brushing et les escarpins, mais on n’en espérait pas tant. Reste à écouter d’une oreille différente ses innombrables enregistrements.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 19 et 20 septembre, 20h. Photo © DR

A l’Opéra Bastille, quarante-et-unième reprise, cent-soixante-dix-huitième représentation des Noces de Figaro dans la mise en scène de Giorgio Strehler. Un spectacle tout trouvé pour les Journées du Patrimoine. Salle bondée, et pas seulement de nostalgiques ; en découvrant le décor du 3ème acte (la galerie en perspective), un jeune homme lâche : « Ça, c’est génial ! ». Au rideau final, applaudissements nourris pour Humbert Camerlo, assistant de Strehler en 1973, et gardien du temple : c’est lui qui, depuis les années 1990 – époque où le spectacle était si décalé que le metteur en scène et le scénographe Ezio Frigerio avaient fait retirer leurs noms de l’affiche – passe le relais aux chanteurs, génération après génération. Ce soir, l’ensemble est impeccable, comme un vin vieux dont on redécouvre les arômes, et pourtant la tonalité n’est pas la même. Cela tient probablement à la direction enlevée d’Evelino Pido – un spécialiste de Rossini – et à la personnalité d’Alex Esposito, Figaro virevoltant, assez éloigné du jacobin voulu par le metteur en scène. Du coup, le fond « commedia dell’arte » cher à Strehler prend le dessus. Décalage, peut-être, trahison, pas vraiment.
François Lafon
Photo © Opéra de Paris

Reprise, à l’Opéra Garnier, de Capriccio de Richard Strauss, dans la mise en scène de Robert Carsen. Un pendant intimiste des Contes d’Hoffmann selon Carsen à la Bastille. Là aussi, le Palais Garnier est en vedette, mais dans ses murs : cage de scène apparente, foyer de la danse (arrière scène) ouvert, jeu de perspectives incluant la salle, comme si le salon de cette Comtesse hésitant entre un poète et un musicien ne pouvait être que ce théâtre d’opéra où les mots et les notes sont indissociables. Lors de sa création en 2004, le spectacle était un cadeau d’adieu à Hugues Gall terminant son mandat de directeur en même temps qu’un écrin à la voix melliflue de Renée Fleming, sa diva fétiche. Une brillante démonstration de virtuosité. Avec Michaela Kaune - physique alla Schwarzkopf, style straussien accompli, tempérament de comédienne -, avec au pupitre un Philippe Jordan plus à son affaire que jamais, le palais de la Belle au bois dormant se réveille. Et ce Capriccio, traité d'esthétique en forme de conversation musicale créé à Munich en pleine horreur nazie, prend des allures d’ultime signe de civilisation avant la débâcle. Délicieux et effrayant à la fois.
François Lafon
Opéra de Paris, Palais Garnier, 8, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 27 septembre 2012 Photo © Opéra de Paris-Elisa Haberer

Concert, à la salle Pleyel, du Lucerne Festival Academy Orchestra. Public nombreux, malgré le beau temps, et très jeune : Pierre Boulez, créateur et animateur de l’Académie, dirige Philippe Manoury (son élève), Jonathan Harvey (un des pionniers de l’IRCAM) et Arnold Schönberg (son père spirituel). Mais comme à Lucerne vendredi, le maître, « à la suite d’une inflammation soudaine de l’œil », est remplacé par son assistant Clement Power, lequel ne devait diriger que l’œuvre de Harvey. Power, qui a fait travailler les cent-trente étudiants de l’Académie tout au long de la session 2012, a la Boulez touch : gestique économe, précision naturelle. Dans Sound and Fury de Manoury, sorte de bataille rangée orchestrale inspirée de Faulkner (deux groupes de cordes, deux de cuivres, séparées par la petite harmonie et les percussions), le mimétisme est impressionnant. Dans Speakings de Harvey, où « le discours orchestral est touché par les structures du langage » par la magie de la technique IRCAM, c’est à toute une école inspirée et soutenue par Boulez qu’hommage est rendu. La frustration vient avec Erwartung de Schönberg, quand l’orchestre couvre la voix pourtant grande de Deborah Polaski, au lieu de réaliser « l’enregistrement sismographique des chocs traumatiques » ressentis par cette dernière. Un seul chef vous manque…
François Lafon
Photo © DR

Début de saison à l’Opéra Bastille avec Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach dans la mise en scène à grand spectacle de Robert Carsen. Un must maison, maintes fois repris, filmé en 2002 et diffusé en DVD (EuroArts), maintenant emblème de la politique « opéra au cinéma » mise en place par l’Opéra de Paris dans la foulée du MET et de quelques grandes scènes : retransmission en direct le 19 septembre en France (71 salles) et en Europe (167 salles dont 47 en Allemagne), en attendant le Japon, l’Australie, Hong-Kong et les Etats-Unis. Une carte de visite toute trouvée pour le public du bout du monde (ou des salles UGC parisiennes) que cette métaphore géante de l’Opéra de Paris, cet hommage au Palais Garnier - vu de la salle, de la scène, des coulisses, de la fosse d’orchestre - à la mesure du plateau de la Bastille, impensable sur la petite (!?!) scène de Garnier. Quand le rideau se lève au troisième acte sur … la salle de Garnier, avec ses fauteuils rouges dansant au rythme de la Barcarolle, la tête du spectateur chavire. Elle chavire aussi pour les deux Américaines de la distribution - Jane Archibald en Poupée nymphomane (taillée, il y a douze ans, à la mesure de Natalie Dessay) et Kate Aldrich en Muse travestie – et pour la Française Sophie Koch, brûlante en courtisane suppôt du Diable.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille les 7, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28 septembre, 1er, 3 octobre. Photo © Opéra de Paris

La Symphonie liturgique d’Honegger, donnée à La Chaise-Dieu par l’Orchestre national de Lorraine et Jacques Mercier, traite de l’homme face à la divinité, comme souvent chez Bach, mais sans référence explicite à ce dernier. Chez Mendelssohn, ce n’est pas le cas : premier compositeur à s’être confronté, et ce dès l’enfance, aussi bien à Bach qu’à Beethoven, il redonna avec Paulus et Elias ses lettres de noblesse à l’oratorio luthérien, par conviction et aussi grâce à ses liens avec l’Angleterre, pays où se pratiquait assidûment le culte de Haendel. Elias fut créé en anglais à Birmingham et à Londres (1846), puis à titre posthume en allemand à Hambourg (1847). Le festival de Birmingham, qui avait passé la commande, était la grande institution chorale de l’ère victorienne, ce qui fit d’Elias l’une des clés de voûte de l’oratorio romantique, une fresque haute en couleurs, sans chorals étant donné l’origine « Ancien Testament » du livret, mais non sans rapports avec l’opéra. Le chœur d’amateurs et l’orchestre OTrente et leur chef et fondateur Raphaël Pichon souhaitaient depuis quelque temps monter Elias. Il en est résulté un concert mémorable et salué comme tel : ovation spéciale pour la basse Stéphane Degout, interprète d’un rôle-titre aux accents tour à tour farouches, cruels ou pitoyables, faisant du prophète Elie une sorte de cousin de Telramund, voire de Wotan.
Marc Vignal
Abbatiale Saint-Robert, 29 août Photo © DR

Parmi les contemporains de Bach, un des plus grands est Jan Dismas Zelenka (1679-1745), natif de Bohême. Il séjourna à Dresde (comme contrebassiste) et à Vienne, voyagea en Italie, et, à partir de 1719, se fixa définitivement à Dresde, où en 1726 lui fut confiée la supervision des services catholiques mais où en 1729 on lui préféra, pour le poste de maître de chapelle, Johann Adolf Hasse, tenant du goût italien. Sa production relève essentiellement du domaine religieux : grande maîtrise contrapuntique, audacieuses recherches harmoniques. Un des sommets du festival de La Chaise-Dieu a été l’exécution, par l’orchestre baroque Collegium 1704 et l’ensemble vocal Collegium Vocale 1704 menés par leur chef et fondateur Vaclav Luks, de ses Responsoria pro hebdomada sancta (Répons pour la semaine sainte) en trois parties - jeudi, vendredi, samedi - de 1723. Le style théâtral « moderne » s’y mêle à la tradition grégorienne et au contrepoint plus ou moins issu de Palestrina. L’œuvre, de vastes dimensions, était entrecoupée d’un bref Crucifixus de Lotti, que Zelenka connut sans doute, et de pages instrumentales de Haendel et Vivaldi. Le concert prit fin avec le puissant Miserere de 1738 de Zelenka lui-même. La personnalité et les activités de Zelenka restent entourées de mystère, mais on ne peut qu’être saisi par la dimension mystique de sa musique et par son « extraordinaire propension à traduire la souffrance et la mort ». Les auditeurs des Responsoria ne n’y sont pas trompés. (à suivre)
Marc Vignal
Le Puy-en-Velay, église Saint-Pierre des Carmes, 28 août Photo © Célik Erkul

Située sur un plateau granitique de Haute-Loire à 1082 mètres d’altitude, la commune de La Chaise-Dieu est célèbre pour son abbaye du XIVème siècle, construite à l’instigation de Clément VI, pape à Avignon et qui disposait d’une chapelle musicale prestigieuse. On peut admirer dans cette abbatiale Saint-Robert une fresque sur la Danse macabre et des tapisseries comme celle de L’Apparition du Christ à Marie Madeleine. Un jubé sépare le chœur en deux parties : l’une était réservée aux moines, l’autre au peuple. Un festival de musique initié en 1966 par Georges Cziffra se déroule tous les ans en août à La Chaise-Dieu et dans des lieux avoisinants. Trois compositeurs français - Claude Debussy, Gabriel Fauré et Théodore Gouvy - étaient cette année à l’honneur, du 22 août au 2 septembre, mais une grande partie de la programmation s’articulait autour de Bach et de sa Messe en si. A la tête de la Capella Amsterdam et de l’ensemble Il Giardinello, Daniel Reuss - apprécié notamment comme directeur du RIAS Kammerchor de Berlin - a donné de cette œuvre unique une interprétation à la fois sobre et puissante. A la fin des nombreux morceaux où il avait son mot à dire, le chœur faisait montre de surprenantes et très efficaces réserves d’intensité. Trompettes et timbales étaient placés bien en vue à gauche de l’auditoire, et le jeu des timbales, discret mais présent, précis surtout, fascinait. Une belle ouverture avant les Zelenka et autres Mendelssohn des jours suivants. (à suivre)
Marc Vignal
Abbatiale Saint-Robert, 27 août
En haute saison, la basilique de Carcassonne ressemble à un hall de gare où les touristes viennent reprendre haleine après avoir échappé aux odeurs de frites et aux boutiques de fripes, aux armures médiévales fabriquées en RPC et aux reproductions de statues garanties PVC. Un petit tour en écarquillant les yeux pour repérer les traces romanes et les souvenirs gothiques, et puis… Et puis, voilà que des voix s’élèvent comme venues de nulle part, tout le monde s’arrête, le silence se fait. Ténor à la voix pure qui monte jusqu’à la voûte, basse profonde à faire trembler les vitraux, le quatuor (parfois quintette) enchaîne deux chants tirés d’une liturgie orthodoxe russe, puis l’un des chanteurs s’adresse à la foule pour vendre ses CD. Depuis 2005, où il est venu en France animer un marché de Noël, le chœur Doros de Moscou a pris ses habitudes en Languedoc-Rousillon comme en Midi-Pyrénées : concerts çà et là et point fixe à Carcassonne où il commence à faire parti du patrimoine, au même titre que les restaurations de Viollet-le-Duc.
Gérard Pangon

« Allez tonton, on va à Londres. » Myrtille continue son apprentissage. En ce matin de juillet, la Tate Modern d’abord : les citernes de l’ex-centrale thermique devenue musée d’art contemporain viennent d’ouvrir au public. « Regarde, le premier ministre ! » (français) débarque incognito à l’entrée Holland Street (véridique). Dans les « Tanks », L’Art en action. Sung Hwan Kim est un poète - sculpteur de mots, d’images et de sons - artiste inter-disciplinaire majeur. Son remix de Gute Nacht (du Voyage d’hiver de Schubert) vaut à lui seul…le voyage. On quitte Ayrault et Schubert, « Direction Trafalagar Square ! », pas pour le Square, mais pour la National Gallery. Je n’en reviens pas. Ni du choix de la nièce, ni du spectacle à l’entrée du Musée : personne, pas de queue ! A nous le Titien, trois tableaux spécialement réunis, dédiés à Diane et à Actéon – le prince de Thèbes, transformé en cerf puis dévoré par ses chiens pour avoir surpris Diane au bain. En association avec le Royal Opera House, l’événement réunit autour de ces trois chefs d’œuvres huit chorégraphes dont Wayne Mac Grégor, et trois compositeurs dont Mark-Antony Turnage. Chris Offili, Conrad Shawcross et Mark Wallinger ont conçu les décors et les costumes. A spectacular multi art project. Je la vois triturer son smartphone. « Actéon… mars 2013… Opéra de Lille… tu m’y emmèneras ? » Elle ne serait pas un peu snob, la nièce ?
Albéric Lagier
Photo : Diane et Actéon par Lucas Cranach

Paris Quartier d’été pour trois soirs au Théâtre de l’Athénée. A 19h : Sylvie Courvoisier (piano préparé) et Mark Feldman (violon). A 21h : Israel Galvan (danse) et Sylvie Courvoisier (composition et piano). Public calme, estival, venu découvrir, dans ce théâtre habituellement fermé en cette saison, un duo américano-suisse, disciple de l’éclectique John Zorn, et pratiquant une musique savamment indéfinissable : jazz, folk, improvisée, classique. Petit quiz, reconnaître les références et citations : longue variation sur les premières mesures du Concerto à la mémoire d’un ange de Berg, réminiscences de Debussy, Liszt, Paganini et Feldman (l’autre, Morton), tout cela alimentant l’univers ludique et sérieux, pas toujours convaincant mais constamment déroutant, de ce drôle de couple. Une programmation pointue, une sorte de Festival d’Automne en été, une bulle d’art contemporain. A deux pas : l’Olympia assiégé par les fans de Madonna. Un contraste assez parlant en ces temps de subventions en berne et de basses eaux culturelles.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, 26, 27, 28 juillet. Photo © DR

Aux Voûtes, ancienne gare frigorifique à l’ombre de la Grande Bibliothèque, Le Balcon aux Enfers par le collectif Le Balcon, dans le cadre de Paris Quartier d’été 2012. Trois salles, deux compositeurs colombiens (Pedro Garcia Velasquez et Marco Suarez Cifuentes), deux œuvres en kit, pass disponible pour assister en trois soirées aux trois versions du spectacle. Avant l’entracte : Plip, inspiré de José-Luis Borges, pour ensemble, électronique et vidéo. En seconde partie : L’Enfer musical d’Alejandra Pizarnik, poétesse argentine, opéra pour trois lieux, trois chanteuses, trois ensembles sonorisés. Premier soir vu de la Voûte 2 : public prêt à toutes les expériences, atmosphère Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon dans les années 1970. Pénombre, effets acoustiques planants, longues phases d’attente, interprètes imperturbables, plages d’humour à froid. Une jeune fille à une femme plus âgée : « C’est expérimental ». La dame : « On ne se moque pas un peu de nous ? ». La jeune fille : « Le collectif a été adoubé par Pierre Boulez lui-même ». Sous les Voûtes aussi, l’Enfer est pavé de bonnes intentions.
François Lafon
Le Balcon aux Enfers, 19, 20, 21 juillet à 21h. Photo © Jacki Herbet

Ouverture du 28ème Festival de Radio France et Montpellier. Programme tentaculaire à propos, entre autres, de « Musique et pouvoir », thème bien trouvé dans une ville en proie à un bras de fer musclé entre le directeur de l’Opéra et ses équipes. Concerts gratuits ou payants, de chambre ou symphoniques, jeunes solistes ou confirmés, dans les diverses salles du Corum ou les caves vinicoles de l’Aude, œuvres lyriques en scène ou en concert, sessions d’orgue, master-classes, académie d’orchestre, émissions de radio en direct, films sur la musique, cycle autour de l’exposition Caravage, etc. Pas de vedettariat forcené, mais une locomotive en résidence : cette année, Renaud Capuçon. Trois concerts pour la journée d’ouverture. « Jeunes solistes » avec Liya Petrova (« choix » de Capuçon) et David Kadouch : le pianiste se taille la part du lion dans Beethoven (Sonate n° 1 « Le Printemps »), la violoniste reprend du poil de la bête dans Brahms (3ème Sonate). « Musique de chambre » avec Jean-Efflam Bavouzet, qui met la salle (bondée, shorts et tongs) dans sa poche en expliquant que « les Etudes de Debussy, c’est moins rébarbatif qu’il n’y paraît », et en les jouant dans le même esprit après une éblouissante 33ème Sonate de Haydn. « Séquence violon » (traduire : ouverture officielle) le soir avec Brahms (Concerto pour violon, 1ère Symphonie), par Capuçon lui-même et l’Orchestre National de France, handicapés par un chef (David Afkham) un peu vert pour ce répertoire. Juste le temps pour un tour à la demi-expo « Corps et ombres, Caravage et le caravagisme européen » au Musée Fabre (l’autre moitié est au musée des Augustins à Toulouse, seul l’Amérique la verra en une fois) : toiles brûlantes dans une atmosphère à 18°, température nécessaire à leur conservation. Longtemps rendez-vous des (chefs-d’) œuvre(s) oubliés sous l’égide du flamboyant René Koering, compositeur et homme de radio, Montpellier, maintenant dirigé par Jean-Pierre Le Pavec, ambitionne d’être la grande manifestation estivale généraliste, face au festival d’Aix-en-Provence, plus centré sur l’opéra. Il conserve pour l’instant – en dépit de ou grâce à son étiquette Radio France - un parfum régional. C’est peut-être cela qui lui garantit de ne pas perdre son âme.
François Lafon
festivalradiofrancemontpellier.com Photos David Kadouch et Liya Petrova © DR

Aux Bouffes du Nord, Le Bourgeois Gentilhomme de Molière et Lully, mis en scène par Denis Podalydès et dirigé par Christophe Coin. Plus libre que la reconstitution archéologique de Benjamin Lazar et Vincent Dumestre (DVD Alpha), plus fin que la version de Catherine Hiegel avec François Morel cet hiver à la Porte Saint Martin. Podalydès et Coin jouent en funambules le jeu de la comédie-ballet : les comédiens dansent, les chanteurs jouent, les musiciens (sept membres de l’Ensemble Baroque de Limoges) contribuent à faire du délire nobiliaire de Monsieur Jourdain un ballet fou, onirique, cauchemardesque parfois (la cérémonie du Mamamouchi en séance d’humiliation burlesque). Toute la musique est là, même le Ballet des Nations final, qui devient une joute entre les sexes dont les hommes ne sortent pas vainqueurs. Et quand Lully vient à manquer, Delalande, Couperin, Telemann sont appelés en renfort. On comprend d’autant mieux qu’après Le Bourgeois, Lully, brouillé avec Molière, ait inventé l’opéra français. Un spectacle idéal pour la Comédie Française, que le sociétaire Podalydès est allé créer ailleurs. Cherchez l’erreur…
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 21 juillet. Tournée en France jusqu’en 2013. Photo © Victor Pascal

Reprise, à l’Opéra Bastille, de L’Amour des trois oranges de Prokofiev dans la mise en scène de Gilbert Deflo (2005). Le chef Alain Altinoglu fouette l’ensemble, donne vie à ce spectacle tiré au cordeau qui avait laissé un souvenir à la fois brillant et glacé. Comme la salle n’est pas pleine pour les huit représentations prévues, l’Opéra a lancé une opération tarif préférentiel à l’usage des familles. Aux enfants la fable commedia dell’arte inspirée de Carlo Gozzi (1761), aux parents la bombe à retardement qu’est cet opéra qui prédit la mort de l’opéra. Fini le règne des Lyriques et des Comiques, des Tragiques et des Têtes-Vides qui s’opposent au prologue. Ce sont les Ridicules qui mènent le jeu, et le jeu est dangereux. Il ouvre la porte, en 1921, à l’anti-opéra, au contre-opéra, à l’opéra déconstruit du siècle à venir. Dans sa rigueur géométrique, le spectacle montre bien cela, là où d’autres mises en scène privilégient la fête déjà surréaliste, la contestation juvénile de l’opéra de papa.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille, 23, 26, 29 juin, 3, 6, 9, 11, 13 juillet. Photo © Opéra de Paris

A la MC 93 de Bobigny, fin de saison de l’Atelier Lyrique de L’Opéra de Paris avec La Finta Giardiniera de Mozart. Tout au long de l’année, on aura vu les douze jeunes chanteurs du cru 2012 s’essayer aux styles scéniques et musicaux les plus variés, voire les plus antinomiques : mélodies de Liszt, grands airs de Massenet, fragments lyriques de Debussy façon opéra-concept, oratorio de Haendel (La Resurrezione) mis en scène par une disciple de Peter Brook. Succès public, phénomène de mode presque. La Finta Giardiniera met la barre toujours plus haut : sept rôles à haut risque pour un Mozart de dix-huit ans maniant déjà l’ambiguïté suprême : opéra bouffe, comédie sentimentale, parcours initiatique. Code de jeu, sous la direction du metteur en scène Stephen Taylor : jongler avec la tradition. Costumes d’époque, mélange de grand style et de commedia dell’arte. Le chef Guillaume Tourniaire va dans le même sens, aux prises avec un orchestre d’élèves. Voix agiles, peps scénique : la tradition est maîtrisée. On attendait trop, peut-être, qu’elle soit revisitée.
François Lafon
MC 93, Bobigny, les 23, 25, 27, 29 juin

Au moment de la création, Chabrier affirmait que ces Pêcheurs de Perles auraient pu être des pêcheurs de harengs ! Autant dire qu'aujourd'hui, il faut un sacré coup de vent pour leur donner un peu de consistance, et c’est chose faite avec la mise en scène de Yoshi Oida. Loin de l’exotisme à la papa, nous voilà transportés dans un ailleurs inconnu et désolé, de terre ou d’eau peu importe. Mais c’est surtout un véritable coup de baguette magique, du même ordre que celui porté, grâce à sa partition, par Bizet sur un livret de carton pâte. Avec ces choix scéniques, la bluette de palmeraie écrite avec leurs pieds par Cormon et Carré devient définitivement un drame sombre et sensuel. Car tout l’intérêt des Pêcheurs de Perles est dans les tensions qui unissent les trois principaux caractères. André Heyboer (Zurga) est un baryton profond et tout en rondeur, séduisant bien qu’un peu pataud sur scène. Dmitri Korchak (Nadir) a le timbre idéal et la diction parfaite. Qu’il chante moins en force et avec plus d’assurance, et il sera de la trempe d’un Vanzo. Mais la palme revient à Sonya Yoncheva (Leïla), époustouflante de justesse. A côté de ce trio de choc, les chœurs, hélas, ont la diction et l'unisson flous. Les danseurs adorent se « desépauler » en se roulant par terre, mais - qu'ils en soient remerciés - sans que cela ne gêne trop la dramaturgie. Quant à l’Orchestre Philharmonique de Radio France, on aurait simplement préféré qu’il soit, tout comme Dmitri Korchak, plus dans la subtilité que dans l’effet.
Albéric Lagier
Opéra Comique 24, 26, 27 et 28 juin Photo © P. Grosbois

Concert Fête de la musique ce soir sous la pyramide du Louvre, avec l’Orchestre de Paris dirigé par Kristjan Järvi. Musique espagnole ou assimilée : Concerto d’Aranjuez de Rodrigo, Alborada del gracioso de Ravel, Suites du Tricorne de Falla. Hier à Pleyel, même concert, avec en plus la Sinfonia India du Mexicain Carlos Chavez (1936). Un programme grand public à l’usage des amateurs de raretés : étrange la symphonie de Chavez, rythmes et mélodies amérindiens adaptés à l’orchestre symphonique, curieux le Concerto d’Aranjuez transcrit pour harpe par Rodrigo lui-même. Xavier de Maistre, capable de faire avouer à la harpe des possibilités qui échappaient même à Lily Laskine, Kristjan Järvi, aussi débridé que son frère Paavo est réfléchi, mettent le feu à l’orchestre : en bis, la Danse du feu de L’Amour sorcier (toujours Falla) fait un tabac. Il y a décidément du Bernstein chez Järvi frère. Amenez les néophytes : il les emmènera au bout du monde.
François Lafon
Pyramide du Louvre, 21 juin, 22h.

Au théâtre de l’Athénée, L’Histoire du soldat de Stravinsky et Charles-Ferdinand Ramuz, dans une mise en scène de Jean-Christophe Saïs. Un faux cadeau que cette fable faussement naïve – musique de foire et morale biaisée – où l’on voit un pauvre soldat vendre son âme au Diable. Sans insister sur l’aspect théâtre de tréteaux de ce chef-d’œuvre des temps de disette (écrit pendant la Grande Guerre, créé à Lausanne en 1918), Saïs tourne le problème en suivant Stravinsky à la lettre (« J’ai toujours eu horreur d’écouter la musique les yeux fermés ») et se rappelle que l’âme du soldat est un petit violon : dans son spectacle, le Diable est chef d’orchestre (Laurent Cuniot) et les instrumentistes mènent la danse. Tout est étrange et tout est évident : Soldat funambule, Princesse danseuse et Narrateur Monsieur Loyal, pluie d’or, livre qui vole et violon escamoté. Les musiciens (Ensemble TM+) sont impeccables, les acteurs virtuoses. Produit par l’Arcal - qui depuis trente ans emmène l’art lyrique là où on ne l’attend pas -, créé l’année dernière à Reims, le spectacle poursuit sa tournée. Les enfants s’amusent, les parents ont froid dans le dos. Du bonheur pour tout le monde, en somme.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 22 juin. Photo © Enrico Bartolucci

Dernier nouveau spectacle de la saison à l’Opéra Bastille : Arabella de Richard Strauss et Hugo von Hofmannsthal. Un Strauss de second rayon, un Chevalier à la rose vingt ans après (1933), marqué par la guerre, la dépression, la fin d’un monde. On y voit des nobles ruinés, essayant de vendre leur fille au plus offrant, le tout sur un rythme de valse évoquant davantage celle, déréglée, de Ravel que celles, triomphantes, de l’autre Strauss (Johann). Excès de sentiments sur fond de crise : à peine besoin de transposer. On imagine ce qu’en auraient fait un Michael Haneke, un Christoph Marthaler. Le metteur en scène Marco Arturo Marelli ne tient pas compte de tout cela. Son spectacle est bleu pastel, un peu froid, pas trop mièvre. Tout est organisé autour de la star Renée Fleming, voix de miel parcimonieusement dispensée, silhouette irréprochable. Pour la servir, des comparses sans aspérités, un orchestre discret (Philippe Jordan). Comme si cet opéra dérangeant ne devait pas déranger.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille, 14, 17, 20, 24, 27, 30 juin, 4, 7, 10 juillet

Au Palais Garnier, Hippolyte et Aricie de Rameau dans une présentation empruntée au Capitole de Toulouse, la production de Jean-Marie Villégier (1996) ayant depuis longtemps été déclassée (c'est-à-dire envoyée à la casse). Le metteur en scène Ivan Alexandre, surtout connu comme journaliste, déclare « n’avoir souhaité faire ni transposition ni reconstitution historique, mais plutôt inviter à un songe en cherchant l’unité sans doute utopique, entre le verbe, le son, l’esprit et l’image. » Mission accomplie. Tout, dans son spectacle, n’est que ronds de jambes et perruques poudrées, toiles peintes et robes à panier. Pas une faute de goût ni d’analyse : en devenant tragédie lyrique, Phèdre abandonne l’ascétisme racinien, et prend le temps de danser comme on le faisait à la cour. Les chanteurs, impeccables et corsetés, le chef Emmanuelle Haïm, qui fait passer la grâce avant la fougue, participent de ce moment d’élégance ancien régime. A l’entracte, un pianiste qui n’ignore rien de la musique française explique que pour une fois, le spectacle ne l’empêche pas d’écouter la musique. Un confrère du metteur en scène (c'est-à-dire un critique) rétorque qu’avec Villégier la tragédie - toute lyrique qu’elle fût - était plus tragique. Le public, qui ovationne le spectacle, est du côté du pianiste : tragédie peut-être, mais lyrique avant tout. On n’en sortira jamais !
François Lafon
Opéra National de Paris, Palais Garnier, 9, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29 juin, 1er, 4, 7 9 juillet Photo © Opéra de Paris

Quand on parle d’un seul souffle de Carl Philipp Emanuel Bach et Haydn, il y a de grandes chances que ce soit à propos de leurs sonates pour clavier. Oui, Haydn découvrit et joua lui-même les sonates d’Emanuel, mais ce fut plus tard qu’on ne le crut longtemps. Oui, certaines de ses sonates s’inspirent plus ou moins de celles de son aîné, mais seulement aux alentours de 1770, pas dès ses débuts. Quand en 1784 un journal anglais prétendit que Haydn, dans certaines de ses sonates, non seulement plagiait Emanuel mais surtout se moquait de lui, le musicien d’Eszterhaza n’en sut rien et celui de Hambourg, l’ayant appris, prit sa défense et lui témoigna par écrit son estime. Dans un récital de pianoforte, Mathieu Dupouy a réuni les deux compositeurs. Les premières pièces du programme - le rondo Wq.61/1 et la sonate Wq.61/2 du dernier recueil « pour connaisseurs et amateurs » d’Emanuel et la sonate en ré n°56 (Hob.XVI.42) de Haydn - ont mis en évidence leurs façons différentes d’aborder l’improvisation : plutôt débridée chez l’un, sans perdre de vue l’architecture chez l’autre, mais avec des effets de surprise d’autant plus marqués. Suivaient deux œuvres tardives de Haydn : la sonate en ut n°60 (Hob.XVI.50) et les célèbres variation en fa mineur. On était dans un autre monde, plus question d’Emanuel. Reste que cette expérience intéressante mérite d’être poursuivie, bien des œuvres de l’un et de l’autre s’y prêteraient volontiers.
Marc Vignal
Reid Hall, Paris. 2 juin 2012

Ouverture, à la salle Pleyel, de Manifeste 2012, le nouveau festival-académie de l’Ircam. Tout le milieu de la « contemporaine » est là pour la première mondiale, par l’Orchestre de Paris, d’Echo-Diamodon, concerto pour piano, orchestre et électronique en temps réel de Philippe Manoury. Programme équilibré : Atmosphères et Lontano, deux des pièces les plus planantes de György Ligeti, encadrent le Concerto, le tout se terminant par l’Adagio de la 10ème Symphonie de Mahler. La technique Ircam aidant, Manoury a imaginé un scénario shakespearien : « Quatre pianos fantômes viennent hanter le soliste et prendre progressivement possession de lui. » La maîtrise et la virtuosité de Jean-Frédéric Neuburger décuplent l’impression de rêve glacé. C’est très brillant, très savant. Après l’entracte, quand s’éteint Lontano - « nuages bleus, rayon doré du soleil couchant qui transparaît au travers » - utilisé par Stanley Kubrick dans Shining, le chef Ingo Metzmacher suspend son geste, et enchaîne sur l’Adagio de Mahler, lequel sonne plus que jamais comme un adieu à tout un monde déjà lointain. Un de ces moments qui comptent dans une vie de mélomane.
François Lafon
Manifeste 2012, festival et académie. Du 1er juin au 1er juillet. www.ircam.fr. 01 44 78 12 40 Photo : Ph. Manoury © Ircam

Au Châtelet, Pop’pea, opéra video-pop d’après Le Couronnement de Poppée de Monteverdi. Troisième des sept représentations programmées, salle pas tout à fait pleine : les rockeux se méfient, les baroqueux aussi. Le pari était risqué : appliquer les canons de l’opéra rock à un chef-d’œuvre shakespearien, prototype d’un théâtre musical que l’opéra mettra trois siècles à retrouver. Et cela marche : dramaturgie ingénieuse (Ian Burton), réalisation scénique inventive (Giorgio Barberio Corsetti et Pierrick Sorin, à qui l’on doit sur la même scène une Pietra del Paragone de Rossini tout en effets spéciaux et incrustations vidéo), tenues high-tech (Nicola Formichetti, costumier de Lady Gaga). Résultat musical acrobatique : mariage habile du rock, de l’électro et de Monteverdi - dont les rythmes et mélodies hantent l’ensemble -, distribution panachée, avec chanteurs rock (Carl Barât, Néron tueur cool et fou), diva dévoyée (Valérie Gabail, Poppée façon Madonna), star inattendue (Benjamin Biolay en cocu magnifique). Tout cela à la fois kitsch et chic. Les rockeux ne sont pas volés, les baroqueux non plus : pour une fois que musique et représentation scénique vont dans le même sens…
François Lafon
Châtelet, Paris, 29, 30, 31 mai, 2, 3, 5, 7 juin Photo © Marie-Noëlle Robert - Théâtre du Châtelet

Avec Rodolphe Kreutzer (dédicataire d’une célèbre sonate) et Pierre Rode, Pierre Baillot (1771-1842) domina l’école française de violon au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Tous trois étaient élèves ou disciples de Viotti. Un des titres de gloire de Baillot fut d’avoir organisé à partir de 1814 des concerts de quatuors qui familiarisèrent les Parisiens avec Haydn, Mozart et Beethoven, mais aussi Boccherini et plus tard Cherubini. On pouvait s’attendre à ce qu’un nouveau quatuor prît enfin le nom de Baillot : c’est fait. Pour un de ses tout premiers concerts, cette jeune formation a joué, dans l’ordre, Boccherini (quatuor en si mineur opus 58 n°2 de 1799), Schubert (quatuor en mi bémol majeur D.87 de 1813) et Haydn (quatuor en sol majeur opus 33 n°5 de 1781). On ne peut que féliciter les membres du Quatuor Baillot d’avoir mis Haydn en fin de programme et non au début, comme ils l’avaient envisagé à l’origine et comme on le fait trop souvent en attendant les choses « sérieuses ». L’ouvrage de Haydn, par son écriture même, par ses sonorités tour à tour compactes et aériennes, était en l’occurrence celui permettant le mieux de se faire une idée des interprètes (Hélène Schmitt, Xavier Julien-Laferrière, Reyner Guerrero et Karine Jean-Baptiste), et c’est dans cette partition de maturité qu’ils se sont révélés les plus convaincants, par delà les séductions de Boccherini et surtout de Schubert.
Marc Vignal
Cité Universitaire (Paris), Maison du Portugal. 30 mai 2012

Reprise à l’Opéra Bastille du Barbier de Séville, efficacement transporté par Coline Serreau au pays (et dans l’imagerie) du grand vizir Iznogoud, où les femmes sont encore assignées à résidence. Plateau de rossiniens aguerris (Karine Deshayes, Maurizio Muraro), chef fonctionnel (Marco Amiliato, « Mr Opéra italien » au MET de New York) pour ce spectacle qui a beaucoup servi depuis sa création en 2002. Le ténor Antonino Siragusa est plus buffo que gracioso dans le rôle du comte Almaviva qu’il promène dans le monde entier. Pendant le rondo « Cessa di piu resistere » - scène à haut risque souvent coupée - il arrache son caftan et apparaît en maillot de foot n° 10 (celui de Zidane) tandis que les choristes agitent des drapeaux français et italiens. Tonnerre d’applaudissements couvrant la voix du chanteur, lequel s’épargne les aigus les plus dangereux. Succès pour Coline Serreau au rideau final. En parsemant la Manon de Massenet de facéties de ce style, elle a déclenché cet hiver un concert de sifflets. « On peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui », disait Pierre Desproges.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, 26, 29 mai, 1er, 4, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 juin, 2 juillet. Photo © Opéra de Paris

A l’Opéra Bastille, concert de l’Orchestre de l’Opéra de Paris dirigé par Philippe Jordan. Le programme initialement prévu célébrait les beaux jours : Im Sommerwind de Webern, les Nuits d’été de Berlioz, Le Sacre du printemps de Stravinsky. Mais le projet d’un enregistrement live (Naïve) a déplacé le propos : c’est de danse qu’il est maintenant question, à travers des œuvres créées à Paris. Le Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy remplace le poème symphonique de Webern, les Nuits d’été restent au programme, mais ne figureront pas sur le disque. Le public, hors sérail, plus jeune que d’habitude, applaudit Waltraud Meier entre chaque Nuit d’été : « Honte à vous ! », hurle du balcon une dame probablement très sérail. Jordan affine son style, battue souple, main de fer dans un gant de velours : Debussy et Berlioz (que la diva, retenant sa grande voix, chante dans un esprit « musique de chambre ») s’en portent bien, Le Sacre aussi, du coup plus félin que sauvage. « Et maintenant, un petit bis, annonce le chef : le Boléro de Ravel ». Orchestre déchaîné, standing ovation. Le voilà, le troisième volet du disque. A quoi tiennent les divines surprises...
François Lafon
Photo © DR
A l’Opéra Comique, création de Re Orso, premier opéra scénique (après deux opéras radiophoniques) de Marco Stroppa. Le livret, tiré d’un poème surréaliste avant la lettre d’Arrigo Boito (le dernier librettiste de Verdi) raconte l’histoire d’Orso (Ours), un despote monstrueux - mi-Richard III mi-Ubu - harcelé par la voix d’un Ver qui lui reproche ses crimes. C’est ce qu’on comprend en lisant le programme et les surtitres, parce que le spectacle, mis en images esthétiques (genre Twilight) par le metteur en scène Richard Brunel, est plutôt abstrait. La musique - inventive, assez éclatante même, mais truffé de formules rebattues - n’aide que partiellement à s’y retrouver dans cette fable simpliste dans son propos et complexe dans son expression, si ce n’est que dans la seconde partie (la mort d’Orso rongé par son Ver) les instrumentistes de l’Ensemble Intercontemporain, dirigés par leur directrice Susanna Mälkki, laissent la place aux voix et sons imaginaires de la technique IRCAM, dont Stroppa a été l’un des pionniers. « Le livret montre comment le théâtre social construit par le Roi Ours et le théâtre produit par son inconscient prennent la dimension universelle d’un théâtre du monde », expliquent Richard Brunel et la dramaturge Catherine Allioud-Nicolas. Comme si, encore une fois, complexité était synonyme de modernité.
François Lafon
Opéra Comique, Paris, 19, 21, 22 mai

Au Théâtre de la Colline, Des Arbres à abattre, tiré du roman de Thomas Bernhard. Une soirée infernale, où l’auteur, ancien élève du Mozarteum de Salzbourg, accepte de revoir, vingt ans après, un couple de Verdurin-artistes-viennois, elle chanteuse, lui compositeur « dans la lignée de Webern ». Dans le box des accusés : l’Autriche, ses intellectuels, ses acteurs, ses musiciens. L’assemblée s’était retrouvée, l’après-midi même, pour l’enterrement d’une amie dissidente, au son du Boléro de Ravel. Le champagne aidant, le débat s’envenime : le narrateur se rappelle la Mort de Didon (Purcell) chanté autrefois pas l’hôtesse, mais c’est maintenant Pierrot Lunaire que celle-ci place dans la conversation, entre deux citations de Wittgenstein. Quand son mari craque, il se met au piano : Webern (à moins que ce ne soit sa propre musique) mais aussi Schumann. Lors de la parution du roman, en 1984, un obscur compositeur viennois, Gerhard Lampersberg, a porté plainte pour diffamation. C’est Bernhardt qui a gagné le procès. Ni dans le programme, ni dans le dossier dramaturgique, ni dans la présentation de presse (visible sur Internet), Célie Pauthe et Claude Duparfait, les adaptateurs et metteur en scène, n’insistent sur l’aspect musical de l’œuvre, pourtant très présent dans leur (excellent) spectacle. Différence entre Vienne et Paris ? On n’en admire pas moins la virtuosité de François Loriquet (l’hôte compositeur), aussi habile comme comédien que comme pianiste.
François Lafon
Théâtre National de La Colline, Paris, petite salle, jusqu’au 15 juin. Photo © E. Carrechio

Sous les voûtes du collège des Bernardins (Paris), Alterminimalistes 9 Meredith Monk, la voix intérieure, dans le cadre de « Questions d’artistes ». Nef bondée, public très jeune pour la grande prêtresse de la contre-culture américaine des années 1970, contemporaine de Steve Reich et de Phil Glass, inspiratrice de Bob Wilson aussi bien que de Björk. Première partie : musique pour voix seule (1977-1994). Chants indiens, rythmes yankees, travail sur le souffle, la gorge, le nez, les harmoniques, recherche d’une expression primordiale, à la fois naïve et savante. Seconde partie, musique pour voix et piano (1975-2008). Même invention vocale, mais parasitée par les cellules répétitives, très datées, du piano. Meredith Monk, soixante-dix ans, fascine les enfants, voire les petits-enfants de ses premiers fans. Besoin de retour aux sources dans un monde qui nous dépasse ? Après le concert, discussion avec le philosophe et théologien Antoine Guggenheim : « Les liens entre musique et spiritualité ». Le flower people cherchait la réponse dans les paradis artificiels. Rue de Poissy, devant les Bernardins, légère odeur d’herbe au milieu des fumées de cigarettes.
François Lafon
Collège des Bernardins, 16 mai. Meredith Monk & Vocal Ensemble en Quartet, Auditorium du Louvre, 18 mai.

En 1953, Jacques Prévert acheva un court et onirique livret, L'opéra de la Lune. Ce fils du surréalisme a toujours voué un culte à Séléné, le Baptiste des Enfants du paradis l'atteste. Dans L'opéra de la Lune, commandé au compositeur Brice Pauset par l'Opéra de Dijon, un enfant délaissé sur Terre est transporté en téléférique sur la Lune, seul endroit où il est libre. Sur cette Lune (sans économie marchande), trône un opéra où chacun est à la fois spectateur et acteur, où la salle est un espace sans mur ni fosse. En écho à Prévert qui aimait trop les enfants pour bêtifier avec eux, Pauset reste lui-même. Résultat : une belle réussite dans un genre où les réussites sont rares. On entend çà et là d'élégantes orchestrations des Scènes d'enfants de Schumann, An der Mond (À la Lune) de Himmel, des lieder de Reichardt, Schubert et Zelter. Loin de rompre l'atmosphère, ces emprunts renforcent la douce mélancolie que la mise en scène de Damien Caille-Perret, la direction précise du compositeur et une équipe d'interprètes engagés, parmi lesquels Luanda Siqueira et Vincent Deliau, rendent fidèlement.
Frank Langlois
Opéra de Dijon, les 12, 14, 15 mai Photo © J.L. Tardivon

Aux Bouffes du Nord, Andreas Staier joue les Variations Diabelli de Beethoven. Le pianoforte – copie d’un Conrad Graf de l’époque – se détache en rouge profond sur le rouge patiné des murs. Le son est à l’avenant, net et enveloppé. C’est là toute la différence avec l’enregistrement qui vient de paraître, capté de près, surexposant le jeu très contrasté de l’artiste. Staier au public : « Je suis Allemand, donc, euh, très précis, mais je ne vous expliquerai pas la fonction des cinq pédales de l’instrument ; vous entendrez vous-même. » Au programme du disque (dix variations sur la valse de Diabelli par les musiciens viennois de l’époque, suivies des trente-trois de Beethoven sur ladite valse), il a ajouté les Bagatelles op. 26, testament de Beethoven au clavier. Murmures ravis de la salle, applaudissements même aux effets de harpe ou de percussions, silence recueilli après les énigmatiques dernières notes du chef-d’oeuvre. Staier n’a pas son pareil pour nous faire oublier que Beethoven était le premier à pester contre les instruments de son temps, impuissants selon lui à traduire sa musique intérieure.
François Lafon

Débat Mise en scène d’opéra, pourquoi faire ? au Palais Brongniart, dans le cadre du salon Musicora. Spectacle intemporel sublimé par la musique ou matériau dialectique permettant de mieux comprendre notre époque ? De gauche à droite autour de François Lafon : Philippe Beaussant, auteur du livre La Malscène (Fayard), la dramaturge Leyli Daryoush, le chef d’orchestre Louis Langrée et Christian Schirm, directeur de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris. Une heure et demie de passes d’armes à fleurets non mouchetés, interventions du public. Conclusion : opéra pas mort (loin de là). Diffusé en direct sur Medici.tv, le débat est disponible en VOD.

Reprise au Théâtre de l’Athénée, de Nietzsche/Wagner : le Ring, l’étonnant spectacle d’Alain Bézu, créé fin 2010 à Reims. Tout est dans le titre : sur le ring, deux génies qui furent amis s’affrontent par Ring (des Nibelungen) interposé. Aux déclarations d’amour/haine du philosophe, personnifié par l’acteur François Clavier, répondent trois jeunes chanteurs et un orchestre répétant quelques scènes clés de La Tétralogie. Une sorte de jeu de l’envers selon l’écrivain Antonio Tabucchi (« Le fait de m'être un jour aperçu, à cause des imprévisibles événements qui régissent notre vie, que quelque chose qui était "ainsi" était pourtant autrement »). En un an et demi, le spectacle a évolué. Il est moins pédagogique, moins ironique (disparition de la savoureuse explication au tableau noir de la généalogie des dieux), comme pour mieux répondre à la question essentielle : dans quelle mesure toute cette histoire nous parle de nous ? Les chanteurs sont valeureux - à commencer par Paul Gaugler, Siegfried tel qu’on le rêve -, et le chef Dominique Debart discipline efficacement l’Orchestre Lamoureux en « formation Siegfried-Idyll » (vingt-deux musiciens). Plus excitant, en tout cas, que le scolaire Ring Saga donné à la rentrée dernière à la Cité de la Musique.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 11 mai. Rencontre avec l’équipe le 9 mai à 19h à la Médiathèque Musicale de Paris (Forum des Halles) Photo © M. Berthaume

A l’Amphithéâtre Bastille, L’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris donne La Resurrezione, premier oratorio de Haendel (1708), mis en scène par un(e) disciple de Peter Brook, Lilo Baur. Espace brookien : du sable, des roseaux, pas d’accessoires ou presque, des costumes intemporels. Salle comble, au-delà de la jauge : une dame apostrophe le chef Paul Agnew, reprochant à l’orchestre d’occuper une partie des gradins. L’œuvre est recueillie : style vocal orné, mais pas de fugue monumentale, ni de grand choeur façon Messie. A Rome, le jeune Haendel imite les anciens pour raconter la deuxième nuit après la Crucifixion. Agnew-chef mène ses troupes - à commencer par les étudiants de la classe de musique ancienne du Conservatoire - avec l’élégance et la précision que l’on reconnaît à Agnew-ténor, et les stagiaires de l’Atelier, toutes promotions confondues, se livrent à un travail de haute école : pyrotechnie vocale et maîtrise de cet « espace vide » (concept brookien par excellence) où le public est à portée de main. Et même s’il s’agit-là de Brook sans Brook dans un lieu qui n’a pas la magie des Bouffes du Nord, le côté En attendant Godot de l’œuvre apparaît comme il ne le fera jamais en version de concert.
François Lafon
Amphithéâtre Bastille, 30 avril, 2, 4 et 6 mai Photo © DR

Après Philippe Herreweghe le mois dernier avec son Orchestre des Champs-Elysées, Christoph Eschenbach dirige l’Orchestre de Paris dans les trois dernières Symphonies de Mozart. Trois chefs-d’œuvre composés en six semaines (juillet-août 1788) par un génie dans le creux de la vague (l’empereur a détesté Don Giovanni), tout cela pour la beauté du geste (on s’est longtemps demandé s’il les avait entendu jouer) : le concept se tient. Pour l’orchestre et le chef, en tout cas, une gageure : trois fois quarante minutes de travail au petit point, avec l’obligation de bien montrer que Mozart livre là trois versions de la vie, aussi différentes dans leur atmosphère que dans leur architecture. Comme cadeau de retrouvailles avec son ancien chef titulaire, l’orchestre offre ses plus belles sonorités : quels bois, quelles cordes ! Comme à son habitude, Eschenbach soigne le détail et traite en romantique une musique qui ne l’est pas encore. Et pourtant, à certains moments, on jurerait qu’il a écouté Herreweghe.
François Lafon
Paris, Salle Pleyel, 25 et 26 avril.

A la Cité de la Musique, concert Folk Songs de l’Ensemble Intercontemporain. Pas de création mondiale, public d’habitués. Le thème, musiques savantes et racines ancestrales : Sirene Song de Lu Wang, (translittération d’un ancien dialecte de Xi’an), Palimpseste de Marc-André Dalbavie (sur un madrigal de Gesualdo), les Huit miniatures et le Concertino de Stravinsky (versions pour petit ensemble), les Trois Poèmes de Mallarmé de Ravel (ensemble réduit, là encore, en opposition aux lourdes orchestrations de l’époque), les Folk Songs façon Luciano Berio. La mezzo Nora Gubisch (photo) ne cherche pas à imiter l’inimitable Cathy Berberian (Madame Berio). Au pupitre : Alain Altinoglu, chef éclectique, très à l’aise dans ces joyaux plus ou moins précieux, rescapé du Faust de l’Opéra Bastille, s’apprêtant à diriger la Salomé de Florent Schmitt avec l’Orchestre de Paris (16 mai), au piano dans un CD Ravel avec Nora Gubisch (Naïve). Entre deux Miniatures de Stravinsky, un portable sonne. Le chef se retourne. « Allez biloute ! », crie quelqu’un. Un folk song à orchestrer ?
François Lafon

Schubertiade, dans le théâtre pompéien-1830 du Conservatoire d’art dramatique de Paris. Lieu historique, à l’acoustique unique, rendu depuis 2005 à la musique grâce à l’excellente série Les Pianissimes. Trois produits du Conservatoire (celui de musique) de vingt-deux à vingt-cinq ans, déjà bardés de prix internationaux. Adam Laloum, suivi par les pianomaniaques de la Folle Journée à La Roque-d’Anthéron, maîtrise les sublimes errances de la 18ème Sonate (sol majeur), avec ce petit quelque chose en plus qui annonce les grands interprètes. Avec Mi-Sa Yang (violon) et Victor Julien-Lafferière (violoncelle) : 2ème Trio op. 100 (celui de Barry Lindon). Etat de grâce, standing ovation. Verre-cacahuètes offert après le concert (signature des Pianissimes). « Qui aura-t-on à la Culture ? » demande un décideur. Depuis deux heures, la campagne paraissait si loin…
François Lafon
www.lespianissimes.com

Myrtille a 16 ans. Elle est de Savoie. De n’importe quelle Savoie, une bourgade comme il y en a tant entre le lac de Genève et Annemasse. Pour son anniversaire, un week-end à Paris chez son oncle. Samedi, un trou dans le programme. Et voilà qu’elle sort du Pariscope « Œuvres de Haydn, 16h30, Saint Vincent de Paul », parce que ça colle juste entre la tour Eiffel (à 14h00) et Battle Ship (en VF au Grand Rex à 18h40, arghhh)… Je me console : elle aurait pu choisir Les Saisons de Vivaldi à la Sainte-Chapelle ! Bon oncle, me voici cheminant avec elle vers la seule église de Paris qui me fasse sourire (c’est elle que l’Oncle Gabriel confond avec le Panthéon dans Zazie dans le Métro). A l’arrivée, première surprise, les « œuvres de Haydn » sont Les Sept dernières paroles du Christ. A l’intérieur, seconde surprise, le quatuor Antarès , peu connu et délaissé de la critique, entame ce chef d’œuvre et la magie opère. Une interprétation fervente et impeccable, une sonorité ronde et amplifiée par la réverbération de l’église, la proximité des interprètes, les jeux de la lumière naturelle, l’attention non feinte du public. .. Après une heure de béatitude, Myrtille dit bravo. Moi aussi. J’ai (re-)découvert qu’entre la Tour Eiffel et Le Grand Rex, il n’y a pas que le Théâtre des Champs-Elysées, et qu’en cette période électorale, la démocratie a un sens.
Albéric Lagier

A l’Opéra Bastille, Cav et Pag (Cavalleria Rusticana de Mascagni et Pagliacci de Leoncavallo). Quand Cav se termine, on se dit que le plus dur est fait, que Pag, c’est moins ennuyeux, moins sommaire, voire moins bruyant. Quand Pag est fini, on regretterait Cav si l’on n’était aussi heureux que tout cela soit terminé. Après, on se raisonne : ces deux brefs opéras jumeaux (1890-1892), prototypes du courant vériste qui avait déjà envahi la littérature italienne, ont un intérêt historique, mais aussi sociologique (le petit peuple en vedette) et musical (mélodies faciles et débordements vocaux). Dans la mise en scène de Giancarlo Del Monaco, importée de Madrid, l’accent est mis sur le carcan religieux (Cav) et la tranche de vie façon néo-réaliste (Pag). L’orchestre file droit, tenu par le spécialiste Daniel Oren, et les chanteurs font du son, encouragés par la vastitude du lieu. Le spectacle fait partie du cycle « un opéra italien mal aimé par saison » initié par le directeur Nicolas Joël. Le public applaudit fort. Décibels et passion fruste : « Nous sommes des êtres de chair et de sang, et tout autant que vous de ce monde orphelin nous respirons l’air », dit le prologue de Pag. Pour beaucoup, c’est ça, l’opéra.
François Lafon
Opéra de Paris, Bastille, 17, 20, 23, 26, 28 avril, 2, 6, 11 mai. Photo © DR : Pagliacci

A Pleyel, entre deux étapes de son cycle Schubert avec Christoph Eschenbach au piano, Matthias Goerne panache des lieder orchestrés de Schubert et Strauss avec Paavo Järvi et l’Orchestre de Paris. Des objets un peu kitsch destinés en leur temps à populariser un art pour happy few, les orchestrations fussent-elles signées Brahms ou Webern (pour Schubert) ou Strauss lui-même. Souriant, Goerne a l’air plus détendu qu‘avant d’attaquer Le Voyage d’hiver ou La Belle Meunière. Fausse impression : piano, pianissimo, il reste dans la confidence. Pas d’effets de voix, ou seulement guidés par le texte. Du coup, l’orchestre se fait discret lui aussi. Qui, depuis Dietrich Fischer-Dieskau (mais en moins sophistiqué, en moins fabriqué), est capable d’un tel prodige ? En bis, un An die Musik (Schubert, orchestration Max Reger) d’anthologie. En début et fin de concert, Schumann : l’ouverture de Manfred réorchestrée par Mahler (on reste dans le ton) et la 1ère Symphonie « du Printemps ». Honnêtes exécutions, mais la magie est partie.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, les 11 et 12 avril. Photo © DR

Au Châtelet, nouvelle production signée Chen Shi-Zheng de Nixon in China, l’opéra de John Adams donné pour la première fois en France en 1991 dans la mise en scène de Peter Sellars. A l’hyperréalisme de l’Américain répond l’abstraction « pop art de l’après-Révolution culturelle » du Chinois (qui vit aux USA depuis 1987) et de sa décoratrice Shilpa Gupta. « Lors de la création de l’opéra aux Etats-Unis, explique celui-ci, Nixon était décrit comme le pire président américain de l’histoire, mais pour ma génération, en Chine, c’est encore un héros ». L’œuvre, de toute façon, renvoie dos à dos les deux univers qui se rencontrent lors de cette visite « historique » de Nixon à Mao en 1972. Ce curieux opéra, trop long, bizarrement fichu (d’acte en acte, le vernis officiel craque, pour laisser les grands de ce monde égarés face à eux-mêmes, tandis que Zhou Enlai cède au doute), tombe à pic dans le contexte actuel. La musique de John Adams première manière – de somptueuses draperies orchestrales sur des rythmes répétés à l’infini – ajoute elle-même à la vacuité du discours des politiques. Un discours fort bien chanté, avec les belcantistes June Anderson et Sumi Jo en épouses présidentielles. Comme quoi, quand il le veut, l’opéra peut parler au présent (ou presque).
François Lafon
Châtelet, Paris, les 10, 12, 14, 16, 18 avril Photo © DR

Fondée sur un événement historique – la révolte du peuple napolitain contre le vice-roi espagnol - La Muette de Portici enflamma la Belgique lors d’une représentation à Bruxelles en août 1830, au point de mener le pays à l’indépendance. La Muette eut un succès continu au XIXème siècle, avant de tomber dans l’oubli au XXème. Elle reste néanmoins connue pour son ouverture (très rossinienne) et le duo célèbre, cet « Amour sacré de la Patrie » dont se sont emparés les Belges. Pourtant Aubert, compositeur au style très personnel, Rossini français qui n’aurait pas oublié son Gluck, y déploie ses talents de mélodiste, et deux airs fleuve. Mais, hélas, ce soir-là, certains interprètes n’étaient pas au mieux, même si, dans son ensemble, la distribution rend honneur au livret de Scribe (et Delavigne) par une diction soignée et une prononciation justement expressive. L’autre difficulté de la Muette, c’est elle, ce rôle muet, dansé et mimé. L’actrice Elena Borgoni occupe la scène, mais au prix d’agitations qui peuvent fatiguer, jusqu’au très beau tableau final en vierge napolitaine aux allures de Frida Kahlo. La très classique mise en scène d’Emma Dante donne une cohérence remarquable aux chants, aux danses, aux mouvements de foule, servie par une mise en lumière et des costumes qui font de cette production un spectacle complet. Quoiqu’il soit coproduit avec la Monnaie de Bruxelles, les Belges devront attendre 2015 pour le voir : est-ce par crainte que cette grande Muette dénoue aujourd’hui ce qu’elle avait initié en 1830 ?
Albéric Lagier
Paris, Opéra-Comique 9, 11, 13 et 15 avril Photo © DR

A l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille, premier tableau de l’acte III des Maîtres Chanteurs de Nuremberg (1 h 20 de musique), tel qu’il a été créé au Palais Garnier en 1897, dans la traduction française d’Alfred Ernst. Un projet risqué mené par deux chercheurs, Aurélien Poitevin et Rémy Campos. Le décor en trompe-l’œil, les costumes Renaissance sont comme à l’époque, et les chanteurs respectent la rhétorique gestuelle qui a prévalu à l’opéra (et chez les politiques, lesquels imitaient les artistes) jusqu’à ce que les metteurs en scène de théâtre viennent tout chambouler. Seul manque l’orchestre (sur instruments d’époque ?), remplacé par un piano (moderne). Dépaysement garanti, mais pas autant qu’on pourrait l’espérer. Sans démériter (Didier Henry est très émouvant en Hans Sachs), les interprètes sont désespérément de notre temps. On imagine les créateurs plus « monstres sacrés », plus « en représentation », maniant la déclamation française sans se soucier d’une version originale que le public n’avait de toute façon pas dans l’oreille. Pourquoi alors ce « à la manière de… » ? Pour retrouver l’innocence originelle, pour montrer que la fidélité à la lettre - même un siècle après - révèle mieux l’esprit d’une œuvre que nos actuelles relectures ? Les maîtres d’œuvre viennent de sortir un gros livre intitulé La Scène lyrique autour de 1900. A suivre dans Musikzen.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, Amphithéâtre, 30 et 31 mars à 20h. Photo © DR

Lo Speziale aux Athévains, Orlando Paladino au Châtelet, maintenant Il Mondo della Luna : trois opéras de Haydn à Paris depuis le début de l’année, mais trois réalisations très différentes ! Il est possible de « réduire » un opéra, si sa musique et sa dramaturgie s’y prêtent. C’est le cas d’Il Mondo della Luna, « dramma giocoso per musica » en trois actes sur un livret d’après Goldoni (1777). Au Théâtre Mouffetard, l’orchestre est remplacé par un simple pianoforte, à l’exclusion de tout autre instrument, et le nombre de personnages limité à cinq, au lieu des sept de l’original. Manquent Flaminia, une des filles du barbon Buonafede, et son amoureux Ernesto : les deux parties « sérieuses » de l’ouvrage. Le spectacle dure 1h 35’, au lieu des 2h 15’ de l’opéra dans son intégralité. Même les personnages retenus se voient privés de certains airs : Buonafede de son anthologique « Che mondo amabile » à l’acte II. Sans doute parce que là justement, les couleurs orchestrales sont primordiales, impossibles à rendre au seul pianoforte. Le finale de cet acte est amputé de son début. Mais miracle : la musique de Haydn renverse la situation. Grâce à elle, on dresse plus d’une fois l’oreille (finale de l’acte I au moment du supposé envol vers la lune), grâce aussi aux interprètes, à la tête desquels on a envie de placer Anna Reinhold, très présente vocalement et scéniquement en servante Lisetta. La mise en scène d’Alexandra Lacroix évoque la première expédition vers la lune, en juillet 1969.
Marc Vignal
Théâtre Mouffetard, Compagnie Manque Pas d’Airs. Jusqu’au 21 avril Photo © Accent tonique

Au Théâtre de la Colline, Les Autonautes de la cosmoroute, une création collective d’après Julio Cortazar et Carol Dunlop, par la compagnie Jakart et Mugiscué. En 2010, un groupe de huit acteurs réitère le pari fou tenu vingt-huit ans plus tôt par l’écrivain franco-argentin et sa compagne : faire, en camionnette Volkswagen Combi rouge, le voyage Paris-Marseille sans quitter l’autoroute, en faisant escale sur soixante-cinq aires de stationnement, à raison de deux par jour. Le spectacle, fou lui aussi, mêle les deux expériences. Première scène : quatre filles et quatre garçons assis en rang d’oignon, huit voix soigneusement accordées décrivant les lieux, les bruits, les événements, la végétation, le monde vu depuis « cette grande voie qui s’étalait en vain depuis des années, devant nos yeux scellés par l’ignorance. » On pense à l’Octuor de Schubert (clarinette, basson, cor, deux violons, alto, violoncelle, contrebasse), un des compositeurs favoris de Cortazar. Au fil du voyage : solos, duos, trios, thèmes récurrents, ruptures façon Schumann, mélodie continue wagnérienne (le Combi s’appelle Dragon Fafner), musique concrète à la Pierre Schaeffer (la circulation de jour et de nuit), chansons variées, de Kate Bush à Delphine Seyrig chantant Carlos d’Alessio. On sort de ce délire très fin avec la même impression d’équilibre qu’après un bon concert de chambre. Et en plus, on rit.
François Lafon
Théâtre National de la Colline, Paris, Petite Salle, jusqu’au 19 avril - Julio Cortazar et Carol Dunlop : Les Autonautes de la cosmoroute (Gallimard, collection « Du Monde entier », 1982, hélas! épuisé) Photo © Elisabeth Carecchio

Reprise à l’Opéra Bastille du Don Giovanni de Mozart dans la mise en scène du cinéaste Michael Haneke (2006). L’histoire d’un prédateur sexuel qui se croit au-dessus des lois et s’étonne d’être tout à coup harcelé par ses victimes, dans le cadre glacé d’une tour de la Défense. Le décor est « bleu Sofitel », comme le remarque un directeur de maison de disques habitué à voyager. Suivez son regard… Outre cette actualité inespérée, le spectacle n’a rien perdu de sa charge explosive, ne serait-ce que parce que Peter Mattei, seul rescapé de la distribution d’origine, est plus impressionnant encore en arriviste suicidaire. Problème récurrent : Mozart passe mal à la Bastille. Les dames (Véronique Gens, Patricia Petibon, Gaëlle Arquez, valeureuses) doivent forcer la voix, et Leporello (David Bizic) est bien souvent inaudible, malgré le soin de Philippe Jordan à équilibrer la scène et la fosse. Mais la salle est pleine, et elle a sept-cents places de plus que le Palais Garnier, où le spectacle a été créé.
François Lafon
Opéra de Paris Bastille, 21, 23, 25 mars, 3, 8, 12, 14, 19, 21, avril Photo © DR

Au Châtelet, création parisienne d’Orlando Paladino, dramma eroicomico de Joseph Haydn d’après l’Arioste. Spectacle branché : Kamel Ouali à la mise en scène, Nicolas Buffe aux décors et costumes. Le Landerneau opératique s’attendait au pire. Le chorégraphe de la Star Ac’ reconverti dans le « spectacle musical » (Le Roi Soleil, Dracula) et le graphiste design branché manga : le chef-d’oeuvre de Haydn – même dans le domaine, secondaire pour lui, de l’opéra – ne méritait pas cela. Surprise, la greffe prend. Cette histoire échevelée, avec guerrier fou d’amour, valet vantard, méchant ontologique et magicienne facétieuse, cette série B à la musique triple A (et plus encore) devient une grande BD pur manga mâtinée de Star Wars et de music-hall bien de chez nous, sans pour autant tomber dans le n’importe quoi : l’histoire est racontée, la musique est mise en valeur, les chanteurs sont en situation. Tous impeccables, les chanteurs, comme le chef Jean-Christophe Spinosi, décidément capable du moins bon, mais aussi, comme ici, du meilleur. Standing ovation, final bissé. Il ne faut décidément jurer de rien.
François Lafon
Châtelet, Paris, 19, 21, 23, 25 mars Photo © Théâtre du Chätelet

Concert d’airs d’opéras de Massenet au Palais Garnier par l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris, un mois après un récital collectif de mélodies du même Massenet à l’Amphithéâtre Bastille. Une manière d’enrichir un anniversaire plutôt morne (Massenet est mort le 13 août 1912), lancé par la vilaine Manon de l’Opéra Bastille. Programme équilibré : du Manon et du Werther, un peu de Don Quichotte et d’Hérodiade, mais aussi des raretés, Le Jongleur de Notre-Dame, Grisélidis, Roma, La Vierge, Cendrillon. Il n’y a pas que des pépites dans tout cela. Massenet avait intégré l’air du temps (à commencer par le wagnérisme), mais il le mettait au goût du public Troisième République. Réponse du berger à la bergère : le chant des sirènes de son opéra Ariane (1906) n’a pas échappé à Richard Strauss quand il a composé son Ariane à Naxos (1912). Treize stagiaires de l’Atelier pour affronter ce répertoire musclé, tous prêts pour la carrière. Parmi eux, deux oiseaux rares : Marianne Crebassa (mezzo) et Cyrille Dubois (ténor). Massenet, c’est connu, composait pour les oiseaux rares.
François Lafon

Depuis les années 1980, Parsifal a changé de nature. Adieu le rituel sacré, étouffant et post-IIIème Reich du metteur-en-scène Wieland Wagner et du chef Hans Knappertsbusch, bienvenue à un ouvrage humain et « discutable », un opéra (presque) comme les autres. Cinéaste, familier du Cirque du Soleil comme du Metropolitan Opera, le Québécois François Girard est de cette nouvelle famille. Pas plus que ses collègues Roberto Castellucci (à Bruxelles) et Krzysztof Warlikowski (à l’Opéra de Paris), il ne cherche, à l’Opéra de Lyon, le sublime en continu : friche volontaire pour le touffu acte I, onirisme de science-fiction au II, puissance symbolique au III. Plateau international dominé par Georg Zeppenfeld, Gurnemanz élégant, endurant et d’une hypnotique musicalité. À la tête d’un orchestre et de chœurs en grande forme, Kazushi Ono rappelle que Debussy ( Pelléas et Mélisande, Le martyre de Saint-Sébastien), Dukas, Mahler, Schönberg, Sibelius et Zemlinsky ne se sont jamais remis de Parsifal.
Frank Langlois
Opéra National de Lyon, 14, 17, 20, 23, 25 mars. Photo © Opéra de Lyon

Reprise de La Veuve joyeuse de Franz Lehar au Palais Garnier dans la mise en scène de Jorge Lavelli. Un spectacle mal-aimé. En 1997, le public d’opéra avait lâché Lavelli après l’avoir idolâtré. Avec cette Veuve plus grinçante que joyeuse, il écornait un mythe viennois, mais aussi français. Karita Mattila et Bo Skovhus parlant gros sous entre deux tours de valse dans un décor évoquant un hall de banque ne cadraient pas avec le gai Paris selon Maurice Chevalier dans le film de Lubitsch ni avec l’ « Heure exquise qui nous grise » de la VF signée Flers et Caillavet, rois du boulevard de la Belle Epoque. Avant Lavelli, Maurice Béjart lui-même s’y était cassé les dents, en mariant Hanna et Danilo dans les tranchées de la Grande Guerre. Hier le public, très Opéra Comique (jeune couple invité par les parents, vieille dame se rappelant Jeanne Aubert et Jacques Jansen à Mogador en 1942), applaudissait plutôt le cancan, très enlevé, que les inquiétantes Walkyries-chauves-souris lançant des flammes au tableau final. Gros succès aussi pour Susan Graham, moins sexy que Mattila mais chantant à ravir, et Skovhus, fringuant comme il y a quinze ans. Applaudissements même pour le chef, catastrophique, couvrant les voix et cassant le rythme dialogues-musique en faisant systématiquement partir l’orchestre trop tôt ou trop tard.
François Lafon
Opéra National de Paris Palais Garnier, les 11, 14, 16, 19, 22, 26, 29 mars, 2 avril Photo © Opéra de Paris

Dernier concert du cycle Beethoven commencé l’année dernière à Pleyel par Bernard Haitink avec le Chamber Orchestra of Europe. « J’ai atteint ce que je voulais : un son léger et transparent, dans un tempo vif », déclarait Haitink au Figaro en janvier 2011. « Diriger un orchestre symphonique, c’est un peu comme piloter un énorme paquebot. Pour tourner, il faut commencer à manœuvrer des kilomètres en avance. Le COE est au contraire extrêmement réactif. » Main droite imperturbable, main gauche économe, le vieux chef se fait sa musique intérieure. Dans la 1ère Symphonie, son d’ensemble terne, mais solistes impeccables. Dans la 9ème, manquent les grandes orgues des énormes paquebots haitinkiens, le Concertgebouw d’Amsterdam, la Staatskapelle de Dresde, le Symphonique de Chicago. Il y a vingt ans, avec le même Chamber Orchestra of Europe, Nikolaus Harnoncourt a déclenché une petite révolution dans l’interprétation beethovénienne. Haitink tient compte du message, mais reste au milieu du gué. Comme si l’Hymne à la Joie n’annonçait plus des lendemains qui chantent.
François Lafon

Année Debussy à l’Opéra Bastille : reprise de Pelléas et Mélisande dans la mise en scène de Bob Wilson. Distribution soignée (une très jolie Mélisande : Elena Tsallagova), direction sensible de Philippe Jordan. Le spectacle, filmé par le spécialiste Philippe Béziat, sera diffusé en direct le 16 mars sur operadeparis.fr et medici.tv, et visible en streaming pendant trois mois. Un classique : salle bondée, public rajeuni. Quinze ans après sa création dans le cadre plus intime (tout est relatif) du Palais Garnier, le rituel wilsonien fascine encore : lent ballet de silhouettes isolées dans un espace vide aux lumières étudiées, mouvements évoquant à la fois le théâtre nô et la gestique électronique du groupe Daft Punk. Or aujourd’hui, la photo paraît floue : les éclairages dérapent, les lignes de force sont émoussées. Simple décalage, fréquent à l'opéra. Qui oserait penser que Bob Wilson est démodé ?
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, 5, 8, 11, 14, 16 mars. Photo © Opéra de Paris

A l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille, Le Diable dans le beffroi et La Chute de la Maison Usher de Debussy d’après Edgar Poe. Enfin, les fragments qu’en a laissés le compositeur, mis en spectacle par l’OFNY (Opéra Français de New York). Montage astucieux, spectacle maladroit : un acteur très cabot vocifère la traduction du Diable par Baudelaire, et assure le lien avec La Maison Usher. L’intérêt est dans la musique : quelques thèmes finement ironiques au piano pour Le Diable, trois quarts d’heure, piano et voix, pour La Maison Usher, où l’on retrouve le ton et l’atmosphère de Pelléas et Mélisande. Pour combler les trous : texte parlé, un extrait de Children’s Corner, des mélodies, un Prélude. Décor bateau (une bibliothèque comme métaphore de l’« appréhension purement livresque du réel »), maquillages expressionnistes (tant pis pour l’impressionnisme debussyste), interprètes valeureux, parmi lesquels l’excellent Pelléas de l’Opéra Comique, l’année dernière, sous la direction de John Eliot Gardiner. Moralité : laissez les fragments vivre leur vie de fragments.
François Lafon
Opéra Bastille, Amphithéâtre, 1er, 3, 5 mars

Le Voyage d’hiver, deuxième cycle schubertien par Matthias Goerne et Christoph Eschenbach à la salle Pleyel, après La Belle Meunière en novembre dernier. Goerne ne raconte ni ne joue l’histoire du désespéré. Premier lied (Le Voyage) : jeu avec les mots et la musique, gestes parasites, mains (immenses) en avant comme pour saisir, équilibres étranges sur la pointe des pieds. Deuxième lied (Wohin ? – Vers où ?) : jeu avec les rythmes. Tout au long du cycle, gestes et attitudes apparemment hors de propos, et qui pourtant éclairent le propos. Le chanteur se laisse émouvoir, rejette l’émotion, la transmet à la salle, cède au désespoir, s’amuse d’une phrase, brandit un mot comme une arme, tombe en prostration, termine dans une presque atonie. Pas de cabotinage, mais l’essence même du curieux exercice qu’est l’interprétation du lied. Brecht et sa distanciation avant la lettre. Eschenbach relance le débat, habite les silences, calque les couleurs du piano sur celles de la voix. Il y a bien plus de théâtre ici que dans le récent Voyage d’hiver orchestré et dramatisé de l’Athénée. Le 11 mai, Le Chant du cygne, troisième cycle. Il est prudent de réserver.
François Lafon

Tout est contraste, dans Don Pasquale, la farce y côtoie la tragédie, et la violence, la sensualité. On attendait Denys Podalydès au tournant. Placer Don Pasquale sous l’étoile de Fellini, et plus particulièrement de La Strada, faisait craindre que les excès de l’auteur d’Amarcord ne fassent pas bon ménage avec une scène d’opéra. Il les évite, et c’est tant mieux, servi par une scénographie qui joue des contrastes sans verser dans la caricature. Le spectateur peut ainsi pleinement profiter d’un plateau italien à la diction impeccable, d’une brochette de chanteurs doublés d’acteurs plein d’énergie. Côté hommes, Alessandro Corbelli mène la danse du début à la fin avec aisance jouissive, et Gabriele Viviani est un baryton comme on aimerait en écouter plus souvent à Paris. Désirée Rancatore, bien que parfois trop en force, charme par son jeu espiègle et un registre aigu tonique et élégant. Mais la palme revient à Francesco Demuro. La première apparition en France du ténor fera date : sa prestation minorée par un trac perceptible promet un futur brillant. Dans ce spectacle rehaussé par les costumes de Christian Lacroix la fausse note vient de la fosse. Malgré bien des efforts, Enrique Mazzola ne parvient pas à faire décoller l’Orchestre National de France. Dommage, sinon, le plaisir aurait été total.
Albéric Lagier
Paris Théâtre des Champs Elysées 19, 21 et 23 Février Photo © DR

Nicholas Angelich joue le Concerto « L’Empereur » de Beethoven avec l’Orchestre de Paris. Il est le quinzième pianiste à le jouer depuis son entrée au répertoire de l’Orchestre en 1969. Il y a eu avant lui Arthur Rubinstein, Claudio Arrau, Zoltan Kocsis, Daniel Barenboim, Clifford Curzon, Alfred Brendel, Rau Lupu, Krystian Zimerman, Nikolaï Lugansky et quelques autres. Rubinstein collectionnait les fausses notes, mais justifiait le sous-titre « L’Empereur », Arrau avait l’air de ne pas écouter l’orchestre et déployait une mélodie infinie, Kocsis violentait la partition pour lui faire avouer l’inavouable, Brendel questionnait l’œuvre comme Brecht un texte, Lupu se contentait de quelques moments de pur génie, Zimerman couvrait la partition d’un très personnel palimpseste. Angelich, dès sa première phrase, décolle de l’Orchestre dirigé sans grâce particulière par le jeune chef Juraj Valcuha. Son premier mouvement est tout en fines ruptures, son Adagio coule de source, son Rondo libère des réserves de formule 1. L’ensemble est olympien et très intime à la fois. Il n’a en tout cas rien à envier à ses quatorze prédécesseurs.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, les 15 et 16 février.

A l’Athénée, « Voyage d’hiver, d’après le cycle de lieder de Schubert ». D’après. Il s’agit d’une dramatisation du cycle : trois personnages (le Poète, la Femme, le Musicien vagabond), deux bancs, un arbre nu. Comme la mise en scène est signée Yoshi Oïda, le disciple de Peter Brook, ce qu’on voit est beau et harmonieux. Les chanteurs sont bons, à commencer par le baryton Guillaume Andrieux (le Poète). Dans la fosse, l’ensemble Musica Nigella joue avec sentiment, sous la direction de Takénori Némoto, lequel signe l’adaptation. Règle du jeu : oublier la version originale. Difficile exercice : l’action paraphrase le texte, l’orchestration (formation de l’Octuor pour cordes et vents) enrobe le drame. C’était déjà le cas avec l’adaptation, plus savante, qu’en avait fait le respecté compositeur Hans Zender pour ténor et vingt-quatre instruments (1993). « Faites théâtre de tout », disait Antoine Vitez à ses élèves du Conservatoire. Mais quand l’œuvre originale - voix seule et piano - est à elle seule un théâtre invisible, mieux vaut ne pas en éventer le mystère.
François Lafon
Théâtre de l'Atnénée, Paris, les 15, 16, 17 février, 20h.

On va à l’opéra pour voir mais aussi pour entendre. Cela va sans dire, mais on se le redit quand on lit et entend les commentaires pincés suscités par Le Trouvère au Capitole de Toulouse. La mise en scène très épurée de Gilbert Deflo et le décor minimaliste de William Orlandi ont le mérite de ne pas alourdir un livret déjà alambiqué. Avec le spécialiste Daniel Oren, qui sait admirablement équilibrer le chant et l’orchestre, l’opéra prend une couleur inattendue : décor, scénographie et direction en font une sorte de tragédie grecque. Ce soir, seconde distribution, dite des « jeunes talents » : un plateau vocal plein de générosité, à peine entaché par les graves limites de la mezzo-soprano Andrea Ulbrich et par les imprécisions du ténor Alfred Kim. Force du destin, liens de fraternité, fatalité, autosacrifice, vérité trop tard avouée : on quitte la salle la tête pleine de sentiments épiques. La preuve que, sans avoir l’air d’y toucher, le spectacle a été efficace.
Katchi Sinna
Théâtre du Capitole les 3, 4, 5,7, 9, 10, 11, 12 février. Photo © DR

On dit Karajan ou Bernstein tout court, mais avec Järvi (il y en a trois), Jurowski (idem) ou Petrenko (il y en a deux, qui n’ont rien à voir avec le patineur, et qui, apparemment, ne sont pas frères), il faut préciser le prénom. Ce soir, c’est Vasily Petrenko, trente-six ans, qui dirige à Pleyel le Philharmonique de Radio France. Programme troublant : Le Chant des forêts, oratorio à grand spectacle de Chostakovitch, et Roméo et Juliette, suites de ballet de Prokofiev. Deux œuvres pour le peuple (ou qui essayent de l’être), mais l’une écrite sous la contrainte par un génie malheureux (1949), l’autre composée dans la joie par une star internationale désireuse de rentrer au bercail (1935). Petrenko le jeune (l’autre, Kirill, a quatre ans de plus) s’était fait remarquer l’année dernière en dirigeant Eugène Onéguine de Tchaïkovski à l’Opéra Bastille. Le revoilà tout feu tout flamme mais très organisé, habile à faire apparaître le grand Chostakovitch sous le Chostakovitch de circonstance, et à rappeler que même redistribué en suites, Roméo et Juliette est un ballet, et que le mouvement en est le fin mot. Méfiez-vous de ce Petrenko-là, il serait capable de vous faire admettre que la 3ème Symphonie de Rachmaninov (le CD sort chez EMI) est un chef-d’œuvre.
François Lafon
Pleyel le 10 février

A Venise, du temps de Cavalli, l’art se fait populaire et se double d’une entreprise commerciale. Pour faire recette, compositeurs et librettistes mêlent les sentiments et ratissent large, de la joie à la nostalgie, de l’amour à la haine, de la sagesse à la folie en passant par la farce. Sur scène, les toiles peintes laissent place à des machineries théâtrales dont le plus célèbre inventeur, Giacomo Torelli, est surnommé le Grand Sorcier. Comme Egisto se situe au début de cette mutation, on s’attend naturellement à voir l’Opéra-Comique envahi de machines plus merveilleuses les unes que les autres. Las, le décor unique sous forme de temple d’Apollon enferme comme en cage, dont il adopte la forme avec ses trop nombreux piliers, des chanteurs noyés dans la pénombre des bougies. (Une habitude chez le metteur en scène Benjamin Lazar). Ce choix se retrouve aussi dans le parti pris vocal : quelles que soient les circonstances, ça chante aigu et en force. Si la diction est souvent correcte, la prosodie univoque, qui fait figure de style imposé, finit rapidement par ennuyer. Et si Anders J. Dahlin (Lidio) respecte ce contrat à la lettre, on sent que Marc Mauillon (Egisto) ne pense qu’à le transgresser. C’est aussi ce que font Vincent Dumestre et son Poème Harmonique, qui se moquent de cette noirceur ambiante comme d’une guigne. Pour notre plus grand plaisir.
Albéric Lagier
Opéra-Comique, Paris, les 8 et 9 février 2012 ; Opéra de Rouen , les 16, 17 et 19 février 2012.

« C'est quoi les gens modernes ? » demande un enfant qui a tout compris à la fin de Von Heute auf Morgen, d’Arnold Schönberg. C'est aussi la question que pose Serge Dorny au Triptyque de Puccini. Plutôt que de proposer, ces trois courts opéras en une soirée, le directeur de l'Opéra de Lyon a confronté chaque volet à un ouvrage en un acte contemporain : Il Tabarro / Von Heute und Morgen de Schönberg ; Suor Angelica / Sancta Susanna de Hindemith ; Gianni Schicchi / Une tragédie florentine de Zemlinsky. Ce triple jeu de miroirs fonctionne à merveille : les ambitions artistiques, esthétiques et politiques de Puccini saillent comme jamais. Quant aux trois ouvrages germanophones, ils tracent une stupéfiante carte des modernités entre 1917 et 1930. À sa façon, chacun est un brûlot : sociétal (Von Heute und Morgen) avec ce couple tenté de vivre à la « moderne » (chacun mènerait sa propre vie amoureuse) ; moral (Une tragédie florentine) avec une épouse vénéneuse qui, pour retrouver son mari, le laisse assassiner son amant ; et, surtout, religieux (en matière de blasphème, la pièce Golgota picnic de Rodrigo García est une bluette à côté de Sancta Susanna). Sur scène, les distributions sont au pire opportunes, au mieux d'un exceptionnel standard international. Scéniquement, les ouvrages germaniques l'emportent, grâce aux metteurs en scène John Fulljames (Hindemith et un très élégant Schoenberg), et Georges Lavaudant au mieux de sa forme (Zemlinsky). Comme quoi une maison d’opéra peut être l'égale des grandes institutions théâtrales (Schaubühne de Berlin, Théâtre Vidy de Lausanne, Théâtre national de l'Odéon). Pourquoi l'Opéra de Paris ne s’y mettrait-il pas ?
Frank Langlois
Opéra National de Lyon, jusqu’au 13 février http://festival-puccini.opera-lyon.com/le-festival/ Photo © DR

Nouveau chapitre de la série noire à l’Opéra de Paris : la création de La Cerisaie de Philippe Fénelon, d’après la pièce de Tchékhov. Comme Peter Eötvös, qui avait réorganisé Les Trois Sœurs (1998) en adoptant le point de vue de chacune des sœurs sur la même situation, Fénelon et son librettiste Alexei Panine ont composé une grande variation sur la scène clé du bal, où l’on apprend que la cerisaie est vendue à l’ancien moujik Lopakhine. Une façon d’échapper au temps tchékhovien et à la petite musique qui va avec. L’ennui est que le non-dit - lui aussi essentiel chez Tchékhov -, laisse la place au trop dit, et même au ressassé, sans que le propos soit clair pour autant. La musique est à l’avenant, indiscrète, explicative, référentielle, déjà entendue, et la mise en scène de Georges Lavaudant essentiellement clownesque, sans doute pour montrer qu’on est en Russie, où l’on rit et pleure en même temps. L’ouvrage est d’ailleurs chanté en russe (coproduction avec le Bolchoï de Moscou), ce qui ajoute à la confusion sans lui conférer un quelconque parfum d’authenticité.
François Lafon
A l’Opéra de Paris, Palais Garnier, les 30 janvier, 2, 5, 7, 10, 13 février. Photo © Opéra de Paris

Reprise à l’Opéra Bastille de La Dame de pique de Tchaïkovski dans la mise en scène de Lev Dodin (1999). Un spectacle qui fait du bien, après la série noire des créations maison de la saison (Faust, La Force du destin, Manon). Le public (le vrai, pas celui des premières) est encore divisé. « Au fou ! », persifle un monsieur en voyant cette histoire d’obsession du jeu et de cartes maléfiques transporté dans un asile d’aliénés, où le héros dans son délire revoit les aventures qui l’ont mené là. Enthousiasme pour les chanteurs (Vladimir Galouzine, Olga Guryakova, Ludovic Tézier), succès plus modéré pour le chef Dmitri Jurowski, qui n’a que le tort d’être moins charismatique que son frère Vladimir, lequel dirigeait le spectacle en 99. Dodin, en 2005 sur la même scène, a déçu dans Salomé de Strauss. N’empêche que c’est de metteurs en scène de sa trempe qu’aurait actuellement besoin la Grande boutique.
François Lafon
A l’Opéra de Paris Bastille, les 29 et 31 janvier, 3 et 6 février Photo © Opéra de Paris

A Pleyel, Viktoria Mullova joue le Concerto pour violon de Brahms avec l’Orchestre de Paris. C’est la fin d’un cycle commencé en janvier à l’auditorium du Louvre : Bach, Vivaldi, Haendel, Leclair, Beethoven, Schubert, Bartok, Weather Report, c'est-à-dire trois siècles et demi de musique, du baroque au jazz-rock-fusion. Public mêlé : on sent que ses fans la suivent, que sa façon, ou plutôt ses façons de faire de la musique – sur violon monté ou non à l’ancienne - font école, deviennent des modèles. Son Brahms profite de cette perspective : on y entend tout ce qu’il a de classique, mais aussi, et tout autant, les innovations que Joseph Joachim, le créateur, avait revues, corrigées, « rendues jouables » avec le compositeur. Paavo Järvi va dans son sens. Il a commencé le concert par une impeccable Symphonie n° 83 « La Poule » de Haydn, et le terminera avec une 2ème Symphonie de Brahms qu’il entend comme un lointain écho du grand style classique viennois. Même esprit pour le Concerto pour violon : avec Mullova, il dégraisse cette musique sans jamais l’assécher.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, les 25 et 26 janvier. Au Grand Théâtre d’Aix-en-Provence le 27.
 Aux Bouffes du Nord, Katia Kabanova de Janacek. Mais où met-on l’orchestre ? Nulle part. Il s’agit d’un travail d’atelier, accompagné au piano et venu de la fondation Royaumont. « J’ai pensé que je pouvais très modestement inscrire cette démarche dans les pas de Peter Brook, » explique André Engel, le metteur en scène. Mais Engel n’est pas loin d’être lui aussi une légende, et son travail est exemplaire. L’œuvre s’y prête : un drame provincial à quelques personnages, tiré d’une pièce russe célèbre (L’Orage d’Alexandre Ostrovski), une musique calquée sur les inflexions de la langue tchèque. « Je voulais inscrire l’œuvre dans un lieu où l’on accepte le présupposé de ne pas faire de l’opéra stricto sensu, continue Engel, un espace ouvert à un travail à la frontière entre l’opéra et le théâtre. » Difficile de donner un opéra en gros plan sans en tuer la magie. Brook y est arrivé aux Bouffes du Nord avec La Tragédie de Carmen et Impressions de Pelléas. Engel y parvient en obtenant de sa troupe (ils sont tous justes, comme acteurs et comme musiciens) un jeu à la fois réaliste et dénué d’effets. Et l’orchestre somptueux de Janacek (photo), il ne manque pas ? Si, tout le temps. Et pourtant cette épure de Katia Kabanova nous en dit bien autant que nombre de productions à gros budget.
Aux Bouffes du Nord, Katia Kabanova de Janacek. Mais où met-on l’orchestre ? Nulle part. Il s’agit d’un travail d’atelier, accompagné au piano et venu de la fondation Royaumont. « J’ai pensé que je pouvais très modestement inscrire cette démarche dans les pas de Peter Brook, » explique André Engel, le metteur en scène. Mais Engel n’est pas loin d’être lui aussi une légende, et son travail est exemplaire. L’œuvre s’y prête : un drame provincial à quelques personnages, tiré d’une pièce russe célèbre (L’Orage d’Alexandre Ostrovski), une musique calquée sur les inflexions de la langue tchèque. « Je voulais inscrire l’œuvre dans un lieu où l’on accepte le présupposé de ne pas faire de l’opéra stricto sensu, continue Engel, un espace ouvert à un travail à la frontière entre l’opéra et le théâtre. » Difficile de donner un opéra en gros plan sans en tuer la magie. Brook y est arrivé aux Bouffes du Nord avec La Tragédie de Carmen et Impressions de Pelléas. Engel y parvient en obtenant de sa troupe (ils sont tous justes, comme acteurs et comme musiciens) un jeu à la fois réaliste et dénué d’effets. Et l’orchestre somptueux de Janacek (photo), il ne manque pas ? Si, tout le temps. Et pourtant cette épure de Katia Kabanova nous en dit bien autant que nombre de productions à gros budget.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 4 février. www.bouffesdunord.com

A Pleyel, Andris Nelsons dirige l’Orchestre de Paris dans la Symphonie alpestre de Richard Strauss. La semaine dernière, même lieu même orchestre, Herbert Blomstedt dirigeait Une Vie de héros du même Strauss. Si l’on vous demande à quoi sert un chef, prenez ces deux là comme exemples. Nelsons, trente-quatre ans, disciple du grand manieur d’orchestres qu’est Mariss Jansons, prend l’énorme phalange straussienne à bras le corps, en exacerbe les contrastes, en tire une symphonie de couleurs. Blomstedt, quatre-vingt-cinq ans, superpose les couches sonores en un savant tuilage et traite, comme le faisait Karl Böhm, cette musique de l’excès avec la même finesse qu’une symphonie de Mozart. Deux époques, deux écoles ? Deux tendances plutôt, aussi vieilles que le métier de batteur de mesure. En première partie, Nelsons accompagne le jeune Sergey Khachatryan dans le Concerto pour violon de Beethoven : archet flamboyant, orchestre péremptoire. Blomstedt choisit lui aussi Beethoven - le 4ème Concerto pour piano -, avec en soliste le raffiné Till Fellner : clavier nuancé, orchestre romantique mais point trop. Encore une fois on pense à Böhm. Pas de bataille à la sortie entre pro l’un et anti l’autre. Avec les deux, d’ailleurs, l’orchestre est sur son trente-et-un.
François Lafon
Andris Nelsons – Sergey Khachatryan : 18 et 19 janvier. Concert du 19 en direct sur Radio Classique.

Ouverture, au Châtelet, de Présences 2012, 22ème festival de musique contemporaine de Radio France. L’année dernière, le héros de la fête était Esa-Pekka Salonen, piètre compositeur, mais chef vedette : salles pleines, grosse couverture médiatique. Cette année, c’est Oscar Strasnoy, présenté comme « le plus français des Argentins de Berlin ». Un jeune Mauricio Kagel, en somme, connu pour son éclectisme, son goût pour un théâtre musical décalé, propre à séduire des publics venus d’ailleurs. Mais Strasnoy n’est connu que du sérail et l’aventure est plus risquée. Premier programme : création française du Bal, opéra en un acte d’après la romancière Irène Némirovsky. Public clairsemé pour cette histoire de parvenus qui convient le tout Paris mais dont la fille jette les invitations dans la Seine au lieu de les mettre à la poste. L’œuvre est donnée en version de concert, agrémentée d’amusantes illustrations projetées d’Hermenegildo Sabat. La musique aussi est amusante, pleine de citations et de dérapages, et les chanteurs payent de leur personne, mais rien ne décolle. Restent treize concerts pour vérifier l’effet Strasnoy.
François Lafon
Présences 2012 : Oscar Strasnoy. Au Châtelet jusqu’au 22 janvier

Nouvelle Manon à l’Opéra Bastille, pour le centenaire de la mort de Massenet, et pour Natalie Dessay. Etrange cas de dédoublement d’intentions. En grand format, un curieux spectacle signé Coline Serreau : des bas de soie et des punks à moto, des bigotes en roller et un abbé Des Grieux en soutane transparente, une panoplie de Miss Arras et une pub fifties à la gloire de la femme américaine, tout cela pour bien montrer que Manon est une histoire de tous les temps et que la courtisane est avant tout une femme bafouée. Sifflets mérités au rideau final. Toute petite dans ce fatras géant, Natalie Dessay joue exactement cette situation, mais avec une justesse, une sobriété, une modernité qui rendent tout le reste inutile. « Renée Fleming, sur la même scène, c’était autre chose », entend-on à l’entracte. Côté décibels, sûrement. Il faut tendre l’oreille et faire l’impasse sur le ténor (pas très bon), le chef, tout. L’exercice est fatiguant, mais on est récompensé.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, les 14, 18, 22, 25, 28 janvier, 2, 5, 10, 13 février.
Photo © DR
Reprise, au Théâtre des Champs-Elysées, de La Flûte enchantée dans la production voyageuse (Bruxelles, Naples, Aix, Lille, Rouen, Caen, etc.) de William Kentridge, Laurent Pelly, initialement prévu, ayant déclaré forfait pour cause de surbooking. En 2009 au festival d’Aix, René Jacobs était au pupitre : un somptueux théâtre pour l’oreille, soutenu par les images mouvantes en noir et blanc du plasticien metteur en scène. Cette fois, c’est Jean-Christophe Spinosi qui est aux commandes, et la perspective est inversée : c’est le spectacle qui vient en aide à la musique. Aux tempos fous du chef, aux dérapages de l’orchestre, le ballet de transparences et de projections qui anime ce spectacle par ailleurs assez sage apporte un semblant de cohérence. Mais en ce 22 décembre (4ème représentation), devant une salle bondée, les chanteurs ont la voix dans les chaussettes, et les trouvailles de Kentridge ne suffisent plus. De ce dernier, guettez plutôt l’époustouflante mise en scène du Nez de Chostakovitch, créée à New York et déjà passée par Aix et Lyon.
François Lafon

Sous la pyramide du Louvre, devant un parterre assis par terre, Pierre Boulez dirige Schoenberg et Bartok avec l’Orchestre de Paris. L’année dernière, c’était L’Oiseau de feu de Stravinsky : même public, plus jeune que celui de Pleyel, peut-être moins argenté (l’entrée est gratuite : deux heures de queue) mais non moins choisi. « Assis ! » entend-on alors que l’orchestre n’est pas encore placé. Le matin, sur une antenne de la radio nationale, Boulez affirmait qu’il comprenait très bien que l’on n’ait pas envie d’entrer dans une salle de concert. Il ne la joue pas cool pour autant. Salut bref et l’orchestre attaque. Nuances infinies dans La Nuit transfigurée (Schoenberg), rythme et couleurs en fête dans le Concerto pour orchestre (Bartok). Peu de déperdition sonore dans cette salle des pas perdus en verre et béton : orchestre en état de grâce et chef au zénith. Demain, même programme à Pleyel, avec en prime le 2ème Concerto pour piano de Bartok (soliste : Bertrand Chamayou). Ce soir, le timbre du piano et le postérieur des spectateurs n’y auraient pas résisté.
François Lafon
Photo © Olivier Debien

La compagnie Les Brigands fête son dixième anniversaire au théâtre de l’Athénée. Au programme : La Botte secrète (1903) de Claude Terrasse sur un livret de Franc-Nohain. C’est une histoire leste qui se passe dans un magasin de chaussures, haut lieu du fantasme coquin (voir Dédé d’Henri Christiné et Baisers volés de François Truffaut). Voilà donc dix ans que Les Brigands enchaînent les opérettes qui faisaient glousser nos arrière-grands-parents, pour le bonheur toujours plus grand d’un public toujours plus nombreux. Leur recette : en rajouter dans le nonsense, pratiquer l’anachronisme, cultiver le décalage, tout en préservant l’esprit parisien d’avant-guerre, à la fois bête et fin, naïf et vachard. Clou de La Botte secrète : un duo entre une princesse et un égoutier. Refrain : « Toute à l’égout ! ». En seconde partie (mais sans entracte) : revue d’anniversaire. La compagnie au grand complet offre des extraits de son répertoire. Pas de voix exceptionnelles, mais une énergie qui fait du bien. Entendu à la sortie : « Par les temps qui courent, Intouchables et ça, on en a bien besoin ». Comme dit Ionesco dans La Cantatrice chauve : « Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux ».
François Lafon
La Botte secrète. Mise en scène Pierre Guillois, direction Christophe Grapperon. Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 8 janvier.

Doté de nombreux chœurs et ballets, Amadis de Gaule reste l’opéra le plus ambitieux, le plus varié et le plus coloré de Johann Christian, le cadet des fils Bach : tragédie lyrique dans la lignée de Gluck certes, mais Mozart n’est pas loin. Dernier opéra de J.-C. Bach, créé à Paris le 14 décembre 1779, l’ouvrage est un remake de l’Amadis de Lully (1684), composé sur le même livret de Quinault, d’après un roman de chevalerie espagnol du XIVe siècle. Les six représentations données à Versailles et à Paris sont les premières en France depuis 1779-1780. L’œuvre mérite amplement cette résurrection, et l’on apprécie qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une quelconque actualisation : les décors et les costumes respectent l’époque, comme les ballets très XVIIIème. Les chanteurs sont de qualité et l’orchestre est rompu à ce style. Les retouches apportées aux ballets terminant les deux derniers actes sont, toutefois, assez frustrantes : supprimer la gigue entrainante de la fin de l’acte II et déplacer le tambourin - l’un des clous de la partition - pour le faire revenir à la fin du III n’est pas du meilleur effet. L’intérêt et la beauté du spectacle ne sont pas en cause, mais si l’œuvre doit faire l’objet d’un enregistrement…
Marc Vignal
Mise en scène : Marcel Bozonnet ; Chorégraphie : Natalie van Parys ; Direction musicale : Jérémie Rhorer
10 et 12 décembre 2011 : Opéra Royal, Versailles ; 2, 4, 6 et 8 janvier 2012 : Opéra Comique, Paris

Reprise de The Sound of Music ( La Mélodie du bonheur ) au Châtelet, un succès déjà il y a deux ans. Inutile de comparer cet increvable hit avec les autres classiques du genre donnés in loco (A Little Night Music, Sweeney Todd, My Fair Lady). Comme le film de Robert Wise, plus que lui, même, le musical nage dans le sirop. Tout y est sucré : l’histoire du baron Trapp, qui épouse la novice déléguée par le couvent voisin pour s’occuper de ses sept enfants et fait entrer la musique, donc la joie dans la maison, les refrains de Richard Rodgers, plus mièvres les uns que les autres, le vert tendre des collines salzbourgeoises, qui sert de fond au décor. Mais il faut croire que le sucre est une drogue, car on sort de là tout propre, tout enfant, en fredonnant Do-ré-mi ou (pire) My Favourite Things. On se rassure en énumérant les qualités du spectacle : cast impeccable, mené par Katherine Manley (Maria) et William Dazeley (le Baron), mise en scène « tradition dépoussiérée » d’Emilio Sagi, avec un effet final (l’Anschluss, mars 1938) habilement angoissant. Il y a même un personnage intriguant dans cette aventure inspirée d’une histoire vraie : Max, l’imprésario qui crée un festival de musique et pactise avec les nazis. En 1938, Max Reinhardt, le créateur du festival de Salzbourg, a dû, lui, fuir en Amérique.
François Lafon
Au Châtelet, Paris, jusqu’au 1er janvier 2012

Mélodies et lieder de Liszt, à l’Amphithéâtre Bastille, par l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris. Salle pleine, comme pour les spectacles scéniques : l’Atelier est devenu une institution à la mode. Neuf des douze stagiaires, dont quatre nouveaux, se livrent à l’exercice périlleux du récital. Un piano, une présence, une voix, et rien pour se rattraper, qui plus est dans le cadre glacial de cet amphi en sous-sol. Le niveau général est bon, et quelques personnalités explosent : le ténor Cyril Dubois, qui enchaîne les virtuosissimes Trois Sonnets de Pétrarque avec une aisance de grand pro, le baryton Michal Partyka, la soprano Andreea Soare, et bien sûr la mezzo Marianne Crebassa, Orphée de Gluck mémorable la saison dernière, et qui donne cette fois un Mignons Lied d’anthologie. On sort débarrassés de quelques préjugés : de Pétrarque à Goethe, de Musset à Hugo, Liszt a inventé un monde mélodique à la mesure de son éclectisme, et qui n’a pas grand-chose à envier à Schubert, Schumann ou Wolf. Pour en faire le tour, neuf voix prometteuses et quatre pianistes ne sont pas de trop. Quelle autre institution peut offrir cela à son public ?
François Lafon
Marianne Crebassa

Récital, à l’Auditorium du Louvre, du pianiste espagnol Luis Fernando Pérez, alors que paraît chez Mirare son enregistrement des Goyescas de Granados. Très jeune, très vieux ce personnage longiligne qui arrive à petit pas rapides et se lance, penché sur le clavier, dans une série de Lieder de Schubert et de Schumann transcrits par Liszt ? L’artiste est plein de surprises : fantasque sous ses airs sérieux, bouillant et analytique en même temps. Il se révèle vraiment avec la Mort d’Isolde… transcrite par Liszt (le récital fait partie de la série Au fil de Liszt), qu’il détricote et retricote avec une agilité incroyable. Puis vient une Rhapsodie espagnole (de Liszt bien sûr) qui ferait danser un public moins correct, prélude à de larges extraits d’Iberia d’Albeniz, en seconde partie. Pourquoi Albeniz ? Parce qu’il a failli rencontrer Liszt à Barcelone en 1880, ou plutôt, comme le montre Pérez, parce que, comme Liszt, il repoussé les limites du piano ? Jouée ainsi, en tout cas, cette musique complexe tourne au feu d’artifice. A propos, Luis Fernando Pérez est très vieux et très jeune : il a trente-quatre ans.
François Lafon

Emotion et émerveillement à Garnier, avec La Cenerentola de Rossini. Jean-Pierre Ponnelle l’avait mis en scène à Munich en 1967. Nicolas Joël, l’actuel directeur de l’Opéra National de Paris dont il fut l’élève, lui rend hommage en l’installant enfin à Garnier, avec les décors d‘origine dans un spectacle pétillant d’intelligence et admirablement réglé. Les décors, d’abord, faits de quelques toiles, comme dans le théâtre de tréteaux d’antan, dont la simplicité et le constant à propos font la magie, à l’opposé de tous les chercheurs de concepts nouveaux, dont les tics font l’académisme d’aujourd’hui. Les voix ensuite, dont Nicolas Joël se montre, si besoin, un fin connaisseur, et dont la recherche de l’équilibre dans les distributions fait mouche : Karine Deshayes (Angelina/Cendrillon) est une des meilleures sopranos rossiniennes d’aujourd’hui ; José Camarena, entendu l’année dernière à Bastille dans la Somnambule aux côté de Natalie Dessay, peut s’accaparer le qualificatif de grand ténor rossinien ; Carlos Chausson, en don Magnifico, est désopilant ; les deux sœurs Clorinda (Jeannette Fischer) et Tisbé (Anna Wall) sont loufoques sans verser dans le ridicule, et Alex Esposito est un Alidoro plus qu’honnête. Présent à Paris depuis plus de dix ans, mais peu remarqué, Riccardo Navarro (Dandini) a pourtant une présence sur scène qu’on aimerait partagée par plus de chanteurs. Tous jouent ensemble avec jubilation et ont une diction parfaite, choses trop rares pour être soulignées. Les chœurs et la direction musicale (Bruno Campanella) sont impeccables. Tout cela est très « classique », certes, mais tellement séduisant, et donne envie de voir et revoir les mises en scènes de Ponnelle. Celle de Madame Butterfly serait un beau cadeau que Nicolas Joël pourrait faire au public…
Albéric Lagier
Opéra de Paris du 26 novembre au 17 décembre Photo © Opéra de Paris

"Vadim and friends, concert anniversaire". On imagine déjà une version violon de Pavarotti and friends, avec formation à géométrie variable et bœuf final mêlant Beethoven et Stéphane Grappelli. Eh bien pas du tout ! Pour ses quarante ans, Vadim Repin et ses friends jouent deux sextuors à cordes : le 2ème de Brahms et « Souvenir de Florence » de Tchaikovski. Du sérieux, voire de l’austère. La salle Pleyel est presque pleine : Repin a son public, et parmi les friends - tous russes sauf le violoncelliste Henri Demarquette -, on trouve l’altiste vedette Yuri Bashmet. Une réunion de virtuoses, sans que personne ne tire la couverture. Au moindre solo de l’hôte, pourtant, la tension monte. Peut-être, en bis, jouera-t-il seul. Espoir perdu : le 2ème mouvement du Sextuor de Borodine, tous ensemble, et puis s’en va. Dans le programme, une photo de trois enfants sages, à Moscou en 1985 : Vadim Repin, Evgeni Kissin et Maxim Vengerov. Qui aurait parié sur le plus sage des trois ?
François Lafon

Vingt-sept donateurs privés (3000 € chacun) pour les vingt-sept pièces (lieder et intermèdes pour piano) constituant O Mensch !, la nouvelle création de Pascal Dusapin aux Bouffes du Nord. Un mécénat à l’ancienne, en somme. C’est pour le baryton autrichien Georg Nigl, créateur de ses opéras Faust et Passion, que Dusapin a imaginé cette promenade dans l’univers de Nietzsche. C’est surtout, comme il le reconnaît lui-même, pour faire « son » Nietzsche. Comme Nigl est aussi bon acteur que bon chanteur, il l’a mis en scène, agrémentant le spectacle de vidéos imaginatives du chercheur en nouvelles technologies Thierry Coduy, et laissant dans l’ombre le piano tenu par l’excellente Vanessa Wagner. Question rebattue : le lied, genre allusif, s’accommode-t-il d’un jeu théâtral sans risquer la paraphrase ? La musique du cycle, à la fois ascétique et truffée de références (Schubert, Mahler, Wagner et les autres, même Monteverdi), ne se suffisait-elle pas à elle-même ? Une façon, en tout cas, d’éviter que les généreux donateurs ne regrettent d’avoir investi dans la musique contemporaine, et pas la plus facile.
François Lafon
Bouffes du Nord, Paris, les 18 et 19 novembre.
En photo : Georg Nigl

Trente ans que La Force du destin n’avait pas été donné à l’Opéra de Paris. Et pourtant, en voyant la nouvelle mise en scène, signée Jean-Claude Auvray, on a l’impression de retrouver l’ancienne, qui à l’époque avait déjà paru désuète. L’œuvre est impossible, aussi, et pas du meilleur Verdi : livret méloissime, invraisemblances à la chaîne, psychologie de carton-pâte, musique fourre-tout, où les flonflons charrient des pépites. Au moins, il y a trente ans, y avait-il des voix (Placido Domingo, Martina Arroyo, Gabriel Bacquier) capables de rendre cette hystérie transcendée. Ce soir, personne ne démérite, mais aucun n’entraîne les autres, surtout pas le ténor, remplaçant la locomotive Marcelo Alvarez, qui lui, peut-être... Chœur impeccable, orchestre irréprochable, dirigé par un Philippe Jordan plus italien qu’on ne l’aurait espéré. Après Faust, la maison-Opéra continue son entreprise de rétropédalage esthétique. Force du destin ou nostalgie assumée ?
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, les 17, 20, 23, 26, 29 novembre, 2, 5, 8, 11, 15, 17 décembre. Diffusion en direct dans des salles de cinéma le 8 décembre et sur France Musique le 10.
Photo © Ch. Leiber

A l’Oratoire du Louvre, dans l’excellente série des concerts Philippe Maillard, Philippe Herreweghe dirige le Collegium Vocale de Gand, qu’il a créé il y a quarante ans. Au programme, deux motets de Roland de Lassus et l’Office des défunts de Tomas Luis de Victoria. Musiques austères et magnifiques : l’apogée de la polyphonie Renaissance pour exalter la délivrance par la mort. Dans ce temple calviniste, ancienne église où ont été chantées les messes d’enterrement de Richelieu et d’Anne d’Autriche, les treize solistes sont comme désincarnés, invisibles presque, présents seulement par leurs voix, incroyablement précises et expressives, qui habitent l’espace plus qu’elles ne le remplissent. A voir Herreweghe retrouver son premier métier de chef de chœur, avec sa gestique bien à lui, on se revoit à Saint-Etienne-du-Mont, le 15 mars 1980. Une mini-baguette à la main (un crayon ?), le jeune Belge réinventait la Passion selon Saint Matthieu, comme William Christie et Jean-Marie Villégier réinventeront l’Atys de Lully, sept ans plus tard. Moments d’histoire. Ce soir, public jeune, pour qui la révolution baroque n’a pas été un combat. Herreweghe, lui, continue la lutte.
François Lafon
Photo © Olivier Debien

La Belle Meunière, premier volet de la trilogie Schubert par Matthias Goerne et Christoph Eschenbach à Pleyel (Voyage d’hiver en février, Le Chant du cygne en mai). Pas facile de créer l’intimité dans ce grand hall blanc. Goerne, qui a longtemps chanté les yeux baissés et les mains à hauteur de plastron, embrasse la salle du regard et transforme le creux du piano en scène imaginaire. Il occupe l’espace, comme savait le faire Dietrich Fischer-Dieskau. Même attitude vocale : rage, éclats, déploration, et ces merveilleux moments suspendus dont il a le secret. Le piano d’Eschenbach tonne et murmure, arrête le temps avec un art égal. La Belle Meunière dure un quart d’heure de plus que d’habitude : on irait, avec eux, jusqu’au bout de la nuit.
François Lafon
Photo © Marco Borggreve

Soirée d’exception hier à la Salle Gaveau, avec un programme fait de grands classiques, dont deux sommets du piano romantique : les Variations Diabelli de Beethoven et la Fantaisie D 760 dite Wanderer de Schubert. Deux œuvres de commande : la contrainte a joué un rôle fertile…Les premières, on le sait, furent commandées par Diabelli à partir d’une pauvre valse de sa composition, pour une publication au bénéfice des victimes des guerres napoléoniennes. Diabelli désespérait de recevoir une variation de Beethoven quand, bien après les autres compositeurs sollicités – ils étaient 50 - il en livra 33 en 1823. 33 pièces bijou de force descriptive, autant de personnages, peut-être ceux morts sur le champ de bataille, et celles et ceux parmi leurs proches. La Fantaisie de Schubert quant à elle fut commandée en 1822 par un riche aristocrate viennois, et ce fut la seule partition de Schubert à être publiée de son vivant par... Diabelli. Les parallèles entre les deux œuvres sont nombreux – la Fantaisie joue sur des variations complexes, dans et à partir de son deuxième mouvement lent. Mais pour le reste, tout les sépare, la construction, l’univers sonore, sauf encore… la virtuosité. C’est au diable de jouer cette pacotille, disait de son œuvre Schubert, lui-même incapable de la jouer. C’est en privilégiant la virtuosité que Laurent Cabasso, s’en tire, au risque de ne pas toujours s’intéresser aux élans poétiques, méditatifs ou jubilatoires de ces œuvres. Mais quel programme !... avec en entrée la très romantique Sonate K 310 de Mozart, et en encore demandés vivement par le public la Variation sur la valse de Diabelli par Schubert.. . et – de mémoire- le 3ème prélude du 2ème Livre du Clavier bien tempéré de Bach. Un moment généreux, donc, au profit des actions de l’Association Coline en Ré, au profit d’enfants hospitalisés à Kaboul et à Phnom-Penh.
Albéric Lagier

20h30 : face à face, un piano classique et un piano préparé. Volant de l’un à l’autre sur un tabouret tournant, David Greilsammer joue alternativement Scarlatti et Cage, « de véritables visionnaires, en avance sur leur temps, pour lesquels la sonate n’était pas une forme rigide et pesante, mais plutôt un espace de création et d’expérimentation ». Nous sommes à la Gaîté lyrique, temple des « révolutions numériques », où Greilsammer et l’Orchestre de Chambre de Genève commencent leur premier week-end baroque et contemporain (il y en aura trois jusqu’à fin 2012). 22h15 : Greilsammer, sur son piano préparé, lance le concert Phil Glass. Au programme : le Quatuor « Mishima » (tiré de la bande sonore du film de Paul Schrader), enserré dans une création sonore et visuelle de Radiomentale (les DJ Jean-Yves Leloup et Eric Pajot). L’ensemble fleure bon ses années 80, mais le public est plus jeune et plus nombreux que celui du concert précédent, et tout aussi attentif. Le week-end, où l’on entend jusqu’à dimanche Vivaldi et Crumb, Denis Schuler et Rameau, Leclair et Berio, se veut emblématique de « ce qu’il faut faire pour renouer le lien entre passé et présent ». Greilsammer, Frégoli musical, capable de libertés borderline avec les partitions mais doué comme personne pour leur donner un coup de jeune, est l’homme de la situation. Des friandises pour jeunes bobos dans un espace clinique (blanc, noir, tubulures, seul le vieux foyer Napoléon III a subsisté) conçu tout exprès ? Plutôt un pli à prendre, peut-être irréversible.
François Lafon
8 concerts et un atelier animé par David Greilsammer, jusqu’à dimanche 6 novembre. www.gaité-lyrique.net

Le Huron, sur un livret de Marmontel d’après L’Ingénu de Voltaire, est le premier opéra-comique parisien de Grétry, créé en 1768. Venu du Canada et débarqué sur les côtes bretonnes, ce Huron se révèle être le neveu de notabilités du lieu. Né libre, il se trouve confronté à ce qui est en place, à ce qu’on attend de lui. Les violentes attaques de l’original de Voltaire contre la société et l’Eglise ont été gommées, mais subsistent des traces du mythe de bon sauvage. La conduite héroïque du « Huron » devenu Français contre les Anglais lui vaudra finalement la main de la belle Mlle de Saint-Yves, auparavant promise à un autre. Ressusciter cette œuvre mêlant le chanté au parlé n’est pas facile, des choses très sérieuses étant évoquées avec légèreté. Pour ces représentations, l’action a été transposée en 1968, exactement deux siècles plus tard, heureusement sans forcer le trait, sans tomber dans la satire. L’orchestre (sur scène) a été réduit à sept instrumentistes, remarquables de discipline et de précision. « Le compositeur s’est élevé sans conteste au premier rang », écrivit Melchior Grimm, célèbre critique musical de l'époque, à propos du Huron et du genre opéra-comique en général. A l’issue du spectacle de La Compagnie de Quat’Sous et du Concert Latin, mené avec vaillance par sept chanteurs-acteurs, on était tenté de partager ce point de vue, malgré une connaissance regrettablement limitée de ce type de répertoire.
Marc Vignal
Mise en scène : Henri Dalem Direction Musicale : Julien Dubruque
1er, 2 et 3 novembre : Théâtre Adyar, Paris ; 6 novembre : Théâtre J. Brel, Champs-sur-Marne

Ce 27 octobre à la Cité de la musique, à l’heure où Nicolas Sarkozy regarde la France dans l’œil de la caméra, Fanny Ardant joue Cassandre, celle dont le destin est de ne pas être crue. Il s’agit, dans le cadre du cycle Paul Klee, Polyphonies, du monodrame de Michael Jarrell, créé par Marthe Keller au Châtelet en 1994. Cette fois, c’est en version de concert qu’est donnée cette pièce de musique avec voix parlée, et pourtant le théâtre est bien présent. Jeu de regards : ceux, fascinés, des musiciens de l’Ensemble Intercontemporain, qui vont de leur chef Susanna Mälkki à la comédienne tout de noir vêtue ; celui de Fanny Ardant sur les mains de Susanna Mälkki, qui lui impriment le rythme et le souffle. Inclus dans la musique par la magie du « son Ircam », le texte de Christa Wolf, entre Iliade et Allemagne ex-de l’est, devient une arme. Images : Fanny Ardant, le visage tendu vers la chef, comme en état de voyance, ou se débarrassant de ses chaussures pour mieux s’arrimer à la terre. On la savait tragédienne, depuis Tête d’or de Claudel, il y a longtemps. Soutenue par la musique de Jarrell, elle retrouve sa nature de bête de théâtre.
François Lafon
Photo © Jean Radel

Au théâtre de l’Athénée : L’Egisto de Marco Mazzocchi et Virgilio Marazzoli. Rien à voir avec Egisthe, le deuxième mari de Clytemnestre : c’est d’un personnage de Boccace qu’il s’agit. Rien à voir non plus avec l’ouvrage de Francesco Cavalli, connu pour être le premier opéra italien représenté à Paris, et que l’on a confondu avec celui-ci. Le spectacle est importé de la Fondation Royaumont, laboratoire d’études musicales des plus sérieux et des plus inventifs. Le chef (et ex-baryton) Jérôme Correas s’est passionné pour ce proto-opéra mêlant drame et comédie, pastorale et commedia dell’arte. L’œuvre, créée à Rome pour un public averti, décorée par le Bernin, regorgeait d’allusions, de références, de clins d’œil esthétiques, politiques, linguistiques, religieux. En France, où Mazarin l’avait fait venir, on n’y comprit pas grand-chose. C’est un peu ce qui arrive trois siècles et demi plus tard, avec cette résurrection pourtant exemplaire : bons chanteurs aguerris aux dialectes de l’italien ancien, finement mis en scène par Jean-Denis Monory (le Covielle du Bourgeois Gentilhomme restitué par Vincent Dumestre et Benjamin Lazar), danseurs astucieusement intégrés à l’action, instrumentistes hors-pair (Les Paladins), direction enflammée de Correas. On imagine que le travail a été passionnant. On regrette davantage de n’en saisir que l’ombre portée.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, du 19 au 23octobre. Photo © Didier Saulnier

Soirée Rachmaninoff (avec deux « f », ainsi qu’il l’orthographiait lui-même) par l’Orchestre de Paris à Pleyel : une œuvre de jeunesse, Le Rocher, poème symphonique rimski-tchaikovskien, un tube, le 2ème Concerto pour piano, un dernier feu d’artifice, les Danses symphoniques (1940). Ici plus qu’ailleurs, Paavo Järvi modèle l’orchestre, qui retrouve sa spécificité : sonorités raffinées, solistes superlatifs. Le Cubain Jorge Luis Prats, qui joue le Concerto, est de ces stars du clavier découvertes sur le tard, tels Claudio Arrau, Jorge Bolet ou Nelson Freire. Il ne fait qu’une bouchée des acrobaties requises : grand son, technique de fer, fine musicalité, avec un côté jazzy savamment dosé. En bis, ce gros monsieur à l’œil qui frise donne un mini-récital : quatre pièces qu’il promène sur tous les podiums, à commencer par la Petite boite à musique cassée de Villa-Lobos. Succès assuré. Le piano-spectacle est aussi une forme d’art.
François Lafon

Il reste des places pour Lulu à l’Opéra Bastille. Rien d’étonnant, à revoir le spectacle de Willy Decker donné pour la dernière fois en 2003. Sur l’affiche : la Femme de tous les dangers lovée sur le Canapé Bouche de Salvador Dali et cernée de voyeurs en chapeaux mous. Un cirque coloré, une BD (très) animée, l’antithèse du piège de marbre noir imaginé par Patrice Chéreau et Richard Peduzzi en 1979, lors de la création très médiatisée de la version complétée par le compositeur Friedrich Cerha. Une mise en scène illustrative, voire explicative, mais qui n’empêche pas que cette histoire soit complexe, et la musique d’Alban Berg à tout jamais dérangeante. Interprétation impeccable : Laura Aikin (Lulu) et Jennifer Larmore (la Comtesse), Wolfgang Schöne (Schön) et Franz Grundheber (Schigolch), sous la baguette très sûre de Michael Schonwandt. Remarque saisie à l’entracte : « Ils jouent cela comme du Mozart, mais cela reste un brûlot ». Un classique, en somme.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, les 21, 24, 28 octobre, 2, 5 novembre.

Comment un concert qui peine à décoller finit-il par s’envoler ? La salle Pleyel accueille ce lundi le Russian National Orchestra dirigé par son fondateur et directeur Mikhail Pletnev. La soirée commence avec la version Sibelius de Pelléas et Mélisande. Dans cette pièce inspirée, l’orchestre donne le change mais cherche en vain à faire advenir la magie. On guette le 3ème concerto de Rachmaninov avec Nikolaï Lugansky. Dans le 1er mouvement, l’orchestre et le soliste règlent les équilibres pour ne pas couvrir le piano. On s’inquiète ; on commence même à s’ennuyer. Et tout à coup, le miracle se produit, on est pris par ce qui se passe sans comprendre pourquoi cette interprétation si peu romantique, martelant les phrasés, parvient à nous saisir. La dernière note à peine jouée, standing ovation méritée pour le pianiste. Reconnaissance de la prouesse, mais aussi gratitude pour l’instant magique. La deuxième partie du concert, avec une version arrangée par Pletnev lui-même du Lac des cygnes de Tchaïkovski, bénéficie d’abord de cet instant magique, mais rapidement la flamme s’éteint, la lumière disparaît. On a la même sensation qu’avant le décollage, et l’on s’aperçoit qu’on a déjà atterri.
Katchi Sinna
Salle Pleyel 17 octobre Photo©DR

Escale au théâtre de l’Athénée, du Tour d’écrou de Benjamin Britten, présenté par La Clé des chants (Région Nord-Pas-de-Calais). Un opéra de chambre (six chanteurs, quatorze instrumentistes) tiré d’une nouvelle de Henry James. Difficulté suprême : comment montrer des fantômes ? Dans sa nouvelle, James ne fait que suggérer la présence d’un couple de revenants pourrissant l’âme de deux enfants. Britten leur fait chanter une étrange musique vénéneuse et éthérée. Le metteur en scène Olivier Bénézech les mêle aux vivants, qui sentent ou non leur présence, et parfois les voient. C’est tout simple et cela fonctionne, même si nous sommes loin de l’ambiguïté suggérée, avec davantage d’idées et de moyens, par Deborah Warner (Covent Garden - 1997) ou Luc Bondy (Festival d’Aix-en-Provence - 2001). Sur le plateau exigu de l’Athénée, les corps sont désespérément réels. En revanche la musique, bien chantée, bien jouée par les jeunes instrumentistes de l’Orchestre-Atelier OstinatO, gagne à être entendue de près. Seize scènes, seize interludes, un thème principal comprenant les douze notes de la gamme, et Britten serrant l’écrou jusqu’à l’étranglement final, nous explique le programme. Chapeau bas ! Mais comment le compositeur nous fait basculer dans un monde où l’on n’est plus sûr de rien, cela n’est pas près de s’expliquer.
François Lafon
Théâtre de l’Athénée, Paris, 15 et 16 octobre- Le Phoenix, Valenciennes, 20 octobre - Opéra de Lille, 12, 13 et 15 décembre - Château d’Hardelot, 8 et 9 juin 2012
Photo : © Frédéric Iovino

Aux Bouffes du Nord, concert du Quatuor Zemilnsky. Dans le hall, Pierre-Emile Barbier vend lui-même les enregistrements de son label Praga Digitals. « Ce soir, ils jouent Haydn, Mozart et Beethoven. La salle est pleine et les disques partent. Le seul que je n’arrive pas à vendre, c’est leur album … Zemlinsky ». Affluence en effet pour ces lauréats du Concours de Bordeaux, élèves de Walter Levin (fondateur du Quauor LaSalle) et Josef Kluson (violoncelliste du Quatuor Prazak). Pour le public, tout cela compte : depuis une vingtaine d’années, et grâce à des mordus comme Barbier et Georges Zeisel (créateur de l’association ProQuartet et d’ailleurs présent ce soir), le quatuor à cordes, genre réputé élitiste – donc rébarbatif – est à la mode. Ecoute religieuse de « L’Empereur » de Haydn, sourires entendus quand commence le deuxième mouvement, qui deviendra l’hymne national allemand. Les Zemlinsky perpétuent la tradition bohémienne d’interprétation : riches sonorités, propension à souligner les aspects populaires de cette musique aristocratique. Frantisek Soucek, le premier violon, est fâché avec la justesse, mais il est la pile électrique de l’ensemble. Cela fonctionne dans Beethoven (Quatuor n°18), et surtout dans « Les Dissonances » de Mozart, où l’équilibre classique est à la fois contredit et magnifié. En bis : le finale du Quatuor « Américain » de Dvorak et la Barcarolle de Josef Suk, joués « comme là-bas ». Même pour les accros, la couleur locale est payante.
François Lafon
Photo © Thomas Bican

Wagner à l’Opéra Bastille, avec la reprise de Tannhäuser dans la mise en scène de Robert Carsen. A la première, en 2007, grève des techniciens. Au milieu du plateau vide, une harpe ; chanteurs en costume de tous les jours, atmosphère de répétition. Seiji Ozawa est au pupitre, Matthias Goerne est un grand Wolfram : on ne sort pas frustrés. Aujourd’hui, toujours des grèves. Tannhäuser est menacé, mais la première a lieu. Pas de décors, mais grand ballet de cimaises et de châssis : Tannhäuser est peintre (?), il est rejeté pour avoir puisé l’inspiration dans le cloaque de Vénus, son amoureuse Elisabeth est la seule à comprendre que l’Artiste a besoin du ciel et de l’enfer pour nourrir son imagination. Un subterfuge comme un autre pour gratter le vernis sulpicien de cet auto-plaidoyer du jeune Wagner en guerre contre les Pharisiens. Plateau de premier ordre, correctement dirigé par Mark Elder, avec cette fois le carré d’as Nina Stemme-Sophie Koch-Christopher Ventris-Stéphane Degout, et des chœurs revitaminés. On ne sort pas plus frustrés que la première fois, mais pas moins non plus. A un tel niveau vocal, la dramaturgie perd de son importance.
François Lafon
Opéra National de Paris Bastille, les 9, 12, 17, 20, 23, 26, 29 octobre Photo©Opéra de Paris

Enesco a entrepris neuf symphonies, dont quatre « d’école » et les deux dernières inachevées : trois « officielles », donc. Gergiev dirigea « à la russe » la Symphonie n°3 opus 21 (1918), vaste fresque aux références « dantesques » pour piano, célesta, harmonium, chœur et orchestre. Uniquement instrumentale, la granitique Symphonie n°2 opus 17 (1914) se meut parfois dans l’ombre de Richard Strauss, notamment au début, mais sa rudesse est propre à Enesco. Kocsis, qui ne l’avait jamais abordée, la conduisit par cœur, suscitant un enthousiasme amplement mérité. Grand succès aussi pour Foster avec l’ambitieuse Suite pour orchestre n°3 « Villageoise » opus 27 (1938). Programmée par Rojdestvensky, la cantate Vox Maris opus 31 (1953) s’inscrit moins dans les mémoires que les trois autres partitions ci-dessus, qui comptent parmi les plus fortes du compositeur. Supprimé par le régime communiste en 1971, rétabli après la chute de Ceaucescu, le Festival Enescu a attiré cette année environ 16 000 touristes étrangers. Le Concours International qui lui est intégré n’a décerné de premier prix ni en piano ni en violon. Pour la première fois, il comprenait une section violoncelle : le lauréat, Tian Bonian, un Chinois, a interprété de façon mémorable le concerto de Dvorak.
Marc Vignal

Les artistes invités au Festival George Enescu sont censés jouer Enesco : pour la 20ème édition, ce ne fut pas toujours le cas. Dirigeant les 13 et 14 septembre la Staatskapelle de Berlin, Daniel Barenboim interpréta deux concertos de Mozart (les 24e et 22e) de façon assez précieuse, mais donna le meilleur de lui-même dans la Septième Symphonie de Bruckner et la Dante Symphonie de Liszt. Ses collègues, eux aussi, firent entendre un vaste panorama de compositeurs. Guennady Rojdestvensky choisit naturellement Prokofiev : deux œuvres, dont une mémorable intégrale d’Ivan le Terrible. Valery Gergiev et « son » orchestre du Mariinsky, terminèrent leurs deux concerts « en puissance », avec respectivement Une Vie de Héros de Richard Strauss et les Tableaux d’une Exposition. L’Orchestre Symphonique Gulbenkian et Lawrence Foster, grand spécialiste d’Enesco, s’imposèrent avec la symphonie The Age of Anxiety de Leonard Bernstein (en soliste la remarquable pianiste roumaine Dana Ciocarlie). A la tête de la Philharmonie Hongroise, Zoltan Kocsis se révéla une fois de plus chef d’orchestre d’exception, mais Boris Berezovsky joua le 2e concerto de Bartok sans subtilité. Et Enesco dans tout cela ?
Marc Vignal
(suite et fin demain)

Violoniste (un des plus fameux de son temps), pianiste, chef d’orchestre et pédagogue, George Enesco fut essentiellement compositeur, le plus éminent qu’ait produit la Roumanie. C’est ainsi que, depuis 1958, un Festival International, qui a lieu tous les deux ans, porte son nom. Considéré par Pablo Casals comme « le plus grand phénomène musical depuis Mozart », Enesco avait déjà donné à vingt ans plusieurs œuvres importantes, dont le Poème roumain opus 1 (1897) et l’Octuor à cordes opus 7 (1900). Seules ses deux Rhapsodies roumaines opus 11 (1901), et sans doute aussi sa splendide Sonate pour violon et piano n°3 « dans le caractère populaire roumain » opus 25 (écrite en 1926 alors qu’il a vingt-cinq ans), bénéficient d’une notoriété certaine. C’est regrettable. Son style musical est certes inhabituel, surtout du point de vue rythmique et polyphonique, mais se définit également par sa puissance et son pouvoir de suggestion. Son penchant pour l’autocritique limita sa production officielle, mais il composa sans relâche : sa testamentaire et complexe Symphonie de chambre opus 33 date de 1954, un an avant sa mort. De ce Français d’adoption, la partition majeure, l’opéra Œdipe, fut créée à Paris au Palais Garnier en 1936. Le vingtième Festival International George Enescu (Enesco est la francisation de son patronyme) s’est tenu du 1er au 25 septembre 2011 à Bucarest et dans sept autres villes roumaines : plus de 160 événements dont 90 concerts et spectacles, 100 solistes et 65 ensembles musicaux dont 31 orchestres et 3 corps de ballet. Y assister permet de saisir l’ampleur et la variété de la vie musicale dans ce pays.
Marc Vignal
(suite demain)

Première de Faust à l’Opéra Bastille, dans la nouvelle mise en scène de Jean-Louis Martinoty. Au quatrième acte, ce sont les bourgeois qui chantent « Gloire immortelle de nos aïeux », pendant que les soldats, éclopés, défilent en silence. La référence est raffinée : en 1975, dans la mise en scène de Jorge Lavelli (donnée jusqu’en 2003), les éclopés chantaient eux-mêmes, sous les huées du public. Aujourd’hui, l’acte de défaitisme ne choque plus personne, et Martinoty explique qu’il est fier d’avoir corsé la situation. Tout est à l’avenant dans le spectacle : le sexe, la science et la religion sont surexposés, les situations grassement soulignées. Il doit s’agir de retrouver le parfum de scandale. Peine perdue : Faust est plus que jamais l’emblème du vieil opéra, même si Méphisto est habillé en Monsieur Loyal, même si Marguerite est court vêtue. De belles idées pourtant : l’Air des bijoux transformé en flirt avec le Diable, ou le vieux Faust contemplant son jeune avatar. Le spectacle est à la gloire de Roberto Alagna, rock star à la diction fluide et à l’aigu brillant. Les autres sont perdus dans la foule. C’est juste si l’on remarque Paul Gay, Méphisto à la française rappelant Roger Soyer, le premier interprète de la production Lavelli. Le chef Alain Altinoglu (né en 1975) maintient les troupes et épouse les tempos du ténor. Ce dernier ne s’est pas entendu avec Alain Lombard, dont ce devait être la rentrée à l’Opéra, et qui a quitté le navire. Dommage : il y aurait eu quelque chose de faustien dans l’affrontement de ces deux egos.
François Lafon
Gounod : Faust. Opéra National de Paris Bastille, les 1, 4, 7, 10, 13, 16 (matinée), 19, 22, 25 octobre. En direct sur France 3 le 10 octobre.

Ouverture de la saison au Châtelet avec Cruzar la Cara de la Luna (Gagner l’autre côté de la Lune), un opéra mariachi signé José « Pepe » Martinez. Trompettes y sombreros en version lyrique ? D’une certaine manière. Il s’agit en fait d’un musical créé au Houston Grand Opera dans le cadre de l’opération Songs of Houston, une série de commandes mettant en scène les diverses communautés peuplant la capitale du Texas. Là bas, cette romance convoquant trois générations, depuis le grand-père parti du Mexique pour chercher fortune dans le nord jusqu’à la petite fille qui ne sait plus que quelques mots d’espagnol, est ancrée dans le quotidien. Ici, on est charmé par la musique (excellent Mariachi Vargas de Tecalitlán : six violons, trois trompettes, harpe, guitare, guitarrón et vihuela) et séduit par le professionnalisme de la troupe, où chanteurs classiques et voix traditionnelles se marient sans fausse note. A la troisième des six représentations, samedi soir, la salle est enthousiaste, mais loin d’être pleine : les rythmes hispaniques attirent moins que les feux de Broadway. C’était déjà arrivé il y a deux ans avec Magdalena de Villa-Lobos. C’est dommage : en matière d’entertainment, ce côté de la Lune vaut bien l’autre.
François Lafon
Au Châtelet, Paris, les 25 (matinée et soirée), 26 et 27 septembre.

Rentrée de Myung-Whun Chung à la tête du Philharmonique de Radio France à Pleyel. Au programme, deux œuvres nées sur le même sol (Salzbourg - Linz), mais séparées par un siècle et tout un monde : le Concerto pour hautbois de Mozart et la 6ème Symphonie de Bruckner. Dans ce Mozart galant, contemporain du Concerto pour piano « Jeunehomme », Chung prépare Bruckner : articulations abruptes, cordes capiteuses. Le Philharmonique, très en forme, le suivra dans sa volonté de hisser à la hussarde la mal aimée des Symphonies de Bruckner à la hauteur de ses voisines. Contraste entre les œuvres, contraste entre les interprètes : François Leleux joue Mozart. En bis : transcription du 2ème air de la Reine de la Nuit. Nasillard, le son du hautbois ? Ce soir, c’est la plus belle, la plus virtuose des voix que l’on entend. C’est Chung qui avait engagé Leleux dans l’Orchestre de l’Opéra de Paris à sa sortie de Conservatoire. La star revient au bercail.
François Lafon

Avant de partir pour Londres en 1762, Johann Christian Bach, le dernier fils de Johann Sebastian, s’était engagé à composer deux opéras pour le King’s Theatre. Le second, Zanaïda, y fut créé le 7 mai 1763. Huit airs furent immédiatement publiés, en réduction pour clavier et sous le titre de Favourite Songs (Chansons favorites), le reste disparut. Miracle : en 2010, le manuscrit autographe a refait surface dans une collection privée aux Etats-Unis, sans toutefois que puisse être précisé quel avait été son itinéraire durant deux siècles et demi. Résultat : en 2011, Zanaïda a été ressuscité en Allemagne, et maintenant à Paris en version de concert. Le livret, d’après Siface de Pietro Metastase, traite de rivalités amoureuses et politiques consécutives à une guerre entre la Perse et la Turquie. Or sur une intrigue d’un type déjà passablement usé, le jeune Johann Christian - compositeur n’ayant rien de « baroque » - écrivit une musique belle et originale relevant pleinement du « classicisme » en ses débuts, ouvrant grand les portes d’une époque illustrée notamment par Mozart (sept ans en 1763) : trois actes, vingt-trois scènes, neuf personnages, airs évitant soigneusement le traditionnel da capo, orchestre aux sonorités inventives, avec clarinettes. A retenir : les 11 et 12 février 2012, Zanaïda sera donné en version scénique au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Marc Vignal
Zanaïda. Opera Fuoco. Direction musicale : David Stern Paris. Cité de la Musique. 15 septembre

Dynastie Borgia à la Cité de la musique, dans le cadre du cycle Passions – Le désordre amoureux. Diable ! A l’heure où Canal + annonce une nouvelle série à grand spectacle sur le sujet (« Borgia : n’ayez pas foi en eux »), le - comment dire ? - concert, spectacle, happening ? - imaginé par Jordi Savall promet de sulfureuses émotions. Il s’agit en fait d’un condensé du livre-disque (3 CD) paru l’année dernière (Alia Vox – Soleil de Musikzen.fr). Programme en main, on suit en six siècles, sept chapitres et trente-trois stations musicales l’ascension de la famille Borja de Valence devenue la dynastie Borgia en Italie. Une dynastie moins infréquentable qu’il n’y paraît : on croise deux papes (Calixte III et Alexandre VI), un saint (François), et une femme d’action en avance sur son temps (eh oui, Lucrèce). Chant arabe, chants d’église, fanfares guerrières, requiem, divertissements, actions de grâce se succèdent. Sur scène, dirigé de l’archet par Savall, l’ensemble Hesperion XXI est plus que jamais à géométrie variable. Impression générale : le melting pot culturel ne date pas d’hier, il a semé mort et merveilles. Hier soir, nous avons eu les merveilles.
François Lafon

Hier, quarante-neuvième représentation de La Clémence de Titus à l’Opéra de Paris. L’ouvrage, aujourd’hui considéré comme un des « big seven » de Mozart, n’est entré au répertoire qu’en 1987. Le spectacle, signé Willy Decker, date de 1997. En 2005, il a été temporairement remplacé par une reprise de la production célèbre mais plus ancienne encore (Bruxelles - 1981) de Karl Ernst Hermann. Esthétiquement et dramatiquement, les deux se ressemblent, sauf que celle-ci est moins pertinente, moins mémorable : trop de jeux de scène parasites pour animer l’alternance air-récitatif. La distribution est de premier ordre : Klaus Florian Vogt (le Lohengrin de Bayreuth, vu sur Arte cet été), Stéphanie d’Oustrac, Hibla Gerzmava (une soprano grand format venue d’Abkhazie), sous la direction du spécialiste Adam Fischer. Le public applaudit sans excès, comme refroidi par le bloc de marbre au centre de la scène, qui devient un buste géant de l’empereur, et qui rappelle que La Clémence de Titus est un retour au vieil opera seria, alors que la musique, contemporaine de La Flûte enchantée, est du plus bouleversant Mozart.
François Lafon
Opéra National de Paris, Palais Garnier, les 15, 20, 23, 26, 30 septembre, 5 et 8 octobre.

Une reprise pour l’ouverture de la saison de l’Opéra de Paris. Une reprise, vraiment ? En 1994, le metteur en scène André Engel monte Salomé de Strauss. Honnête succès, deuxième série de représentations en 1996, puis plus rien. En 2003, nouvelle production, avec Karita Mattila, dans une mise en scène de Lev Dodine. Déception : on cherche l’illustre animateur du Théâtre Maly de St Pétersbourg dans ce vilain péplum à dominante jaune (la lune ?). Surprise : c’est la version Engel qui revient aujourd’hui. On y gagne. Sans être du grand Engel (Lady Macbeth de Mzensk, Cardillac, Louise), cette Salomé enfermée dans un somptueux palais-souk signé Nicky Rieti est plus originale qu’il n’y paraît : brouillage des époques (plus subtil que l’actualisation à tout faire qui sévit un peu partout), révision des stéréotypes (le prophète débarrassé de son look christique), effets pertinents (l’éclipse de lune). Formidable direction d’acteurs aussi : valse mortelle d’Angela Denoke (une Salomé de rêve : ah, ces notes « flottées »!) avec Stig Andersen, Hérode politique autant que concupiscent. A venir : La Clémence de Titus, monté par Willy Decker en 1997, remplacé un temps par la version célèbre de Karl- Ernst Hermann (1981). A l’opéra, l’histoire se répète. Tant qu’elle ne bégaie pas...
François Lafon
Salomé, Opéra National de Paris Bastille, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 30 septembre.

Les Solistes aux Serres d’Auteuil, douzième édition. Une vingtaine de concerts dont cinq « cartes blanches » à un soliste avec un partenaire de son choix. Concept simple, public fidèle. L’institution est pourtant menacée : une douzaine de serres va disparaître, pour laisser la place à une extension de Roland-Garros. L’année prochaine, ou la suivante si les pétitions des riverains sont prises en considération, les essences rares vont être replantées dans les serres historiques, dont celle où ont lieu les concerts. Hier, récital du pianiste Geoffroy Couteau, un élève de Bruno Rigutto et Nicholas Angelich, un jeune dont on parle. Le programme est aussi original que périlleux : du Charles-Valentin Alkan, dit le Berlioz du piano, du Hélène de Montgeroult, la compositrice de l’Empire (le 1er), une Etude d’exécution transcendante (Wilde Gast) de Liszt, quatre Etudes de Chopin (dont la « Révolutionnaire »), plus une pièce de Rodolphe Bruneau-Boulmier (né en 1982) intitulée Ses ailes déployées, inspirée de la figure de l’ange décrite par le philosophe-critique Walter Benjamin. Les morceaux de bravoure s’enchaînent, les doigts suivent, la tête aussi, les moyens sont imposants. On rêve d’un peu de douceur, qui arrive en bis, avec le premier des trois Intermezzos opus 117 de Brahms. Moment de grâce. Qui peut le plus…
François Lafon
Les Solistes aux Serres d’Auteuil, vendredi, samedi et dimanche, jusqu’au 11 septembre.
www.ars-mobilis.com

Récital Kathia Buniatishvili à l’Orangerie de Sceaux. Un événement presque incongru : le festival de l’Orangerie – quarante-deux ans d’existence, mille quatre cent cinquante concerts – est une institution estivale. Jacqueline Loewenguth, belle sœur du créateur, le violoniste Alfred Loewenguth, y accueille des artistes choisis pour un public d’habitués. Avec cette star de vingt-quatre ans, que s’arrachent orchestres et festivals, c’est le show biz classique qui investit le lieu. Sanglée dans un fourreau en lamé noir (il est 17h30 et l’on peut voir, par les baies, les promeneurs en short), l’artiste attaque la Fantaisie de Schumann dans un esprit de conquête : doigts infaillibles, sonorité variée, mais sur-lignage expressif permanent. Décuplés par l‘acoustique réverbérée de l’endroit, les forte claquent, les piani murmurent, les foucades se font orageuses. Kathia Buniatishvili bouscule la barre de mesure alla Argerich et sollicite le texte. D’émotion, point, ou trop fabriquée pour être communicative. Efficace dans les folies digitales de la Méphisto-Valse de Liszt, le système s’essouffle dans Chopin et tourne au remix dans les 3 Mouvements de Petrouchka de Stravinsky. Public partagé : on adore ou l’on déplore. De quoi alimenter le buzz, puisque c’est de cela, apparemment, qu’il s’agit.
François Lafon

Création mondiale, hier à Saint-Eustache, d’Art de la fugue odyssée de Pierre Henry. Autour du public : une forêt d’enceintes. Au milieu, le maître lui-même à la console. Seul éclairage : un mur de cierges. Quand il ne transforme pas sa propre maison en henryophone géant pour un public choisi (il l’a encore fait ce printemps), le démiurge de l’électroacoustique aime réunir ses fidèles et faire trembler les voûtes gothiques. « Ce rêve de fugues entrecroisées s’accordant les unes aux autres comme dans un même voyage. Un voyage odyssée-occident-orient où l’âpreté tribale s’oppose à des variations de rites inconnus ». Comprenne qui pourra. Son Bach revisité fuse et tournoie, écrase et élève, mêle orgue, orchestre, voix d’ailleurs et sons non-identifiés. Tout cela se tient, et a même une certaine gueule. En deuxième partie : la Messe de Liverpool, composée en 1967, en même temps que les jerks électroniques de Messe pour le Temps présent, le ballet de Béjart. Les nostalgiques retrouvent le Pierre Henry bruitiste de l’époque, d’autres décrochent. Paris Quartier d’été consacre toute la semaine à ce solitaire touchant et mégalomane : Le Livre des morts égyptien, Ceremony, Requiem profane, 666 d’après l’Apocalypse de Jean sont au programme. Il ne manque que Dieu, son oratorio monstre d’après Victor Hugo.
François Lafon
Pierre Henry, 7 concerts à Saint-Eustache. Jusqu’au 1er août.

Danse dans la nef de l’église St Eustache, sous le grand orgue Van den Euvel, avec Annonciation d’Angelin Preljocaj, dans le cadre de Paris Quartier d’Eté. C’est le spectacle le plus court de l’année (20 minutes), donné quatre fois en deux jours. Créée en 1995, entrée au répertoire de l’Opéra de Paris l’année suivante, filmée en 2002 avec un soin particulier, la pièce est une des plus connues de Preljocaj. C’est un pas de deux entre une petite blonde (la Vierge) et une grande brune (l’Ange), une merveille toute simple mais très pensée : « Ce que l’on appelle aujourd’hui l’art conceptuel ne serait-il pas, plutôt qu’un art abouti, l’annonce d’un art nouveau ? » se demande le chorégraphe. La musique, pensée elle aussi, n’est pas moins simple, et efficace : prémonition sur des rires enfantins, illumination sur le Magnificat de Vivaldi (dirigé par Michel Corboz), dialogue avec l’Ange sur des sons électroniques de Stéphane Roy (Crystal Music). L’église est comble, le public ravi. Preljocaj n’est jamais aussi bon que dans les petites formes. Celle-ci, en tout cas, est déjà un classique. Jusqu’au 24, dans la cour des Invalides : Empty Moves I & II. Dans Annonciation, Angelin joue à l’Ange. Dans Empty Move, Preljocaj salue John Cage. Très pensé, tout cela.
François Lafon
Photo © Jean-Claude Carbonne

Paris l’été, ville morte ? Pour le mélomane (et l’amateur de théâtre, de ballet, etc.), oui. Ou presque. Il faut bien chercher. Il y a le consensuel Paris Quartier d’été, et à peu près rien, si ce n’est le festival Jeunes talents, dont la localisation (l’hôtel de Soubise, alias les Archives Nationales) rappelle le légendaire Festival du Marais, et dont la programmation a des airs de Festival Estival, légendaire lui-aussi, et datant de l’époque où l’on pouvait aller tous les soirs au concert pendant la période où la ville dort. Hier, concert dans la Salle des Gardes, où Jeunes talents donne sa saison d’hiver, la plus estivale cour de Guise étant impraticable pour cause de mauvais temps. Au programme : Brahms, Schubert et Nicolas Bacri, le compositeur en résidence cette année. Salle pleine, public de mordus, voire d’habitués, allant du très jeune au très âgé, honnête succès pour le pianiste François Dumont et le violoniste Julien Szulman - qui participait, il y a quinze jours à Gaveau, au concert de l’Académie Seiji Ozawa. Aujourd’hui, Handel et Purcell par un contre-ténor néerlandais. Demain, le Trio Paul Klee dans un programme Liszt, Takemitsu, Chostakovitch. Du sérieux, dans une atmosphère familiale, et, peut-être, la chance d’être les premiers à entendre des stars de demain. Une entreprise d’utilité publique, en somme.
François Lafon
Jeunes talents. Tél. 01 40 20 09 34 – www.jeunes-talents.org – (Photo : Nicolas Bacri et ses interprètes)

Concert, salle Gaveau, des stagiaires de la Seiji Ozawa International Academy Switzerland. Salle pleine, mais sans plus : un concert de fin de session, ce n’est pas toujours drôle, et la communication (c'est-à-dire la publicité) n’a pas insisté sur le fait qu’Ozawa lui-même y fait un discret come back, après une année de lutte contre une « longue maladie ». En première partie, des mouvements de quatuors : six formations pour la plus dure des disciplines. Le niveau est haut, mais le « tous pour un, un pour tous » ne fonctionne pas toujours. Il y en a qui font cavalier seul, d’autres qui abdiquent devant les partenaires. Après l’entracte, 2ème et 3ème mouvements de l’Octuor à cordes de Mendelssohn. Le groupe est cohérent, la tension monte, la salle est chauffée. Avec l’Académie au complet, Robert Mann, fondateur de l’illustre Quatuor Juilliard et professeur in loco (les autres sont, entre autres, la violoniste Pamela Frank et la grande altiste Nobuko Imai) donne son arrangement du Lento du dernier Quatuor de Beethoven. Cela ferait un beau final si Ozawa lui-même ne venait faire basculer l’ensemble dans une autre dimension. Le Divertimento en ré majeur de Mozart, en bis le premier mouvement de la Sérénade de Tchaikovski et l’on oublie l’exercice d’élèves. On n’entend plus que des virtuoses galvanisées par un petit homme au charisme ravageur.
François Lafon
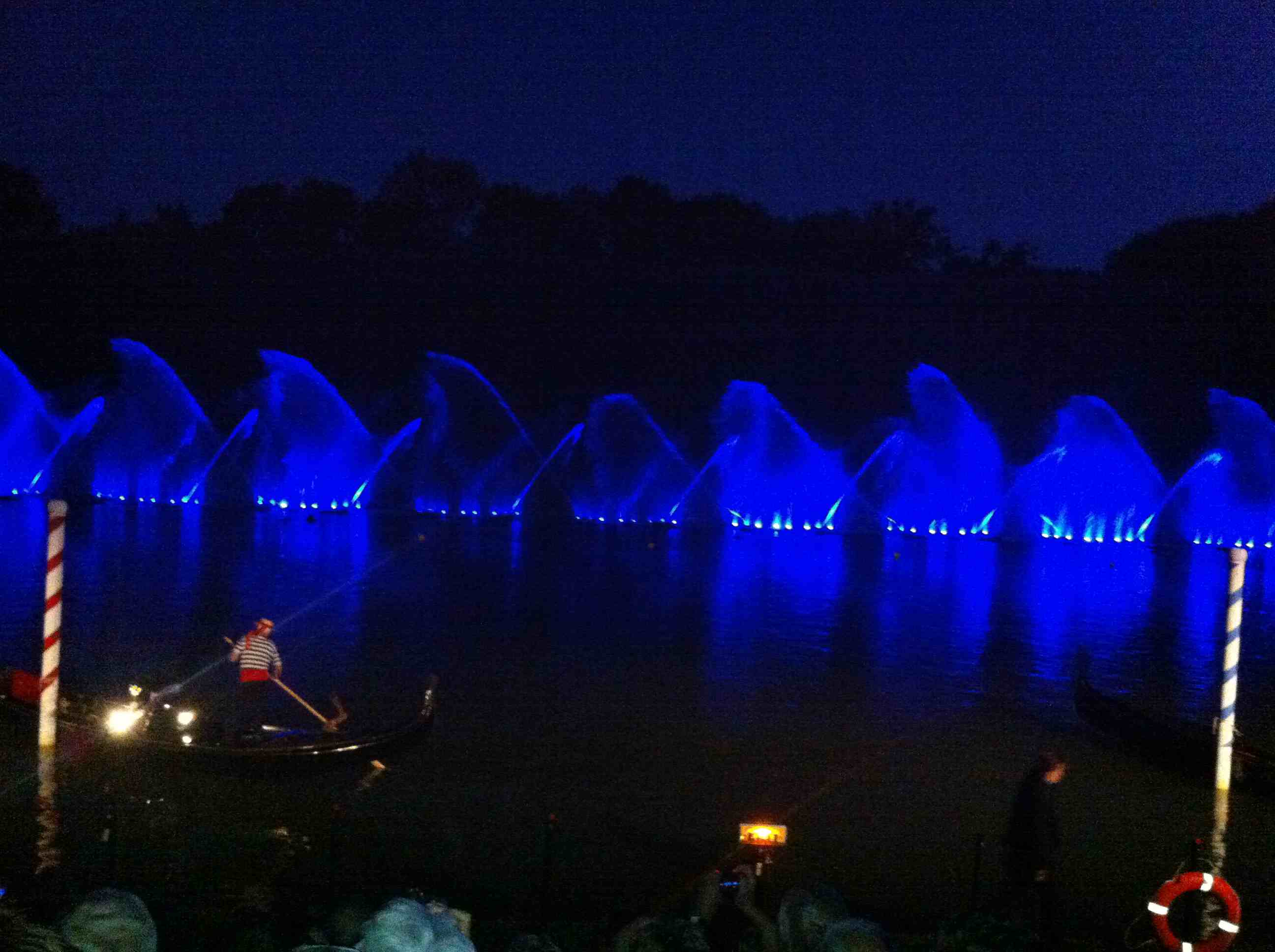
Venise – Vivaldi – Versailles : curieux alliage, avec fêtes Louis XIV pour un compositeur dont la renommée est arrivée en France à l’époque de Louis XV. Mais les trois V sont magiques, et le concept fonctionne. Hier, au Château, Galerie de Batailles, Rinaldo Alessandrini et son Concerto Italiano inaugurent le cycle Quatre Saisons (trois autres concerts suivront, avec, entre autres, David Grimal jouant les Quatre Saisons … de Buenos Aires d’Astor Piazzolla). Deux séances, public nombreux. Sonorités dorées, contrastes bien amenés : la musique trop connue se refait une beauté. Quand arrive "L’Automne" (3ème Concerto), le soleil couchant vient réchauffer les musiciens. L’art et la nature : du pur Vivaldi. Sur le Grand Canal, Quatre Saisons encore, mais façon Sons et Lumières. Foule énorme, gradins bondés, ballet de gondoles, jets d’eau colorés, dragon enflammé, ciel embrasé. Il y a même deux Fiat 500 roulant sur l’eau (La Dolce Vita ?). Mais tout cela manque de folie, et la sono sature. On rêve aux gondoles traversant le parc enneigé dans le Molière d’Ariane Mnouchkine. Or pur côté cour, ersatz côté jardin : l’ancien régime n’est pas si loin.
François Lafon
Venise – Vivaldi – Versailles, jusqu’au 17 juillet

Pas facile, le métier de chef d’orchestre ! Prenez Philippe Jordan, directeur musical de l’Opéra de Paris. Lundi 20, il dirige Cosi fan tutte de Mozart au Palais Garnier. Une reprise de la sage production d’Ezio Toffoluti, qui date de 1996. Distribution standard, dominée par la piquante Anne-Catherine Gillet en soubrette à qui on ne la fait pas. Une façon pour lui de se reposer d’un Crépuscule des dieux qui n’a pas fait l’unanimité (sauf pour lui). Or voilà que les fumigènes censés, au lever du rideau, ajouter du sfumato au décor partent dans la fosse. Les musiciens jouent à l’aveuglette, l’ouverture est ratée. Jordan, qui connaît pourtant son Cosi sur le bout de la baguette, mettra le premier acte entier à empêcher le bateau de tanguer. Mardi 21, Fête de la musique. Kurt Masur dirige l’Orchestre National dans la nef du Musée d’Orsay et Paavo Järvi l’Orchestre de Paris sous la Pyramide du Louvre. Eternelle rivalité. Au Louvre, programme Schumann : Konzertstück pour quatre cors et Symphonie « Rhénane ». Curieux choix pour une fête. Non moins curieux, et qui justifie l’entreprise : cette musique passe bien dans ce hall de marbre au plafond de verre, les cornistes ont l’air de bien s’entendre (dans tous les sens du terme) et Järvi donne-là un des meilleurs concerts de sa première saison comme directeur de l’orchestre. Ovation d’un public assis par terre. Le confort n’est pas toujours où on l’attend.
François Lafon

Comment résister à l’annonce d’un Placido Domingo dans un opéra composé et écrit pour lui par son ami Daniel Catán, compositeur mexicain d’origine russe actif en Californie, mort il y a deux mois ? Après la création en septembre 2010 à l’Opéra de Los Angeles (dont Domingo est directeur), la version parisienne du Postino reprend l’essentiel de la version américaine. Malgré la différence d’âge, Placido Domingo exulte dans le rôle de Neruda jeune, et la partition est taillée à ses mesures : la montée en force progressive soigne la voix, et le livret lui donne maintes occasions de faire preuve de ses talents de comédien. C’est Catán lui-même qui a écrit ce livret en suivant à la lettre le scénario du film de Michael Radford avec Philippe Noiret. Il invoque en plus Dante, d’Annunzio et un certain Milovan Perkovitch de fiction, mais ne fait qu’effleurer le thème, pourtant central, de l’exil (pas seulement celui de Neruda, mais celui de tout homme, car nous sommes tous des exilés), et maintient l’œuvre en Italie sans que rien n’évoque l’Italie – même les scènes de rues renvoient à Santiago du Chili. Ce mode de butinage se retrouve dans la partition. Catán était obsédé par l’idée de faire un opéra espagnol, et dit être redevable de « compositeurs allant de Monteverdi à Berg ». Mais c’est moins d’influence que d’emprunts épars qu’il s’agit. Tous les genres (hors la musique atonale) sont à l’appel, ou presque, quoi qu’il se passe sur scène : Debussy parfois, Puccini souvent (et immanquablement dans les duos), Ravel plus rarement, et aussi le flamenco (qui plus est dans une scène de mariage, il y a pourtant plus festif), le tango, les musiques de fanfare municipale, et l’accordéoniste elle-même ne sait guerre d’où elle est (Amérique du Sud ou Montmartre, difficile à dire). C’est ainsi un World Opera que Catán nous sert, tout comme on parle de World Food. Et comme on le sait, même avec les meilleurs ingrédients, la World Food n’est pas gage de qualité, tout au moins en Europe. Après deux heures que tous les talents réunis ne parviennent pas à faire passer légèrement, l’ensemble laisse perplexe, tout comme la sentence finale : « Si ma voix tremble, c’est que la mer se lamente ».
Albéric Lagier
Théâtre du Chätelet 20, 24, 27 et 30 juin

Le chef d’orchestre Simon Rattle a déclaré une fois que le compositeur avec qui il aimerait diner et passer une soirée était Joseph Haydn, pour son esprit et sa curiosité de tout. Pour entendre en sa compagnie sa symphonie n°64 ? Relativement peu connue, cette symphonie en la majeur de la seconde moitié de 1773 est une des plus fascinantes du musicien d’Eszterhaza. A la plus extrême concentration, elle allie la souplesse et la séduction mélodique, ce à quoi vient s’ajouter, dans ses deuxième et quatrième mouvements, une grande complexité formelle. L’étrange et sublime Largo, d’une sensibilité à fleur de peau, a tout d’une fantaisie, et le finale présente en moins de trois minutes les multiples facettes d’une idée unique. Rattle et l’Orchestra of the Age of Enlightenment ont commencé avec cette 64ème leur concert dans le cadre du Festival Mozart du Théâtre des Champs-Elysées. Peu d’œuvres aussi discrètes d’apparence sont à ce point aptes à mener sans préparation un auditoire vers les sommets du « style classique ». Il faut dire que du Largo, Rattle a tiré le maximum. Le concert s’est poursuivi, toujours en beauté, avec le concerto pour deux pianos (joué au pianoforte par les Katia et Marielle Labèque) et la symphonie n°33 de Mozart, pour se terminer avec la 95ème de Haydn. Il est sûr que sans le souvenir obsédant de la 64ème, l’impression d’ensemble n’aurait pas été la même.
Marc Vignal
Théâtre des Champs-Elysées Samedi 18 juin, 20h (Photo DR)

Un Festival Mozart au Théâtre des Champs-Elysées, comme un écho de celui qu’organisait chaque année Daniel Barenboim du temps où il était directeur de l’Orchestre de Paris. Cette fois, on commence par Idomeneo, le jeune Jérémie Rhorer est au pupitre de son Cercle de l’Harmonie, la mise en scène et la scénographie sont signées Séphane Braunschweig. Sons d’époque et images contemporaines : un spectacle à la mode, en somme. Sur scène, une coque de bateau transformable en bois strié, façon Buren. Costumes modernes pour cette tranche de mythologie dont la psychanalyse fait son miel : antagonisme père-fils, hérédité, culpabilité. Selon Braunschweig, la quotidienneté des costumes et des attitudes rapproche le mythe de nous. Pas sûr : chacun joue, fort bien, « comme au cinéma », mais peine à trouver l’ampleur dramatique requise. Rhorer va dans le même sens : direction élégiaque, assez lente, équilibre millimétré des chœurs et des ensembles. Comme les voix ne sont pas grandes, cela donne un Idoménée de chambre, qui se souvient de son ancêtre, la tragédie lyrique française de Campra. Pourquoi pas ? On savoure le style de Richard Croft (Idoménée), la fraîcheur de Sophie Karthauser (Ilia). Pour un Idoménée grand format, on reviendra à l’enregistrement de René Jacobs, paru il y a deux ans.
François Lafon
Théâtre des Champs-Elysées, le 19 juin à 17h, les 21 et 22 juin à 19h30. Version de concert le 9 juillet au Festival de Beaune.

Arts réunis au Grand Palais, avec un concert Karlheinz Stockhausen- Salvatore Sciarrino (festival Agora) dans les replis de Leviathan, structure géante signée Anish Kapoor dans le cadre de l’exposition Monumenta 2011. « Le Leviathan d’Anish Kapoor est un lieu de rencontre, d’émotion de surprise. C’est pour cela que l’oeuvre accueille, pour des rendez-vous intimes, des artistes, des musiciens, un écrivain, des danseurs ou un jongleur ». Ce soir, en fait de rendez-vous intime, c’est une foule impressionnante (deux-cents mètres de queue, dehors) qui se presse autour des musiciens de l’Ensemble musikFabrik, venus de Cologne. Au programme, des œuvres que l’on croirait réservées à un cadre intime : deux Stockhausen (In Freundschaft – En toute amitié – pour cor solo, et Oberlippentanz – Danse de la lèvre supérieure – pour trompette piccolo) et un Sciarrino (Mur d’horizon, pour flûte en sol, cor anglais et clarinette basse). On entend assez bien, somme toute, ces pièces à la fois austères et acrobatiques. Il y a, sur les galeries, des visiteurs facétieux qui ne sont pas venus pour la musique : cris d’oiseaux, effets d’échos, rires appuyés. Il y en a aussi qui veulent tester l’acoustique du lieu encombré de l’énorme ballon marron en courant d’un point à un autre de la nef. Une foule insaisissable – ni tout à fait musique contemporaine, ni vraiment faune d’expositions. Des jeunes couples comme il faut, des messieurs en complet gris. Depuis un mois, l’installation du radical Kapoor fait un tabac. Alors pourquoi pas un peu de musique avec, façon Arte povera ? Agora, inauguré le 8 juin à l’IRCAM par le spectacle Luna Park de Georges Aperghis, y a en tout cas trouvé un public.
François Lafon
 Vedette en février de Présences, le festival de Radio France, Esa-Pekka Salonen revient au pupitre de l’Orchestre de Paris. Au programme : Debussy (La Mer), Ravel (Concerto en sol), Beethoven (7ème Symphonie). Standing ovation du public, mais aussi des musiciens, ce qui est plus rare. Pour lui, ils jouent comme ils ne le font pas toujours : bois à la fête dans Beethoven, cordes de velours dans Debussy. Fête aussi de voir Salonen diriger : économe de ses mouvements, directif mais pas trop, fascinant tel ou tel groupe du seul regard. La Mer est passée au scanner et miroite à l’infini : on comprend mieux sa réputation d’ « acte fondateur de la musique du XXème siècle ». Délices aussi dans Ravel - rythmes jazzy de l’Allegramente et grand souffle de l’Adagio -, avec l’original David Fray au piano. Grand style chez Beethoven : rien à voir, en janvier dernier à Pleyel, avec cette même 7ème hollywoodisée par Gustavo Dudamel, successeur de Salonen à Los Angeles. « Il a l’air naturel, ce chef », entend-on à la sortie. Le plus juste compliment qu’on puisse lui faire.
Vedette en février de Présences, le festival de Radio France, Esa-Pekka Salonen revient au pupitre de l’Orchestre de Paris. Au programme : Debussy (La Mer), Ravel (Concerto en sol), Beethoven (7ème Symphonie). Standing ovation du public, mais aussi des musiciens, ce qui est plus rare. Pour lui, ils jouent comme ils ne le font pas toujours : bois à la fête dans Beethoven, cordes de velours dans Debussy. Fête aussi de voir Salonen diriger : économe de ses mouvements, directif mais pas trop, fascinant tel ou tel groupe du seul regard. La Mer est passée au scanner et miroite à l’infini : on comprend mieux sa réputation d’ « acte fondateur de la musique du XXème siècle ». Délices aussi dans Ravel - rythmes jazzy de l’Allegramente et grand souffle de l’Adagio -, avec l’original David Fray au piano. Grand style chez Beethoven : rien à voir, en janvier dernier à Pleyel, avec cette même 7ème hollywoodisée par Gustavo Dudamel, successeur de Salonen à Los Angeles. « Il a l’air naturel, ce chef », entend-on à la sortie. Le plus juste compliment qu’on puisse lui faire.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 8 et 9 juin.

Hier vendredi, un cordon de CRS, armes en bandoulière, protège l’Opéra Bastille d’une manifestation d’Indignés … qui ne viennent pas. Pendant ce temps, se termine la première Tétralogie maison depuis 1962. Ce sont les dieux, là, qui ne sont pas venus. Après avoir lancé des pistes modernes, postmodernes, politiques, numériques et cartoonesques, le metteur en scène Günter Krämer rend les armes avec Le Crépuscule des dieux. La Walkyrie s’est embourgeoisée, le vilain fils du Nibelung se venge du stupide Siegfried sous les lampions d’une fête triste, un Walhalla virtuel s’écroule sur une scène vide. Cela pourrait être fort, ce n’est qu’anodin. Cela, au moins, réussit au chef Philippe Jordan, qui dirige ces cinq heures de théâtre exsangue comme un poème symphonique géant avec voix obligées. De belles voix d’ailleurs, à la mesure du drame dont nous sommes privés. La veille, nième reprise des Noces de Figaro dans la mise en scène de Giorgio Strehler. Beau plateau, avec la star Erwin Schrott et la stylée Dorothea Röschmann, dirigés par Dan Ettinger, un jeune chef à poigne et à personnalité, qui serait enthousiasmant s’il ne cultivait pas, jusque dans La Folle Journée, une lenteur chère à son maître Daniel Barenboim. Dehors, même cordon de CRS, mais quelques manifestants, benoitement assis par terre. Strehler, disciple de Brecht, croyait, lui, aux lendemains qui chantent.
François Lafon
Le Crépuscule des dieux, les 8, 12, 18, 22, 26, 30 juin. Les Noces de Figaro, les 5 et 7 juin. (En photo : Philippe Jordan)
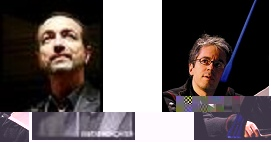
Vendredi soir, au bar de l’hôtel Bel-Ami, à Saint Germain-des-Prés, Laurent Naouri chante le jazz. Au piano, Manuel Rocheman, à l’harmonica, Olivier Ker Ourio. Des pros. La veille, il était à Berlin pour Samson et Dalila, le lendemain, il a repris ses valises, destination Cosi fan tutte. Il est coutumier du fait. Avec Rocheman, il a même enregistré un disque jazz, « Round about Bill » (Evans) en 2007. A le voir ni à l’entendre, on ne soupçonne le baryton d’opéra. Mais il n’y a pas que cela. Dans le « grand » répertoire, il est un virtuose, un chanteur de notre temps : il jongle avec les époques, les langues, les styles. Ici, il n’a rien à prouver, il cède à une passion. Quand Michel Legrand, présent dans la salle, lui demande s’il peut l’accompagner, il jubile : « Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe à l’intérieur ». Par moments, il en fait trop, on dirait qu’il joue au chanteur de jazz. Et alors ? Combien, parmi ses confrères, sont capables de se remettre ainsi en question ?
François Lafon

Deux soirs de suite à la salle Pleyel. Mercredi 25, Leif Ove Andsnes, Paavo Järvi et l’Orchestre de Paris dans le 2ème Concerto pour piano de Brahms. Concert unique, presque un gala, retransmis en direct sur Radio Classique et filmé par Mezzo. Déception : piano très maîtrisé mais sec et dur, orchestre en vrac, musique vidée de sens. Pas de souffle ni de poésie, on n’entend que les clichés. Seulement cela, le monument dont tant de grands ont su faire quelque chose ? Jeudi 26, tournée de l’Orchestre Philarmonique du Luxembourg, avec son directeur musical Emmanuel Krivine. Salle un peu moins pleine. En hors-d’œuvre : Uncut, le dernier des sept Solos de Pascal Dusapin, une grande pièce avec cuivres en fanfare. « C’est devenu une ouverture toute trouvée, à laquelle chacun donne un sens différent, s’amuse le compositeur à l’entracte. Krivine le dirige comme une pièce classique, pleine de références ». Une toccata de Monteverdi version 2011, en somme. Vient le Concerto pour violon de Dvorak. Julia Fischer et Krivine dialoguent merveilleusement, chaque trait porte, chaque réplique d’orchestre trouve son sens. La pièce mineure en dit beaucoup plus que le monument brahmsien. En seconde partie, un Petrouchka (Stravinsky) à faire danser les pierres. On retrouve le grand Krivine, loin de ses pas de clerc baroquisants avec La Chambre Philharmonique. Le vrai gala n’est pas celui que l’on croyait.
François Lafon

A 86 ans, Aldo Ciccolini fait se presser les auditeurs comme à un dernier rendez-vous, tout le monde le pense, personne ne le dit. Mais comme le pianiste n’est pas du genre à utiliser l’astuce des concerts d’adieux répétés d’année en année, celui de ce soir, loin d’être un au revoir, est juste un moment de vie où jeunesse et vieillesse se rejoignent, qu’il y ait ou non encore quelque chose à prouver. Et cela s’appelle : la sagesse. A voir Aldo Ciccolini parcourir la scène, d’un pas à la fois mesuré et assuré et débuter la sonate Alla Turca de Mozart la K331, c’est bien sur le monde de l’enfance que s’ouvre ce programme, avec une émotion dénuée d’emphase, en un récit qui unit l’innocence juvénile et l’expérience de la grande maturité. Et soudain, le pont aux ânes qu’est devenue la Marche Turque est restituée comme un morceau jubilatoire et inventif. La sonate Alla Turca apparait ainsi comme le prélude d’une sonate moins éclatante, plus intime, pourtant contemporaine la K333. Moments de grâce… A l’entracte, immanquablement, on s’interroge : après des Mozart passés si remarquablement, quid de Liszt ? Liszt subit le même traitement, avec la virtuosité en plus. La technique est là, sans effort apparent, dégraissée tout comme dans les deux sonates précédentes, débarrassant Liszt des travers dont il est si souvent affublé. Les deux Paraphrases (d’Aida et de la Mort d’Isolde) se déroulent comme un ample tableau familier que l’interprète jouerait chez des amis de longue date, tandis que les Harmonies poétiques et religieuses terminent le programme sur la solitude de l’être endolori par la vie, et Aldo Ciccolini semble s’y fondre lui-même. Deux bis (un nocturne de Chopin et une danse de Granados) font retomber la tension, mais s’élever la salle dans une standing ovation à l’image du concert : émouvante et spontanée.
Albéric Lagier
Theâtre des Champs-Elysées 18 mai 2011

Au programme de l’Orchestre de Paris cette semaine : La Barque solaire, pour orgue et orchestre, de Thierry Escaich, la 3ème Symphonie « avec orgue » de Saint-Saëns et le Concerto pour violoncelle de Dvorak. Paavo Järvi est au pupitre, Escaich lui-même à l’orgue et Gautier Capuçon au violoncelle. Le clavier d’Escaich est installé côté jardin. De part et d’autre du plateau : de grandes enceintes. La Barque solaire, inspiré du Livre des Morts Egyptien, place l’orgue, aux harmonies d’éternité, au centre d’un orchestre déchaîné. Des sonorités faibles et étouffées : ce n’est pas un concerto pour orgue, précise le compositeur. Soit. Dans la Symphonie de Saint-Saëns, l’orgue est là aussi pour soutenir, mais il éclate, au début du Finale, en un péremptoire do majeur. Même discrétion. Avant l’entracte, Capuçon, très applaudi (à juste titre) dans Dvorak, appelle Escaich pour un bis kitsch et délicieux : « Mon cœur s’ouvre à ta voix » (Saint-Saëns, Samson et Dalila) transcrit pour violoncelle et orgue. Egale frustration. Le grand Cavaillé-Coll de Pleyel, inauguré en 1929 par Marcel Dupré, n’est qu’un lointain souvenir. Aujourd’hui, on se passe, quand on construit ou rénove une salle, de ce genre de monument, onéreux, archaïque et encombrant. Hier soir, on l’a quand même un peu regretté.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 18 et 19 mai.

Deux remarques à propos des Variations Goldberg de Bach, telles que Nicholas Angelich vient de les enregistrer (Virgin) et de les jouer au Théâtre des Champs-Elysées her soir. A l’écoute du disque (voir ici), c’est l’équilibre qui domine : équilibre des mains, équilibre structurel (mise en valeur de la composition en miroir des trente Variations encadrées par l’Aria), équilibre stylistique (Angelich n’imite pas le clavecin mais n’en fait pas non plus un prototype des Variations Diabelli de Beethoven). En concert, le danger prédomine. Millimétrée, équilibrée (encore), carrée même, son interprétation est aussi d’une parfaite liberté : ornements discrets, rythmes démultipliés, pensée moderne éclairant le texte ancien. Creuser le texte, les références viennent après : on reconnait là l’élève d’Yvonne Loriot-Messiaen. Seconde remarque, ou plutôt corollaire de la première : Angelich joue Bach au piano sans les scrupules de la génération précédente, traumatisée par les oukases baroqueux. On peut adorer les Goldberg dansant sous les doigts de Scott Ross (au clavecin). Avec lui, on approche des régions plus mystérieuses. Il suffit d’oser le suivre aussi loin.
François Lafon

A Bobigny, l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris donne Orphée et Eurydice de Gluck. Dominique Pitoiset et Stephen Taylor, les metteurs en scène, ont passé la pastorale au Kärcher : un appartement high tech, une femme assassinée (salle de bains ensanglantée, les Experts en pleine enquête), un homme (un musicien) qui visite l’enfer et entrevoit le paradis entre ses quatre murs, veillé par une jeune délurée nommée Amour. Et tout cela dans le théâtre qui a vu, il y a un quart de siècle, les premiers signes du regietheater avec les opéras de Mozart revus par Peter Sellars. Musicalement, un travail impeccable. Geoffroy Jourdain, avec l’Ensemble Ostinato et son Jeune Chœur de Paris, retrouve le ton exact, encore classique et déjà romantique, de la version revue par Berlioz de cet opéra à métamorphoses. Effet pervers de la réussite, on place la barre très haut : Marianne Crebassa est stupéfiante en Orphée, on la met tout naturellement en concurrence avec les grandes interprètes du rôle. On en oublierait qu’elle n’a que vingt-trois ans. Salle bondée, rangs entiers de décideurs culturels. L’Atelier, qui forme par tranches de trois ans des décathloniens du chant et alimente les distributions de l’Opéra, est devenu le lieu où il se passe quelque chose. Une sorte d’oasis dans un paysage lyrique en mode mineur.
François Lafon
MC 93, Bobigny, les 4, 6 et 8 mai à 20h30. Représentations scolaires les 3 et 5 mai à 14h30.
Mercredi 27 avril, Pleyel. Paavo Järvi et l’Orchestre de Paris commencent par une partition typiquement « française de l’entre-deux-guerres » : les Trois danses pour orchestre opus 6 de Maurice Duruflé (1932), dont on ne connaît « que » le Requiem. La deuxième danse est de trop. Dans le Concerto n°1 de Brahms, le pianiste allemand Lars Vogt s’impose surtout dans l’Adagio central, d’une poésie intense et discrète, alors que dans les deux mouvements extrêmes, on aurait souhaité davantage d’ampleur et un orchestre plus transparent. C’est Sibelius qui avec sa Cinquième Symphonie (1919) remporte la palme, comme souvent lorsqu’il est excellemment interprété. Järvi était dans son élément, et l’orchestre métamorphosé : clarté des plans et des interventions instrumentales, subtiles oppositions de nuances. Järvi a dirigé de façon assez enlevée, évitant ainsi toute chute de tension à la fin du difficile premier mouvement et faisant de l’apothéose terminale une sorte de rouleau compresseur emportant tout sur son passage. Et que dire des constantes mais si efficaces variations de tempo dans l’Andante central ? A la fin, les ovations confirmaient que Järvi avait bien tapé dans le mille.
Marc Vignal
Mercredi 27 avril 2011 à 20h. Salle Pleyel

Il faut en connaître des opéras, pour suivre The Second Woman, de Frédéric Verrières (idée originale et musique) au théâtre des Bouffes du Nord. Il faut aussi être calé en cinéma, puisque cette histoire de cantatrice vieillissante, qui convoque tout le répertoire dans son délire, est inspirée du film de John Cassavetes Opening Night (1977). Au début, l’humour sauve la mise. La salle de la première, garnie de professionnels, rit d’un air entendu aux caprices du metteur en scène et aux blocages des chanteurs. Mais cela ne dure pas, et l’on attend sagement que la cantatrice à problèmes finisse de réinventer selon ses fantasmes l'opéra qu'elle est en train de répéter. Comme la musique, elle aussi, se met à tourner à vide, on s’occupe à essayer de se rappeler la fin du film, avec la formidable Gena Rowlands. Heureusement, il y a Jeanne Cherhal, qui passe d’un style à l’autre avec une certaine aisance. « Dans The Second Woman, l’opéra est un résultat : le résultat d’un devenir qui est le spectacle lui-même », déclare Bastien Gallet, l’auteur du livret. « J’ai une vision du chant lyrique comme irrémédiablement contenu dans le passé », ajoute Frédéric Verrières. Ensemble, ils ont du mal à inventer l’opéra de l’avenir.
François Lafon
The Second Woman, mise en scène de Guillaume Vincent, Ensemble Court-circuit dirigé par Jean Deroyer. Bouffes du Nord, Paris, du mardi au samedi à 21h, jusqu’au 13 mai

Au Châtelet, Sweeney Todd, le barbier démoniaque de Fleet Street. L’affiche est minimale (un couteau, un gâteau, le tueur, tout juste évoqué), mais les cinéphiles connaissent le film de Tim Burton, avec Johnny Depp, que Stephen Sondheim, l’auteur, considère comme le meilleur tiré d’un de ses musicals. Au théâtre, l’histoire de ce barbier qui a des raisons d’en vouloir à l’humanité et s’acoquine avec une faiseuse de petits pâtés pour lui fournir une viande délicieuse et interdite, est traitée dans un style opératique : musique omniprésente, voix lyriques. Nous sommes assez loin d’A Little Night Music, le marivaudage gris et rose inspiré d’Ingmar Bergman, qui a fait connaître Sondheim en France l’année dernière, déjà au Châtelet. L’ouvrage, demi-succès à Broadway en 1979 et four noir à Londres, est d’ailleurs monté aujourd’hui dans des maisons d’opéra, Covent Garden en tête. Sus aux bien-pensants et description d’un monde partagé entre les « bouffeurs et les bouffés » : on pense à la fois à L’Opéra de Quat’sous et à Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès. La musique est au service de l’action, efficace, raffinée, truffée de références, mais sans génie, sans les tubes d’A Little Night Music, sans commune mesure en tout cas avec Kurt Weill ni même Bernard Herrmann, le musicien d’Hitchcock, dont Sondheim admire le talent à faire peur avec des notes. Tel quel, n’empêche, le spectacle a de l’allure. Il est même transcendé par Caroline O’Connor, éblouissante en Mrs Lowett, la traîteuse qui met son amour de l’humanité entre deux couches de pâte feuilletée. A la fin, standing ovation pour l'auteur.
François Lafon
Châtelet, Paris, jusqu’au 21 mai

Lorsqu’on écoute de près la Troisième Symphonie de Brahms, on s’aperçoit qu’elle est truffée de pièges. La mélodie romantique qu’on connaît par cœur depuis le film d’Anatole Litvak n’est facile qu’en apparence, la symphonie comporte des solos de cor qui feraient perdre le souffle à un marathonien, des entrelacs de tempos où les violons risquent de larguer les violoncelles en route, des mélis-mélos de hautbois, clarinette et basson où chacun doit garder impeccablement son rythme sous peine de crash général. Mais quand on aime, on ne compte pas : c’est ainsi que Musiques en Seine, un orchestre d’une quarantaine de musiciens amateurs, n’a pas hésité à s’attaquer au chef d’œuvre qu’il a donné en concert il y a quelques semaines sous la direction efficace et bienveillante de Constantin Rouits. Résultat : un petit flottement par ci par là, mais une belle tenue d’ensemble parce que la passion permet de déplacer les montagnes. En ouverture, Musiques en Seine a joué le Concerto pour violoncelle d’Elgar, avec en soliste Noé Natorp, dix-neuf ans seulement, un son profond déjà. « Il n’y a que deux classes d’hommes distinctes sur la terre : celle qui sent l’enthousiasme et celle qui le méprise, » écrivait en 1807 madame de Staël dans Corinne ou l’Italie. Chez les musiciens c'est d'autant plus vrai.
Gérard Pangon
PS : Qui plus est, ce concert était donné au profit d’une ONG, Les Amis des Enfants du Monde. Enthousiasme et générosité vont de pair.

Ariane et Barbe-Bleue de Paul Dukas (1907), surtout au deuxième acte, n’est pas un opéra où prime l’action. Cet ouvrage symboliste inspiré de Maeterlinck gagne à être interprété en concert plutôt qu’à la scène, d’autant que l’orchestre y est traité avec splendeur. Le succès de la soirée doit beaucoup au jeune chef français Jean Deroyer : il tire le maximum du Philharmonique (et du Chœur) de Radio France, en particulier à l’acte III, très émouvant, hymne à la lumière et à la liberté. Plus transparent dans ses sonorités que les précédents, cet acte est aussi celui qui a permis d’apprécier dans toute sa beauté la prestation de la mezzo-soprano suédoise Katarina Karnéus en Ariane : là, son personnage n’a plus besoin d’affronter l’orchestre avec force. « La musique, plus qu’aucun autre art, [..] donne un corps aux aspirations vers l’infini, » a écrit Dukas. Nous étions prêts à faire nôtre cette maxime.
Marc Vignal
Vendredi 15 avril à 20h, Salle Pleyel

Pelléas et Mélisande, en concert au Théâtre des Champs-Elysées. Des années durant, le chef Désiré-Emile Inghelbrecht l’a dirigé une fois l’an. C’était la messe de la francité, la sacralisation de cet essai d’anti-opéra, d’antidote contre le poison wagnérien. En 2000, Bernard Haitink le dirige, toujours avec l’Orchestre National. Le résultat, édité sur disque (Naïve), est excellent mais dépourvu de dimension symbolique. Hier, Louis Langrée avec l’Orchestre de Paris, et un plateau introuvable : Natalie Dessay, Simon Keenlyside, Marie-Nicole Lemieux, Laurent Naouri. Atmosphère recueillie, lent ballet des solistes. L’orchestre, capiteux et violent, rappelle Inghelbrecht (ou ce qu’on en sait par le disque). Peu à peu, le théâtre s’installe : Lemieux fait de la lettre à Pelléas un moment d’anthologie, Naouri impose un Golaud souffrant qui ne ressemble à aucun autre, Dessay est insaisissable en amoureuse venue d’on ne sait où. L’œuvre apparaît sous ses deux faces : négation du théâtre et exacerbation de la tension dramatique. On en sort épuisé et un peu frustré, avec le sentiment qu’on a touché le cœur du sujet. Quelle mise en scène a jamais exprimé cela ?
François Lafon
Théâtre des Champs-Elysées, Paris. Les 15 et 17 avril à 20h. Londres, Barbican Center, 19 avril. (Photo de répétition ©Orchestre de Paris)

A la fin de sa vie, Sibelius déclare à propos de Bartok : « C’était un grand génie, mais il est mort dans la pauvreté en Amérique. J’ignore ce qu’il pensait de ma musique, mais j’ai toujours tenu la sienne en grande estime. » Le chef finlandais Jukka-Pekka Saraste et la Philharmonie de Rotterdam programment ensemble les deux compositeurs, en commençant par la Suite de danses du Hongrois (1923) : belles sonorités cuivrées, rythmes implacables, forte entrée en matière. Avant l’entracte, la soprano Karita Mattila chante non sans postures théâtrales les Quatre instants (2003) de sa compatriote Kaija Saariaho (née en 1952), sur des textes en français d’Amin Maalouf : une musique dépeignant avec sensualité, mais peu de contrastes, les « paysages du cœur féminin ». Luonnotar de Sibelius (1913) est une fascinante évocation - plus ésotérique que dramatique ou pittoresque - de la création du monde d’après la mythologie finlandaise du Kalevala. Retrouvant sa langue maternelle, Mattila en fait ressortir l’intensité et le mystère. Un sommet est atteint avec, toujours de Sibelius, l’énigmatique Quatrième Symphonie (1911), la fois classique, romantique et moderne. Servi notamment par un prodigieux timbalier, Saraste maintient la tension, non seulement dans le difficile troisième mouvement « Tempo largo », mais aussi dans finale, aux atmosphères si changeantes.
Marc Vignal
Mercredi 13 avril 2011 à 20h, Théâtre des Champs-Elysées

Entendu ce soir à l’Opéra Comique :
- Pourquoi John Eliot Gardiner a-t-il choisi Le Freischütz et non Der Freischütz ?
- Probablement parce qu’il avait envie de diriger L’Invitation à la valse.
Explication : en 1841, Berlioz établit pour l’Opéra de Paris une version française, avec récitatifs chantés, du Freischütz de Weber. Comme les abonnés exigent un ballet, il orchestre le rondo pour piano Aufforderung zum Tanz op.65 du même Weber, et le place au début du 3ème acte, juste après le célèbre Chœur des chasseurs. S’il ne traduit pas le titre, c’est qu’il est intraduisible. Freischütz veut dire franc-tireur, mais avec une connotation maléfique : c’est le chasseur qui n’atteint son but qu’aidé par le Diable. Mais si Gardiner dirige cette version, c’est aussi et surtout parce qu’il tient, en baroqueux historique qu’il est, à remettre la chronologie à l’endroit. Pour lui, ce n’est pas parce que Der Freischütz est considéré comme l’acte de naissance de l’opéra romantique allemand (préparé par La Flûte enchantée de Mozart et Fidelio de Beethoven), qu’il faut le traiter comme du pré-Wagner, avec orchestre lourd et chanteurs stentors. C’est plutôt dans la tradition de l’opéra comique français qu’il faut chercher ses sources. D’où cette recréation de la version Berlioz, qu’on ne connaissait que par un enregistrement de qualité moyenne, paru en 1999. Sur ce point, le pari est gagné : impeccablement chanté (craquantes Sophie Karthäuser et Virginie Pochon, sublime Monteverdi Choir), dirigé avec une finesse à peine trahie par un Orchestre Révolutionnaire et Romantique en petite forme, le chef-d’œuvre perd l’aspect Biedermeier qui gêne les Allemands eux-mêmes. S’il ne nous fait pas rêver autant qu’on le voudrait, c’est probablement parce que la mise en scène de Dan Jemmett transpose l’action dans une fête foraine. Balles et fusils = stand de tir, et adieu les prolongements métaphysiques de l’histoire. En matière d’analyse dramaturgique, c'est un peu court.
François Lafon
A l’Opéra Comique, Paris, les 11, 13, 15 avril. (Photo DR)
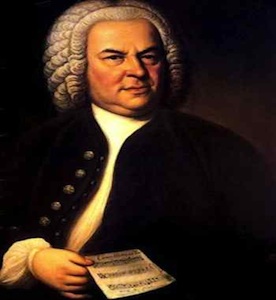
La Passion selon Saint Jean à Notre-Dame de Paris, dans le cadre de la saison Musique sacrée. Affiche de luxe : Reinhard Goebel au pupitre, Werner Güra en Evangéliste, avec l’Ensemble Orchestral de Paris et la Maîtrise de la Cathédrale. Tout n’est pas parfait : les fans de Goebel ne retrouvent pas les sonorités rugueuses, très « baroqueux première génération » qu’il obtenait de Musica Antiqua Köln, les deux solistes féminines ne sont pas inoubliables, et l’acoustique est traître : les VIP des premiers rangs ont l’impression que les bois se sont ligués pour les empêcher d’entendre leurs partenaires. Et pourtant, l’essentiel est là, dans cette rapidité, cette violence, cette impression qu’il manque des répétitions, que le désordre n’est pas loin, que l’orchestre est désarçonné par le chef, que le chœur-maison, solide et bien préparé, aurait pu être mieux mis en valeur. La Passion selon Saint-Matthieu, plus lyrique, ne s’en serait peut-être pas remise. La Saint Jean, si. On remarque comme jamais que Bach évite les scènes à faire, qu’il insiste davantage sur la rémission des péchés que sur la divinisation du Christ (attitude très protestante), qu’il nous livre sans ménagement ce fait divers qui a changé la face du monde. Pendant les saluts, Goebel, l’œil allumé, tente de discipliner ses troupes, de mettre en rang ses solistes un peu perdus. Au centre, Güra, plus sûr de lui, Evangéliste de haut vol, dans la lignée de Peter Schreier. Comme si toute l’histoire se recréait devant nous.
François Lafon
Notre-Dame de Paris, les 5 et 6 avril à 20h.

Bronca pour Akhamatova, l’opéra de Bruno Mantovani donné en première mondiale à l’Opéra Bastille. Renaud Machart, dans Le Monde, s’en prend à l’équipe : musique du directeur du Conservatoire, mise en scène de celui de l’Opéra (Nicolas Joel), livret du dramaturge maison (Christophe Ghristi), interprétation de l’épouse de ce dernier (Janina Baechle). Un spectacle institutionnel, en somme, bien dirigé (Pascal Rophé), bien éclairé, bien chanté. Dans cette optique, le sujet n’est pas anodin : résistance et compromission, disgrâce publique et drame privé de la grande poétesse russe Anna Akhmatova (1886- 1966) sous le régime stalinien. Une forme d’exorcisme ? Le résultat est sans pitié : rien de vivant, rien d’émouvant dans cette musique habile et bruyante où passent tous les tics de la « contemporaine », dans ce texte exposant des idées à défaut de susciter des personnages, dans cette mise en scène élégamment géométrique. Au rythme des changements de décors, le portrait célèbre d’Akhmatova par Modigliani ne cesse de glisser de la scène aux coulisses, de la lumière à l’ombre. Au moins, lui, reste-t-il dans les mémoires.
François Lafon
A l’Opéra National de Paris – Bastille, les 2, 6, 10, 13 avril – Diffusion sur France Musique le 27 avril. A l’Amphithéâtre Bastille : Lectures d’Anna Akhmatova, avec Françoise Fabian (récitante), le 4 avril; concerts Beethoven/Mantovani/Chostakovitch les 5 et 12 avril.
Photo : Elisa Haberer/Opéra de Paris

Avec un Mr Ford qui ressemble à Michel Debré et une Mrs Ford à Catherine Deneuve dans Potiche, le film de François Ozon, le Falstaff monté à l’Opéra de Nantes par Patrice Caurier et Moshe Leiser n’a plus grand chose à voir avec l’Angleterre du XVème siècle. Et pourtant, l’esprit de l’ultime opéra de Verdi est bien là, sans futilité, sans hâblerie, mais avec une rare élégance, dans un chatoyant éventail de couleurs et de styles, dans un tempo enlevé mais jamais précipité. Transportées dans ce cadre boulevardier et savamment décalé, les aventures des Joyeuses Commères de Windsor et du vieux chevalier obèse, encore séducteur et toujours escroc, relèvent d’un univers que nous ne connaissons que trop, où la norme est seule acceptable et où la désignation d’un bouc émissaire justifie toutes les cruautés. Si la transposition s’avère judicieuse, l’interprétation l’est tout autant avec, en particulier, un quatuor vocal féminin - Véronique Gens et Amanda Forsythe en tête - qui affiche son bonheur d’être de cette aventure portée par un Orchestre national des Pays-de-la Loire qui galope agréablement. Voici un Falstaff « sans rien qui pèse et qui pose », où la règle est « glissez mortels, n'appuyez point ! » : toute la philosophie de Verdi au soir de sa vie.
Frank Langlois
Angers-Nantes-Opéra Nantes Théâtre Graslin 20, 22 mars – Angers le Quai 31 mars, 3 avril (Photo DR)

En 1998, au festival de Salzbourg dirigé par Gerard Mortier, Katia Kabanova a quelques fans et beaucoup de détracteurs. Christoph Marthaler, le metteur en scène, prend l’opéra de Janacek à rebrousse-poil. Quand la musique parle de fleuve immense et de grands espaces, il enferme l’action dans un coin de cour. Quand le livret (tiré de L’Orage, une pièce d’Alexandre Ostrovski) nous raconte l’histoire d’une Bovary russe écrasés par les préjugés bourgeois, il nous transporte chez les déclassés de l’époque soviétique. Le comble du regietheater, dont Marthaler est un des pères fondateurs ! Le spectacle est filmé, diffusé à la télé et en DVD ; il est repris à l’Opéra de Paris (directeur Gerard Mortier) et au Capitole de Toulouse (directeur Nicolas Joel). Comme il est frustrant, démoralisant même, mais rigoureux dans son exploitation de la dialectique scène/musique, il se bonifie avec le temps, à moins que ce ne soit le public qui ne s’y soit fait, à la longue. Aujourd’hui, il est repris au Palais Garnier (direction … Nicolas Joel). On le regarde comme un classique. Angela Denoke, chanteuse moderne (on dirait anti-diva, si ce n’était un lieu commun) y officie toujours, en grande amoureuse qui se punit elle-même. Sa voix est fatiguée, mais elle est plus que jamais l’interprète qu’il faut pour ce spectacle-là. On pourrait en dire autant du chef, le jeune Tchèque Thomas Netopil, qui donne la sensation de recréer à mesure cette musique à jamais belle et dérangeante.
François Lafon
A l’Opéra National de Paris - Palais Garnier, les 23 et 29 mars, 1er et 5 avril (Photo DR)

Un Messie multimédia au Châtelet. Diable ! C’est le plasticien russe Oleg Kulik qui s’y est collé, dans la foulée de son illustration, simpliste mais efficace, des Vêpres de Monteverdi sur la même scène. Mais, le sujet aidant, l’affaire, cette fois, s’est compliquée. Au jeu très postmoderne de Kulik visant à montrer que le Messie est notre contemporain – vitraux en 3 D, tableaux éclatés, ciels étoilés, bandes d’actualités, Jésus danseur au couvre-chef d’idole aztèque et solistes vocaux déguisés en popes –, sont venus s’ajouter les cogitations de quelques cerveaux de poids, tels les philosophes Benoît Chantre, signataire de la dramaturgie, et Michel Serres, qui se lance en personne (et en soutane) dans des prêches interminables autant que redondants. Pour corser le tout, ce n’est pas l’oratorio originel qu’on entend, mais l’épaisse réorchestration de Mozart sur un texte traduit en allemand, exécutée (c’est le mot) par le chef Hartmut Haenchen. Il y a une trentaine d’années, au Théâtre des Champs-Elysées, Pier Luigi Pizzi et William Christie s’étaient lancés dans une mise en espace de la Passion selon Saint Jean de Bach façon défilé de haute-couture ecclésiastique dans Fellini-Roma. Au moins, là, on riait.
François Lafon
Châtelet, Paris, les 17, 19, 20 mars.

Hier soir, au Théâtre des Champs-Elysées, Marie-Nicole Lemieux, aphone, a joué l’Orlando Furioso de Vivaldi, tandis qu’une inconnue nommé Delphine Galou lui fournissait le son en play-back. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. On se souvient, jadis à Bayreuth, de Patrice Chéreau dans la peau de Siegfried, tandis que René Kollo, le pied dans le plâtre, chantait depuis la fosse, ou naguère au Châtelet d’Anna Caterina Antonacci mimant les fureurs de Médée, pendant qu’à l’avant-scène, une dame en tailleur, sac à main posé au pied du pupitre, se chargeait des imprécations chérubiniennes. Cela pose le problème, crucial dans le cas d’un opera seria, du son et de l’image. Il y a sept ans, déjà au TCE mais en version de concert, Jean-Christophe Spinosi s’est fait le croisé de l’ouvrage de Vivaldi, que l’on ne connaissait que dans une version musicologiquement douteuse mais vocalement somptueuse (Marilyn Horne) et théâtralement esthétique (Pier Luigi Pizzi), donnée au Châtelet au début des années 1980. Aujourd’hui, l’affiche est sensiblement la même qu’en concert (Lemieux, Philippe Jaroussky, Jennifer Larmore), mais c’est d’une version scénique, signée Pierre Audi, qu’il s’agit. On voit les héros de l’Arioste, en pourpoints et bas noirs, errer dans la pénombre d’un palais design. Cela n’apporte pas grand-chose, mais le seul fait que le personnage principal soit - si l’on ose dire - coupé en deux, donne à l’ensemble un aspect brechtien assez inattendu. Delphine Galou a eu droit à une ovation méritée, et les autres ont fait comme si de rien n’était, fort bien d’ailleurs, même si certains flottent, dramatiquement autant que vocalement, dans des habits un peu grands pour eux. Moralité : si vous ne pouvez pas avoir de places (c’est complet), ne regrettez rien, écoutez le disque, très réussi (3 CD Naïve), ou regardez la retransmission sur Mezzo, pour laquelle, on l’espère, la Lemieux aura retrouvé sa voix.
François Lafon
Au Théâtre des Champs-Elysées, les 16, 18, 20, 22 mars. Sur Mezzo vendredi 18 mars. Sur France Musique samedi 7 mai.

Le Prince Charmant : Ma Lucette !
Cendrillon : Ô mon Prince Charmant !
Dans le « conte de fées (d’après Perrault) par Henri Cain, musique de Jules Massenet » que reprend l’Opéra Comique cent-deux ans après sa création in loco, Cendrillon s’appelle Lucette, comme la divette d’Un Fil à la patte de Feydeau (1894). Ce n’est pas que cet ouvrage soit un vaudeville qui s’ignore : l’auteur de Manon et de Werther y est sérieux comme un pape. Le metteur en scène Benjamin Lazar, connu pour ses reconstitutions baroques éclairées à la chandelle, tente de donner à tout cela une certaine dimension parodique en célébrant la Fée électricité, Marc Minkowski, dans la fosse, cherche à muscler ce « festival d’émotions et de sensations renouvelées » (dit-il), rien n’y fait : Cendrillon est un de ces nombreux opéras-dinosaures que l’on tente périodiquement de ranimer, en les traitant avec les égards dus aux causes perdues. Joue-t-on encore le théâtre de Porto-Riche (1849-1930), lit-on les romans de Paul Bourget (1852-1935) ? Comme les voix sont belles, comme le public est sage et a même l’air heureux, on se fait une raison. Pour la première, le 24 mai 1899, le président Emile Loubet s’était déplacé. Hier, François Fillon, premier ministre, était là. Troisième République pas morte?
François Lafon
Opéra Comique, Paris, les 7, 9, 11, 13, 15 mars
Photo : Elisabeth Carecchio

Pourquoi Siegfried est-il un rasta blond ? Pourquoi Mime, le fourbe Nibelung, porte-t-il une perruque empruntée à Zaza Napoli ? Pourquoi le dragon Fafner a-t-il pour gardiens de l’or du Rhin (qu’il a volé) des coolies sortis de La Nuit des morts-vivants ? Pourquoi, après un Or du Rhin comico-politique et une Walkyrie néo-spielbergienne, Siegfried, monté par Günter Krämer à l’Opéra Bastille, est-il si disparate ? Pourquoi le metteur en scène attend-il le troisième acte pour laisser les chanteurs chanter et la musique parler, sans parasiter ceux-là par une agitation permanente et celle-ci par des effets qui montrent qu’en 2011, on ne s’en laisse plus conter ? Tentative de réponse : parce que dans Wagner, tout a une petite chance de faire sens, et que les metteurs en scène ont peur que le public s’ennuie. Est-ce pour cela que le chef Philippe Jordan ne donne l’impression de prendre le pouvoir que lorsque le spectacle le laisse tranquille, c'est-à-dire dans les moments lyriques (les Murmures de la forêt, le Réveil de Brünnhilde) ? De quoi se plaint-on d’ailleurs ? Le spectacle est riche, la distribution est belle, et Siegfried n’avait pas été donné à l’Opéra depuis 1959, la dernière tentative tétralogique, en 1976, s’étant arrêtée net après La Walkyrie. En 1878, dans Humain, trop humain, Nietzsche écrivait : « Nous nous imaginons que le conte de fées et le jeu appartiennent à l’enfance, myopes que nous sommes. Comme si nous avions envie de vivre sans conte ni jeux quel que soit notre âge ! » Ce Siegfried où les Deschiens rencontrent le docteur Mabuse est peut-être un conte de notre temps.
François Lafon
A l’Opéra National de Paris – Bastille, les 6, 11, 15, 18, 22, 27, 30 mars.

Grand final et salle comble, au Châtelet, de Présences 2011, vingt-et-unième festival de création musicale de Radio France, dédié cette année à Esa-Pekka Salonen. Treize concert gratuits, dont quatre dirigés par le maître, dont on aura entendu l’œuvre quasi intégrale. Car c’est le compositeur qui est à l’honneur, plus que le chef. Ce soir, il dirige un Philharmonique de Radio France tiré au cordeau dans deux pièces pour grand orchestre : Nix, en création mondiale, et L.A Variations, dédié au Philharmonique de Los Angeles, sur lequel il a régné dix-sept ans durant. C’est de la « musique de chef d’orchestre », bien écrite, bien sonnante, mettant en valeur tous les pupitres. On y entend du Stravinsky, du Sibelius (son compatriote, qu’il a d’abord détesté, puis qu’il s’est mis à vénérer), du John Adams. On se souviendra davantage du formidable clarinettiste Kari Kriikku sillonnant les rangs de l’orchestre dans le raffiné D’OM LE VRAI SENS de Kaija Saariaho, et surtout de son exécution anthologique d’Amériques, d’Edgar Varèse, génial brûlot créé en 1926, et plus que jamais symbole de modernité. Comme Furtwängler, comme Klemperer, comme Markevitch, Salonen est un grand chef qui compose. Mahler, Strauss, Bernstein, Boulez restant, à tous égards, des exceptions.
François Lafon
Photo DR

« Cocteau et Poulenc sont morts tous les deux en 1963, peut-on lire dans le programme du théâtre de l’Athénée. Poulenc le 31 janvier ; le lendemain, la NASA envoie le premier chimpanzé dans l’espace. Cocteau meurt en octobre, deux heures après avoir appris la mort d’Edith Piaf. » On ne saurait mieux définir l’atmosphère du one woman opera show proposé par la mezzo Stéphanie d’Oustrac, arrière petite nièce du compositeur. Le rideau se lève sur La Dame de Monte-Carlo, ou la dernière nuit d’une joueuse qui a tout perdu, suivi de Lis ton journal, extrait du monologue Le Bel indifférent, créé par Piaf (mais sans musique). Puis vient La Voix humaine, ou comment le téléphone peut devenir une arme mortelle en cas de rupture sentimentale. Stéphanie d’Oustrac est très bien (hystérie contrôlée, passages en douceur du parlé au chanté) et le pianiste Pascal Jourdan (puisque c’est la version originelle avec piano, plus théâtre, qui est utilisée) jongle habilement avec les pleins et les creux de ce dialogue unilatéral. Que le spectateur se sente mal à l’aise est le but de l’opération. La structure d’oripeaux colorés qui sert de décor - peut-être pour rappeler que c’est à l’Athénée qu’a été créé La Folle de Chaillot (Giraudoux et Cocteau étaient contemporains) - appuie les intentions des auteurs. En 1982, dans le foyer glacial du théâtre de Chaillot, Antoine Vitez avait monté La Voix humaine dans la même version de chambre, mais avec une femme vieillissante (Anne Béranger, ex-chanteuse devenue chorégraphe) et pour tout accessoire un collier qui finissait par lâcher. C’était terrifiant. Stéphanie d’Oustac est jeune et fraîche, comme le voulait Cocteau, et c’est encore plus terrible. Si votre couple ne va pas fort, réfléchissez avant d’y aller.
François Lafon
Au théâtre de l'Athénée, Paris, jusqu'au 13 février. Diffusion sur France Musique le 24 février à 9h05. (Affiche Malte Marin)

Au Théâtre des Champs-Elysées, Roger Muraro joue la Symphonie fantastique transcrite pour le piano par Liszt. Dans le disque, qui vient de paraître chez Decca, on entend l’œuvre comme un laboratoire d’idées, encadré d’extraits de la première Année de pèlerinage, qu’elle a l’air d’avoir inspirée. On imagine le public de l’époque devant ce festival de bizarreries rythmiques et harmoniques En concert, Muraro intercale les Images de Debussy : Liszt le décanteur, Debussy l’aventurier, entracte, retour à Berlioz l’inventeur. La Fantastique paraît plus folle encore. Muraro y prend tous les risques, frôle les précipices, rajoute chicanes et démarrages en côte. « Il y a des moments où Liszt ne note presque plus rien, explique-t-il. Il oublie des entrées d’instruments. J’ai dû imaginer des liens : 90% de Liszt écrit, 10% recréé ». Quand se terminent ces trois quarts d’heure de voltige, il pousse un énorme soupir. Il faudrait publier le concert avec l’enregistrement studio. L’un et l’autre, paradoxalement, dégagent la même impression : de la surenchère naît une sorte d’ascèse. Chapeau l’artiste.
François Lafon

Première de Francesca da Rimini de Riccardo Zandonai (1883-1944) à l’Opéra de Paris, cent ans après sa création. Pourquoi cent ans après ? L’ouvrage a bonne réputation : Zandonai avait beau être un disciple de Mascagni (l’auteur de Cavalleria Rusticana), il aimait Strauss, Debussy et, par-dessus tout, Wagner, et cela s’entend. Et puis le livret est tiré d’une pièce de Gabriele D’Annunzio, elle-même inspirée de Dante. Le spectacle, mis en scène par Giancarlo del Monaco, est riche : « Au premier acte, on découvre un jardin avec de vrais arbres, des statues et des milliers de fleurs, explique celui-ci dans Opéra Magazine. Cela pourra déplaire à ceux qui ne supportent pas qu’un opéra soit replacé dans le cadre esthétique de sa création ». Dans la fosse, le chef Daniel Oren s’emploie à montrer que l’orchestration, elle aussi, est riche. Sur scène, des voix riches, à commencer par celle de Roberto Alagna, plus en forme que jamais. Trop de richesse, alors ? Sur le rideau de scène, énorme et angoissant : le masque mortuaire de D’Annunzio. Giancarlo del Monaco a tout compris : quoi qu’on fasse, Francesca da Rimini est une pièce de musée.
François Lafon
Opéra National de Paris – Bastille, les 6, 9, 12, 16, 19, 21 février.

Pas de banderoles, pas de choeur de bienvenue, comme la dernière fois que Gustavo Dudamel a dirigé l’Orchestre des Jeunes Simon Bolivar à la salle Pleyel. Venu pour deux concerts avec le Philharmonique de Los Angeles, le prodige se comporte en maestro. Enfin, presque. Il commence par une pièce de John Adams, Slominsky Earbox - du nom d’un théoricien et compositeur américain célèbre pour son oreille absolue -, et enchaîne sur le 1ère Symphonie « Jeremiah » de Leonard Bernstein. Ces musiques - un œil sur Stravinsky et l’autre sur Broadway - lui vont bien. Il y a même du Mahler dans « Jeremiah », quand l’alto chante « Juda habite au milieu des nations, et n’y trouve pas de repos ». C'est en revanche Wagner qui a surnommé la 7ème Symphonie de Beethoven « L’apothéose de la danse » : après l’entracte, Dudamel s’y déchaîne. Rythmes forcenés, effets appuyés, thèmes surexposés : tout est « trop » dans ce Beethoven considéré comme un pourvoyeur de blockbusters musicaux. Une partie de la salle hurle de joie, et délire quand vient, en bis, la 1ère Danse hongroise de Brahms. On retrouve l’ « effet Dude », qui a conquis la planète. Il y a quinze jours, sur la même estrade, Bernard Haitink dirigeait Beethoven. Mais ne comparons pas l’incomparable.
François Lafon

Courtes échappées au fil de la longue représentation des Fiançailles au couvent, importé du Capitole de Toulouse à l’Opéra Comique. L’œuvre est donnée comme essentielle, parce que le livret est de Sheridan (1751-1816, auteur de L’Ecole de la médisance) et la musique de Prokofiev. On nous explique dans le programme que dans les années 1940, la mode en Russie soviétique était aux classiques anglais, que cette histoire de barbons (capitalistes ?) bernés par leurs enfants (communistes ?) grâce à des religieux paillards (c’était avant que le clergé ne rentre en - relative - grâce) est un chef-d’œuvre sous ses allures conventionnelles, que Prokofiev y a renoué avec l’inspiration de L’Amour des trois oranges, et qu’il n’était que temps de lui donner sa chance à Paris, où il n’avait jamais été représenté. A voir cette farce à la musique sur-vitaminée, traitée comme un guignol constructiviste par le Britannique Martin Duncan, on se demande pourquoi, à l’opéra, le comique vieillit plus mal que le dramatique, et pourquoi les oeuvres que la postérité n’a pas retenues finissent un jour ou l’autre par refaire surface (ce qui arrive plus rarement au théâtre, où la création, il est vrai, est un peu plus vivace). Très bon Tugan Sokhiev, que l'on avait découvert au festival d’Aix dans L’Amour des trois oranges, Orchestre du Capitole russifié à point, distribution labellisée par la casteuse Larissa Gergieva (sœur de Valery Gergiev). Essentiel, vous dit-on.
François Lafon
Opéra Comique, Paris, les 30 janvier, 1er et 3 février

Comme on parle de droite décomplexée, on parlera bientôt d’opéra décomplexé. Hier soir, au Châtelet, ovation pour Le Barbier de Séville de Rossini mis en scène par Emilio Sagi, connu dans la maison pour y avoir monté Le Chanteur de Mexico et La Mélodie du bonheur. Décors mouvants, flamenco comme à Séville (on oublie souvent que ça se passe là), montgolfière rose emmenant Rosine et le Comte au septième ciel. Là où, naguère à l’Opéra Bastille, cheikh-Bartolo cachait sa pupille sous un tchador (mise en scène de Coline Serreau), ce ne sont que pas de danse et amours heureuses. A la question « Et la critique sociale ? » Sagi répond : « Rossini se plait à critiquer la morale établie, à singer la société de son époque, et il le fait avec grâce et minutie ». Comme tout le monde chante bien, à commencer par l’époustouflant ténor Bogdan Mihai, comme Jean-Christophe Spinosi fouette le crescendo comme un pâtissier fait monter une crème, on sort heureux. Sans oublier, tout de même, le tchador de Rosine.
François Lafon
Châtelet, Paris, les 24, 26, 28, 30 janvier. Le spectacle, filmé en 2005 au Teatro Real de Madrid avec Maria Bayo et Juan Diego Florez, est disponible en DVD (Decca)

Trouvée sur un forum, cette explication de la différence entre rythme et tempo :
« Le tempo est la vitesse à laquelle un rythme est joué. Le tempo se mesure en BPM (battement par minutes). Un BPM de 60/70 correspond à ton rythme cardiaque. Le rythme lui, est la manière dont la musique est construite : poum poum tchac est un rythme différent de poum tchac poum tchac. »
Application directe : le spectacle Feydeau Du mariage au divorce (ses quatre dernières pièces en un acte), donné au Théâtre Marigny dans une mise en scène d’Alain Françon. Accord parfait dans On purge bébé et Feu la mère de Madame : diastole et systole, allegretto et furioso négociés de main de maître par une troupe virtuose, avec Gilles Privat et Anne Benoit en chefs de pupitres. Grain de sable en revanche dans Léonie est en avance. Le rideau se lève sur un allegro agitato : une femme va accoucher, son mari, pour la calmer, la promène à travers le salon. Julie Pilod, l’actrice qui joue Léonie, est dans le tempo, mais pas dans le rythme : elle ajoute des poum et des tchac en marquant les « e »muets et en respirant à contretemps. Ses partenaires ont beau être à l’unisson, le rythme est brouillé. Dans Mais n’te promène donc pas toute nue, c’est le tempo qui se dérègle. Judith Henry, comédienne fine, a du mal à endosser le tempérament volcanique de son personnage. Du coup, son partenaire Eric Elmosnino (Gainsbourg au cinéma) a tendance à accélérer. Tout cela se joue à un cheveu. Dans le programme, Alain Françon se montre sensible au problème. A la question « Quelle liberté Feydeau laisse-t-il à un metteur en scène d’aujourd’hui ? », il répond : « Ce qu’il a décrit, il faut absolument l’expérimenter sur tous les plans : situation, rythme, descriptions de gestes et parfois d’intonations. Il ne faut pas faire le malin avec les pièces de Feydeau, sinon ça fait boomerang et ça vous revient dans la figure. Chez Feydeau, la dérive inconsciente des situations nécessite la vitesse et la variation continue (rapports de vitesse, rapports d’intensité). C’est une prison qui donne la liberté. » Un chef d’orchestre ne s’exprimerait pas autrement.
François Lafon
Théâtre Marigny, Paris, jusqu’au 9 mai. (photo DR)

Question : pourquoi une nouvelle production de Jules César au Palais Garnier ? La précédente a été maintes fois reprise, alors que nombre d’opéras de Handel n’y ont jamais été donnés. Réponse : parce que Natalie Dessay voulait chanter Cléopâtre, et que la maison lui devait bien un spectacle tout neuf. Question : en quoi la nouvelle mise en scène de Laurent Pelly marque-t-elle un progrès sur l’ancienne, signée Nicholas Hytner ? Réponse : comme celle de Peter Sellars, qui a fait date et qui remonte elle aussi à la fin des années 1980, la relecture de Hytner nous montrait, dans un esprit BD (genre Tintin et Milou dans Les Cigares du Pharaon), le choc orient-occident sur fond de puits de pétrole. Pelly, lui, imagine César, Cléopâtre, Ptolémée et Cornélie hantant les remises de musée du Caire, où travaillent des magasiniers qui ne soupçonnent même pas leur présence. Question : et c’est plus actuel que les dictatures à l’ombre des derricks ? Réponse : au théâtre (et à l’opéra), la contestation est aujourd’hui moins politique, plus désabusée, plus dure et désespérée à la fois. Regardez les programmations du festival d’Avignon. Dernière question : et la musique dans tout ça ? Réponse : elle va son train sous la direction fluctuante d’Emmanuelle Haïm. Le plateau est correct, avec une Dessay s’affirmant d’air en air (elle en a huit, plus un duo) et apportant partout ce petit quelque chose qui n’est qu’à elle. Question subsidiaire : il reste des places ? Réponse : pas beaucoup, mais on pourra voir le spectacle en direct dans le circuit UGC le 7 février. Et si vous flanchez à l’idée d’endurer - sur scène ou sur écran - quatre heures d’alternance airs-récitatifs, écoutez le dernier album de Natalie Dessay chez Virgin : les huit airs en question, dont certains sont parmi les plus beaux de Handel.
François Lafon
A l’Opéra National de Paris - Garnier, les 20, 23, 27, 29 janvier, 1er, 4, 7, 10, 12, 14, 17 février
Photo : Natalie Dessay. Crédit : Agathe Poupeney / Opéra national de Paris

« La 5ème de Beethoven ? Pfff…bateau, voire ringard ». Du coup, l’œuvre emblématique de la « grande musique » est une des moins données en concert, si ce n’est au sein d’une intégrale des neuf Symphonies. C’est d’ailleurs une intégrale que Bernard Haitink et le Chamber Orchestra of Europe ont entrepris sur deux saisons, à Paris et Amsterdam. Pleyel complet, hier mardi, les gens debout, acclamant le moins marketing mais le plus respecté des chefs, ont une fois de plus confirmé « l’effet 5ème ». Les mêmes ont été plus sages, avant l’entracte, à la fin de la 8ème Symphonie, elle-même précédée de l’ouverture de Fidelio. Haitink n’est pas tendance, avec sa queue de pie et sa manière old fashion de diriger Beethoven, mais il est fascinant à regarder : les bras « en bas », le geste rare, il rappelle (en plus souriant) Karl Böhm, qui lui aussi déchaînait des tempêtes d’une simple levée de baguette. Mais pourquoi l’orchestre, qui est pourtant composé des plus fines lames des grandes phalanges européennes, sonne-t-il si gris ? Peut-être qu’Haitink, qui fréquente cette musique depuis plus d’un demi-siècle, est au-delà de ce genre de considération. Il se rattrape en mettant le feu à l’orchestre à des moments où l’on ne s’y attend plus, comme le finale de la 8ème. Mais il n’y a pas d’« effet 8ème » comme il y a un « effet 5ème ».
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 18 janvier. Aujourd’hui 19 : Symphonies n° 2 et 3 « Héroïque ».
 « Comment l’amour fait exploser le cadre d’une œuvre ». Ambitieux programme. C’est celui de Christophe Crapez, qui met en scène et chante Le Journal d’un disparu au théâtre de l’Athénée. Il n’est pas le premier à chercher l’opéra dans ce cycle de mélodies composées par Janacek au moment où il se consume d’amour pour une femme de trente-huit ans plus jeune que lui. En 2001, au festival d’Aix, Claude Régy avait fait de ce bizarre cycle de mélodies pour jeune homme amoureux (ténor), gitane ensorceleuse (alto) et trois femmes formant chorus une disparition mystique aux yeux du monde d’en bas. Crapez est plus pragmatique. Il nous emmène dans un bureau des partitions perdues, où un pianiste (Nicolas Krüger) joue Janacek (Sonate, Sur un sentier recouvert) jusqu’à ce que naisse un opéra miniature. Mais pour être un chef-d’œuvre vocal composé par un génie de l’opéra, Le Journal d’un disparu n’est pas un opéra, et l’exercice, une fois de plus, reste un exercice. Musicalement, c’est très réussi. On a envie de (ré)écouter Janacek, les opéras, les pièces pour piano, tout : il n’y a rien à jeter.
« Comment l’amour fait exploser le cadre d’une œuvre ». Ambitieux programme. C’est celui de Christophe Crapez, qui met en scène et chante Le Journal d’un disparu au théâtre de l’Athénée. Il n’est pas le premier à chercher l’opéra dans ce cycle de mélodies composées par Janacek au moment où il se consume d’amour pour une femme de trente-huit ans plus jeune que lui. En 2001, au festival d’Aix, Claude Régy avait fait de ce bizarre cycle de mélodies pour jeune homme amoureux (ténor), gitane ensorceleuse (alto) et trois femmes formant chorus une disparition mystique aux yeux du monde d’en bas. Crapez est plus pragmatique. Il nous emmène dans un bureau des partitions perdues, où un pianiste (Nicolas Krüger) joue Janacek (Sonate, Sur un sentier recouvert) jusqu’à ce que naisse un opéra miniature. Mais pour être un chef-d’œuvre vocal composé par un génie de l’opéra, Le Journal d’un disparu n’est pas un opéra, et l’exercice, une fois de plus, reste un exercice. Musicalement, c’est très réussi. On a envie de (ré)écouter Janacek, les opéras, les pièces pour piano, tout : il n’y a rien à jeter.
François Lafon
Théâtre de l'Athénée, Paris. Les 14, 15 (20 h) et 16 (16 h) janvier.

Sur la façade ouest (en travaux) du Palais Garnier, une immense photo de Rolf Liebermann. L’exposition du centenaire, à la Bibliothèque-musée, est à la hauteur de ce « directeur de la dernière chance », qui en sept ans (1973-1980) a fait d’une maison en ruines un palais des merveilles. Ceux qui disent « J’y étais » y retrouvent ceux qui soupirent « J’aurais voulu y être », et tous célèbrent ensemble la Fête de la fédération. L’exposition ne passe pourtant pas sous silence les difficultés rencontrées par celui que des campagnes douteuses qualifiaient de Juif allemand. D’une cimaise à l’autre, on rêve aux moments de grâce (Les Noces de Figaro « de » Strehler, Lulu par Chéreau et Boulez, Faust décapé par Jorge Lavelli), et l’on s’attarde moins sur les spectacles ratés, où l’on ne perdait pourtant pas toujours son temps : Nicolaï Gedda en Orphée de Gluck, malgré la mise en scène (signée René Clair) et la chorégraphie (de Balanchine) ; la création in loco du Moïse et Aaron de Schoenberg, fût-ce en français et avec un Moïse essoufflé (le comédien Raymond Gérôme), Shirley Verrett en transes, même dans un Trouvère sans grâce, le duo Jon Vickers - Gwyneth Jones, bien peu baroqueux mais grandiose dans Le Couronnement de Poppée, sont aussi des grands souvenirs. Que reste-t-il de tout cela, hormis les documents exposés ? Liebermann croyait en l’opéra filmé, mais les spectacles diffusés à la télévision (Les Contes d’Hoffmann et Lulu par Chéreau, Faust et Oedipus Rex par Lavelli, Le Chevalier à la rose avec Christa Ludwig, la reprise des Noces de Figaro en 1980) sont introuvables. Seul témoignage disponible en DVD : le Don Giovanni réalisé par Joseph Losey, prototype du « filmopéra », en play-back et décors naturels. N’empêche : vécue ou fantasmée, l’ère Liebermann, comme les années De Gaulle, est un fleuron intouchable de la légende collective. Le catalogue de l’exposition est particulièrement soigné : textes clairs, photos nombreuses (et rares, pour certaines), maquettes, distributions complètes (y compris les reprises). Un cadeau de Noël tout trouvé.
François Lafon
Exposition L’ère Liebermann à l’Opéra de Paris. Bibliothèque-Musée de l’Opéra, Palais Garnier, angle rues Auber et Scribe. Tous les jours de 10h à 17h, jusqu’au 13 mars 2011. Catalogue aux éditions Gourcuff Gradenigo (49 euros).

Phi-Phi et Ariane à Naxos, même combat. J’exagère ? Oui, un peu, quoique… Hasards de la programmation : on peut voir les deux dans la foulée, l’un à l’Athénée, l’autre à l’Opéra Bastille. Mais quel rapport entre l’opérette gauloise qui a émoustillé nos arrière-grands-parents et l’opéra ultra-sophistiqué, plus germanique que nature de Strauss et Hofmannsthal, avec intrigues en abîme et musique à l’avenant, sinon qu’ils racontent des histoires de leur temps sous couvert d’antiquité et qu’ils datent tous deux de la fin de la guerre de 1914-1918, c'est-à-dire, selon les historiens, du début effectif du XXème siècle ? Eh bien tout est là, justement : l’instinct de vie, le besoin de conjurer l’apocalypse, la redistribution des rôles entre les guerriers désarmés et les amazones ragaillardies. Les deux spectacles poussent à la comparaison : univers bling-bling, légèreté de l’être soulignés par Laurent Pelly dans sa mise en scène d’Ariane, marionnettes façon statues grecques, théâtre dans le théâtre et cynisme de notre temps pour Phi-Phi (bravo la compagnie Les Brigands, qui renonce enfin au bâclage sous couvert de second degré). Dans Ariane, la comédie de l’infidélité coiffe au poteau la tragédie de la fidélité. Dans Phi-Phi, dont le librettiste Albert Willemetz avait plus d’idées que le musicien Christiné, les épouses et les maîtresses revendiquent les mêmes pouvoirs, et ce sont les modèles court-vêtus du sculpteur (Phi-Phi, c’est Phidias) qui manipulent les mâles-marionnettes. Salles pleines, public concerné. S’agirait-il, cette fois encore, de conjurer l’apocalypse ?
François Lafon
Phi-Phi, d’Henri Christiné. Mise en scène Johanny Bert, direction musicale Christophe Grapperon. Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 9 janvier.
Ariane à Naxos, de Richard Strauss. Mise en scène Laurent Pelly, direction musicale Philippe Jordan. A l’Opéra de Paris-Bastille, les 20, 22, 25, 28 ; 30 décembre.
Photo : Phi-Phi © Elisabeth de Saverzac

A l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille, salle pleine, malgré la neige, pour Street Scene de Kurt Weill par l’Atelier Lyrique de l’Opéra. Avec My Fair Lady au Châtelet, c’est Broadway sur Seine. Les moyens ne sont pas les mêmes, les dialogues ont été élagués, il n’y a qu’un piano (formidable, le pianiste : il s’appelle Alphonse Cemin) pour donner leur rythme à deux heures de musique, mais comme les jeunes chanteurs sont déchaînés, comme le spectacle est d’autant plus touchant qu’il est simple, on y rêve tout autant. Cette histoire d’un taudis de Brooklyn et de ses habitants en période de canicule n’est pourtant pas rose. Weill, en devenant américain, a troqué les brulots de Brecht contre des livrets plus soft, sa musique s’est broadwaytisée, mais il n’est pas complètement entré dans le moule. Il grince encore, il dérange, il invente le musical intellectuel dont s’inspireront Bernstein et Sondheim. Le spectacle se donne encore aujourd’hui 19, mardi 20 et mercredi 21. Si vous êtes Toulonnais, ne manquez pas la reprise, les 29 et 31, du même Street Scene dans la mise en scène d’Olivier Bénézech, déjà donné en février dernier. C’était la création en France. Il était temps de s’y mettre !
François Lafon
Songs from Street Scene. Mise en scène : Irène Bonnaud, par l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris. Les 19, 21, 22 décembre, 20h, Opéra Bastille, Amphithéâtre
Street Scène. Mise en scène : Olivier Bénézech, Opéra de Toulon, les 29 et 31 décembre
Street Scene. Josephine Barstow, Samuel Ramey, Barbara Bonney, Scottish Opera Orchestra, John Mauceri (dir). 2CD Decca (1991)
Photo Mirco Magliocca/Opéra national de Paris

Au Châtelet pour les fêtes : My Fair Lady. Superproduction (3 millions d’euros), mise en scène chic et réussie de Robert Carsen, distribution de grands professionnels anglais, qui jouent là un de leurs classiques. A Paris, des versions en VF ont souvent été annoncées, venues de Belgique ou d'ailleurs, mais elles n'ont jamais passé le périphérique. Inadaptable, disait-on, intraduisible cette histoire de marchande de fleurs venue du ruisseau, qui entre dans la bonne société parce qu’elle apprend à parler correctement l’anglais. On n’a pourtant jamais hésité à monter Pygmalion, la pièce de Bernard Shaw dont le musical est une copie presque conforme, et tant pis si l’accent de Belleville n’a pas les mêmes implications que le cockney londonien. Le film de George Cukor, aussi, avait achevé de dissuader les téméraires. Hier à l’entracte, on entendait : « Elle est bien, cette Sarah Gabriel, mais, bon, Audrey Hepburn… ». Des réactions d’enfants gâtés, les mêmes que l’année dernière, même endroit, avec La Mélodie du bonheur. Là, on regrettait Julie Andrews, qui est d’ailleurs la créatrice de My Fair Lady au théâtre. Et puis, ne serait-ce que pour la pirouette finale, où Carsen réinjecte le cynisme de Shaw dans le happy end obligatoire du musical (je vous laisse la surprise), le spectacle mérite de passer à l’Histoire. En juin prochain, il sera repris au Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg. Là, ce sera une vraie première, et autrement plus symbolique qu’elle ne l’est ici.
François Lafon
Châtelet, Paris, jusqu’au 2 janvier.

Nietzsche/Wagner : le Ring, hier soir au Théâtre Charles-Dullin de Grand-Quevilly (Rouen). Succès la semaine dernière à Reims. Tournée en vue. Le titre se prête aux fausses pistes. Dialogue philosophique ? Explication de textes ? Non. C’est la répétition d’une Tétralogie de poche. Sur scène, devant un rideau magique (mur et forêt en même temps), trois chanteurs, des assistants, des techniciens. Dans la fosse, une vingtaine de musiciens de l’Orchestre de Basse-Normandie et leur chef Dominique Debart. Vient un empêcheur de chanter en rond : Nietzsche, l’amoureux déçu, le fanatique revenu de sa passion. Il nous donne toutes les raisons – les meilleures comme les pires – de détester Wagner. En réponse, les chanteurs chantent et les musiciens jouent. Ce ne sont pas les moments qu’on attend (pas de Chevauchée, pas de Marche funèbre), mais les scènes clé, entre Wotan et Brünnhilde, entre Brünnhilde et Siegfried, entre Siegfried et ses rêves. Les chanteurs sont très jeunes, l’orchestre joue avec la finesse qu’il mettrait à Siegfried-Idyll. On se croirait revenus aux origines, quand le format wagnérien n’existait pas. Alain Bézu, le metteur en scène, casse l’enchantement quand il le faut : réjouissante explication au tableau noir de la généalogie des dieux, film muet façon Méliès, où l’on voit le vilain Hagen ourdir ses complots. Ce n’est ni Le Ring pour les Nuls, ni une leçon de théâtre musical. C’est le poison et l’antidote en même temps. Amenez vos amis que Wagner endort. Si cela ne les réveille pas…
François Lafon

Récital Chopin de Maurizio Pollini à Pleyel. Salle comble, rangées supplémentaires de chaises sur scène. A la fin, quatre bis, dont la première Ballade et la Berceuse. Standing ovation. Beaucoup ont appris leur Chopin en écoutant Pollini, en usant ses disques. Alors qu’est-ce qui rend une telle soirée inoubliable ? Contre lui : un son un peu sec, un refus de l’effet qui frise l’ascétisme. Pour lui : une main gauche qui parle et une droite qui chante, un rubato léger qui évoque vraiment ce vent dans les feuilles dont parle Chopin, une façon sans pareille de faire flamber la musique au moment où l’on s’y attend le moins. Mais cette soirée en particulier ? Le programme : les vingt-quatre Préludes, huit Etudes de l’op. 25. Il y aurait un livre à écrire sur les enchaînements selon Pollini, sur la très légère respiration qu’il prend, ou ne prend pas, ou qu’il décale un peu, pour passer du majeur au mineur, sur les correspondances, les idées fixes (merci Berlioz), les embryons de leitmotifs (merci Wagner) qu’il indique sans en avoir l’air, sur la façon dont il éclaire un accord, une formule dont le XXème siècle fera son miel. Entre ces deux voyages au long cours, un 1er Scherzo fulgurant, deux Nocturnes op. 27 d’autant plus mystérieux qu’ils ne cherchent pas à l’être. Le tout-venant ? Pour lui, oui. C’est dire !
François Lafon
Photo DR

Thème de la saison : Les utopies. Titre du cycle : L’art total. Clou du concert de l’Orchestre National de Lyon dans la salle ovale de la Cité de la musique : la version son et lumière du Prométhée de Scriabine. Pour chauffer la salle et l’orchestre, dirigé avec plus d’élégance que de punch par son bientôt ex-chef Jun Märkl : le Prométhée de Liszt (Malheur et gloire), Mort et transfiguration de Strauss (sans commentaire) et Les Créatures de Prométhée de Beethoven (avec le thème du finale de la Symphonie « Héroïque » en version ballet). De Baudelaire à Messiaen, « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent », et Scriabine, en 1911, a rêvé un clavier de lumières aujourd’hui réalisé : à chaque harmonie, une couleur projetée derrière l’orchestre, doublée, sur les murs de la salle, d’une progression lumineuse moins illustrative. Au début, la magie opère : l’énorme orchestre, avec orgue et piano (Roger Muraro, toujours à l’aise dans les défis fous) est plongé dans une pénombre animée de lueurs mi-boite de nuit mi-Nuit de Walpurgis. Mais bien vite, ce sont les mêmes effets qui se répètent, et l’on finit par se dire que cette musique monstre manque d’imagination. Alors on ferme les yeux, et si l’extase ne vient pas, on ne peut s’en prendre qu’à soi.
François Lafon

Inviter des baroqueux à diriger l’Orchestre de Paris, c’est une idée louable, ne serait-ce que pour conjurer l’expérience ratée avec Frans Brüggen (1998 – 2000). Cette fois, c’est Jean-Christophe Spinosi qui s’y colle, avec un programme à risques : la Symphonie « L’Ours » de Haydn, le Concerto pour deux pianos et la Messe du Couronnement de Mozart. Pour le chef, le grand jeu : exercice de style (Haydn), accompagnement de solistes – instrumentistes et chanteurs – et maniement de grands effectifs. Spinosi, connu pour ses Handel et ses Rossini, attaché à prouver sa valeur dans des répertoires plus récents, s’est fait une réputation en galvanisant du geste son Ensemble Matheus. Face à l’Orchestre de Paris, son agitation est étrange : n’est pas Leonard Bernstein qui veut. L’orchestre le suit, mais sans renoncer à sa respiration, qui est large, ni à sa sonorité, qui est charnue. La symphonie de Haydn est en place, mais tournée vers l’effet. Cela marche : le public se laisse avoir par les fausses fins du dernier mouvement, et applaudit en plein milieu. Dans le concerto, l’orchestre se relâche, mais on écoute surtout la grande Maria Joao Pires phraser à ravir, secondée par son élève David Bismuth. La messe, elle, est de trop : mise en place hasardeuse, éclats à contre-sens. Un moment de grâce, quand la soprano Marita Solberg chante l’Agnus Dei, petit frère du Dove sono de la Comtesse dans Les Noces de Figaro. Mais il y a longtemps que pour le chef, l’enthousiasme ne suffit plus.
François Lafon

Idées toc
Il y a des opéras à thèse, comme il y a du théâtre à thèse. Mathis le peintre, qui entre au répertoire de l’Opéra de Paris pour le cent-quinzième anniversaire de la naissance de Paul Hindemith, en est l’exemple type. C’est un monument - trois actes d’une heure chacun et un livret à clé : Matthias Grünewald (l’auteur du Retable d’Issenheim) hésitant entre l’art et l’action, alias Hindemith lui-même face la montée du nazisme. Musique bavarde et texte redondant. L’ouvrage est difficile à monter, et l’est d’ailleurs rarement. Christoph Eschenbach, qui fait ses débuts dans la fosse de la Bastille, allège le plat autant qu’il le peut. Mais le metteur en scène Olivier Py tombe dans le piège. Il sucre le sucre, symbolise les symboles, illustre l’illustration. Dans des décors raides et mouvants comme la partition d’Hindemith, il mélange tanks et bombardes, SS avec chiens et anges avec ailes, évocations du Retable et flashs des camps de la mort. Quand Matthias Goerne, à la fin, reste seul pour enfin faire montre de son art de diseur, il est trop tard. On a ingurgité trop de grandes phrases et de riches harmonies, trop d’images choc et d’idées toc. Mathis le peintre a un cousin germain : Palestrina, de Hans Pfitzner. Ne le dites à personne : on risquerait de le retrouver sur la scène de la Bastille.
François Lafon
Création choc
Mathis est une vaste réflexion sur la place de l’artiste dans une société totalitaire, sur la solitude de l’individu face aux choix qu’imposent ces périodes de déchirement, sur le bouleversement dans les repères de la pensée et de la religion. Et cette imposante réflexion se déroule sous nos yeux comme une fresque historique et spirituelle, à la manière du Retable d’Issenheim lui-même, peint au XVIème siècle et conservé à Colmar, qu’il n’est peut-être pas inutile de contempler avant la représentation. Qu’Olivier Py fasse référence au nazisme, rien de plus normal : c’est l’œuvre elle-même qui veut ça. Sa mise en scène, impressionnante par ses dimensions picturales, s’allie ainsi en contrepoint à l’austérité d’une partition qui prend souvent des allures de « longue steppe » musicale. Elle traduit les désarrois qui hantent l’œuvre, ces contraintes qui ne laissent de choix qu’entre la marginalisation de l’individu libre et la servitude volontaire de la masse, la résistance pour le catholicisme flamboyant ou l’adhésion aux idées rigoureuses de Luther. Avec, en point d’orgue, un Mathis qui se dépouille de ce qu’il a fait de bien, ce à quoi il aspirait, ce qu’il a créé, les honneurs qu’il a reçus, ce qui l’a tourmenté, ce qu’il a aimé. Christoph Eschenbach, l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra de Paris soutiennent la partition pendant ces quatre heures en puisant dans les profondeurs les plus charnelles d’une Passion symbolisée par le Retable. Et si ce qui caractérise la distribution est sa qualité et son homogénéité, signalons, à côté d’un Matthias Goerne qui fera date dans l’histoire de l’Opéra de Paris, l’exceptionnelle Mélanie Diener.
Albéric Lagier
Opéra National de Paris Bastille, les 19, 22, 25 et 28 novembre, 1er, 3 et 6 décembre.
Photo : Eric Huchet (Sylvester von Schaumberg) et Matthias Goerne (Mathis). Crédit : Charles Duprat / Opéra national de Paris

Débarrasser l’opéra de ce qui l’enchaîne au passé, en extraire l’or pur, n’en garder que ce qui nous parle. Pour cela se fier à ses souvenirs, faire œuvre de ce qui reste après qu’on a tout oublié. Tout amateur en a rêvé, Peter Brook l’a fait. Magistralement avec La Tragédie de Carmen (1981), plus difficilement avec Impressions de Pelléas (1992), en état de grâce aujourd’hui avec Une Flûte enchantée. Une Flûte « librement adaptée », qu’il a longtemps méditée sans oser s’y coller, et qu’il donne aux Bouffes du Nord, où il officie depuis trente-six ans, en guise de cadeau d’adieu. De fait, c’est du super-Brook que nous avons là, c'est-à-dire que l’artifice est réduit à sa plus simple expression, que le théâtre naît de rien, comme cette flûte escamotée à la fin, qui est partout et nulle part, et que, probablement, nous emportons avec nous. Pas de rituel maçonnique, ni de théâtre de tréteaux : des murs rouges, des costumes neutres, de très jeunes chanteurs-acteurs, deux comédiens qui servent de dei ex machina. Adaptée pour un piano et sept voix par Franck Krawczyk, la musique est mieux qu’un digest : une fantaisie sur un thème. L’histoire ? Effleurée. Comme dit Papageno au début : « Tout le monde me connaît. » Ce qui a intéressé Brook, c’est l’initiation, l’abandon de ce qui nous retient au sol, nous empêche d’arriver aux « régions de lumière » entrevues par l’essayiste Joubert. Ce qu’il avait raté dans son film sur Gurdjieff Rencontres avec des hommes remarquables, il le réussit ici, trente ans plus tard. Peut-être parce que maintenant il sait, ou que, comme Jack London dans Martin Eden : « Au moment où il sut, il cessa de savoir. »
François Lafon
Une Flûte enchantée. Théâtre des Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 31 décembre. Suivi d’une tournée à Athènes, Brême, Londres, Grenoble, Luxembourg, Milan, New York
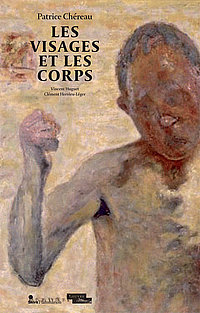
« Faire théâtre de tout », répétait Antoine Vitez. Patrice Chéreau, invité au musée du Louvre, le fait, et tout naturellement. Dans les salles immenses, théâtres des oeuvres mortes et de la vie retrouvée, il donne la pièce de Jon Fosse Rêve d’automne – des retrouvailles dans un cimetière – et le monologue de Bernard-Marie Koltès La Nuit juste avant les forêts – ou les mots comme dernier espoir. Dans un espace plus intime, il a réuni des tableaux et des photos. L’Homme au gant du Titien converse avec L’Homme à la ceinture de cuir de Courbet, Le Christ mort couché sur son linceul de Philippe de Champaigne renvoie au jeune homme nu, debout, photographié par Nan Goldin. Comme Thierry Thieû Niang, le collaborateur de Chéreau, est aussi danseur, il y a de la danse sous les cimaises, et comme Daniel Barenboim – à défaut de Pierre Boulez, souffrant – est là, on fait de la musique. Cela se passe à l’auditorium du musée, car dans les galeries aux échos de cathédrales… Et pourtant si, et cela, il fallait l’oser. A trois reprises hier soir, de la pénombre de la section espagnole à la grande galerie italienne éclairée a giorno, une centaine de happy few ont suivi Waltraud Meier chantant les Wesendonck Lieder de Wagner comme s’il y allait de sa vie. Par d’autres, cela aurait senti l’installation branchée. Là, chavirés par cette Isolde en quête d’infini, on n’a pensé qu’à faire le grand saut avec elle. Tout cela s’appelle Les Visages et les corps, c’est une grande jonglerie avec le désir, la dépression et la mort (mots clés chéralducéens). Cela pourrait être sinistre comme un musée la nuit, et pourtant on en sort tout revigoré.
François Lafon
« Les Visages et les corps ». Le Louvre invite Patrice Chéreau. Théâtre, films, musique, danse, rencontres, jusqu’au 9 décembre.

Fallait-il ? Ne fallait-il pas ? Trente-sept ans et six mois après sa création, la mise en scène des Noces de Figaro par Giorgio Strehler reprend du service à l’Opéra Bastille. En 2004, quand Hugues Gall a passé les clés de la maison à Gerard Mortier, celui-ci s’est empressé de « déclasser » la production. Si le spectacle qui l’a alors remplacé, signé Christoph Marthaler, avait fait l’unanimité, nous n’aurions peut-être jamais revu celui-ci. Mais pourquoi Nicolas Joël, successeur de Mortier, n’a-t-il pas lui-même tenté d’autre Noces ? « Parce que celles-ci sont parfaites », se plaît-il à rappeler. Dans l’absolu, il n’a pas tort, mais qu’est-ce que l’absolu en matière de mise en scène ? En 1973, Strehler était considéré comme le plus grand metteur en scène du monde, et ces Noces, commandées par Rolf Liebermann, ont imposé l’Opéra de Paris comme la scène internationale qu’elle n’était plus depuis longtemps. De l’Opéra Royal de Versailles (pour les deux premières représentations) au Palais Garnier, de Garnier à la Bastille, Les-Noces-de-Strehler est devenu une coquille vide, où se sont succédé plusieurs générations de grandes voix. Avant qu’Humbert Camerlo, qui avait été son assistant, n’en resserre les boulons, Strehler lui-même et son scénographe Ezio Frigerio avaient même demandé que leur nom ne figure plus à l’affiche. Aujourd’hui Camerlo, secondé par Marise Flach, détentrice de la « grammaire du geste strehlérien » (sic), continue d’entretenir la flamme. Vu avec les yeux de la mémoire, le monument tient debout. Le dernier mot revient pourtant à ce jeune homme qui voyait hier Les Noces de Figaro pour la première fois : « Figaro et la lutte des classes, ça le faisait il y a trente ans. Mais là-dedans, il y a aussi tout ce qui nous prend la tête aujourd’hui. Il faudrait que votre Strehler ressuscite pour nous raconter ça. »
François Lafon
Crédit : Fred Toulet / Opéra national de Paris

« Pierre-Laurent Aimard va enchaîner les œuvres qui constituent son programme. Il vous demande donc de n’applaudir qu’à la fin ». Le public du Théâtre des Champs-Elysées se le tient pour dit, et ne bronchera pas. Un seul portable sonnera, deux ou trois sièges claqueront. Un auditeur qui assiste à son premier récital de piano aura trouvé l’annonce inutile : de toute évidence, le pianiste n’a joué qu’une seule œuvre, coupée en deux par un entracte. Erreur : il y a du Bartok, du Liszt, du Messiaen et du Ravel. Peu auront vu la jointure entre Nénie (Bartok) et Aux Cyprès de la Villa d’Este (Liszt - Années de Pèlerinage). Quelques-uns auront cru que les Oiseaux tristes (Ravel - Miroirs) sont du même auteur que Le Traquet Stapazin (Messiaen - Catalogue d’Oiseaux). Aimard, disciple de Messiaen, complice de Boulez, a pourtant pris soin de mettre en valeur le style de chaque œuvre, de chaque compositeur, comme s’il tenait à parler le hongrois (Bartok, Liszt) sans plus d’accent que le français (Ravel, Messiaen). C’est même, paradoxalement, pour tout cela que ce jeu de miroirs (tiens !) est si troublant. Pas de bis, cela briserait la glace. Dimanche dernier, toujours dans la saison de Jeanine Roze, Aimard faisait équipe avec Alfred Brendel, dans le cadre du centenaire de Jean-Louis Barrault. Une drôle de paire. A talent égal.
François Lafon
Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 15 octobre
Photo : Felix Broede /DG

Toujours féconds, les liens entre musique et politique. Nulle part ailleurs qu’en Union Soviétique ils ont été plus serrés et plus tendus, mais aussi plus troublants, principalement entre 1917 et 1953. C’est la période explorée dans une exposition qui vient d’ouvrir ses portes au Musée de la Musique (jusqu’au 16 janvier 2011). A l’image du « Troisième Reich et la musique », qui a connu un énorme succès en 2004, « Lénine, Staline et la musique » fait défiler toute une époque de la culture russe. On voit (et parfois aussi on entend) des manuscrits de Prokofiev et de Chostakovitch, des esquisses de Malevitch pour un opéra, des portraits à la gloire de Lénine et de Staline, des extraits d’Alexandre Nevsky (le film d’Eisenstein, avec une musique de Prokofiev). On retrouve les noms de Meyerhold, Rodchentko, Chagall, Gorki…
Age d’or ou âge de fer ? Les deux, car on voit surtout comment l’art devient, au nom de la Révolution, le serviteur d’une propagande. Un vent de liberté souffle (très brièvement) sur la Russie au lendemain de la Révolution d’Octobre. Puis, dès les années 1920, Staline se charge de mettre les artistes au pas, dans le sens le plus littéral du terme, processus qui culminera dans le fameux article de la Pravda, rédigé, semble-t-il, par le Petit Père du Peuple en personne, et condamnant sans appel Lady Macbeth de Mzensk, l’opéra de Chostakovitch. L’ombre de Staline (qui comme Lénine avait des goûts musicaux plutôt conservateurs) est omniprésente dans la deuxième partie de l’exposition, qui se termine sur les funérailles du dictateur, mort le même jour que Prokofiev. On apprécie mieux, à la fin de ce parcours, la liberté, fragile mais néanmoins réelle, dont jouissent les artistes dans la société actuelle.
Pablo Galonce
Photos :
Vladimir Tatline, La Porte du Saint-Sauveur, Projet de décor pour Une vie pour le tsar de Mikhaïl Glinka,1913 © Moscou, galerie nationale Tretiakov
Tatiana Bruni, L’Ouvrier au fourneau, projet de costume pour le ballet Le Boulon de Dmitri Chostakovitch, 1931 © Saint-Pétersbourg, musée national du Théâtre et de la Musique
"Lénine, Staline et la musique", du 12 octobre au 16 janvier à la Cité de la Musique, Paris.

Avec sa dernière production de La Bohème de Puccini, le Capitole de Toulouse sacrifie à une tradition fortement ancrée : cette pièce est pratiquement revisitée tous les cinq ans, et l’on compte vingt-cinq reprises depuis sa création in loco. Les amours impossibles du livret sont-elles particulièrement appropriées à la fibre toulousaine, ou bien, au contraire, ce sont les pierres d’attente d’une lecture sociale de l’histoire qui fascinent ? Le metteur en scène Dominique Pitoiset appuie, quant à lui, ce dernier aspect et intensifie le vérisme de l’intrigue qui se déroule dans le Paris du 21e siècle. Pour les deux premiers tableaux, cette adaptation ne contraste pas avec la musique. En revanche, les deux derniers « résonnent » de manière très anachronique par rapport à ce que l’on entend : l’actualisation est exagérée et ne colle plus vraiment avec l’œuvre. Cela n’empêche pas l’émotion de passer, malgré aussi une certaine inégalité des chanteurs, un équilibre fragile entre l’orchestre et les voix, et une direction (Niksa Bareza) très conventionnelle
Katchi Sinna
Théâtre du Capitole, Toulouse, les 3,5,6,7,8,10,12,13,15,17 octobre 2010.
Photo DDM/Frédéric Charmeux

Au Châtelet, les Parisiens continuent à faire leur éducation en matière de musical. Après La Mélodie du bonheur, A Little Night Music et quelques autres, voici Show Boat, l’ancêtre (1927), l’acte fondateur du genre. On y assiste, sur une musique qui a fait son chemin (Ol’Man River et autres tubes), à trente ans d’histoire de l’Amérique. Les auteurs, Jerome Kern (musique) et Oscar Hammerstein II (livret), ont fait fort : on y voit une chanteuse de music hall rejetée parce qu’elle a du sang noir et des couples improbables liés par une incompréhensible passion, tous embarqués sur un show boat, un de ces bateaux théâtres qui sillonnaient le Mississippi. Venue de Cap Town, où la ségrégation n’est pas un lointain souvenir, la production n’est pas riche et la mise en scène ne doit pas être beaucoup plus moderne que celle de Maurice Lehmann, lors de la création française en 1929, déjà au Châtelet. C’est peut-être cela le plus émouvant, cette pièce de musée donnée comme un morceau d’actualité par une troupe qui a l’air de jouer sa vie. Comme tout le monde chante et bouge bien, on n’a jamais l’impression de voir un spectacle au rabais. Prochaine résurrection, en décembre : My Fair Lady. Encore une histoire cruelle sous des dehors souriants.
François Lafon
Théâtre du Châtelet, Paris, jusqu’au 19 octobre.
Crédit : © Malin Arnesson

La morale, le social, la religion, la spéculation : quatre clés du Triptyque, spectacle en trois volets imaginé par Puccini avant la guerre de 14-18, et créé juste après à New York. Drame de la jalousie chez les mariniers en temps de crise (Il Tabarro), opprobre terrestre et consolation céleste pour l’aristocrate qui a fauté (Suor Angelica), magouilles financières chez les bourgeois (Gianni Schicchi) : fantasmes et réalités de notre avant-guerre. A noter que Puccini, en mal d’inspiration, retrouve la forme quand la méchante Princesse vient déshériter la femme perdue (Suor Angelica) et quand l’escroc Gianni Schicchi détourne l’argent de la famille indigne. Dans le spectacle sans grâce ni inspiration signé par Luca Ronconi à La Scala de Milan et repris, avec une distribution passe-partout, à l’Opéra Bastille en guise de « première nouvelle production de la saison », cela se remarque à peine. Pourquoi, alors, monter ces œuvres qui ne valent que par ce qu’elles révèlent de leur époque, et, avec un peu de chance, de la nôtre ?

Jörg Widmann (une création française), Dvorak, Beethoven : à Pleyel, un programme sur mesure pour Christoph von Dohnanyi, avec l’Orchestre de Paris. Sauf que de Dvorak, il s’agit du rare et pas fameux Concerto pour piano, défendu (c’est le mot) par le jeune Martin Helmchen, de Widmann l’ouverture de concert Con brio, où les timbales en folie (bravo le timbalier) illustrent le rythme selon Beethoven, et de Beethoven en personne, la Symphonie « Héroïque ». C’est là que le vieux chef (quatre-vingt-un ans) va faire d’un concert de série un moment d’anthologie. Son « Héroïque » n’a pas bougé depuis son enregistrement avec l’Orchestre de Cleveland en 1983 (Telarc), et si elle nous paraît étonnamment ample, c’est parce que les baroqueux sont passés par là, et que nos oreilles ont changé. Ce qui ne vieillit pas, en revanche, c’est la liberté avec laquelle Dohnanyi dirige cette musique. Plus de bâti : l’édifice tient tout seul. Pour cette « première symphonie romantique », dont le dernier mouvement fait exploser les formes traditionnelles, cette (fausse) improvisation est en situation : l’imagination est au pouvoir et l’Esprit de la révolution souffle. Et dire que Dohnanyi, dans le cercle fermé des baguettes internationales, est encore considéré comme un second couteau !
François Lafon
Paris, Salle Pleyel 29 et 30 septembre

Troisième reprise pour ouvrir la saison à l’Opéra de Paris, troisième production datant de la direction d’Hugues Gall – avec une impasse significative sur le règne de Gérard Mortier : Le Vaisseau fantôme de Wagner. « On évalue le niveau d’une maison d’opéra à la qualité de ses reprises autant qu’à l’éclat de ses premières », affirme l’actuel directeur Nicolas Joël. Cela veut dire des distributions qui tiennent la route, des chefs à toute épreuve et des mises en scène pas trop compliquées. Les fans du festival permanent sont frustrés. Ni L’Italienne à Alger, ni Eugène Onéguine, ni ce Vaisseau, c’est vrai, ne véhiculent le grand frisson. Les salles sont pleines pourtant, et le public applaudit de bon cœur : tout le monde, apparemment, ne mesure pas son plaisir à l’aune du festival permanent. On va entendre une œuvre, correctement interprétée. Un signe de médiocrité ? Pas forcément. Et puis l’oiseau rare n’en est que mieux venu : dans ce Vaisseau piloté par un chef routinier (Peter Schneider) et habité par une Senta sans grâce (Adrianne Pieczonka) entourée de vétérans jouant « au métier » (James Morris, Matti Salminen), la découverte du ténor Klaus Florian Vogt (photo) nous fait passer du noir et blanc à la couleur. Un seul être arrive, et le monde est repeuplé.
François Lafon
Photo : Opéra national de Paris/ Frédérique Toulet


