
A la Philharmonie de Paris, second des "premiers concerts de l’orgue symphonique", construit par l’entreprise Rieger (Autriche) et harmonisé par son facteur (français) Michel Garnier. L’inauguration officielle aura lieu les 6 et 7 février prochains, quand les 6055 tuyaux et les 91 jeux seront prêts. Pour cette avant-première (2/3 des jeux utilisables), Thierry Escaich improvise, arcbouté tel le capitaine Nemo sur le clavier de la console de pilotage (blanche, esthétique années 1970), tandis que s’efface le mur du fond et qu’apparaît à contre-jour la formidable machinerie. Un impressionnant jonglage avec les non moins impressionnantes possibilités de l’instrument, mettant Saint-Saëns (thème du Cygne) à l’honneur, comme une introduction au reste du programme : Concerto en la mineur pour violoncelle et orchestre et Symphonie n° 3 « avec orgue ». Standing ovation pour Paavo Järvi et l’Orchestre de Paris toute harmonie dehors, funambules virtuoses entre le grandiose et le pompier qui caractérise la Symphonie. Beau moment aussi pour la violoncelliste Sol Gabetta dans … l’Elégie de Fauré (en bis), le Concerto de Saint-Saëns trouvant la fougueuse Argentine de Paris à court de son et de vélocité. Le premier « premier concert », hier, proposait en création mondiale le Concerto pour alto du compositeur allemand Jörg Widmann, avec Antoine Tamestit en soliste. Crainte de ne pas remplir deux salles avec une pièce contemporaine, galop d’essai pour Sol Gabetta et l’Orchestre avant tournée (Budapest, Vienna, Berlin, etc) ? Ironie (ou négligence) du calendrier : à l’Auditorium de Radio France, ce même soir, Edgar Moreau et l’Orchestre National jouaient … le Concerto de Saint-Saëns.
François Lafon
Philharmonie de Paris, grande salle, 28 et 29 octobre

Nouvelle ère - celle de Stéphane Lissner - à l’Opéra Bastille : Moïse et Aaron de Schönberg dirigé par Philippe Jordan et mis en scène par Romeo Castellucci, remplaçant Patrice Chéreau initialement prévu. Un chef-d’œuvre inachevé dont le sujet n’est autre que l’impossibilité de dire et de montrer. En 1995 au Châtelet (direction Lissner), le metteur en scène Herbert Wernicke avait enfermé le débat dans un piège de béton ouvert sur l’infini, tandis qu’au même moment, à Amsterdam, Peter Stein chorégraphiait superbement l’errance du peuple indéfiniment manipulé. Castellucci, maître en images qui disent sans dire, part des derniers mots de Moïse descendant du Sinaï : « O Verbe, Verbe qui me manques » et pose la question « Jusqu’à quel point pouvons-nous croire dans les images ? ». Blanc sur blanc pour montrer l’inmontrable au premier acte, goudron et eau lustrale au deuxième, quand Aaron concède aux Juifs le Veau d’or à adorer, en l’occurrence un (vrai) taureau de concours, blanc lui aussi et à son tour goudronné. Comme à son habitude (de La Divine Comédie à Avignon à Parsifal à Bruxelles – son premier opéra) il crée des rituels pour mieux les casser (le magnétophone enfermant le Verbe, le missile à produire des sortilèges) et suscite l’érotisme à force de le réfréner. C’est en fait à Jordan, occupé avec succès à prouver que cette musique est tout sauf cérébrale, que revient la tâche de jeter un pont entre ce monde et le nôtre. Chœurs superlatifs, orchestre somptueux (pas entendu plus beau depuis Boulez à Amsterdam – voir supra), Moïse (Thomas Johannes Mayer) maniant le sprechgesang comme sa langue natale, face à un Aaron dramatiquement convaincant mais vocalement sous-dimensionné. Applaudissements soutenus mais relativement timides, quarante-deux ans après la première de l’œuvre au Palais Garnier, en version française et sous la baguette de Georg Solti.
François Lafon
Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 9 novembre. Diffusion sur Arte le 23 octobre, et sur France Musique le 31 octobre Photo © Opéra de Paris

A des titres et à des degrés différents, aussi bien Mozart que Richard Strauss se sont produits à Leipzig, et pour Strauss, l’auteur d’Idomeneo était un dieu. En 1944, il dédia sa Sonatine pour vents n°2 « aux mânes du divin Mozart, au terme d’une vie pénétrée de gratitude ». En cette année 2015, l’Orchestre du Gewandhaus a conçu un cycle de concerts (dont trois à Paris) permettant d’entendre des concertos de Mozart entourés de poèmes symphoniques de Strauss. Il fallait oser, les sonorités n’étant pas les mêmes, surtout quand il s’agit, en ce qui concerne le Salzbourgeois, non d’un « grand » concerto pour piano mais du discret Concerto pour violon n°3. Pari tenu : interprétation de Christian Tetzlaff sans rien d’ostentatoire, très intérieure, en contraste total avec les côtés tonitruants de Strauss mais d’autant plus en situation. Exploit renouvelé dans le bis consacré à Bach : salle attentive, retenant son souffle. Auparavant Macbeth, ensuite Ainsi parla Zarathoustra, qui traite de la situation conflictuelle existant entre le surhomme nietzschéen et le monde. Là, quand il le faut, l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig et son chef Riccardo Chailly se déchainent sans retenue, servis par l’acoustique de la Grande salle de la Philharmonie : on entend tout, même en plein vacarme, les silences soudains dont (après un sommet d’intensité) ces ouvrages abondent restent habités de musique, sans aucune impression de sécheresse, et surtout, d’un bout à l’autre, le moindre détail, le moindre accent « parle » ». Une prestation vraiment de grande envergure.
Marc Vignal
Grande salle de la Philharmonie de Paris, 12 octobre Photo © DR
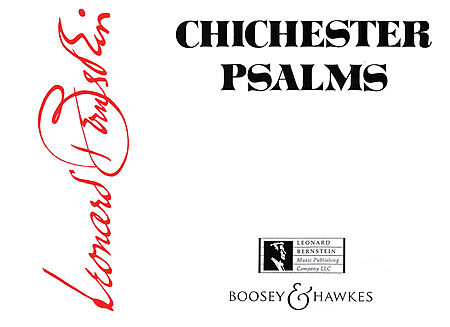
Chichester Psalms est une œuvre de Leonard Bernstein commandée en 1965 par le Southern Cathedrals Festival (Angleterre). Créée le 15 juillet de cette année-là à New York sous la direction du compositeur, elle est entendue le 31 dans la cathédrale de Chichester, dirigée par John Birch. Avec la symphonie Kaddish (1957), c’est l’ouvrage de Bernstein le plus ouvertement « juif ». Il y a trois mouvements suivis d’un finale s’enchainant directement au troisième. Le premier mouvement, joyeux, a la particularité d’être écrit en mesure déhanchée à 7/4, ce qui le rend difficile à exécuter, le deuxième, avec voix d’alto solo, n’est pas sans accents tragiques, mais tout se termine dans la lumière et la sérénité. Dans le cadre de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, Chichester Psalms a été interprété par la Maîtrise Notre-Dame de Paris et le Jeune chœur de Paris sous la direction d’Henri Chalet, dans sa version (authentique) pour orgue, harpe et percussion, des étudiants du Conservatoire régional de Paris assurant les parties vocales solistes. La harpe joue dans Chichester Psalms un rôle important, y compris dans la version pour orchestre (la harpe de David). En début de programme, six œuvres pour chœur (accompagné ou non) d’autant de compositeurs différents, tous sauf un (l’Américain Samuel Barber) bien vivants. Prestations de haut vol, dans les épisodes chantés aux limites du silence mais surtout dans ceux investissant de façon très impressionnante et toute naturelle le vaste espace sonore de Notre-Dame de Paris.
Marc Vignal
Cathédrale Notre-Dame de Paris, 6 octobre

Les Planètes (1918) est une suite pour grand orchestre en sept mouvements du compositeur britannique Gustav Holst (1874-1934). Chaque mouvement « décrit » une des sept planètes, de Mars (qui apporte la guerre) à Neptune (le Mystique) en passant par Mercure (le Messager ailé) ou encore Uranus (le Magicien). Oeuvre très populaire, ce dont le compositeur se plaignait en songeant au reste de sa production, que tous les chefs d’orchestre (dont évidemment Karajan) ont enregistrées, mais très rare au concert, du moins en France. L’Orchestre philharmonique de Radio France l’a inscrite à son programme, accompagnée de la projection d’un film de la Nasa : belles images de notre univers, mais tendant à réduire Les Planètes au rang de musique carrément descriptive. Or ce n’est pas toujours vrai, en particulier dans Saturne (qui apporte la vieillesse), douloureuse procession, le mouvement préféré de Holst. En tout cas, superbe interprétation (Mars d’une cruauté implacable), due non au directeur musical de l’orchestre Mikko Franck, empêché « pour des raisons personnelles », mais à son chef assistant, la Polonaise Marzena Diakun. Le sommet du concert était néanmoins Angels and Visitations (1978) du Finlandais Einojuhani Rautavaara (né en 1928). Page très contrastée, superbement orchestrée, inspirée de vers de Rilke, « née de la conviction qu’en dehors de notre conscience quotidienne, il y a des réalités autres [dont] relèvent des créatures que l’on peut appeler ’anges’ ». Pour en revenir à la musique britannique, à quand une symphonie de Vaughan Williams ?
Marc Vignal
Auditorium de Radio France, 2 octobre Photo © Magdeburski


