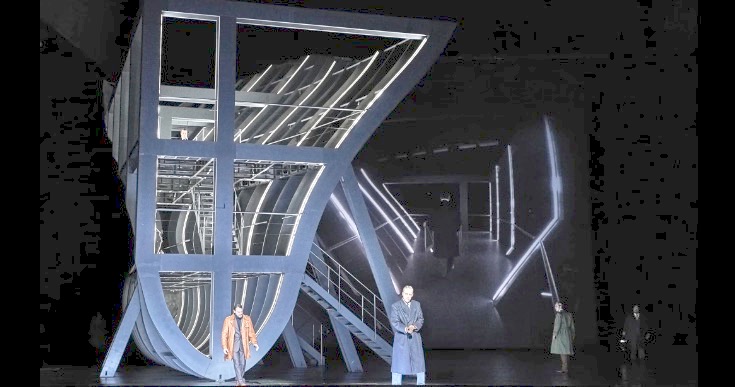A propos de MusikzenInformer et donner envie parce que la musique classique est d'abord un plaisir, tel est l'objectif de Musikzen. Pour partager ce plaisir et permettre aux internautes de s'y retrouver dans une actualité qui galope, Musikzen propose
- la sélection quotidienne CD, DVD ou téléchargement.
- le blog qui va dénicher la musique là où elle se trouve
- des places de concerts à gagner
- des biographies et discographies pour chaque compositeur.
La rédaction est assurée par six journalistes qui ont participé à l’aventure du Monde de la Musique : Pablo Galonce, François Lafon, Albéric Lagier, Franck Mallet, Gérard Pangon, Marc Vignal.
La rédaction se réserve le droit de publier ou non les textes ou contributions qui lui sont envoyés spontanément. Les commentaires déposés par les internautes sur le blog sont soumis à modération.
Contactsredaction@musikzen.comPublicité et annoncesPour tout contact commercial ou publicitaire
pub@musikzen.comLicenceLe site Musikzen est protégé par la législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle et les conventions internationales applicables. Le contenu du site et celui du blog qui y est attaché sont destinés à l'information personnelle de l'utilisateur du site. Ce contenu est protégé par la loi, notamment par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Le téléchargement et l'impression d'extraits du contenu de ce site web ne peuvent être effectués que pour un usage personnel à titre privé et à des fins non commerciales. Aucune reproduction, publication, vente, distribution ou exploitation commerciale du contenu de ce site web ne peut être faite sans l'accord préalable écrit de sa société éditrice.
ResponsabilitéMusikzen peut établir un lien avec d'autres sites ou sources. Musikzen ne répond pas de la disponibilité de tels sites et sources externes ni ne la garantit. Musikzen ne s'approprie pas les contenus auxquels ces sites ou sources donnent accès, et exclut toute responsabilité et garantie en ce qui concerne ces contenus. Si, dans les pages du site Musikzen, se trouve un lien avec une page externe dans laquelle des contenus illicites venaient à être diffusés par un tiers, Musikzen effacera, après avoir été informé desdits contenus, le lien avec cette page.
EditionMusikzen est une marque déposée.
Le site Musikzen est la propriété de ses rédacteurs.
Adresse postale :
François Lafon – Musikzen
40 avenue de Flandre
75019 Paris
Directeur de la Publication : Gérard Pangon
Design du site : Caroline Franc
Développement informatique : Axel Crété
Hébergement : Online.net