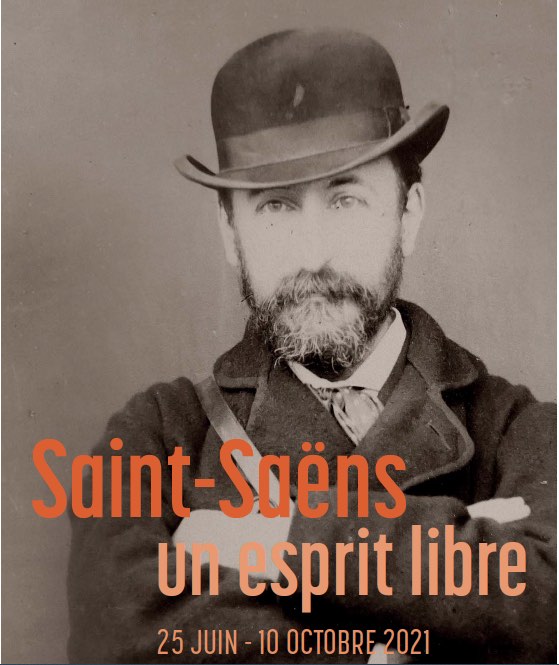

26 mars, France 5 - En replay six mois sur Culturebox - Sur France Musique le 3 avril- Au cinéma, ultérieurement (Photo © Monika Rittershaus/OnP)

Sur Arte Concert jusqu’au 25 février, sur Arte le 21 février à 14h05, au cinéma ultérieurement. En différé sur France Musique le 27 février
Photo © Vincent Pontet/ONP



Exposition Le Grand opéra, 1828 – 1867, le spectacle de l’Histoire. Bibliothèque-musée de l’Opéra, Palais Garnier, du 24 octobre 2019 au 2 février 2020 (Illustration : Affiche de L’Africaine, 1865 (c) BnF)

Opéra National de Paris – Palais Garnier, jusqu’au 16 avril (Photo©Elena Bauer/OnP)

Opéra National de Paris, Palais Garnier, 16 janvier (Photo : Angélique Boudeville © Vincent Lappartient)

Shakespeare, fragments nocturnes, Opéra National de Paris – Bastille – Amphithéâtre, jusqu’au 17 octobre. Le 26 octobre à La Grange au Lac, Evian (Photo © Studio j'adore ce que vous faites ! / OnP)

Collège de France, Paris, 14 juin

Collège de France, Paris, 10 avril (Photo © DR)

Opéra National de Paris – Bastille – Amphithéâtre. Tous publics les 23 et 24 mars (20h), scolaires le 22 mars (14h) (Photo © DR)

Opéra National de Paris – Palais Garnier, 23 mars. En différé sur France Musique le 23 avril (Photo © DR)

(Photo : Paulie Texier © DR)

Conférence de presse au Palais Garnier : la saison 2016-2017 de l’Opéra de Paris. Autour du directeur Stéphane Lissner, le directeur musical Philippe Jordan et celui de la danse Benjamin Millepied. Atmosphère moins électrique que la semaine dernière, lorsque ce dernier a publiquement annoncé sa démission. Interventions des metteurs en scène-dont-on-parle Thomas Jolly (Eliogabalo de Cavalli en ouverture de saison) et Dmitri Tcherniakov (La Fille des Neiges de Rimski-Korsakov en avril 2017), présentation par le compositeur Luca Francesconi de Trompe-la-Mort, son oeuvre nouvelle inspirée du personnage balzacien Vautrin : trois événements haut de gamme coexistant avec une programmation plus rassurante (dont Cavalleria Rusticana, mais couplé avec le rare Sancta Susanna d’Hindemith) et la présence de stars bankable (trois fois Jonas Kaufmann). Accent mis par Lissner sur la recherche de nouveaux publics : écran géant place de la Bastille (Carmen avec Roberto Alagna, qui l’a chanté partout sauf à Paris), mais aussi et surtout deux nouvelles catégories de prix, dont une « 7ème » emblématique (places à 50 €) et précision – elle aussi emblématique - que parmi les moins de vingt-huit ans conviés aux avant-premières instaurées par l’administration Lissner, 58% n’avaient jamais mis les pieds à l’Opéra. Création de nouveaux publics ou formation permanente des anciens? Eternel problème. Equilibre financier enfin proclamé pour 2015, en dépit des événements de novembre et de l’appareil sécuritaire d’urgence. Frémissement de la salle quand même (mais moins que l’année dernière – voir ici) lorsque en vedette américaine Millepied, sportivement salué par Lissner (« Il y aura un avant et un après »), se lance dans une présentation truffée de superlatifs de sa saison. Consensus général. Qui croira encore qu’ainsi looké, l’Opéra n’est pas le fidèle microcosme de l’actuel macrocosme ?
François Lafon

Tollé au Palais Garnier : les cloisons séparant les loges deviendraient amovibles, enlevées le soir pour les représentations, rétablies dans la journée pour les visites touristiques. L’opération, en projet depuis le premier trimestre 2014, permettrait de gagner une trentaine places. Pétition en ligne adressée à Stéphane Lissner (voir ici, 4500 signataires au 8 novembre), réaction de Hugues Gall, ancien directeur de la maison, dans Le Journal du dimanche : « Les vandales ne sont pas qu’à Palmyre (…) Si on se met à manipuler les cloisons, au bout de trois ou quatre fois, elles seront fichues et iront pourrir dans les combles ou les caves. » En 1976, la non moins historique Salle Richelieu de la Comédie Française avait subi un sort plus radical, toutes les loges de balcons ayant disparu. En 1980, devenant Théâtre Musical de Paris, le Châtelet avait été remodelé, perdant entre autres les colonnettes « décoratives » qui faisaient sa spécificité … et empêchaient les spectateurs des balcons de voir l’intégralité de la scène. Dans les deux cas, les répercussions acoustiques et le gain en visibilité avaient été évoquées en priorité. A Garnier, c’est le sacrilège esthétique (voire le sacrilège tout court) qui prime. Mais ni la Salle Richelieu ni le Châtelet ne comptent parmi les monuments français les plus visités.
François Lafon
Photo © DR

Présentation par Stéphane Lissner entouré de Benjamin Milepied (directeur de la danse) et Philippe Jordan (directeur musical) de la saison 2015-2016 à l’Opéra de Paris. En gros sur la façade de la Bastille : " Vibrer ? Frémir ? Oser ? Désirer ? Abonnez-vous ". Tout un programme par ailleurs copieux, contrastant nettement avec celui « de transition » proposé cette année. Mise en place de thématiques déployées sur six saisons et appuyés sur le triumvirat Wagner-Schönberg-Berlioz, l’opéra en temps de crise devant faire réfléchir avant que de divertir et attirer des sponsors au moyen de projets forts, tels le diptyque lyrico-chorégraphique Iolanta/Casse-noisette de Tchaikovski, mobilisant cinq chorégraphes pilotés par le metteur en scène Dmitri Tcherniakov. Mise en place par ailleurs d’une Académie sur le modèle de celle du festival d’Aix (Lissner déjà), englobant l’Atelier Lyrique toujours dirigé par Christian Schirm qui a fait son succès. Paris sur l’avenir : treize avant-premières à 10 € pour les jeunes, ouverture (septembre 2015) de « 3ème Scène », plateforme numérique destinée recevoir des créations originales, commandes d’œuvres nouvelles à des trios compositeur-librettiste-metteur en scène. Pour le grand public : reprises de spectacles anciens, marronniers du répertoire (la Trilogie populaire de Verdi), débuts in loco ou retour de quelques stars (Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Bryn Terfel). Même équation nouveauté-œcuménisme côté danse, Benjamin Millepied insistant sur la vocation du Ballet à entretenir sa tradition « sur les pointes » tout en poursuivant ses expériences contemporaines avec, notamment, Anne Teresa De Keersmaeker. Effet people : bombardé de questions, le wonder boy steals the show. L’autre face de l’opéra responsable selon Lissner ?
François Lafon

Exposition Rameau et la scène à la Bibliothèque-Musée de l’Opéra de Paris. Retour à la maison-mère pour clore le 250ème anniversaire de la mort du génie longtemps mal-aimé. Manuscrits, éditions originales, estampes et maquettes (« De l’écriture à la représentation »), photos et costumes d’un siècle de redécouverte et de recréation des œuvres (« Du Purgatoire à la lumière ») : beaucoup à voir et à lire compte-tenu de l’exiguïté des lieux, des documents rares pour la plupart issus du fonds maison. En milieu de parcours : un grand mur bleu nuit sur lequel sont inscrites, comme sur un tombeau, les grandes reprises à l’Opéra, depuis Hippolyte et Aricie (mise en scène de Paul Stuart, avec Lucienne Bréval en Phèdre - 1908) jusqu’à … Hippolyte et Aricie (mise en scène d’Ivan Alexandre – 2012) en passant par Castror et Pollux, Les Indes galantes, Platée, Dardanus et Les Boréades, soit six des vingt-huit ouvrages scéniques (tragédies et comédies lyriques, opéras-ballets, pastorales héroïques, etc.) composées entre 1733 par un débutant âgé de cinquante ans jusque-là spécialisé dans la musique instrumentale et 1764, date de sa mort et du report sine die de la création de ses ultimes Boréades. Sous l’hommage donc, la moins glorieuse réalité : trente ans et plus après le déferlement de la vague baroqueuse, Rameau n’est toujours pas une valeur sûre et seuls ses blockbusters (si l’on peut dire) figurent au répertoire de l’Opéra. Côté mise en scène, reconstitueurs et actualiseurs continuent pourtant – les seconds distançant les premiers, en nombre tout au moins – à chercher les moyens les plus efficaces de résoudre les problèmes dramaturgiques posés par ce théâtre d’un autre temps, la partie musicale étant une fois pour toutes dévolue au tenants de la philologie. Un work in progress, veut-on croire, plutôt qu’une cause perdue.
François Lafon
Bibliothèque-musée de l’Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 8 mars 2015 Photo © DR

Partenariat entre l’Opéra de Paris et l’Institut culturel Google pour révéler « Les trésors cachés du Palais Garnier ». En fait de trésors : 83 portraits d’étoiles du ballet à travers les âges (à quand les chanteurs, chefs, metteurs en scène et décorateurs ? ), des galeries en HD - avec possibilité de zoomer sur les détails - des peintures et sculptures plus ou moins inaccessibles, à commencer par le plafond de Chagall (une prouesse, paraît-il), des vues à 360° - selon le principe Street View - de la salle, de la scène, de la Bibliothèque-Musée, des toits et de la retenue d’eau souterraine, ces deux derniers étant les plus « cachés » puisqu’interdites au public, révélant pour l’un un panorama unique sur la capitale et confirmant pour l’autre que sans être un vulgaire collecteur, le lac sous l’Opéra cher à Gaston Leroux n’a rien du royaume gothique au sein duquel le Fantôme ourdit ses sombres machinations. « L'Institut culturel a pour but de rendre accessible aux internautes des éléments importants de notre patrimoine culturel et de les conserver sur support numérique afin d'éduquer et d'inspirer les générations futures », lit-on sur le site du Google Cultural Institute. Une flatteuse formulation qui n’a pas empêché nombre d’acteurs culturels de grincer des dents devant cette mainmise du géant américain de l’Internet sur les trésors du monde entier. Comme celle des nombreux autres musées et lieux historiques ainsi « conservés », cette visite du Palais Garnier souffre de la raideur de la mise en pages : arborescence limitée, défilé horizontal des chapitres, manque d’interactivité. On rêve de pouvoir un jour se perdre dans le labyrinthe des couloirs, loges et ateliers, ou même suivre un spectacle depuis le pupitre du chef d’orchestre. En attendant, le documentaire de Laurence Thiriat Le plafond Chagall, il y a 50 ans le scandale(en septembre sur Arte) nous fera voler à travers le Palais Garnier à bord d’un drone (technique Freeway) capable de filmer en contre-plongée.
.
François Lafon – Olivier Debien
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/opéra-national-deparis

Au Palais Garnier, exposition Verdi/Wagner et l’Opéra de Paris. La carpe et le lapin – si tant est que le mutisme de la carpe convienne au(x) sujet(s) – réunis par leur année commune de naissance (1813) et par la place qu’ils occupent au répertoire, en particulier celui de cette maison à l’époque incontournable et que chacun d’eux n’a eu de cesse de conquérir. A part cela, deux mondes différents, voire antinomiques, qui se rejoignent pourtant dans la façon qu’ont eu de les représenter les générations successives, depuis les toiles peintes de l’ère romantique jusqu’aux actuelles relectures dramaturgiques. C’est cette évolution qui guide le visiteur de salle en salle, soulignant les difficultés croissantes des metteurs en scène et scénographes à trouver à Verdi des intentions profondes autant qu’à résister aux exégèses abyssales auxquelles se prête Wagner. A lire le luxueux et très documenté catalogue de l’exposition, on saisit mieux le parallélisme trompeur des deux trajectoires : intéressante évolution-maison de quelques œuvres emblématiques (neuf Verdi pour sept Wagner – onze si l’on découpe La Tétralogie) en seconde partie de volume. Impression finale : si les deux titans se sont entendus à quelque chose, c’est à faire en sorte - inconsciemment ou non - que la postérité ne puisse pas les départager. C’est même le plus incontestable de leurs points communs. Même lieu, Rotonde du Glacier : Les z’animaux musiciens de Pascal Nègre par Michel Audiard. Un orchestre de métal découpé au laser et habillé de pimpantes couleurs, comme des fantômes de l’Opéra au profil de bêtes de scène. Très fêtes, assez magique. Ne manque que le son (arachnéen lui aussi ?), détail que Pascal Nègre, directeur d’Universal, peut régler comme par enchantement. Quant à Michel Audiard, sculpteur tourangeau, il ne manque ni d’humour ni d’invention. Question d’homonymie, sans doute.
François Lafon
Exposition Verdi/Wagner et l’Opéra de Paris, Palais Garnier, du 17 décembre au 16 mars – Catalogue sous la direction de Mathias Auclair, Christophe Ghristi et Pierre Vidal. Bibliothèque Nationale de France – Opéra National de Paris, 216 p., 39 € Photo © DR
Exposition Les z’animaux musiciens de Pascal Nègre par Michel Audiard, du 16 décembre au 2 janvier

Sur Arte en deux après-midi, en DVD dès maintenant : Graines d’étoiles, documentaire en six chapitres de Françoise Marie sur l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris, installée à Nanterre. « Plus que des graines, et pas tous destinés à être étoiles », tempère Brigitte Lefèvre, Directrice de la danse à l’Opéra. Montage rapide, rien de didactique, simplement, par petites touches, la conquête de la liberté dans la discipline, de l’art à travers la technique. Musique variées, rythmes tout simples ou très compliqués : « Stravinsky, ce n’est pas du Bach », prévient le chorégraphe néerlandais Nils Christe. « Danser avec un orchestre, c’est intéressant, il faut essayer de suivre le chef, et le chef doit arriver à nous suivre », philosophe un élève, anticipant l’éternel jeu de chien et chat entre les musiciens et les danseurs. Constante de ces trois heures - qui passent comme l'éclair - d’apprentissage accéléré de la vie : l’obsession des nombres. « Un couple, c’est deux personnes », rappelle la prof de danse de caractère ; « Un, deux, trois », scande le pianiste en tapant sur le couvercle du piano ; « Là, vous êtes ensemble » ; « En mesure le pied gauche …" Dans le cocon sécurisant et étouffant de l’école, le temps ne s’écoule pas, il se maîtrise. « Ils ne sont vraiment pas comme nous », remarque une petite Nanterrienne venue assister au spectacle annuel de l’Ecole. « Ce que les chanteurs et les danseurs envient aux acteurs ? » disait Régine Crespin : « Ils n’ont pas à compter sans arrêt, ils ne se réveillent pas en sursaut la nuit en criant : Ca y est, j’ai mangé le temps ».
François Lafon
Arte, 21 et 28 avril, 16h20. DVD Arte Editions.

5 spectacles, 75 représentations, 160 000 spectateurs (l’équivalent d’une ville comme Dijon), un taux de remplissage de 95%, 26 salles UGC et 50 cinémas indépendants bondés pour Carmen et le ballet Don Quichotte diffusés en direct : l’Opéra de Paris publie triomphalement le bilan de la période des fêtes. « Notre institution, grâce au savoir-faire de ses équipes, a rempli les missions qui lui incombent avec un succès de fréquentation incontestable et un public renouvelé, » commente le directeur Nicolas Joël. Réponse du berger à la bergère, à savoir la presse, dans l’ensemble très critique quant à ses choix artistiques, ouvertement destinés à renouer avec un public rebuté par les audaces de son prédécesseur Gerard Mortier. 27 000 spectateurs se sont précipités à Carmen, pourtant unanimement éreinté. La Tétralogie, Faust, Manon, mal reçus eux aussi, ont fait salle pleine. Günter Krämer, metteur en scène de La Tétralogie, a été prié de revoir sa copie en vue de la reprise des quatre journées. Les huit cycles prévus, de janvier à juin, sont de toute façon sold out.
François Lafon

Plan de carrière bouclé pour Stéphane Lissner, nommé à l’Opéra de Paris après avoir dirigé le Châtelet, le festival d’Aix-en-Provence et la Scala de Milan. Continuité naturelle pour l’Opéra, après les règnes antagonistes de Gerard Mortier et Nicolas Joël. Choix prévisible de la part du ministère de la Culture, assurant une programmation classieuse en dépit des économies dictées par la crise. Bonheur non dissimulé de la presse conservatrice italienne, qui espère voir « sa » Scala revenir à ses fondamentaux, après neuf années de dévoiements nordiques. Le site people dagospia.com (200 000 clics quotidiens) donne le « la » : « Milan, réjouis-toi : le surintendant Lissner s’enfuit à l’Opéra de Paris ». Et de lister les griefs, privés et publics, financiers et artistiques accumulés à l’encontre dudit surintendant, annonçant la création d’un club d’abonnés excédés, et terminant par le péché suprême : c’est avec Wagner (Lohengrin) et non avec Verdi que La Scala ouvre la saison anniversaire des deux compositeurs. Ce n’est pas à Paris que le successeur de Nicolas Joël se verra ainsi reprocher ses fastes personnels ni ses options artistiques.
François Lafon
Photo © DR

Au Palais Garnier, exposition L’Etoffe de la modernité, costumes du XXème siècle à l’Opéra de Paris : costumes pré-hollywoodiens hérités du XIXème, spectacles de peintres dans le sillage des Ballets Russes (Benoit, Derain, Léger, Cocteau), sages innovations de l’après-guerre (Masson, Leonor Fini, Carzou, Chagall). Cela s’arrête à l’aube du XXIème siècle, ère de la mondialisation des styles et des esthétiques. Le ballet est mieux servi que l’opéra : tradition de modernité, long règne créatif de Serge Lifar (1930-1958), premiers costumes de couturiers (Yves Saint-Laurent pour Notre Dame de Paris de Roland Petit – 1965). Les touristes se font photographier devant les pourpoints de Noureev exposés dans les espaces publics, mais combien pousseront la porte (discrète) de la Bibliothèque Musée, où les costumes, dessins, croquis et accessoires racontent, dans un clair-obscur propice au rêve, l’apogée et le déclin des arts réunis ? Le catalogue met en vedette les ateliers-maison (cent-cinquante-trois salariés, trois sites, sept services) et permet de s’attarder sur les croquis zébrés d’indications techniques. On apprécie les détails de la croix de fer portée par le Capitaine de Wozzeck (André Masson – 1963) et l’on apprend comment, en Olympia des Contes d’Hoffmann (Michael Levine – 2000), Natalie Dessay se débarrassait de sa robe de poupée pour apparaître en robot violeur.
François Lafon
Bibliothèque Musée et espaces publics de l’Opéra de Paris – Garnier, du 19 juin au 30 septembre 2012. Catalogue Opéra National de Paris – Bibliothèque Nationale de France. 20 €.

Exposition Massenet au Palais Garnier. Plus précisément La Belle époque de Massenet, à l’occasion du centenaire de la mort du compositeur de Manon et Werther. De photos en affiches, de manuscrits reliés pleine peau en bijoux et costumes, on suit ce roi de la série B honoré comme un grand pro, on admire son talent à faire entrer l’antiquité (Thaïs), le Moyen-âge (Le Jongleur de Notre-Dame), le siècle des Lumières (Chérubin), la mythologie (Ariane), l’exotisme (Le Roi de Lahore), le romantisme (Werther), le wagnérisme (Esclarmonde), le vérisme (La Navarraise) dans le moule érotico-bien-pensant de son temps. Impression en sortant : une drôle de Belle époque. Ce n’est pas tant le Jules de ces dames (il détestait d’ailleurs ce prénom qui lui allait si bien), l’idole du Paris petit-bourgeois que l’on quitte, qu’un angoissé entouré de ses non moins souffrantes créatures. En cela, l’exposition prélude à la Manon torturée de Natalie Dessay, la semaine prochaine à l’Opéra Bastille.
François Lafon
Bibliothèque-Musée de l’Opéra de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 13 mai.
Catalogue : La Belle époque de Massenet, sous la direction de Mathias Auclair et Christophe Ghristi. Editions Gourcuff- Gradenigo, 39 €

Mais pourquoi les archives de l’Opéra de Paris sont-elles pour la plupart introuvables en DVD ? Problèmes de droits, rétention de l’INA, médiocrité technique, manque d’intérêt (présumé) du public ? Treize d’entre elles – les plus anciennes jamais rediffusées – sont projetées cette saison à l’Auditorium du Louvre. Jusqu’à la fin janvier, quelques pépites : Les Noces de Figaro « de » Strehler repris en 1980 pour le départ de Rolf Liebermann (Solti dirigeant Janowitz, Von Stade, Popp, Bacquier, Van Dam), l’Otello de Verdi avec Placido Domingo et Margaret Price (1978), L’Enfant et les sortilèges (Ravel) et Oedipus Rex (Stravinsky) revus par Jorge Lavelli avec Seiji Ozawa au pupitre (1979), le Moïse de Rossini programmé par Massimo Bogianchino pour son arrivée à l’Opéra en 1983 (Samuel Ramey, Shirley Verrett, Chris Merritt), Adrienne Lecouvreur de Cilea avec Mirella Freni (1994), Guerre et Paix de Prokofiev en grand large sur la scène de Bastille (2000). La Scala de Milan, le Bolchoï de Moscou, le Mariinski de St Pétersbourg, le Staatsoper de Vienne ont ainsi été revisités, ces dernières saisons. On a même revu, à l’occasion de la résidence de Patrice Chéreau au Louvre, la Lulu de 1979, superbement filmée par Bernard Sobel, que l’on croyait à jamais cadenassée. Le DVD d’opéra n’a jamais bien marché, répètent les éditeurs : retransmissions mal travaillées, pléthore de spectacles inutiles, absence de bonus, prix prohibitifs. Les directs (MET ou Bastille) font en revanche recette en salles : il fallait bien le musée des musées pour exposer ces chefs-d’œuvre du passé.
François Lafon
Une Saison à l’Opéra de Paris. Six opéras filmés, du 17 décembre au 22 janvier. www.louvre.fr
(photo : Les Noces de Figaro, mise en scène Giogio Strehler)

A la rubrique « Activité » de l’opuscule « L’Opéra National de Paris en 2010 », on trouve, entre autres statistiques, un bilan de fréquentation. Pour le ballet, le classique est en tête : 100% de jauge physique (à ne pas confondre avec la jauge financière, qui peut différer de 1 ou 2%) pour La Bayadère, Casse-Noisette ou Le Lac des cygnes. 100% aussi pour les grands noms : John Neumeier (La Dame aux Camélias), Pina Bausch (Le Sacre du Printemps), Anjelin Preljocaj (Siddharta) ou le Béjart Ballet Lausanne. 74% seulement, en revanche, pour Kaguyahime, pourtant signé Jiri Kylian. Bilan tout aussi parlant pour l’opéra. Parmi les nouvelles productions, Wagner reste une valeur sûre (100% pour L’Or du Rhin et La Walkyrie, pourtant malmenés par la critique), Natalie Dessay rassemble ses fans (100% pour La Somnambule), alors que le « Werther du siècle » (Jonas Kaufmann, Benoit Jacquot) ne fait que 96%, tout près du difficile Faust de Philippe Fénelon (95%). Mais Mathis le peintre de Paul Hindemith, pourtant très médiatisé, ne dépasse pas les 85%, et La petite Renarde rusée de Janacek (une reprise, dans la superbe mise en scène d’André Engel) tient le pompon rouge avec 61% de fréquentation. Tous ces chiffres doivent bien sûr être relativisés (Garnier ou Bastille, nombre de représentations). L’opéra aura attiré 406 333 spectateurs, le ballet 325 007. 500 000 touristes auront par ailleurs admiré le Palais Garnier, qui reste un des monuments les plus visités de France. L’Opéra Bastille se visite aussi, mais tente moins de monde.
François Lafon
ncore Carmen ? Oui, mais pas n'importe laquelle, celle dont l'Opéra de Paris ne s'est jamais remise, celle « de » Raymond Rouleau, donnée au Palais Garnier du 10 novembre 1959 au 14 juillet 1970. Un site lui est consacré, préfigurant la sortie d'une monographie consacrée à l'événement, et ne nous laissant rien ignorer des distributions qui ont succédé à celle, très médiatique, de la première (Jane Rhodes sous la direction de son époux Roberto Benzi), ni du buzz, comme on dit aujourd'hui, suscité par le spectacle. Un extrait du papier de Denise Bourdet (l'épouse du dramaturge Edouard Bourdet, l'auteur du Sexe faible) dans Le Figaro littéraire suffit à rappeler que Raymond Rouleau n'avait rien à envier à Luchino Visconti, avec lequel il partageait la scénographe Lila de Nobili : " Le cortège entre dans les arènes, la foule le suit, et sur la scène désertée on aperçoit un groupe de mendiants accroupis contre un mur dont ils ont la couleur et l'immobilité de pierre. Ils restent là sans bouger pendant la scène finale, et ce n'est que sur le dernier cri de don José, Oh ma Carmen adorée, qu'ils se redressent silencieusement et se retournent pour regarder le meurtrier tandis que le rideau tombe."
Après cela, en 1980, l'opéra le plus joué au monde retournera à l'Opéra-Comique pour quelques représentations avec Teresa Berganza et Plácido Domingo, puis connaîtra à l'Opéra Bastille deux productions qui n'ajouteront rien à sa gloire. En 1990, quand Grace Bumbry, qui a chanté le rôle à Garnier et a alterné avec Jane Rhodes lors d'une tournée du spectacle au Japon, viendra essuyer les plâtres de l'Opéra Bastille dans Les Troyens de Berlioz, elle n'aura de cesse de trouver en vidéo le film de Jacques Becker Falbalas, où Rouleau joue un couturier bourreau des cœurs, et le programme de Dialogues d'exilés de Bertolt Brecht, le dernier spectacle joué à Paris pas l'acteur-metteur en scène. Elle garde un souvenir ébloui de celui qui, tel un Maurice Pialat du théâtre, aimait tant faire pleurer les actrices.

Aujourd'hui 5 janvier 2010, cent-trente cinq ans après son ouverture, le Palais Garnier est un des monuments les plus visités de Paris, c'est à dire du monde. On y vient pour le spectacle autant que pour le coup d'œil sur la salle et les foyers. Vingt-et-un an et cent-soixante-seize jours après son inauguration, l'Opéra Bastille, lui, fait son office, sinon d'opéra populaire (utopie de départ), du moins de grande salle aux normes internationales. Rénové par tranches sur une période de quinze ans, le premier est solide comme le pont neuf. Le second, à peine ouvert, a commencé à se fissurer. On attend sa fermeture pour révision générale. Le Palais Garnier a été classé monument historique le 16 octobre 1923. Classera-t-on un jour l'Opéra Bastille ? Et d'ailleurs, tiendra-t-il assez longtemps ?

En juin dernier, Gerard Mortier a quitté la direction de l'Opéra de Paris avec Am Anfang (« Au commencement »), une « installation » du plasticien Anselm Kiefer, où l'on ne chantait ni ne dansait. Le public, bourgeoisement installé dans la salle, n'était même pas censé assister à l'intégralité de l'événement, qui se prolongeait sur les six plateaux coulissants de l'Opéra Bastille. Le sujet ? La mort des idéologies, la quête de la transcendance à travers les gravats de l'expérience humaine, la renaissance après la catastrophe. Trois mois plus tard, Nicolas Joel reprend les rênes de la maison, et, en guise de renaissance, donne Mireille de Gounod dans le cadre symbolique du Palais Garnier. Le passage du relais frise la perfection. « Ouf, Mortier est parti, disent les anciens. Finies les programmations prise de tête, dehors les mises en scène de Christoph Marthaler et de Krzystof Warlikowski. Avec Joel, l'opéra, le vrai, retrouve droit de cité ». « Aie, répliquent les modernes. Gounod et Puccini sont de retour. ».
En fait, il est très fort, Joel. En montant lui-même Mireille façon opéra de grand papa, avec farandoles et folklore provençal, il récupère le public qui a fui l'opéra selon Mortier. Parallèlement, en reprenant à la Bastille le Wozzeck de Berg mis en scène, sous Mortier, par … Marthaler, il montre aux modernes qu'il ne les oublie pas. Et comme il est encore plus fort qu'on ne l'imagine, il peut se glorifier de faire salle comble avec Mireille (diffusé, qui plus est, en léger différé sur France 3 le soir de la première), tandis que Wozzeck se joue devant un parterre clairsemé. Et puis, si vous vous ennuyez en voyant Mireille mourir d'insolation sous le soleil du midi, vous pouvez toujours imaginer la version qu'en aurait donné un metteur en scène branché : transportée dans les quartiers nord de Marseille, cette histoire de loi des pères, de mariage arrangé et de carcan religieux trouverait des résonances tout à fait actuelles. On ne pourrait – hélas ! – pas changer la musique, indigeste à force de vouloir plaire.
Photo : Opéra national de Paris/ A. Poupen



